






















aeçe!èyiu\ntexte accentué
Et toi Blanche-Neige, pauvre colombe
Avec ta douce figure
Toi Blanche-Neige, grosse colombe
Retourne à tes confitures
Brigitte , 1968.

Retourner à ses confitures, à ses tartes, à ses tambouilles. Retourner à sa place, par opposition à vivre sa vie. Cʼest une représentation sans doute assez binaire de la condition des femmes que Brigitte Fontaine propose dans sa chanson «  Blanche-Neige  » sortie en 1968, et pourtant, cette dualité est assez emblématique du paysage culturel de son époque. Au début des années 1960, Betty Friedan publie aux États-Unis The Feminine Mystique (1963), ouvrage dans lequel elle décrit lʼexistence essentiellement domestique des femmes blanches bourgeoises étasuniennes. Son texte est une production clé dans la constitution dʼune conscience féministe spécifique aux années 1970, que lʼon désigne communément comme le féminisme de la seconde vague1. Ce mouvement politique sʼest donné pour programme la libération des femmes, en insistant sur deux points au moins : la critique de lʼassignation des femmes au foyer (qui les prive dʼune participation aux affaires publiques et de lʼaccès au marché du travail) ainsi que de lʼabsence dʼautonomie corporelle (opposée à la connaissance de son corps par le self-help et la gestion de la fertilité). Dans ce contexte, quitter la cuisine semble un acte rebelle et profondément politique (fig. 0.2), permettant aux femmes dʼentrer dans le champ économique capitaliste, mais aussi de quitter la sexualité normative du foyer pour prendre le contrôle de leurs corps et de leurs vies. Si ce programme remet en question les fondements du patriarcat, il a aussi produit son lot dʼangles morts, comme les autrices afroféministes ou lesbiennes lʼont rapidement montré. Elles ont sévèrement jugé lʼagenda monochrome et monofocal déployé par des féministes blanches dʼabord soucieuses dʼobtenir des droits équivalents à ceux de leurs homologues masculins et bourgeois, sans remettre profondément en cause les systèmes dʼoppression raciaux et économiques (pour ne citer quʼeux) qui traversent le champ social. Cʼest ainsi que bell hooks, en 1984, lit B. Friedan avec ironie, lui signalant que les femmes noires nʼont peut-être jamais souhaité se libérer de la cuisine et du foyer, et que leur libération ne repose pas sur lʼopposition aux hommes, noirs notamment, mais plutôt à leurs «  sÅ“urs  » blanches qui ne les ont jamais incluses que de biais dans un mouvement quʼelles envisageaient dʼabord comme le leur (2017[1984], 78).
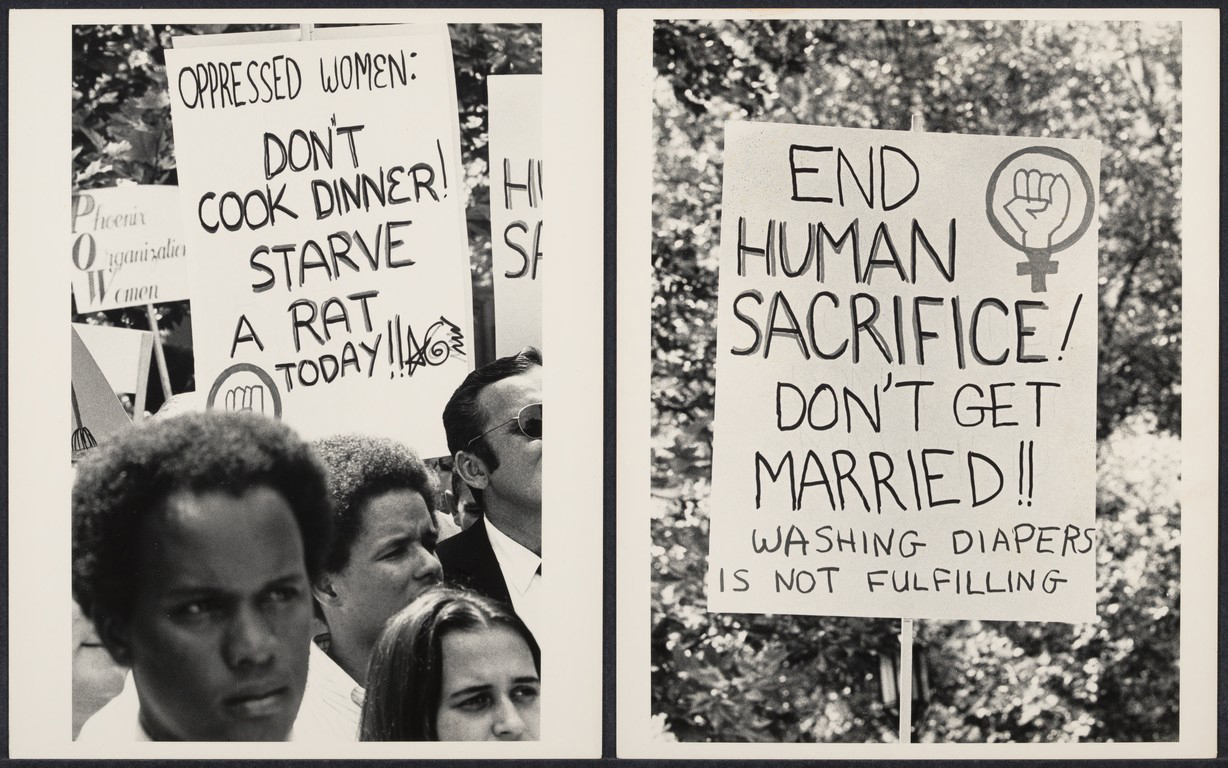
Une lecture un peu rapide de ces événements pourrait nous inciter à penser que ce mouvement de fuite du foyer a été couronné de succès. Cʼest du reste la lecture proposée par un féminisme dʼÉtat (incarné notamment entre 2017 et 2020 par Marlène Schiappa en tant que secrétaire dʼÉtat chargée de lʼÉgalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement Philippe) qui se félicite souvent dʼune meilleure intégration des femmes dans la vie professionnelle, faisant du franchissement du «  plafond de verre  » lʼobjectif modeste et illusoire de son action. Aux États-Unis, cette rhétorique a été portée de manière particulièrement emblématique par Sheryl Sandberg, COO de Facebook (aujourdʼhui Meta) et autrice en 2013 de Lean In: Women, Work, and the Will to Lead, un ouvrage emblématique dʼune forme de féminisme adouci, qui prend acte de certaines limitations systématiques, mais prescrit surtout le courage individuel et lʼesprit dʼentreprise comme principaux remèdes à lʼoppression systémique. Là encore, bell hooks produit une critique étayée de lʼouvrage et propose de «  creuser plus profond  » (jusquʼaux racines des problèmes dʼinégalités) plutôt que de «  faire pression  »2 (2013). En 2019, le féminisme semble connaître une quatrième vague3 dans le sillage des mouvements #metoo (aux USA notamment) et #balancetonporc (en France). Lʼautonomie corporelle, précisément face aux agressions systémiques qui ciblent les femmes, semble être au centre des préoccupations, et rejoint un activisme LGBTQIA+ dont les intérêts sont convergents et parfois communs, notamment au sujet des droits des personnes trans.
En résumé, si lʼégalité salariale entre hommes et femmes nʼest toujours pas une réalité4, lʼidée dʼune libération de lʼespace domestique peut sembler dans ce contexte quelque peu datée, sinon complètement hors-sujet. Lʼidée que les femmes peuvent et même doivent se réaliser par un travail rémunéré est devenue une composante dʼun féminisme entrepreneurial occidental, infusé par le concept anglophone dʼempowerment5 et qui nourrit des discours motivationnels visant à lʼindépendance et au succès financier, dans la lignée de S. Sandberg et de ses émules. Lʼidée quʼil faille se libérer de la domesticité, et de la cuisine où «  Bobonne  » prépare tartes et confitures pour son mari et ses enfants nʼest donc pas obsolète mais elle semble presque acquise, dès lors que la réussite féminine est contextualisée dans le marché du travail. Pourtant, en parallèle, le foyer semble retrouver quelque chose dʼun pouvoir dʼattraction dans la culture populaire. Sur les réseaux sociaux, les «  tutos  » de ménage et de décoration, ou encore les chaînes Youtube dédiées à la cuisine témoignent dʼun intérêt renouvelé pour la vie domestique, notamment en cuisine. Certaines femmes, loin de renoncer pour autant à la «  pression  » (lean in), en font même un plan de carrière, au risque de sʼattirer les foudres de commentatrices féministes qui y voient un geste réactionnaire. La célèbre journaliste Mona Chollet, connue pour ses ouvrages de vulgarisation de sujets proches du féminisme, nʼa ainsi pas de mots assez durs dans Chez soi (2015) pour critiquer Mimi Thorisson, riche Étasunienne qui réalise avec dévouement un programme féminin traditionaliste, en bloguant sur sa vie de château, ses allées et venues au marché, les soins prodigués à ses enfants ou encore la réalisation de mets délicats et photogéniques  fig. 0.3 : Mimi Thorrisson est une bloggueuse américaine née à Hong-Kong qui vit en France, dans le Médoc, d’où elle publie le blog Manger depuis 2010.. Tandis quʼelle regrette cette résurgence conservatrice, Mona Chollet avoue sa fascination et lʼinéluctable attraction quʼexercent sur elle les images dʼun foyer bien tenu, et dʼune femme qui, malgré le labeur domestique, est toujours impeccablement habillée et maquillée. Par ailleurs, la crise écologique globale dont lʼOccident semble finalement avoir pris conscience nous appelle à reconsidérer nos modes de vies, notamment ses dimensions dispendieuses, polluantes et toxiques. Les discours prônant un retour à la frugalité, le «  zéro déchet  », ou encore la «  sobriété heureuse  » entendent faire reconsidérer ses modes de consommations et plus globalement son style de vie à la population occidentale. Cʼest ainsi que, sitôt quittée, la cuisine semble regagner de son pouvoir dʼattraction, en tant que siège dʼune vie domestique heureuse et plus juste envers lʼenvironnement.
fig. 0.3 : Mimi Thorrisson est une bloggueuse américaine née à Hong-Kong qui vit en France, dans le Médoc, d’où elle publie le blog Manger depuis 2010.. Tandis quʼelle regrette cette résurgence conservatrice, Mona Chollet avoue sa fascination et lʼinéluctable attraction quʼexercent sur elle les images dʼun foyer bien tenu, et dʼune femme qui, malgré le labeur domestique, est toujours impeccablement habillée et maquillée. Par ailleurs, la crise écologique globale dont lʼOccident semble finalement avoir pris conscience nous appelle à reconsidérer nos modes de vies, notamment ses dimensions dispendieuses, polluantes et toxiques. Les discours prônant un retour à la frugalité, le «  zéro déchet  », ou encore la «  sobriété heureuse  » entendent faire reconsidérer ses modes de consommations et plus globalement son style de vie à la population occidentale. Cʼest ainsi que, sitôt quittée, la cuisine semble regagner de son pouvoir dʼattraction, en tant que siège dʼune vie domestique heureuse et plus juste envers lʼenvironnement.
Ce paysage est brossé à gros traits ; esquisser le portrait des relations des occidentaux·ales avec leurs espaces domestiques est ambitieux et requiert un travail historique et théorique qui semble pour le moins titanesque, quand bien même on sʼintéresse plus spécifiquement à la cuisine, comme cʼest mon cas. On pourrait même abandonner lʼentreprise en écartant les observations précédentes, au profit dʼun pas de côté : à quoi bon encore parler de la cuisine ? Nʼest-elle pas une pièce obsolète, ou en tout cas secondaire, dans un monde occidental contemporain qui préfère les plats préparés, la livraison de mets par Deliveroo et les sorties au restaurant ? En somme, est-ce quʼil y a encore de la cuisine (dans le sens de pratique culinaire) dans la cuisine (dans le sens dʼespace domestique) ? Et sʼil se passe encore des choses en cuisine, peut-on vraiment leur prêter une dimension politique, comme Brigitte Fontaine préfère chevaucher sa moto à faire des confitures ? Ne serait-il pas tentant de déclarer cette opposition dépassée, et de changer de stratégie de lutte ? Ma décision de travailler sur la cuisine comme lieu éminemment conflictuel, paradoxal et politique ne tient pas uniquement de lʼenvie, même si ma passion pour la vie en cuisine nʼest pas étrangère au projet. Ces dernières années, jʼai collecté intuitivement des signes discrets, autant de petits cailloux qui tracent un chemin jusquʼà la cuisine. Cʼest en lisant la bande dessinée Les gens normaux (2013), qui raconte des parcours de vie et expériences de personnes LGBTQIA+6 que je rencontre Bénédicte, une femme trans qui compare son parcours de transition avec lʼéquipement dʼune cuisine.  fig. 0.4 : Dans la bande dessinée Les gens normaux (2013), la dessinatrice Audrey Spiry donne vie au récit de Bénédicte, femme trans qui compare son corps à l’aménagement d’une cuisine (p. 211). Le corps prend place dans lʼespace, mais il est aussi lui-même un espace, potentiellement une architecture, une maison, un logis. Comme un logis, le corps sʼaménage, se meuble, sʼagence : telle est la réalité contemporaine que Bénédicte traduit, faisant ainsi écho à la dimension plastique et éditable du corps soulignée par Paul B. Preciado dans Testo Junkie (2008). En tant que personne transmasculine, engagée, si lʼon tient à ce terme, dans une forme de transition, je suis frappé par cette comparaison, dʼautant plus quʼelle crée une tension vraiment poignante entre «  quitter la cuisine  » et «  ne pas la quitter  ». Se libérer, en tant que femme ou personne assignée femme, ce nʼest plus quitter un lieu en guise de mouvement libératoire ; cʼest faire de son corps le lieu, tâcher de lʼhabiter et de lʼéprouver. Lʼimportance de la cuisine ne tient pas uniquement à une métaphore, que lʼon pourrait dʼailleurs juger fortuite. La cuisine vient, revient, dès que lʼautonomie féminine et féministe est engagée ; non pas comme contre-modèle, mais comme espace où se rassembler, se soigner, prendre soin de soi.
fig. 0.4 : Dans la bande dessinée Les gens normaux (2013), la dessinatrice Audrey Spiry donne vie au récit de Bénédicte, femme trans qui compare son corps à l’aménagement d’une cuisine (p. 211). Le corps prend place dans lʼespace, mais il est aussi lui-même un espace, potentiellement une architecture, une maison, un logis. Comme un logis, le corps sʼaménage, se meuble, sʼagence : telle est la réalité contemporaine que Bénédicte traduit, faisant ainsi écho à la dimension plastique et éditable du corps soulignée par Paul B. Preciado dans Testo Junkie (2008). En tant que personne transmasculine, engagée, si lʼon tient à ce terme, dans une forme de transition, je suis frappé par cette comparaison, dʼautant plus quʼelle crée une tension vraiment poignante entre «  quitter la cuisine  » et «  ne pas la quitter  ». Se libérer, en tant que femme ou personne assignée femme, ce nʼest plus quitter un lieu en guise de mouvement libératoire ; cʼest faire de son corps le lieu, tâcher de lʼhabiter et de lʼéprouver. Lʼimportance de la cuisine ne tient pas uniquement à une métaphore, que lʼon pourrait dʼailleurs juger fortuite. La cuisine vient, revient, dès que lʼautonomie féminine et féministe est engagée ; non pas comme contre-modèle, mais comme espace où se rassembler, se soigner, prendre soin de soi.
 fig. 0.5 : Le tarot de marseille se constitue entre autres de 22 arcanes majeures, numérotées de 0 à 21. La carte 9 (parfois numérotée 8), La Force, est ici représentée dans le Delta Enduring Tarot (2017), tarot militant, avec les traits d’une femme noire trans faisant la vaisselle.Après le dessin de la cuisine-corps de Bénédicte, cʼest dans un jeu de Tarot divinatoire militant7 (le Delta Enduring Tarot paru en 2017) que je rencontre lʼimage dʼune femme noire trans faisant la vaisselle8. Casque audio vissé sur les oreilles, elle ignore les «  haters  » qui se massent à la fenêtre avec leurs pancartes queerphobes9. Cette carte est celle de La Force, une carte qui, dans lʼeschatologie tarologique, peut représenter la force intérieure dʼune personne, mais aussi ses excès et leur déploiement excessif. Dans le traditionnel jeu de tarot Rider Waite-Smith, la Force est représentée par une femme blanche, qui caresse un lion si soumis quʼelle peut glisser la main dans sa gueule. Dans le tarot Delta, la Force est représentée comme résilience ; il ne sʼagit plus de dompter ses propres excès, mais de faire face à lʼhostilité et aux discriminations qui maillent lʼexpérience de nombreuses personnes minoritaires, et tout particulièrement des femmes noires trans10. Le texte qui décrit la carte sur le site Web du jeu est explicite :
fig. 0.5 : Le tarot de marseille se constitue entre autres de 22 arcanes majeures, numérotées de 0 à 21. La carte 9 (parfois numérotée 8), La Force, est ici représentée dans le Delta Enduring Tarot (2017), tarot militant, avec les traits d’une femme noire trans faisant la vaisselle.Après le dessin de la cuisine-corps de Bénédicte, cʼest dans un jeu de Tarot divinatoire militant7 (le Delta Enduring Tarot paru en 2017) que je rencontre lʼimage dʼune femme noire trans faisant la vaisselle8. Casque audio vissé sur les oreilles, elle ignore les «  haters  » qui se massent à la fenêtre avec leurs pancartes queerphobes9. Cette carte est celle de La Force, une carte qui, dans lʼeschatologie tarologique, peut représenter la force intérieure dʼune personne, mais aussi ses excès et leur déploiement excessif. Dans le traditionnel jeu de tarot Rider Waite-Smith, la Force est représentée par une femme blanche, qui caresse un lion si soumis quʼelle peut glisser la main dans sa gueule. Dans le tarot Delta, la Force est représentée comme résilience ; il ne sʼagit plus de dompter ses propres excès, mais de faire face à lʼhostilité et aux discriminations qui maillent lʼexpérience de nombreuses personnes minoritaires, et tout particulièrement des femmes noires trans10. Le texte qui décrit la carte sur le site Web du jeu est explicite :
Debout à son évier, une femme transgenre racisée lave sa vaisselle. Cʼest sa maison et elle en a fait un sanctuaire accueillant. Cʼest sa vaisselle, et elle la nettoie pour elle-même. Elle est consciente de la haine juste à sa fenêtre, du flot de bigoterie qui ne cesse de balayer le Sud […] Elle ne fuit pas. Elle survit et grandit11.
Corps-cuisine ou vaisselle en lutte : ce sont bien deux images, traduites graphiquement, qui incarnent une possible vision transféministe de la cuisine, capable de dépasser la dualité quitter/ne pas quitter pour véritablement investir ce lieu. Cette cuisine queer reste à définir, à décrire, à équiper, en somme. Quelles seraient sa notice, ses modes dʼemplois ? En 1984, lʼautrice afroféministe Audre Lorde comparait le patriarcat à un édifice, en insistant sur le fait que les «  outils du maître ne sauraient démolir la maison du maître  »12 (2018[1984], 16). Si, dans cette citation célèbre, elle fait plutôt référence aux outils intellectuels, et notamment linguistiques, qui autorisent cette démolition, la comparaison entre lʼentreprise politique et la déconstruction dʼun édifice me frappe. Elle montre lʼaspect politique de nos espaces, et la qualité profondément spatiale de la politique, dont sʼest depuis emparée la philosophe Sara Ahmed :
Lorsque nous parlons dʼ‹ hommes blancs ›, nous décrivons une institution. ‹ Hommes blancs › est une institution. En disant cela, que dis-je ? Une institution fait typiquement référence à une structure persistante ou à un mécanisme de lʼordre social qui gouverne le comportement dʼun ensemble dʼindividus dans une communauté donnée. Aussi, lorsque je dis que les ‹ hommes blancs › sont une institution, je ne me réfère pas seulement à ce qui a déjà été institué ou construit mais aux mécanismes qui assurent la persistance de cette structure. […] Ainsi, comment est-ce que ‹ hommes blancs › se bâtit, ou devient bâtiment ? Pensez-y. Un·e praticien·ne mʼa raconté comment ils nommaient les bâtiments dans son institution. Tous des hommes blancs morts, mʼa-t-elle dit. Nous nʼavons pas besoin des noms pour savoir comment les espaces sont organisés afin de recevoir certains corps. Nous nʼavons pas besoin des noms pour savoir pour quoi ou pour qui les bâtiments existent (2014b)13.
Ici, il est question des espaces de lʼinstitution académique que fréquente alors Sara Ahmed. Sa réflexion nous montre comment lʼagencement spatial au sens le plus large du terme -— qui va donc inclure plans, mais aussi matériaux, usages, représentations, signalétique et noms -—ne reflète pas seulement un ordre social mais le constitue, le fixe, lʼincarne, au point que le patriarcat est un bâtiment qui fait ordre social, plutôt quʼun ordre social comparable à un bâtiment.
Penser lʼoppression en termes spatiaux, surtout en des termes aussi concrets que ceux de lʼarchitecture et du design est donc au fondement de ma proposition, qui vise, dans la lignée dʼAudre Lorde et Sara Ahmed notamment, de planifier la cuisine queer comme démantèlement des normes. Ce travail nécessite bien entendu un état des lieux, voire, puisque la question est spatiale, un plan ou une cartographie. De quel territoire la cuisine est-elle une annexe ? Comment penser lʼattachement des femmes à la cuisine et lʼespace domestique de manière critique et spatialisée ?
La question de la domesticité est tendue entre deux jeux de connotations : on trouve dʼabord celui, plutôt positif, attaché à lʼétymologie, qui déploie tout un imaginaire autour de la notion de la domus, concept central en architecture et en design. Un second pan, plus négatif, concerne lʼidée dʼune domestication, qui implique le fait de circonscrire, brider, dompter une nature initiale perçue comme excessive ou encore sauvage. Quand il est question d ʼhabiter, ces deux dimensions cohabitent souvent : la domus fait autant figure de refuge que de cage. Il existe toute une littérature du chez-soi qui vante, pour des raisons diverses, la nidification propre à l ʼespace privé. On la rencontre dès le XVIIIe siècle, avec le Voyage autour de ma chambre de Xavier De Maistre (1794). Ce siècle consacre déjà , avec le boudoir, un art de vivre en intérieur avant que la bourgeoisie européenne nʼen fasse une des pierres angulaires de sa culture à partir du XIXe siècle. La domus, et lʼhabiter quʼelle produit, sont indissociables dʼune valeur cristallisée par les arrangements : le confort. Ce concept complexe, que je ne peux investir en détail ici, relie «  lʼatmosphère de lʼintimité  » à un «  agencement bien précis des biens matériels  » (Maldonado 2016[1987], 24–25). La mention des biens de consommation, inévitable dès lors que je pense depuis la discipline du design, pourrait cependant me mener à condamner un peu vite une sphère domestique saturée par le capitalisme. Or, de Ivan Illich, pour qui habiter est un art (1994[1984]), à la «  chambre à soi  » de Virginia Woolf (1929), sans oublier le synthétique et populaire Chez Soi de la journaliste Mona Chollet, force est de constater que le confort, quʼil soit un idéal ou un accomplissement, est une partie constitutive de la politicité du logis. Cette dimension politique est étroitement reliée à lʼart : le confort dʼun espace à soi ou un «  recours à lʼantre  » (Chollet 2015, 37) est même une condition de possibilité de tout art, comme le pose mémorablement Virginia Woolf. Le peintre, pédagogue et designer Tomà s Maldonado théorise dans les années 1980 une «  dépendance réciproque  » entre «  dynamique de modernisation et généralisation du confort  » (2016[1987], 23). Pour lui, il existe un lien étroit entre hygiénisme et confort, puisque leurs principes sont des «  faiseurs dʼordre  ». Il importe donc de rappeler à quel point le projet moderne nʼest pas seulement un rêve de vitesse et de libération par la technologie. Ce rêve est possible parce quʼil sʼappuie sur lʼimaginaire jumeau dʼun intérieur douillet, préservé des affres de la révolution industrielle qui participe pourtant pleinement à sa fabrication. La domus est un nid et un organe de contrôle ; elle est aussi, comme le suggère lʼexpression «  chez-soi  », une unité de production de lʼindividu moderne compris comme personne (Maldonado 2016[1987], 24–25 ; Villela-Petit 1989).
De même, situer historiquement la domesticité nʼempêche nullement de considérer lʼaspect transhistorique (pour ne pas dire universel) de lʼhabiter chez les humains. Les deux approches sont nécessaires, quand bien même ma réflexion sʼemparera en priorité de la domesticité comme support et manifestation de la culture bourgeoise. James C. Scott pense le concept de domesticité à travers un large trajet historique dans son ouvrage Homo Domesticus (2019). Pour lui, le logis était un «  module dʼévolution  » (2019, 196), une «  concentration spécifique et sans précédent de champs labourés, de réserves de semences et de céréales, dʼindividus et dʼanimaux domestiques dont la coévolution entraînait des conséquences que personne nʼaurait pu prévoir  » (ibid.). Le travail de J. C. Scott permet de transférer la définition de la domesticité de lʼappréhension de ses effets (préservation ou enchaînement) à la conscience de son histoire et de ses conditions de possibilité, quand il déclare que son interprétation classique (les humains auraient cherché à tout prix à sortir du nomadisme) est inexacte. Ses travaux suggèrent également que le développement de pratiques et de cultures autour de lʼhabiter relève aussi, dans lʼhistoire humaine, dʼune vaste entreprise dʼauto-domestication. Le logis est donc tributaire de tiraillements et de lʼassociation paradoxale de valeurs ou de destinations. Expression de soi, il doit aussi servir la cellule familiale ; protecteur, il est enfermant et potentiellement aliénant ; fabrique de lʼintime, il est aussi, nécessairement, relié à des réseaux collectifs plus ou moins serrés et contraignants. Alessandro Mendini, designer, témoigne de ces ambivalences sur un mode poétique :
La maison a le sol visqueux comme le miel, les pieds sʼy attachent et on arrive plus à en sortir […]
La maison est le refuge hypocrite de ceux qui craignent les intempéries de la vie.
La maison est un corps étranger qui se substitue au corps de qui lʼhabite.
La maison est un cercle vicieux qui nʼexiste pas sans un trousseau de clés.
La maison est un entrepôt où sʼaccumulent des meubles et des résidus inutiles […]
La maison est une île obtuse dʼhéritiers […]
La maison nʼest pas un lieu pur parce quʼelle émet par trop de trous nos excréments […]
La maison a toujours ce vice dʼêtre meublée […]
La maison est un lieu dʼordre parce quʼelle a un lavabo, une poubelle, un fer à repasser et une boîte de tomates pelées. (2014[1979], 213–14)
Je coupe cette énumération pour nʼen retenir que quelques points saillants. Ce que la maison a de pur, elle le crée par un lien fort et essentiel à lʼimpureté. Ce que la maison a de familial, elle le doit aux pratiques bourgeoises de lʼhéritage et de la propriété privée. Le texte, par sa forme même (une liste), traduit lʼaccumulation qui traverse la vie domestique. Dans la domus, on amasse autant quʼon nidifie, et on nidifie sans doute dʼautant plus quʼon amasse. Ce phénomène appelle une mise en ordre, et ici les valeurs «   faiseur[ses] dʼordre  » de Maldonado font écho au «  lieu dʼordre  » de Mendini. La domus accueille à condition dʼordonner.
Mon projet consiste à fournir une boussole critique susceptible dʼaccompagner le développement dʼun programme dʼautonomie en cuisine par le design. Cette ambition nʼest réalisable quʼà la condition de questionner les binarités qui polarisent fortement la pensée et lʼenferment potentiellement dans des jeux dʼopposition stricts, comme dehors/dedans, accueillant/aliénant, sédentaire/nomade, etc. Jʼaurai ainsi à cÅ“ur, tandis que jʼhistoriciserai la cuisine dans ce propos liminaire, de lʼinscrire dans une conception volontairement hétérogène, complexe et éclatée de la domesticité. Classe, race, genre et validité constituent des champs de force qui traversent la notion de la domesticité et ses incarnations. Ainsi, historiquement, le «  module dʼévolution  » (Scott 2019, 196) de la domus occidentale a muté vers son incarnation bourgeoise au XIXe siècle, devenant le support dʼune séparation régulatrice entre intérieur et extérieur qui en recouvre dʼautres (bourgeois/ouvrier, propre/sale, promiscuité/virginité). Cette séparation nʼimplique pas une imperméabilité complète des espaces mais, au contraire, de multiples passages qui sont régulés par lʼespace lui-même et ses zones de porosité (portes, fenêtres, cour, escaliers) comme par des agents identifiables, tel·les les domestiques, avant que cette fonction ne soit complètement assignée à «  lʼange du logis  » pour des classes bourgeoises recourant de plus en plus rarement à lʼaide salariée. Je reviendrai sur les mutations historiques successives qui ont conduit à ces incarnations, en tâchant de ne jamais associer trop strictement un modèle à une période historique.
La nature contractuelle (cʼest-à -dire, qui se négocie) de la domesticité, ainsi que les éléments contextuels de J. C. Scott, me conduisent à formuler une observation apparemment banale, en réalité importante : la domesticité domestique. En étant conçue, installée, reproduite à travers des dispositifs aussi variés que la maison de banlieue, le balai ou le nain de jardin, elle est dʼabord un processus qui fabrique son dehors, son envers, son ennemi. Ici surgit la dimension raciale de la domesticité. Cʼest parce que la domestique racisée porte un tablier que la maîtresse de maison peut sʼen passer.  fig. 0.6 : Dans La noire de… (1966), Ousmane Sembène raconte l’histoire de Diouana, venue de Dakar à Paris pour continuer après l’été à être la baby-sitter d’une famille française connue au Sénégal. Je reviens sur ce film dans le chapitre III. Pendant que la domestique sʼoccupe de lʼentretien de la domus, en faisant sols et poussières, la domus produit la domestique comme subalterne, à lʼidentité recomposée ou effacée15. La colonialité repose en effet sur la constitution dʼun Autre qui révèle, par un effet de miroir, les qualités du maître (Hill Collins 1990, 68–70). Ainsi, la domestication du domestique racisé présuppose un état de sauvagerie préalable, appelé à être régulé par la domus et irrigué par les qualités civilisées du maître (qui est quant à lui naturellement civilisé). Enfin, des dynamiques genrées traversent le logis. La boniche est à la maison parce quʼelle est une femme, et la maison en retour participe de la fabrique de sa féminité : en cela, le logis est un sceau autant quʼune cage. Nous verrons comment le soin et la propreté de la maison (littérale, une maison sans taches ni poussière) recoupe la propreté symbolique de lʼépouse, matérialisée par le soin que la boniche apportera à sa propre apparence. En somme, même si je me dois encore de faire plus complètement cette démonstration, il apparaît quʼen Occident, féminité, blancheur et bourgeoisie sont coproduits par le dispositif de lʼhabitat individuel. Ce sont bien ces trois axes, race, classe, genre, qui animent la production de la domesticité, mais parfois de manière contradictoire ou conflictuelle.
fig. 0.6 : Dans La noire de… (1966), Ousmane Sembène raconte l’histoire de Diouana, venue de Dakar à Paris pour continuer après l’été à être la baby-sitter d’une famille française connue au Sénégal. Je reviens sur ce film dans le chapitre III. Pendant que la domestique sʼoccupe de lʼentretien de la domus, en faisant sols et poussières, la domus produit la domestique comme subalterne, à lʼidentité recomposée ou effacée15. La colonialité repose en effet sur la constitution dʼun Autre qui révèle, par un effet de miroir, les qualités du maître (Hill Collins 1990, 68–70). Ainsi, la domestication du domestique racisé présuppose un état de sauvagerie préalable, appelé à être régulé par la domus et irrigué par les qualités civilisées du maître (qui est quant à lui naturellement civilisé). Enfin, des dynamiques genrées traversent le logis. La boniche est à la maison parce quʼelle est une femme, et la maison en retour participe de la fabrique de sa féminité : en cela, le logis est un sceau autant quʼune cage. Nous verrons comment le soin et la propreté de la maison (littérale, une maison sans taches ni poussière) recoupe la propreté symbolique de lʼépouse, matérialisée par le soin que la boniche apportera à sa propre apparence. En somme, même si je me dois encore de faire plus complètement cette démonstration, il apparaît quʼen Occident, féminité, blancheur et bourgeoisie sont coproduits par le dispositif de lʼhabitat individuel. Ce sont bien ces trois axes, race, classe, genre, qui animent la production de la domesticité, mais parfois de manière contradictoire ou conflictuelle.
Une telle analyse, si elle rend visibles des valeurs trop souvent oubliées dans la représentation éternelle et anhistorique du logis, provoque potentiellement un effet de désincarnation de lʼespace considéré. Si la domus émerge comme production de valeurs, elle ne sʼy résume pas : elle est un «  grand[/] objet[/] indispensable[/]  » (Mendini 2014[2000], 442) aux caractéristiques matérielles, concrètes. Dire que la domus repose sur la matérialisation de rapports de race, de classe, de genre et de validité ne doit pas nous faire perdre de vue la dimension proprement matérielle du logis. Une maison, ce sont des murs ; des canalisations ; des tuiles et un tableau électrique ; des rideaux et le tout à lʼégout -— et beaucoup dʼautres choses encore. Pour mʼextraire de lʼornière binaire qui séparerait une approche théorique, de celle, incarnée, du designer, je suis donc lʼincitation du théoricien de lʼarchitecture Hilde Heynen qui, dans lʼintroduction de Negotiating Domesticity (2005), nous signale que les schémas genrés sont «  sédimentés  » dans lʼarchitecture (13). Pour mieux comprendre la cuisine comme champ de force, nous allons la replacer dans le contexte des cultures domestiques : et ce sont bien ces multiples couches de sens dont nous analyserons la superposition et le tressage. Des valeurs, des murs ; il ne faudrait pas oublier les usages, ces gestes et habitus que le design sʼattache à couler dans ses dispositifs. Lʼanthropologue Mary Douglas envisage ainsi la nature contractuelle de la domus, mais en la saisissant comme la somme des interactions entre les habitant·es dʼune unité de vie, comme «  un motif dʼactes réguliers  »16 (1991, 287). Ce qui se négocie, avant les valeurs ou les rapports dʼoppression, ce sont les détails de lʼassise autour de la table ; le choix des mets en fonction des goà »ts et dégoà »ts individuels, le temps que chacun·e met à manger et, directement en relation avec lʼéconomie générale du foyer, le temps de parole. M. Douglas met à mal lʼidée dʼun foyer, doux foyer (home, sweet home) en soulignant les extraordinaires rapports de contrainte et de censure qui en régulent le fonctionnement, pour observer finalement que le home est «  souvent absurde, et souvent cruel 17 » (305). Il existe donc une trinomie entre corps, murs et valeurs à rassembler dans mon approche de la domesticité. Je questionnerai leurs usages pour comprendre comment ils sont reliés.
Lʼarchitecture, avant le design, sʼest imposée au cours de lʼHistoire comme lʼart dʼhabiter. Dʼabord réservée aux bâtiments royaux et aristocratiques, lʼâge classique (pour parler comme Foucault dans Les mots et les choses, 1966) lʼa vue sʼappliquer à la régulation sociale (hôpitaux, asiles) et stratégique (casernes et bâtiments dʼusage militaire), avant de porter le projet moderne dʼun habitat incarnant les utopies sociales du début du XIXe et du début du XXe siècle, notamment le Existenzminimum cher au Bauhaus (Brunet & Geel 2022, 65). Lʼarchitecte est dʼabord au coude à coude avec les ingénieurs dont la pratique émerge en Occident au XVIIIe siècle, avant dʼentrer en négociation avec læ designer, figure plus tardive dont la pratique, dérivée des arts décoratifs, sʼimpose comme une discipline à part entière, successivement cristallisée par les mouvements Arts & Crafts, De Stijl, et le Bauhaus entre 1880 et 1940. Læ designer ne pense pas seulement le bâti, mais investit la relation à lʼhabitat, les gestes et les ambiances qui sʼaniment dans la «  boîte  » du logis. Pour certains (comme Adolf Loos), le design naissant du début du XXe siècle doit rompre en partie avec la tradition des arts décoratifs et leur ornement en excès. Tandis que le mouvement Arts & Crafts prône encore lʼinvestissement de lʼartisanat pour renouveler le langage décoratif, en rupture avec la culture industrielle émergente, le projet moderniste formulé quelques dizaines dʼannées plus tard impose de refuser le goà »t de lʼhabillage et du décor, porté par un «  goà »t de la forme type  » (Leymonerie 2016, 26). Dans son célèbre Ornement et Crime (1908), lʼarchitecte viennois Adolf Loos affirme que «  plus la culture est médiocre, plus lʼornement est apparent  »18 (2015[1908], 94). Henry Van De Velde, peut-être plus nuancé, imagine un ornement rationalisé, porté par la pureté de la ligne et accompli grâce à un usage fonctionnaliste des formes propres à lʼindustrie.  fig. 0.7 : Dans cette célèbre caricature de Karl Arnold diffusée dans le périodique allemand Implicissimus (1914), on découvre Henry Van De Velde proposant sa chaise dessinée, Muthesius et le type moderniste, et enfin l’artisan et sa chaise au dessin traditionnel, ponctuellement vu comme trop encombré et représentatif des excès décoratifs dans le modernisme doit libérer les usager.e.s. Si la tension entre ornement et fonctionnalisme a largement été documentée par les historien·nes du design, la dimension genrée de la moralisation du décor est moins souvent mentionnée, et très souvent absente des cours dʼhistoire du design19. Lʼouvrage dirigé par les théoricien·nes de lʼarchitecture Hilde Heynen et Gülsüm Baydar permet de retracer lʼhistoire du rejet de lʼornement, qui peut être compris comme un geste purgatif vis-à -vis de lʼordre du Second Empire, de la bourgeoisie, du capitalisme industriel encore naissant, et enfin du féminin. Adolf Loos définit le «  sujet accompli  » comme ayant rejeté lʼimpasse morale et esthétique de lʼornement, et en tire les conséquences qui sʼimposent pour lʼensemble de la gente féminine :
fig. 0.7 : Dans cette célèbre caricature de Karl Arnold diffusée dans le périodique allemand Implicissimus (1914), on découvre Henry Van De Velde proposant sa chaise dessinée, Muthesius et le type moderniste, et enfin l’artisan et sa chaise au dessin traditionnel, ponctuellement vu comme trop encombré et représentatif des excès décoratifs dans le modernisme doit libérer les usager.e.s. Si la tension entre ornement et fonctionnalisme a largement été documentée par les historien·nes du design, la dimension genrée de la moralisation du décor est moins souvent mentionnée, et très souvent absente des cours dʼhistoire du design19. Lʼouvrage dirigé par les théoricien·nes de lʼarchitecture Hilde Heynen et Gülsüm Baydar permet de retracer lʼhistoire du rejet de lʼornement, qui peut être compris comme un geste purgatif vis-à -vis de lʼordre du Second Empire, de la bourgeoisie, du capitalisme industriel encore naissant, et enfin du féminin. Adolf Loos définit le «  sujet accompli  » comme ayant rejeté lʼimpasse morale et esthétique de lʼornement, et en tire les conséquences qui sʼimposent pour lʼensemble de la gente féminine :
Les vêtements des femmes diffèrent en apparence de ceux des hommes, de par leur préférence pour des effets ornementaux et colorés, et la longue jupe qui couvrent complètement les jambes de la femme. Ces deux éléments suffisent à montrer que les femmes sont restées très en retard dans leur développement ces derniers siècles (2019[1898], 94–95)20.
Si les femmes ne sont pas le problème des architectes-auteurs qui pensent la modernité, elles font inévitablement leur apparition dans leurs discours, quoique parfois en creux, pour incarner la dimension sensible, sentimentale et in fine, de mauvais goà »t de lʼhumanité. Lʼarchitecte Bruno Taut observe que les femmes sʼenveloppent dans leur maison comme dans un cocon ; il en déduit quʼune architecture rationnelle peut les libérer des excès kitsch du décor (Van Herck 2005, 128). Le Corbusier republie après-guerre Ornement et Crime dans la revue LʼEsprit Nouveau (Ayvazova 2018, 99) et appelle de ses vÅ“ux un fonctionnalisme destiné à purifier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Si, dans lʼessai LʼArt décoratif dʼaujourdʼhui (1925), il parle généralement des «  nerfs deÌtraqueÌs dʼapreÌ€s guerre  » (Le Corbusier 1980[1925], 99 ; Ayvazova 2018, 99) quʼune architecture raisonnée peut apaiser, il nʼhésite pas ailleurs à parler dʼune «  hystérie sentimentale  » (Le Corbusier 1923, 196 ; Van Herck 2005, 124) -— le terme hystérie ne laissant aucun doute sur la dimension féminine de ces crises de nerfs dʼaprès-guerre. En 1998, le sociologue Pierre Bourdieu évoque cette dimension genrée du goà »t lié à certains espaces, quand il oppose «  cuirs […] meubles lourds, anguleux et de couleur sombre  » signes de virilité aux «  espaces dits ‹ féminins ›  » et leurs «  couleurs mièvres […] bibelots […] dentelles [et] rubans  » (2002[1998], 83).
Irrigué par le projet moderne du début du XXe siècle, entre industrie et utopie, ce design qui se donne pour objectif de concevoir les intérieurs sobres et moraux de lʼhomme nouveau crée aussi un paradoxe. La domus est historiquement le territoire de lʼange de maison21 et il nʼest pas question que ce dernier sʼinvite dans les domaines masculins de lʼespace urbain ou de lʼentreprise. La boniche est assignée à lʼespace domestique qui est alors sans cesse menacé de basculer dans la féminité de son occupante. Ce paradoxe, si cʼen est bien un, est tout à lʼavantage des hommes architectes qui sʼoctroient par là même le privilège de concevoir des espaces dans lesquels ils vivent, passent peut-être, mais ne travaillent pas. En somme, pour les hommes : lʼaménagement ; pour les femmes : le ménage. Au-delà du bon mot, on retrouve encore avec le mot «  ménage  » une notion rassemblant le lieu (lʼusage médiéval de maisnage), lʼactivité de gestion dudit lieu, et plus généralement lʼidée transversale de soin (ménager sa monture)22.
Les femmes sont donc des sujets seconds de lʼarchitecture. Si Bruno Taut estime que rejeter les excès kitsch de la bourgeoisie libère les femmes, il les exclut bien de toute possibilité dʼaccès à la conception des espaces : «  [l]ʼarchitecte pense, la femme au foyer règne  »23. Cette assignation comme chef occupante de la maison, à défaut dʼun rôle de conceptrice, est déterminant dans lʼhistoire de lʼarchitecture occidentale. Dans Designing Women (2000), la théoricienne de lʼarchitecture Annmarie Adams et la sociologue Peta Tancred rappellent que les femmes ont bien été présentes comme architectes au cours de lʼHistoire, mais quʼelles sont majoritairement représentées comme des usagères par les revues spécialisées (2000, 43). Elles exposent ainsi comment, au Canada, une revue dʼarchitecture comme RAIC Journal oublie des grands noms de la profession, et, lorsquʼelle inclut des femmes, en saisit majoritairement la contribution au décor dʼintérieur ou à lʼaménagement de certaines pièces (comme, sans surprise, la cuisine). Les visuels de la revue montrent les femmes comme «  régulant des détails  »24 (37), tandis que les publicités les mettent en scène comme extensions du mobilier ou comme objets sexuels. Lorsque les femmes montrées sont des conceptrices, cʼest souvent pour valoriser un talent inné pour la décoration et lʼarrangement de lʼintérieur. En France, si Le Corbusier se méfiait de lʼhystérie dʼaprès-guerre, il avait en revanche une idée assez précise du rôle des femmes en architecture, comme le souligne Catherine Clarisse en citant ses propos :
La femme sera heureuse si son mari est heureux. Le sourire des femmes est un don des dieux. Et une cuisine bien faite vaut la paix au foyer. Alors faites donc de la cuisine le lieu du sourire féminin, et que ce sourire rayonne sur lʼhomme et les enfants présents autour de ce sourire (2004, 18)25.
Ces mots présentent des femmes qui ne sont pas des agentes dans les espaces quʼelles habitent, mais qui composent une partie du mobilier. Plus encore, ils choisissent un motif sexiste qui sépare les hommes des femmes, à travers lʼidée dʼune «  nature  » profondément différente, ce qui leur confère des rôles clairement établis. Il nʼest donc pas étonnant que Le Corbusier, invité dans la maison E1027 (fig. 0.8) conçue par Eileen Gray et son protégé Jean Badovici, ait ressenti le besoin irrépressible dʼy ajouter une fresque, alors que Gray, conformément aux principes modernes dont Le Corbusier était par ailleurs un défenseur, refusant toute décoration des murs (Moore 2013 ; fig. 0.9.b).

Le rejet du décor, en tant quʼélément bourgeois et féminin, est donc tout relatif. Il apparaît que la nécessité, ou non, du décor, dépend de la manière dont le pouvoir masculin se positionne. Le Corbusier nʼa pas vu dʼinconvénient à sacrifier sa doctrine du ripolin pour apposer sa marque (sous la forme dʼune fresque décorative, fig. 0.9.a)  fig. 9.a : La fresque apposée par Le Corbusier. sur un espace par ailleurs souvent analysé, depuis, comme représentatif de la queerness de sa créatrice, qui était bisexuelle (Bonnevier 2005, 176).
fig. 9.a : La fresque apposée par Le Corbusier. sur un espace par ailleurs souvent analysé, depuis, comme représentatif de la queerness de sa créatrice, qui était bisexuelle (Bonnevier 2005, 176).

Despina Stratigakos creuse ainsi cette matrice du décor et de la féminité en analysant les discours sur lʼarchitecture en Allemagne au début du XXe siècle. Dans le contexte de lʼémergence des discours modernistes surgit la figure de lʼarchitecte lesbienne (Stratigakos 2005, 145) qui résout le conflit entre une femme vraiment féminine, incapable dʼêtre architecte, et la femme architecte, qui ne peut quʼêtre une «  femme ratée  », au sens de lʼhétérosexualité obligatoire qui implique quʼune lesbienne ne peut être «  une vraie femme  ». Les commentateurs de lʼépoque sont si désorientés par la possibilité quʼune femme puisse être architecte quʼils imaginent quʼun tel choix de profession occasionnerait une mutation de genre de lʼintéressée (Stratigakos, 2005, 148), allant jusquʼà penser un «  troisième sexe  », issu du choix de carrière malencontreux des femmes oublieuses de leur véritable rôle. D. Stratigakos commente ainsi la réception du pavillon des femmes (Haus der Frau, fig. 0.10) proposé en 1914 par des femmes architectes lors de lʼexposition du Werkbund à Cologne. Le bâtiment repose sur des lignes sévères, et un manque quasi total de décor en conformité avec le programme moderniste dʼalors. Mais ce respect du programme moderne indiffère dès lors que sa réception est conditionnée par le genre de ses autrices : ainsi, la proposition est lue par les journalistes comme révélant un manque de féminité, voire une trahison de leur genre, par les créatrices. En résumé, le programme moderne nʼest jamais mieux respecté que par des hommes, indépendamment des réalités de production, comme le montrent les exemples successifs du pavillon des femmes et du E1027. En même temps quʼun programme moderne a été défini, cʼest aussi lʼimpossibilité dʼune participation féminine qui a été postulée, ce que souligne aujourdʼhui encore lʼinsistance que mettent, ici et là , les théoricien·nes à dire «  le designer  » pour parler dʼune figure qui a pourtant été féminine. Plus encore que sujet second, les femmes sont des sujets impossibles en architecture et en design. Leur réussite dans ces disciplines leur fait courir le risque dʼêtre instrumentalisées ; tout au plus, certains espaces liminaires, comme la décoration dʼintérieur, apparaissent comme habitables pour elles (Sparke 2003, 48 ; Bonnevier 2007, 69).
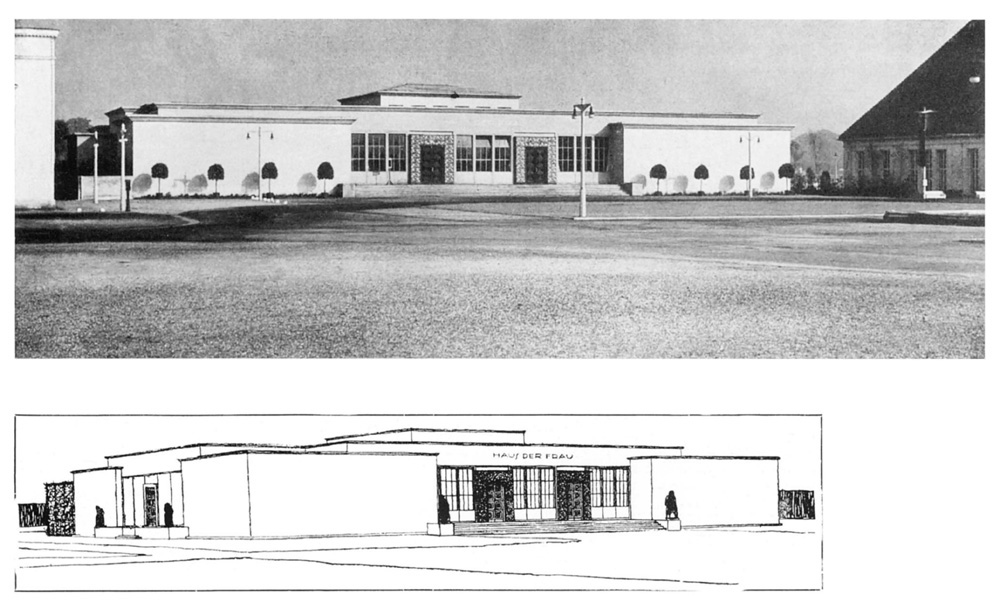
La figure de lʼarchitecte lesbienne nous intéresse parce quʼelle permet de ne pas rester fixé sur une analyse du genre stricto sensu, et étend la conception du genre comme étant également produit par lʼhétérosexualité. Lʼaspect régulateur de la domus se joue ici : en produisant masculinité et féminité comme deux catégories hétérogènes, il produit lʼhétérosexualité qui, par effet retour, solidifie les catégories de genre (Wittig 2013[2001], 63–64). Un passage par la culture pop peut nous aider à comprendre les tensions qui entourent lʼoccupation féminine de lʼespace domestique et lʼhétérosexualité obligatoire. En quoi le contrat social hétérosexuel est-il aussi un contrat architectural ? La chanson «  Y a une fille quʼhabite chez moi  » du chanteur français Bénabar répond dʼune certaine manière à cette question (2001), en suivant un jeune homme qui semble découvrir quʼil vit avec sa compagne. Le ressort humoristique est le suivant : le héros-chanteur énumère lʼensemble des signes plus ou moins discrets qui signalent quʼil ne vit plus seul, et donc plus comme un célibataire, mais en faisant mine, grâce à un amusant chleuasme, de le découvrir. La chanson débute ainsi :
Plusieurs indices mʼont mis la puce à lʼoreille
Jʼouvre lʼœil
Jʼvais faire une enquête pour en avoir le cœur net
Ça mʼinquiète
Yʼa des détails qui trompent pas
Les draps la couette et la taie dʼoreiller
Sont plus dépareillés
À côté de mes fringues en boule
Yʼa des vêtements pliés et repassés
Yʼa des détails qui trompent pas
Jʼcrois quʼy a une fille quʼhabite chez moi !
De manière générale, le propos suit une ligne unique : la présence féminine est lisible non par son corps, ou sa parole, mais par un ensemble de tâches ménagères habituellement délaissées qui semblent sʼêtre accomplies, seules, comme par magie. Ainsi, le linge est repassé et rangé, mais il est aussi question de cafards disparus, dʼune vaisselle terminée, de courses réalisées en intégrant légumes et fruits au régime alimentaire, dʼun «  vrai rideau  » qui remplace un drap cloué, etc. La maison est donc soudainement entretenue et les habitudes de célibataire disparaissent. Mais ces tâches accomplies sont présentées comme une alternative envahissante à un style de vie antérieur qui convenait très bien. Cʼest ce que suggère la posture (certes faussement) outragée de lʼex-célibataire («  je vais porter plainte  »). Ce portrait de lʼhomme en adolescent attardé croise dʼautres représentations contemporaines, comme celle, bien connue, du film Tanguy sorti la même année que le single de Bénabar. En surface, cʼest de lui-même que le chanteur se moque : il ne sait pas grandir, vider ses cendriers, et seule la relation hétérosexuelle acte pour lui le passage à lʼâge adulte. Cʼest le sens de la conclusion de la chanson qui donne la parole à la compagne du chanteur : elle le rabroue en lui rappelant quʼelle paie tout autant que lui son loyer. En dʼautres termes, la chanson admet que «  la fille  » (et non la femme, dʼailleurs) qui habite là est en réalité chez elle. Cette concession apparemment progressiste (les femmes et les hommes partagent leur logis et sont des partenaires sociaux égaux dans leur relation à ce dernier) est en fait minée par la misogynie brutale, quoique discrète, qui maille la chanson. En effet, le texte sʼamuse de cet adulescent qui ne fait pas la vaisselle et semble découvrir lʼexistence de cette tâche, il nʼest à aucun moment question de le renvoyer à ses responsabilités -— puisquʼon comprend tout de même, à lʼécoute du morceau, que le chanteur-héros ne fait strictement rien dans son foyer. La femme du couple prend la parole pour affirmer quʼelle est aussi chez elle, ce que la chanson lui concède, mais cʼest bien la moindre des choses quand on observe la liste des tâches quʼelle réalise.
Si lʼapparition des «  petites boules bizarres  » dans la salle de bain ironise sur lʼobsession féminine de la beauté26, dʼautres objets qui ont trait au soin du corps doivent retenir notre attention. La mention de lʼaspirine qui remplace dans le tiroir les préservatifs se veut amusante dans la mesure où elle dénote, une strophe après lʼévocation de la camomille, une sexualité rangée et ennuyeuse, loin des multiples conquêtes du célibataire. Seulement, la chanson vaut ici tout autant pour ce quʼelle ne décrit pas : car si les préservatifs ont disparu, ce nʼest peut-être pas tant que ce couple nʼa pas de sexualité, mais plutôt que la femme hétérosexuelle gère sa fertilité (par exemple avec une pilule contraceptive). Autrement dit, la chanson nous demande dʼéprouver une forme dʼempathie pour un pauvre garçon dont la vie est devenue, malgré lui, bien rangée, selon le motif culturel occidental de lʼhomme domestiqué par sa femme. On en trouve de très nombreux exemples dans le cinéma américain de divertissement, qui dramatise ad nauseam des escapades entre boys27, loin de femmes pénibles qui pensent à leur fertilité, à leur mariage, etc.  fig. 0.11 : Le film The Hangover (2009) est emblématique d’un courant scénaristique hollywoodien qui consiste à centrer l’action sur les relations amicales d’hommes d’âge moyen, qui s’apprêtent à rentrer dans une vie quotidienne et familiale tranquille, mais s’en échappent pour passer un moment entre hommes. Si la femme de la chanson apparaît comme domesticatrice, ayant relégué vieux mégots et rideau cloué aux oubliettes, cʼest pour mieux noter, par touches, quʼelle sʼauto-domestique pour répondre aux attentes de la relation hétérosexuelle : les légumes du frigo évoquent le contrôle alimentaire qui, comme «  les petites boules bizarres  », garantit lʼattractivité physique dʼune femme, tandis que les préservatifs disparus indiquent paradoxalement que la disponibilité sexuelle est autrement gérée, mais bien préservée. Cette chanson aborde finalement la présence féminine dans lʼhabitat individuel dʼune manière qui nʼest pas si différente de celle dont les journalistes allemands abordaient celle des femmes architectes dans lʼexposition du Werkbund. La présence de femmes est reconnue si elles valident les critères étroits de la féminité, ce qui leur vaudra néanmoins dʼêtre critiquées en tant que femmes. Toutefois, tout ce qui pourrait déborder de cette féminité nʼen devient pas plus désirable. Pour revenir à Bénabar, il apparaît dans sa chanson quʼil est tout fait normal, en 2001, quʼune femme fasse les tâches ménagères. Sʼil peut sʼentendre que lʼintérieur soit féminisé, il nʼen résulte pas pour autant que cette femme est chez elle. Au final, la chanson de Bénabar peut se lire comme un pamphlet réactionnaire, une manière de dire à la «  fille  » de la chanson : nettoie bien chez toi, mais nʼoublie pas que tu vis chez moi.
fig. 0.11 : Le film The Hangover (2009) est emblématique d’un courant scénaristique hollywoodien qui consiste à centrer l’action sur les relations amicales d’hommes d’âge moyen, qui s’apprêtent à rentrer dans une vie quotidienne et familiale tranquille, mais s’en échappent pour passer un moment entre hommes. Si la femme de la chanson apparaît comme domesticatrice, ayant relégué vieux mégots et rideau cloué aux oubliettes, cʼest pour mieux noter, par touches, quʼelle sʼauto-domestique pour répondre aux attentes de la relation hétérosexuelle : les légumes du frigo évoquent le contrôle alimentaire qui, comme «  les petites boules bizarres  », garantit lʼattractivité physique dʼune femme, tandis que les préservatifs disparus indiquent paradoxalement que la disponibilité sexuelle est autrement gérée, mais bien préservée. Cette chanson aborde finalement la présence féminine dans lʼhabitat individuel dʼune manière qui nʼest pas si différente de celle dont les journalistes allemands abordaient celle des femmes architectes dans lʼexposition du Werkbund. La présence de femmes est reconnue si elles valident les critères étroits de la féminité, ce qui leur vaudra néanmoins dʼêtre critiquées en tant que femmes. Toutefois, tout ce qui pourrait déborder de cette féminité nʼen devient pas plus désirable. Pour revenir à Bénabar, il apparaît dans sa chanson quʼil est tout fait normal, en 2001, quʼune femme fasse les tâches ménagères. Sʼil peut sʼentendre que lʼintérieur soit féminisé, il nʼen résulte pas pour autant que cette femme est chez elle. Au final, la chanson de Bénabar peut se lire comme un pamphlet réactionnaire, une manière de dire à la «  fille  » de la chanson : nettoie bien chez toi, mais nʼoublie pas que tu vis chez moi.
Jʼai tâché précédemment de donner quelques éléments de définition de la domesticité, pour faire apparaître la tension à lʼœuvre entre le confort de lʼintérieur et le potentiel enfermement qui en résulte. Au sujet de lʼhabitat, une autre dualité existe, entre la dimension individuelle de cet acte (consacrée comme telle par la culture bourgeoise) et son aspect pourtant universel. Comme le pose le designer Alessandro Mendini, «  [c]haque être vivant habite continuellement  » (2014[2000], 442). Habiter ne serait donc pas un supplément social de la vie, mais un acte qui découle obligatoirement du fait dʼêtre vivant·e. Reste à savoir, et Mendini nʼétait pas indifférent à la question, en fonction de quels traits qualitatifs on habite. La réflexion que je mène, portée par les apports des études queer, féministes et anti-racistes, doit nécessairement prendre acte de cette évidence aux soubassements pourtant complexes : nous nʼhabitons pas toustes au même titre. Habiter ne veut pas nécessairement dire que lʼon possède de lʼagentivité, ou que lʼon contrôle son environnement. En théorie du design, lʼexpression dʼ«  habitabilité du monde  » (Findeli 2015, §16) a connu une grande fortune critique, si bien quʼelle fait aujourdʼhui figure de définition de la discipline28. Ici et là , et souvent dans les copies et mémoires dʼétudiant·es, on lit que le design doit préserver lʼ«  habitabilité du monde  ». Cette définition repose sur un implicite : le monde est habitable. Les théories queer, grâce à leur approche située (Haraway 1988) permettent dʼéclairer différemment le geste apparemment automatique qui consiste à habiter. Il me semble que, dans un monde traversé par des rapports de pouvoir, des hiérarchies, des formes de discrimination, le rôle du design est plutôt de lutter contre lʼinhabitabilité du monde, surtout ces inhabitables quʼil contribue lui-même à fabriquer, tels ces trottoirs sur lesquels les chaises roulantes buttent, ces formulaires face auxquels les dissident·es du genre sont tenu·es en échec ou encore ces peignes dits «  classiques  » pensés pour brosser les cheveux lisses des personnes caucasiennes29. Dans cette liste de dispositifs contraignant les corps minoritaires, lʼhabitat nʼest pas en reste. Il semble donc que la notion dʼhabitat queer mette en jeu une contradiction : cellui qui est queer est cellui qui ne peut pas habiter, cellui pour qui le monde est rendu inhabitable. Et pourtant, les personnes queer vivent, survivent et inventent des modalités domestiques spécifiques et singulières.
La notion de «  queer  » mérite une première définition, que jʼétaierai dans le premier chapitre. Je mentionnerai seulement ici lʼaspect historiquement polysémique du terme : signifiant «  étrange  » ou «  bizarre  » en anglais britannique (fig. 12 & 13), il prend une nouvelle signification au XIXe siècle, pour désigner péjorativement, sur le mode de lʼinsulte, les hommes homosexuels (alors plutôt désignés comme «  invertis  »). fig. 0.12 : Dans ce comic à la source inconnue, une femme s’exclame «  There’s something mighty queer about this!  », qui dans ce contexte peut être lu comme «  Il y a là quelque chose de vraiment bizarre !  ».
fig. 0.12 : Dans ce comic à la source inconnue, une femme s’exclame «  There’s something mighty queer about this!  », qui dans ce contexte peut être lu comme «  Il y a là quelque chose de vraiment bizarre !  ».  fig. 0.13 : En 2016, Meg Jon-Barker publie Queer, A Graphic History, un roman graphique visant à expliquer les origines et les possibles de la queer theory, en les rendant plus accessibles grâce aux ressources visuelles et didactiques de la bande dessinée. L’illustration suivante expose « queer » dans sa dimension d’insulte.Le terme fait ensuite lʼobjet dʼun processus de réappropriation (reclaim)30 par les personnes concernées. Dans les années 1990, des militant·es de Boston et New York produisent le tract Queers Read This! pour la marche de la Pride, dont ils critiquent lʼévolution en faveur des politiques assimilationnistes. Queer permet de resituer la politicité dʼun mouvement qui serait, selon le tract, plus intéressé par la perception des gays et lesbiennes par la société hétérosexuelle que par un véritable programme révolutionnaire. Enfin, la théoricienne Teresa de Lauretis popularise le terme dans une conférence à lʼUniversité de Californie en 1990, puis un texte de la revue differences publié en 1991, pour imaginer dʼautres espaces et penser les conditions liées au sexe et au genre hors des catégories trop rigides de «  gay  » ou «  lesbienne  ». T. De Lauretis sʼempare du terme «  queer  » pour tracer une saignée dans les ordres discursifs alors en vigueur et consacre sa migration dans le champ universitaire, quelques années après que Gloria Anzaldua lʼa utilisé dans ses travaux. T. De Lauretis critique particulièrement la manière dont le terme «  homosexualité  » connote malgré lui la centralité du concept dʼhétérosexualité dans les efforts de théorisation. Aujourdʼhui, le terme queer reste une matrice complexe aux usages hétérogènes : ici, terme parapluie rassemblant des idées multiples, souvent selon un prisme intersectionnel ; là , terme associé aux queer studies qui se sont taillé une place à lʼuniversité, comme en témoigne dʼune certaine manière cet écrit.
fig. 0.13 : En 2016, Meg Jon-Barker publie Queer, A Graphic History, un roman graphique visant à expliquer les origines et les possibles de la queer theory, en les rendant plus accessibles grâce aux ressources visuelles et didactiques de la bande dessinée. L’illustration suivante expose « queer » dans sa dimension d’insulte.Le terme fait ensuite lʼobjet dʼun processus de réappropriation (reclaim)30 par les personnes concernées. Dans les années 1990, des militant·es de Boston et New York produisent le tract Queers Read This! pour la marche de la Pride, dont ils critiquent lʼévolution en faveur des politiques assimilationnistes. Queer permet de resituer la politicité dʼun mouvement qui serait, selon le tract, plus intéressé par la perception des gays et lesbiennes par la société hétérosexuelle que par un véritable programme révolutionnaire. Enfin, la théoricienne Teresa de Lauretis popularise le terme dans une conférence à lʼUniversité de Californie en 1990, puis un texte de la revue differences publié en 1991, pour imaginer dʼautres espaces et penser les conditions liées au sexe et au genre hors des catégories trop rigides de «  gay  » ou «  lesbienne  ». T. De Lauretis sʼempare du terme «  queer  » pour tracer une saignée dans les ordres discursifs alors en vigueur et consacre sa migration dans le champ universitaire, quelques années après que Gloria Anzaldua lʼa utilisé dans ses travaux. T. De Lauretis critique particulièrement la manière dont le terme «  homosexualité  » connote malgré lui la centralité du concept dʼhétérosexualité dans les efforts de théorisation. Aujourdʼhui, le terme queer reste une matrice complexe aux usages hétérogènes : ici, terme parapluie rassemblant des idées multiples, souvent selon un prisme intersectionnel ; là , terme associé aux queer studies qui se sont taillé une place à lʼuniversité, comme en témoigne dʼune certaine manière cet écrit.
Queer a lʼavantage de lʼindéfinition, ce qui ne signifie pas que le terme soit vide, mais quʼil doit sans cesse être retravaillé. Pour ma part, jʼuserai de ses trois dimensions. Premièrement, jʼutiliserai sa définition connectée aux politiques de lʼidentité. Queer peut en effet se comprendre comme «  les personnes queers  », qui sont aussi parfois aussi désigné·es par lʼacronyme LGBTQIA+POC (Lesbiennes, Gays, Bi·es, Trans*, Queer, Intersexes, Asexuel·le.s et People of Color). On peut ici apprécier la clarté peut-être salutaire que produit un terme généraliste et souple par rapport à un acronyme dont lʼexhaustivité ne garantit jamais lʼexactitude, et même crée de multiples débats au sein des communautés concernées. Je me servirai néanmoins des deux termes, dans la mesure où la «  soupe alphabet  » (alphabet soup) de «  LGBTQIA+POC  » a le mérite de resituer les enjeux des identités queer en rappelant que «  gay  » et «  lesbienne  », si elles sont les deux identités les plus connues et visibilisées, nʼont pas vocation à absorber les autres (fig. 0.14). La question de la race est aujourdʼhui centrale dans les débats sur les identités queer, dans le sens où les personnes queer blanches ont acquis des droits ces dernières années dans certains territoires et peuvent bénéficier dʼune plus grande acceptabilité de leurs sexualités et identités en raison de leur privilège blanc (Bourcier 2017 35 ; 58). À cet égard, nʼest pas nécessairement queer ce qui se décale sur le plan de lʼorientation sexuelle ou de lʼexpression de genre, mais aussi des identités constamment marginalisées, et ce à plus forte mesure quʼelles sont vécues simultanément : queer et noir·e, queer et arabe, queer et juif·ve, queer et latinx, queer et indigène, queer et crip, queer et sans-papiers, mais aussi, plus fondamentalement, queer parce que latinx, indigène, crip, etc. ou tout cela à la fois. Je parlerai aussi de queer dans une acception plus large, comme ce qui est trouble, ce qui peut être plié ou désaxé, en ayant conscience quʼune telle définition prend parfois le risque de dépolitiser le terme de queer. Enfin, le terme de queerness sera également sollicité, comme qualité de ce qui est ou peut être queer, de ce qui peut se «  queeriser  » (Plana 2022, 366).
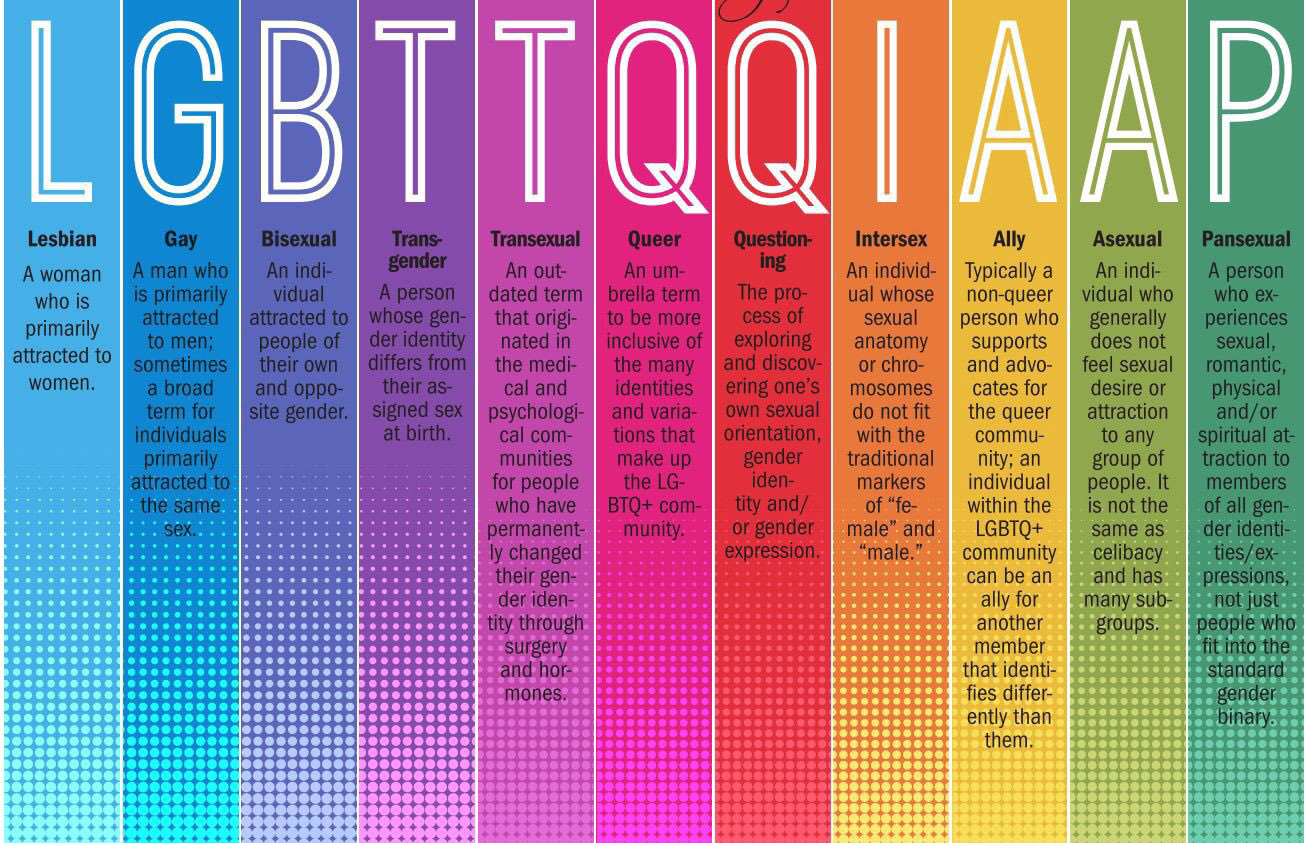
Autrement dit, jʼéviterai dʼemployer ce terme dans lʼanalyse pour estampiller des objets dʼétude (dire que telle ou telle chose est ou nʼest pas queer) mais le comprendai comme un verbe dʼaction : to queer, queeriser, pouvoir affecter lʼenvironnement, les actes, les habitus dʼune queerness qui nʼest jamais stable et sans cesse se renégocie seront les horizons de mon travail. Cʼest aussi à cette condition que le terme de queer, tout comme les identités, concepts et esthétiques associées peuvent résister à une forme dʼabsorption par le marché31 (Plana 2022, 385).
Si jʼai déjà évoqué lʼaspect co-construit du genre et de lʼorientation sexuelle (notamment en parlant de la figure de lʼarchitecte lesbienne), il me faut préciser quel contenu je donne à ce terme dʼhétérosexualité, qui mʼintéresse dʼailleurs en tant que régime politique -— et non comme une orientation sexuelle fortuite, qui aurait, selon les un·es et les autres, un caractère inné ou construit, mais dans les deux cas, un lien fort à la Nature et à une vérité de lʼêtre. Ainsi, il me faudra plutôt parler dʼhétéronormativité32, cʼest-à -dire de la manière dont lʼhétérosexualité, pour les points de vue les plus conservateurs, est vue comme obligatoire, mais aussi, dans des conceptions apparemment plus libérales, perçue comme naturelle ou relevant dʼun «  par défaut  », comme le pointe Monique Wittig en parlant du «  cela-va-de-soi hétérosexuel  » (2013[2001], 65). Elle le relie à la «  pensée straight  », cʼest-à -dire un système linguistique, théorique et politique qui universalise ses concepts et dont la critique nous permet de penser la catégorie «  femme  » comme le vecteur premier de lʼoppression féminine par lʼhétéropatriarcat (63–67). Elle écrit ainsi :
[…] bien quʼon ait admis ces dernières années quʼil nʼy a pas de nature, que tout est culture, il reste au sein de cette culture un noyau de nature qui résiste à lʼexamen, une relation qui revêt un caractère dʼinéluctabilité dans la culture comme dans la nature, cʼest la relation hétérosexuelle ou relation obligatoire entre ‹ lʼhomme › et ‹ la femme ›. Ayant posé comme un principe évident, comme une donnée antérieure à toute science lʼinéluctabilité de cette relation, la pensée straight se livre à une interprétation totalisante à la fois de lʼhistoire, de la réalité sociale, de la culture et des sociétés, du langage et de tous les phénomènes subjectifs (62).
Cʼest sur cette analyse de lʼhétérosexualité comme système politique (plutôt que choix ou nature innée, liée à des pratiques sexuelles) que Paul B. Preciado fonde son propos. En reliant les apports de Wittig à la pensée de la biopolitique chez Foucault. P. B. Preciado souligne lʼimportance dʼanalyser lʼhétérosexualité comme «  technologie bio-politique destinée à produire des corps straight  » (2003). Le domicile, le foyer, la domus peuvent ainsi être appréhendés comme des lieux de production de lʼhétérosexualité (ibid.), et même des techniques du corps. La domus est un des lieux où des actes sexuels peuvent se produire, et les «  mythes  » (pour parler comme Wittig) de la domesticité incluent tout un imaginaire de la chambre à coucher. Plus généralement, le logis, regardé depuis les théories queer et féministes, apparaît comme un lieu de fabrique de lʼhétérosexualité et pas seulement comme son écrin.
Parler dʼhétéronormativité ou dʼune pensée straight permet de sortir dʼune conception étroite portée par le terme «  homosexuel  », qui sous-entend quʼêtre gay, lesbienne ou bi·e correspondrait à une différence de désir -— différence avec lʼétat «  naturel  » de lʼhétérosexualité. Cʼest un écueil dont nʼest pas toujours exempte la théorie queer, comme le montre la géographe Natalie Oswin dans son analyse de lʼhabitat singaporien :
lʼhétéronormativité à Singapour (et partout ailleurs) concerne clairement plus que le simple fait de policer la binarité hétérosexuel-homosexuel. Sa logique implique non pas une norme, mais un ensemble de normes. Sa pratique est animée par les idéologies du sexe conjointement avec les idéologies de race, de genre, de classe et de nationalité (pour en nommer quelques-unes). Et il en résulte une ‹ queerisation › dʼun ensemble divers de sujets, qui incluent mais qui en aucun cas ne se limitent à gay et lesbienne (ou même bisexuel·le ou transgenre) (2010, 258)33.
Elle conclut aussi plus loin que «  ce qui est considéré comme étranger au domestique peut et doit être interrogé comme étant aussi souvent queer  »34 (2010, 265). En effet, au cours de lʼHistoire, différentes formes de queerness se sont définies hors de la domesticité, sinon en opposition à elle. Les raisons tiennent à la définition même de lʼhétérosexualité, imposée en Occident par le modèle familial bourgeois qui consacre lʼunion hétérosexuelle comme fondement de la reproduction sous toutes ses formes (les enfants, les biens). La famille hétérosexuelle fonde le foyer, elle en constitue lʼessence et, par un effet de miroir, lʼhomosexualité est rejetée comme monde contre-nature, en lien avec lʼinfertilité des relations sexuelles quʼelle sous-tend.
Au-delà des problèmes de mÅ“urs et dʼacceptabilité des pratiques sexuelles, lʼincapacité apparente du couple gay et lesbien à participer à la reproduction futuriste des générations35 consolide lʼinterdit jeté sur ces formes de relations (Edelman 2004, 74). Par conséquent, la queerness est considérée comme externe au logis en termes symboliques, mais aussi pratiques. La culture homosexuelle masculine sʼest par exemple fondée sur une socialité secrète investissant des lieux publics, pissotières ou parcs publics, saunas ou quais (Quéré 2018, 108). Cette figure de lʼhomosexuel flâneur cherchant la rencontre rapide et discrète en marge de la cellule familiale hétérosexuelle a consacré la pratique comme une pratique singulière, nommée cruising. Dans la culture populaire, il existe de nombreux récits de coming out liés à lʼexclusion concrète et pas seulement symbolique du foyer. Le clip de la chanson «  Smalltown Boy  » du groupe Bronski Beat (1984) matérialise ce trope du jeune homme gay exclu du domicile familial qui doit survivre sans logis et sans système de support économique (fig. 0.15). Si ce récit fictionnel renvoie aux suites du coming out chez les adolescents LGBTQIA+, il contribue à matérialiser lʼidée dʼune incompatibilité de fond entre vies queers et domesticité familiale. Lʼhomosexualité semble indissociable dʼune géographie et de sa réinvention : Didier Eribon parle ainsi dʼhomosexuels «  condamnés à la ville  » -— le départ étant dans ce cas double, puisquʼil suppose de quitter sa famille mais aussi la ruralité (2012 [1999], 64). Dans une communication conjointe en 2017 lors du colloque Espaces genrés sexués queer* à Paris, Laurent Gaissad et Jean-Didier Bergilez décrivent une «  conjugalité gay construite contre ‹ lʼerrance › du multi-partenariat  ». Au sujet de cette errance, ils évoquent la manière dont les backrooms, plutôt anti-domestiques a priori, reconstruisent du familier et évoquent des référents distants, et initialement hétérosexuels, comme la chambre conjugale.

Autrement dit, ce nʼest pas seulement lʼespace domestique qui implique une forme de négociation, mais la domesticité tout entière qui est renégociée, même et presque surtout dans les espaces qui lui sont externes. Cette réinvention naît de la nécessité économique, sociale, psychologique, qui force les intéressé·es à reconstruire un logis centré sur une cellule familiale réinventée, recomposée. Les activistes trans et racisées Marsha P. Johnson et Silvia Rivera, célèbres pour leur résistance à la police lors de lʼémeute de Stonewall (1969) aujourdʼhui commémorée par les Prides ont ainsi créé la maison STAR, dont le loyer était payé par le travail du sexe (Piepzna-Samarasinha 2018, 34) (fig. 0.16).  fig. 0.16 : Marsha Johnson, Joseph Ratanski et Sylvia Rivera à la Pride de New York en 1973 (photographie de Leonard Fink). Johnson et Rivera ont fondé le STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), associé à la STAR House, située au 213 East 2nd Street. Cette maison n’a pu opérer que jusqu’en 1971. À l’origine, celle-ci n’avait ni électricité ni chauffage. Il existe et a existé d’autres résidences du même type, telle la Transy House, située au 214 16th Street à Brooklyn. Elles ont ainsi répondu à une situation de logement précaire malheureusement constante pour de nombreuses personnes LGBTQIA+. Une étude étasunienne récente montre que le risque dʼêtre sans domicile est encore doublé pour les personnes queer, un contexte régulièrement aggravé par les décisions politiques (Baume, 2020). En effet, lʼadministration Trump (2016–20) a évoqué aux États-Unis la possibilité de refuser les femmes trans dans les foyers dʼaccueil pour femmes (Levin, 2019). En dʼautres termes, les personnes queer ont fréquemment un rapport compliqué au foyer, en raison dʼun vécu marqué par le départ, sinon la fuite, et par les obstacles matériels rencontrés en reconstruisant un semblant de domus.
fig. 0.16 : Marsha Johnson, Joseph Ratanski et Sylvia Rivera à la Pride de New York en 1973 (photographie de Leonard Fink). Johnson et Rivera ont fondé le STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), associé à la STAR House, située au 213 East 2nd Street. Cette maison n’a pu opérer que jusqu’en 1971. À l’origine, celle-ci n’avait ni électricité ni chauffage. Il existe et a existé d’autres résidences du même type, telle la Transy House, située au 214 16th Street à Brooklyn. Elles ont ainsi répondu à une situation de logement précaire malheureusement constante pour de nombreuses personnes LGBTQIA+. Une étude étasunienne récente montre que le risque dʼêtre sans domicile est encore doublé pour les personnes queer, un contexte régulièrement aggravé par les décisions politiques (Baume, 2020). En effet, lʼadministration Trump (2016–20) a évoqué aux États-Unis la possibilité de refuser les femmes trans dans les foyers dʼaccueil pour femmes (Levin, 2019). En dʼautres termes, les personnes queer ont fréquemment un rapport compliqué au foyer, en raison dʼun vécu marqué par le départ, sinon la fuite, et par les obstacles matériels rencontrés en reconstruisant un semblant de domus.
Cette difficulté à créer une domesticité queer a cependant des conséquences paradoxales. En effet, Didier Eribon explique dans le chapitre «  Famille et mélancolie  » de Réflexion sur la question gay, que la rupture nécessaire avec le foyer parental «  explique peut-être, a contrario, pourquoi est si puissante la volonté dʼun certain nombre de gays et de lesbiennes dʼêtre reconnus comme des couples ou des familles légitimes par leurs proches (et notamment par leur propre famille) mais également par la société (donc par le droit)  » (2012 [1999], 56). Il ne faut donc pas céder à des représentations caricaturales et inexactes qui renforcent lʼeffet de ghetto en réduisant lʼhomosexualité masculine (par exemple) aux backrooms et aux rencontres éphémères, ni stigmatiser ces pratiques lorsquʼon revendique une possible domesticité queer. Celle-ci existe bien, et comme toute domesticité, elle doit être historisée et inscrite dans son contexte social et politique. La loi française sur le Mariage pour tous (2012) a bien sà »r facilité lʼinscription de cellules familiales gays et lesbiennes dans des formes reconnaissables par la culture hétéronormative. Cependant, il existait déjà auparavant une somme de tropes culturels incarnant la domesticité queer, comme ces représentations humoristiques sʼamusant de la rapidité avec laquelle les lesbiennes emménagent ensemble (fig. 0.17). 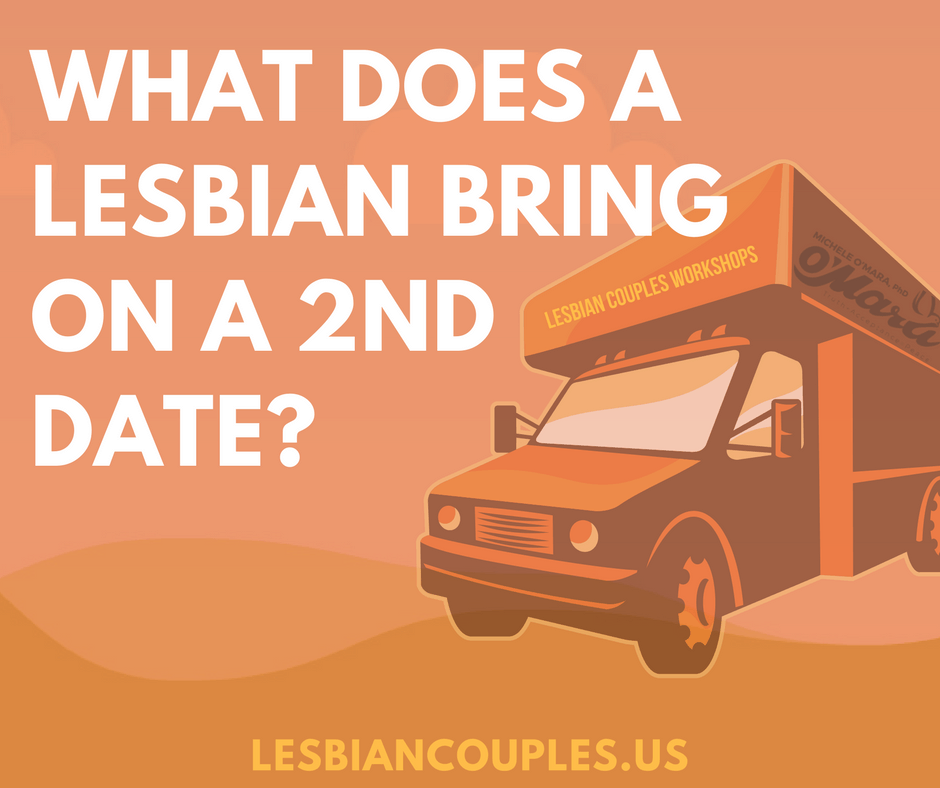 fig. 0.17 : Parmi les clichés concernant les lesbiennes, on rencontre celui de la nidification et de l’emménagement ultra-rapide après la rencontre amoureuse. Ce motif est incarné par la marque de location d’utilitaires américaine U-Haul, donnant lieu à l’expression U-Haul Lesbian pour désigner des femmes qui ont tendance à très vite proposer de partager un appartement commun. Le meme ci-dessus propose une variation humoristique sur ce thème. Cette domesticité composée à lʼimitation ou en rupture avec le modèle hétérosexuel constitue un enjeu politique, comme le montre Sam Bourcier quand il critique lʼobtention de lʼaccès au mariage pour les gays et lesbiennes comme relevant dʼun agenda «  rikiki  » de lʼégalité des droits (2017, 51) :
fig. 0.17 : Parmi les clichés concernant les lesbiennes, on rencontre celui de la nidification et de l’emménagement ultra-rapide après la rencontre amoureuse. Ce motif est incarné par la marque de location d’utilitaires américaine U-Haul, donnant lieu à l’expression U-Haul Lesbian pour désigner des femmes qui ont tendance à très vite proposer de partager un appartement commun. Le meme ci-dessus propose une variation humoristique sur ce thème. Cette domesticité composée à lʼimitation ou en rupture avec le modèle hétérosexuel constitue un enjeu politique, comme le montre Sam Bourcier quand il critique lʼobtention de lʼaccès au mariage pour les gays et lesbiennes comme relevant dʼun agenda «  rikiki  » de lʼégalité des droits (2017, 51) :
Dans le contexte néolibéral actuel, les politiques LG libérales ‹ naturalisent › le démantèlement de lʼaide sociale et la manière dont les politiques néolibérales reversent la charge de la reproduction sociale sur les familles. Ce faisant, elles échouent à prendre en compte les formes de sociabilité et de reproduction sociale queer et trans* qui sortent de ce cadre, qui sont collectives et qui représentent un travail de care et affectif systématiquement effacé par le capitalisme et le néolibéralisme (2017, 37).
Sam Bourcier explique ainsi que lʼinclusion récente des lesbiennes et des gays dans le champ social -— à condition que celleux-ci soient blancs, riches, valides, légaux·ales, etc. -—produit en retour une forme dʼhomonormativité «  complice de la spéculation immobilière  » (109). Il raconte ainsi comment «  quelques bons homos qui habitent encore le West Village ont voté contre le renouvellement de la licence pour lʼalcool dʼun bar bien inoffensif situé à quelques rues de là , le Boots and Saddle, où il arrive à des drag queens de faire un karaoké vers les 10h du soir. Motif : que leurs enfants ne soient pas exposé·e·s au spectacle des drags queens  » (2017, 104). On comprend alors la tension qui traverse lʼexploration dʼune domesticité queer. Si le queer porte en germe un devenir et peut dès lors être pensé à travers le verbe «  queeriser  », il se mêle avec le processus de domestication propre au logis. Autrement dit, une maison où vivent des personnes LBGTQIA+POC nʼest pas queer ni de droit ni de fait, et participe peut-être davantage à domestiquer la queerness qui peut se trouver là . Enfin, le queer nʼest pas imperméable à la reproduction des violences qui marquent les cellules familiales hétérosexuelles (Lejbowicz 2022), même si ces violences peuvent prendre des formes différentes selon les dynamiques genrées qui traversent les unités familiales.
La question dʼune possible domesticité queer rejoint la question récurrente pour les minorités de lʼabandon ou de la préservation du ghetto36. Ces débats ont été centraux dans le développement de lʼactivisme gay et lesbien des années 60–70 en France et en Europe, notamment entre le FAHR qui célébrait le coming out et la sortie de lʼanonymat à travers des moyens militants visibles, et la tradition dʼArcadie, portée sur le changement en douceur de lʼopinion (Quéré 2018, 34–39). Peut-il exister une visibilité LGBTQIA+POC qui ne repose pas sur lʼassimilation ou lʼexclusion de ses franges les plus minoritaires, au profit de lʼhomme homosexuel, cisgenre, blanc et riche, qui reproduit finalement un programme bourgeois dans la plupart de ses lignes ? Similairement, peut-il exister une domesticité queer qui ne domestique pas la queerness, mais laisse la domus et lʼart dʼhabiter se queeriser ? La question doit être posée en termes spatiaux mais aussi temporels. Jʼai montré comment le logis bourgeois est une cellule de reproduction de classe et de race, par le biais des enfants. Lʼaccès récent des gays et des lesbiennes à lʼadoption et à la PMA pose également la question des familles queer, et de lʼembourgeoisement du couple queer qui participe -— quoique de manière plus visiblement appareillée -—à lʼeffort de reproduction. Lʼidée ici nʼest pas de fustiger les personnes LGBTQIA+POC qui décident dʼavoir des enfants ; de manière générale, il est assez vain de surpolitiser des choix individuels, et de leur appliquer des labels (queer, pas queer, etc.). Mais cette évolution du droit concerne directement les imaginaires de la famille, du foyer, et donc de la domus. Queeriser la domesticité peut conduire à queeriser la famille, et à critiquer la manière dont ses formes traditionnelles peuvent créer des inégalités et de la souffrance -— par exemple en instaurant lʼautorité du mari sur sa femme et ses enfants, ou encore en considérant les enfants comme les biens de leurs parents (hooks, 2017[1984], 260), quand ce ne sont pas tout simplement les différences intrapersonnelles qui fracturent le collectif (Douglas 1991, 303). La domus est aussi une clé dʼentrée pour questionner la généalogie, et la façon dont les parents sont considérés comme les premiers et souvent exclusifs éducateurs de leurs enfants (hooks 2017[1984], 262–263). Jean Noudelmann explique ainsi :
ceux ou celles que les hiérarchies de type familial défavorisent nʼont pas manqué de contester le caractère naturel de leurs divisions et répartitions. Cependant ils ou elles lʼont fait en reprenant les figures généalogiques, quitte à leur attribuer de nouvelles fonctions. Ainsi la critique du modèle patriarcal par lʼutopie dʼun antique matriarcat ou dʼune future communauté sororale a le mérite de relativiser lʼautorité du père, fà »t-il symbolique, mais elle nʼéchappe pas à la reproduction des schèmes familiaux  » (2004, 12–13).
Il me semble quʼil en va de même pour la famille queer, dont le pouvoir de subversion de la morale nʼest pas assuré, ne serait-ce quʼen raison de la pression sociale qui négocie les droits en échange de lʼacceptabilité morale et politique. En outre, deux éléments doivent être interrogés : le concept restreint de «  famille  » qui désigne plus volontiers la famille nucléaire blanche, telle que «  un papa, une maman  » et leurs enfants reproduits par fécondation des gamètes (avec ou sans aide technique) ; la notion de futurité qui lui est attachée, et la manière dont la non-participation à lʼeffort de reproduction de lʼespèce marginalise les personnes concernées (Edelman 2014, 29–30). Le concept de famille choisie, cher aux personnes queer, pourra ici croiser la constitution de communautés qui ne sont pas tournées vers la production ou la reproduction, valeurs auxquelles elles peuvent préférer lʼaide mutuelle37 (mutual aid) et lʼinscription des relations dans le présent ou dans des projections futuristes alternatives (temporalités queer, utopies queer).
Un nombre important dʼinitiatives artistiques fait écho à ces tensions entre normalisation des queers et queerisation des formes familiales traditionnelles. Ce nʼest pas un hasard si la photographie de famille est un référent fort dans la majorité des projets que je mʼapprête à exposer. Le contrat administratif et légal, ou encore lʼensemble de murs à habiter ne sont que quelques-uns des moyens qui fabriquent la famille hétérosexuelle et le genre. La photographie familiale, souvent posée dans le salon, est un exemple dʼun tel dispositif. Cette typologie dʼimage est indissociable du processus de monstration qui consiste à exposer la photographie dans le contexte domestique lui-même ou sur le lieu de travail. Bien entendu, les photographies que jʼévoquerai ici sont dʼabord des fragments de lʼœuvre de photographes que jʼappréhende comme des propositions artistiques : néanmoins, par leurs codes, ces images évoquent la photographie amateure ou la pratique vernaculaire du portrait familial pris chez le photographe. Trois projets retiennent mon attention : le projet States of Union par Alice Smith (2008) ; le projet Embodiment, A Portrait of Queer Life in America (2011) par Molly Landreth et Amelia Tovey et enfin la série Pink Choice* (2017) par Maika Elan. Enfin, lʼarchive vivante de personnes queer dans leur cuisine composée par le site autostraddle

States of the Union renvoie à un référent antérieur au portrait photographique, puisquʼil donne à voir les modèles dans des poses et des environnements qui évoquent la tradition aristocratique puis bourgeoise du portrait peint (fig. 0.18). Les couples prennent des poses hiératiques, en incluant leurs enfants et leurs animaux, les seconds étant souvent mis en scène avec les mêmes égards que les premiers. Les tenues sont soignées, et les décors révèlent des détails suggérant lʼappartenance culturelle et de classe (maquette de dinosaure dans une bibliothèque, chevaux sortis en balade) ou révélant un indice sur le contexte politique (telle cette une de journal qui permet de situer le cliché dans les années de la présidence Obama). La majorité des images représente des couples gays et lesbiens, et rares sont les images où des personnes trans ou des arrangements familiaux alternatifs sont visibles. Par ailleurs, lʼimmense majorité des personnes représentées sont blanches, et lorsque des personnes racisées apparaissent, il sʼagit fréquemment des enfants -— ce qui pose tout un ensemble de questions sur la manière dont la parentalité LGBT peut recréer malgré elle des formes de domination38. Lʼintention de la photographe est clairement exposée sur son site :
À travers lʼhistoire, le portrait a été utilisé pour garder en mémoire les lignées familiales et honorer les patriarches et matriarches. Tandis que les familles hétérosexuelles ont un héritage affirmé et représenté, les unions gays nʼont pas été prises en compte dans les livres dʼhistoire. À travers States of Union, des familles de même sexe seront en mesure de revendiquer leur place dans lʼhistoire et dans un héritage séculaire de lʼart du portrait39.
Ce positionnement est révélateur dʼune approche légitimiste : ainsi saisis par les conventions picturales du portrait, les gays et lesbiennes (dʼailleurs compris·es dans la catégorie parapluie de «  gays  ») deviennent des sujets acceptables parce quʼils imitent les sujets dominants, soit les couples hétérosexuels de classe supérieure. Il nʼest nullement question dʼinventer une esthétique propre, ou de remettre en question lʼidéologie de la famille et de la reproduction. Tout au plus est-il accepté que les enfants puissent être adoptés ou que parfois, les animaux domestiques fassent figure dʼenfants du couple. Par ailleurs, rien nʼest dit sur la manière dont lʼinclusion dʼun groupe (les gays blancs et bourgeois) travaillent encore sur la base dʼun système de représentations délimité où les sujets non-blancs, queer, migrants, gros·ses, pauvres ou en situation de handicap nʼont pas leur place. Le titre du projet fait dʼailleurs tristement écho à une conception nationale du sujet gay ou lesbien, proche sans doute de ce que Sam Bourcier nomme comme une «  assimil-nation  » (2017, 61).

Le projet Embodiment ouvre sensiblement le spectre des représentations, en proposant une plus grande variété de corps -— plus souvent trans, non-blancs, gros et moins évidemment bourgeois que dans lʼexemple précédent (fig. 0.19). Les personnes sont représentées dans une multiplicité de contextes, moins frontalement que dans States of Union. Les personnes sont également représentées seules, et le projet ne se limite ainsi pas aux représentations de la famille. Pour autant, la photographe revendique sur son site lʼidée de représenter «  lʼanatomie en perpétuel changement de la famille  »40. Ainsi, le projet semble moins directement porté sur la représentation dʼune familialité queer que la série précédemment commentée. Pourtant, la question de la mutation du concept de famille est annoncée comme un objectif clair : dès lors, même les sujets isolés dans les photographies de Embodiment peuvent être interprétés comme des variantes dʼune famille comprise comme concept plastique, changeant, et incarné (puisque le titre parle dʼembodiment, soit dʼincorporation, et le texte dʼanatomie). Le projet de Maika Elan, Pink Choice (fig.0.20), se donne aussi pour objectif et enjeu lʼacceptabilité des sujets photographiés. Toutefois, si les deux premiers projets se déploient aux États-Unis, les clichés ici produits ont été pris au Vietnam. La photographe évoque dans ses textes dʼintention le nombre réduit de représentations positives de lʼhomosexualité dans son pays41, et lʼaspect redondant des représentations existantes (souvent tournées vers des récits tragiques).

Si Elan cherche lʼacceptabilité de ses sujets, cʼest en représentant leur amour (sur lequel se porte son intérêt) tel quʼil sʼexprime dans des espaces de vie :
The Pink Choice est une série de photographies portant sur lʼamour de couples homosexuels, centrée sur les espaces de vie, les gestes affectueux, et de manière plus importante, sur le rythme synchronisé dʼamants qui partagent leur vie. Le public ne peut peut-être pas sentir la personnalité des sujets dans les photographies, mais jʼespère quʼil sentira la force de leur amour et le soin mutuel42.
De fait, les clichés ne semblent pas se donner comme objectif la construction dʼun sujet légitime. La photographe semble plutôt faire un pari documentaire : ce qui fait famille dans la famille queer sʼy trouve déjà , nul besoin de faire référence à un concept antérieur de famille, par exemple réifié par le portrait comme cʼest le cas dans States of Union. En revanche, on retrouve chez Elan lʼidée dʼune image-antidote en rupture avec les imaginaires populaires de queers nécessairement désocialisés, violents et fornicateurs. Sʼil semble intéressant de résister aux clichés enfermant les personnes queer dans de telles représentations, on peut tout de même sʼinterroger sur les représentations négatives alors intériorisées par effet miroir. Ainsi, le sujet queer a fort à faire avec lʼidée de famille, qui peut lʼenfermer, lʼempêcher dʼêtre ce quʼiel est ; iel peut composer sa famille, au risque de reproduire les mêmes rapports de pouvoir quʼune cellule hétérosexuelle (qui nʼest dʼailleurs pas unique ni nécessairement dysfonctionnelle) ; enfin, la famille queer peut exister, mais elle sera tantôt accusé·e dʼêtre assimilée, trop «  normale  », ou de renforcer les clichés discriminants, si elle connaît le malheur dʼune situation difficile. Autrement dit, la famille queer est attendue au tournant. Contrairement à sa fausse jumelle, la famille hétérosexuelle, elle ne dispose pas du privilège de la transparence et doit toujours exister deux fois : pour elle-même, et comme modèle dʼune identité et de ses possibles.
La domesticité nʼest donc pas lʼailleurs de la queerness : il existe des domesticités queer, mais il nʼest pas sà »r quʼen étant queer elles ne soient pas aussi normatives. Tel est le cercle infernal de cette dialectique : en accédant à la domus et à lʼart dʼhabiter, les queers sont-iels condamné·es à se déqueeriser ? Pour lʼindividu queer, devenir domestique revient-il à domestiquer la marge en ellui-même ? Si ce rapport dialectique est stimulant, il nous enferme aussi dans une forme de binarité, qui ne conçoit que de manière très localisée ses pôles : domestique/non-domestique, hétéronormatif/queer et centre/marge. Pour sortir de cette dynamique circulaire, il convient dʼadopter un regard intersectionnel43 qui permet de ne pas oublier ce qui dans la race, la classe, la validité, participe de la queerness et contribue à la façonner. Partant de lʼidée que le sujet queer ne se définit pas par une orientation sexuelle ou une position dans le genre, mais plutôt par la place subversive quʼiel occupe par rapport à un centre dominant, je souhaite faire lʼhypothèse quʼil existe une, ou mieux encore, des domesticités queer indisciplinées, désobéissant à la normativité potentiellement produite par lʼespace domestique. Cette domesticité nʼest pas queer par essence. Elle travaille sa queerness au quotidien, dans le cambouis et les pelures de pomme de terre, comme lʼévoque la philosophe Sara Ahmed dans son Living a Feminist Life (un blog, puis un ouvrage en 2017). Je ne sais pas encore à quoi ressemble cette queer home que je cherche à esquisser ; mais, comme la vie féministe pensée par S. Ahmed, ou le travail féministe quʼelle définit comme «  homework  »44 (2017, 7), cette entreprise sera servie par des «  concepts en sueur  »45 (2017, 13). Cette définition nous plante directement les deux pieds au sol, peut-être face à lʼévier de la cuisine :
un concept en sueur est un concept qui vient dʼune description dʼun corps qui nʼest pas chez lui dans le monde […] Un concept en sueur peut venir dʼune expérience corporelle éprouvante (2017, 13)46.
Le concept en sueur ramène la pensée dans la réalité basse et sale (down and dirty) qui est celle de la cuisine. Il me faudra aussi considérer des expériences que je nʼai pas eues, qui mʼéchappent : me vient ainsi lʼimage de Silvia Rivera, militante trans et racisée étasunienne, défendant sa maison en carton sur les bords de lʼHudson dans le documentaire consacré à la vie de Marsha P. Johnson (The Death and Life of Marsha P. Johnson, 2017 ; fig. 0.22). Comment prendre en considération le fait que lʼhabitat queer est souvent marginal, marginalisé, éphémère, indigne quoique sublime dans ses dimensions de résistance, sans en «  romantiser  » la pauvreté ? Il serait en effet tentant dʼaller chercher, dans lʼimage de Rivera habitant comme elle le peut, la représentation ultime, authentique, dʼun habiter queer. Il faut donc saisir lʼimage, la réalité quʼelle décrit, dans ses contradictions : elle représente les marges où sont poussées les personnes minorisées, mais montre aussi quʼhabiter se passe de briques et de ciment. Pour autant, dʼautres images me semblent intéressantes à mettre en friction avec le portrait de Silvia Rivera. Dans lʼexposition Queer Domesticities47 (2019) se trouve une installation incluant une boîte aux lettres rose, à la forme typiquement étasunienne, portant lʼinscription «  Queer Home  » (fig. 0.23.a). Je ne sais si le dispositif faisait partie dʼune Å“uvre, de la signalétique du lieu, toujours est-il que lʼimage comporte un certain pouvoir dʼévocation. Elle projette la domesticité queer au-delà de ses deux incarnations -— la pâle copie du foyer hétérosexuel, ou le carton marginal en bordure de ville.

Elle laisse imaginer un possible distant et peut-être, comme le monde quʼimagine Dorothy48, un monde de fantaisie déjà advenu : mais pour læ designer, ce monde est aussi un possible début de la conception. La boîte aux lettres, en supposant une adresse, fixe un lieu, fait imaginer un espace où le queer est possible, où la domesticité ne domestique rien car, pour paraphraser Susan Fraiman, cʼest elle qui devient extrême, portée dans ses retranchements49. Face aux risques dʼune utopie normalisante (le spectre de lʼassimilation) et à un passé constitué de trous, lʼobjet possède peut-être le pouvoir de nous réinstaller dans un présent traversé de temporalités hybrides, multiples, dans une «   articulation dialogique entre passé, présent, et avenir  » (Plana 2022, 385).

Une telle intention nous incite donc à imaginer une queerness mouvante, en construction, dont jʼexpliciterai les critères dans le premier chapitre de cet écrit. Penser ainsi le terme queer permet aussi de résister à des tentations essentialistes décidant si telle ou telle personne, tel ou tel espace «  sont  » queers ou non. Personne nʼa «  le monopole […] du non-normatif  »50 (Nelson 2016, 91). Sʼil semble nécessaire dʼêtre critique de la normalisation classiste du couple gay/lesbien blanc de classe moyenne ou bourgeoise, la critique doit être menée parce que cette figure est instrumentalisée par les États et les entreprises et menace de vider la queerness de son potentiel subversif en accordant dʼun même geste droits, acceptabilité et intégration nationale. Toutefois, il convient de se méfier avec la même exigence de toute glorification de ce qui semble lʼenvers de cette famille homonormative, qui serait a priori révolutionnaire car éloignée du centre. Dans son questionnement, qui intègre dʼailleurs le «  passing  »51 de sa propre famille, Maggie Nelson conclut une interview de Catherine Opie en affirmant que «  cʼest la binarité normatif/transgressif qui est intenable, et avec elle lʼinjonction à ce que chacun vive une vie qui ne soit quʼune seule de ces deux choses  »52 (2016, 93). Ses observations, qui gravitent de la théorisation à la réflexion personnelle, comme nous y enjoignent les concepts suants de S. Ahmed, font écho aux observations de la philosophe Rosi Braidotti qui peuvent ici nous aider à clarifier ce rapport complexe entre marge et centre. Elle observe pour sa part que le capitalisme est une usine à produire et consommer de la différence53 (2012, 173). En sʼappuyant sur la conception foucaldienne du pouvoir, elle affirme :
[…] les chemins vers la transformation engendrés par la ‹ machine à différence › du capitalisme avancé ne sont ni droites [straight] ni prévisibles. Elles composent plutôt une ligne zigzagante dʼoptions paradoxales. Ainsi, les corps humains qui sont pris dans une machine infernale des différences multiples à la fin de la postmodernité deviennent simultanément des biens jetables, prêts à être vampirisés, et aussi des agents de transformation politique et éthique. Comment faire la différence entre ces deux modes de ‹ devenir autre ›, telle est la tâche de la théorie culturelle et politique, et de sa pratique (173–174)54.
Il convient donc de démêler ce nÅ“ud qui oppose trop strictement le normal à lʼanormal. La norme nʼest jamais homogène et ne compose pas un champ délimitable, anhistorique et identifiable. Cha Prieur, qui a travaillé dans sa thèse sur les lieux queer, rappelle avec Phil Hubbard quʼil existe des «  hétérosexualités alternatives ou dissidentes  » (2015a, 55). La norme est avant tout le creuset de lʼanormal, un anormal dont elle retrace sans cesse les contours.
Du point de vue des designers, la question de la norme, du normal et de lʼanormal est également centrale. Les designers composent sans cesse avec les normes légales, mais aussi avec celles qui sont liées à la représentation de ce quʼest un corps, de ce quʼil peut, de la façon dont il sait et doit se mouvoir dans lʼespace. Ces normes sont utiles au travail de læ designer. Par exemple, lʼarchitecte sait quel espace maximum laisser entre deux barreaux dʼune rambarde : cette mesure vient de la taille moyenne dʼun pied dʼenfant, afin que les plus jeunes évitent de se coincer et de se blesser les membres dans le dispositif. Un·e graphiste sait quʼen dessous de sept points, un texte sur papier devient illisible pour les voyant·es, et quʼune taille de seize points sʼimpose même pour répondre aux problèmes de vue les plus courants. Iel sait aussi que son code HTML, généré pour créer un site Web, doit correspondre à certaines normes sémantiques pour être interprété par les moteurs de recherche, ou encore les lecteurs dʼécran, ces outils utilisés par les mal ou non-voyant·es pour consulter le Web. Connexe à la notion de norme, le concept de normalité doit pourtant être approché de manière critique par læ designer. En respectant des normes, le design participe dʼune «  prescription optimale des actions et des gestes  », créant alors des «  objets-types scriptant une fonction-type  » (Kazi-Tani 2018). Mais la normalisation se produit même en amont de la production, par exemple par la sélection de ce qui est digne dʼintérêt : en effet, «  les solutions et processus du design définissent ce qui est socialement pertinent  »55 (Del Gaudio, Tanaka & Onzi Pastori 2021, 159). Ce sont aussi des outils et documents propres aux professions de designer et architecte qui participent de normes potentiellement enfermantes, discriminantes et aliénantes. À cet égard lʼouvrage Architectural Graphic Standards (AGS), qui a connu 11 rééditions depuis 193256, est souvent critiqué, par exemple par Félixe Kazi-Tani (2018) ou Léopold Lambert (2011, 2012, 2017) (fig. 0.23.b).
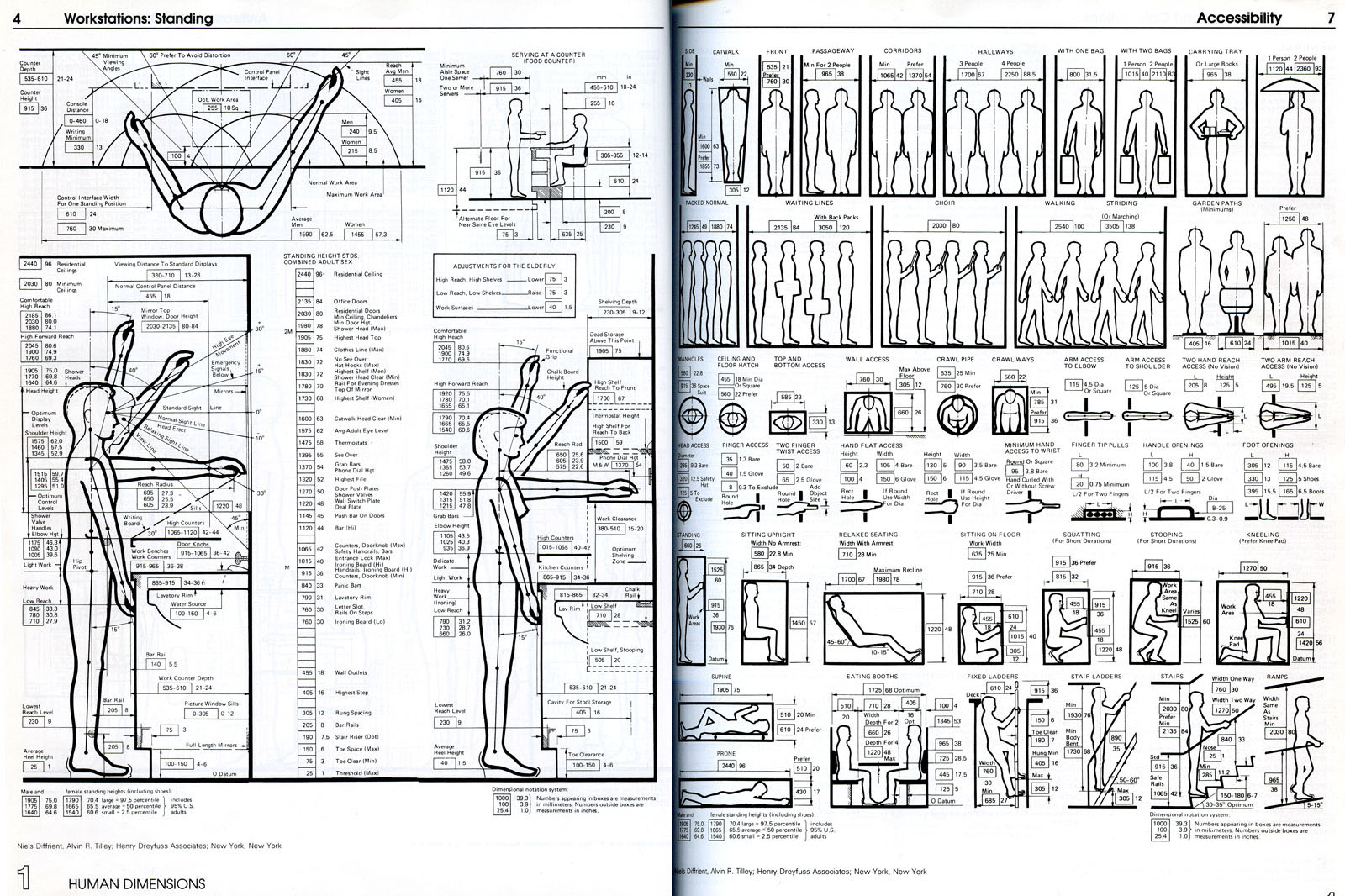
Le registre graphique, à base de lignes claires noires sur fond blanc, connote la rationalité de lʼentreprise. Les codes sont très proches de ceux du dessin technique. Plans de coupe, vues de haut et de côté construisent lʼidée dʼun réel manipulable par la mesure et par les nombres. En cela la publication fait écho au Modulor du Corbusier, lui-même inspiré de lʼhomme (et non de lʼhumain) de Vitruve, pensé au premier siècle avant notre ère et formalisé par Léonard de Vinci au XVe siècle. Pour L. Lambert, le problème de ces «  corps diagrammatiques  » est «  quʼils ne trouvent jamais dʼéquivalent en chair et en os  »57 (2017, 11). Le problème nʼest pas tant que ces représentations soient hors-sol, mais plutôt que leur déconnexion dʼavec la réalité hétérogène des corps concrets produit des effets sur ces derniers. Au lieu de décrire un monde auquel les designers doivent sʼadapter, ces graphes participent dʼune forme dʼ«  ingénierie de lʼhumain  »58. Ceci est éclairé par L. Lambert à travers quelques rappels historiques. En Allemagne, les standards de lʼarchitecture sont lʼouvrage dʼErnst Neufert, qui avait reçu la commande dʼAlbert Speer, proche dʼAdolf Hitler et ministre de lʼArmement dans le régime nazi. L. Lambert, lorsquʼil mentionne le Modulor du Corbusier, rappelle sa proximité avec le régime de Vichy (ibid.). Le design ne possède donc pas seulement un pouvoir de normalisation : ses outils historiques sont infusés par lʼexigence de fabriquer, non seulement les espaces mais, à travers eux, les humains qui les occupent.
Les représentations collectives qui peuplent nos imaginaires ont aussi un fort pouvoir de normalisation, quoique leur dimension prescriptive apparaisse moins nettement que les mesures dʼun standard architectural. En outre, nos images mentales évoluent parfois plus lentement que la société qui les produit : ainsi, si le terme de «  housewife  » suggère très facilement lʼimage dʼune femme blanche, équipée de son tablier, de sa mise en plis et, de son rouleau à pâtisserie, et avec elle la «  condition féminine éternelle  » (Davis 2019[1981], 201), il convient de réaliser que les incarnations concrètes de cette figure ne correspondent probablement pas à cette image dʼÉpinal. Il ne sʼagit pas tant de constater lʼécart entre un cliché et les réalités qui le nourrissent et quʼil informe en retour, mais plutôt dʼobserver que la notion même de «  ce qui est normal  » est changeante -— et tandis que certaines normes ont le pouvoir de malmener les corps, dʼautres, progressistes, tel le Existenzminimum cher au Bauhaus, semblent impossibles à réaliser.
En effet, la manière dont nous habitons, en Occident, a profondément changé ces dernières années et semble marquée par différentes formes de précarisation. Lʼaccès à la propriété est plus difficile quʼautrefois pour les populations modestes et les classes moyennes paupérisées. Ce contexte, ainsi que la mobilité résidentielle, a alimenté un marché du fast furniture, soit du mobilier à bas prix, envisagé comme jetable. Les espaces de vie ont rétréci, mais les appartements et maisons restent des boîtes à remplir de biens divers, et ce, de façon plus facile avec le développement du commerce en ligne et de la livraison à domicile par transporteur. Cet afflux de biens connaît un mouvement inverse avec la tendance pour les urbain·es à louer de lʼespace de stockage, en lʼabsence dʼun garage pour stocker le «  bazar  » (Lyster 2018, 57). Par ailleurs, cette boîte dʼhabitation, parfois comparée à la cellule dʼun moine, nʼest plus aussi privée quʼil y paraît. Dans le contexte dʼune flexibilisation du travail, lʼespace de la maison sʼhybride et devient bureau, annexe de lʼentreprise. Le travail se précarise en même temps quʼil devient flexible (par le jeu de contrats courts, contrats «  zéro heure  » en Grande-Bretagne ou recours à lʼauto-entrepreneuriat en France), faisant dire au géographe Oli Mould que tout converge actuellement vers la «  destruction de la vie à la maison  » (2018, 19) voire vers un «  domicide  » (36)59. À mesure que le logis sʼouvre aux logiques du travail néo-libéral, il perd sa capacité protectrice et sa dimension de refuge -— à plus forte raison dans un contexte épidémique où lʼespace dʼhabitation devient selon les mots de Paul B. Preciado «  une cellule de biovigilance  » (2020)60. Autrement dit, le logis «  normal  » nʼexiste pas, et encore moins sous une forme stabilisée. En revanche, il existe des lieux qui sont des appartements, des maisons, traversés par des contradictions enchevêtrées : le goà »t pour la décoration et lʼaménagement se développe, alors que les styles de décoration sʼuniformisent ; lʼaccès à des biens de consommation directement livrés chez soi est facilité, mais lʼinjonction au minimalisme et au «  declutter  » se répand ; le home sweet home est renforcé en contexte de confinement, mais le travail et ses exigences sʼinfiltrent de plus en plus dans lʼespace privé. Dans un tel contexte, que peuvent les designers ?
Parmi les sujets qui préoccupent les théoricien·nes du design, on rencontre la très connue, presque «  tarte à la crème  », question de la responsabilité de læ designer -— trop souvent compris dʼailleurs comme le designer, soit une figure majoritairement masculine, blanche et bourgeoise. Il est aisé de relier cette question au contexte actuel de lʼeffondrement climatique. Il convient sans doute de se demander quel rôle læ designer joue dans la catastrophe : contribue-t-iel à remplir la boîte dʼhabitation de biens jetables et secondaires, triés et livrés par des employés précaires «  embauché·es  » à la mission par Amazon, Mondial Relay, Uber ? Au sujet de ses qualités normatives, les designers contribue-t-iels à fabriquer lʼacceptabilité sociale dʼun modèle social fondé sur la flexibilité des un·es et la satisfaction instantanée des désirs des autres ? Si la question résonne bien avec lʼactualité, elle est ancienne. En 1973, Ettore Sottsass la traite dans un texte célèbre publié par la revue Casa Bella, «  Tout le monde dit que je suis meÌchant  ». Il écrit :
On veut me faire croire que je suis entieÌ€rement responsable de tout ce qui ne va pas et, peut-eÌ‚tre puisque je suis designer va-t-on aussi me faire porter la responsabiliteÌ de la guerre du Vietnam puisque, par deÌfinition, je travaille pour lʼindustrie, et que lʼindustrie cʼest le Capital et cʼest le Capital qui meÌ€ne les guerres, etc., on connaiÌ‚t la suite.
Sottsass ne refuse pas la responsabilité, mais seulement la fabrique dʼun bouc émissaire. Il répond dans les années 1970 à des griefs qui semblent encore dʼactualité. Jʼen suis parfois témoin, dans telle ou telle conférence, lorsque je croise par exemple un collègue qui explique quʼil va me «  disputer  » après que je lui ai dit être chercheur en design (sans ne rien savoir de ma pratique ni de mon travail). La figure du design méchant et celle, afférente, dʼun design nécessairement instrumentalisé par le Grand Capital, sont somme toute assez stériles. Ici, jʼaurais tendance à rejoindre le philosophe Pierre-Damien Huyghe lorsquʼil affirme que les designers sont bien responsables -— mais pas plus que quiconque (2018[2014], 45–46). Il existe bien sà »r des situations où les designers sont très clairement complices de politiques délétères : par exemple, les architectes qui conçoivent les espaces en proposent aussi des représentations, par lʼintermédiaire de rendus qui produisent autant de prescriptions normatives quant à lʼusage de lʼespace. Alex Schafran, Giorgia Aiello, Theresa Enright et Yohann Le Moigne montrent ainsi dans un entretien publié sur Métropolitiques comment ces images de quartiers blanchissent les représentations de leurs habitants, et fabriquent des images de la banlieue française qui en préparent la gentifrication. Enright explique :
Le fantasme urbain post-industriel qu[e ces rendus] décrivent est composé de campus de recherche high-tech, de quartiers financiers dʼélite, dʼénormes enceintes sportives, de centres commerciaux haut de gamme, de complexes dʼappartements de luxe, dʼespaces verts manucurés, de complexes de loisirs extravagants, de constructions immaculées le long des berges, de lieux culturels branchés et uniques, et dʼinfrastructures intelligentes. En tant quʼoutils marketing, les rendus sont avant tout utilisés pour changer lʼimage des banlieues et accroître la profitabilité de lʼespace métropolitain. Ils fournissent, en dʼautres termes, une projection spéculative dʼun futur désiré qui pourra être rentabilisé dans le cadre dʼun marché immobilier financiarisé (2017).
Ce nʼest donc pas tant de la responsabilité des designers que je souhaiterais parler, que de leur position stratégique inévitable dans une géographie complexe et jamais définitive de la norme, du normatif et du non-normatif. Le point de friction entre capitalisme et industrie constitue un point dur dans la théorie du design, mais tout comme renvoyer dos à dos normal et marginal constitue une impasse, il semble vain de tracer une frontière hermétique entre un «  bon  » design (qui serait raisonné, inspiré par ce nouveau «  capitalisme vert  » ou vertueux qui pointe aujourdʼhui son nez) et le mauvais design de la surconsommation et des objets de consommation produits en masse en Chine61. Voire, dans un tel contexte, il peut être utile, à la manière dʼun Tibor Kalman et dʼune Karrie Jacobs de déclarer «  être là pour être méchant·es  », dans le sens dʼune «  désobéissan[ce]  »62 (Jacobs & Kalman 1990, 125 ; Bierut 2012, 142). Plus que dʼune responsabilité, ou dʼune célébration de la figure dʼun design héroïque qui serait particulièrement à même de résoudre des problèmes sociaux (ou selon lʼexpression dépolitisante à la mode, «  sociétaux  »), je souhaite convoquer dans cet écrit la généalogie dʼun design malin, tactique, de lʼordre de la «  ruse  » (Flusser 2002[1993]) qui plutôt que de renoncer à être méchant, revendique de lʼêtre pour inciter les usager·es à «  désapprendre les règles  » (Jacobs & Kalman 1990, 125). Telle peut être une valeur revendiquée par un design queerisé, que je vais tâcher de mettre en Å“uvre dans les lignes à venir.
Mon intérêt pour la cuisine est apparu dans un contexte qui semblera sans doute improbable, et qui donne parfois à mes recherches le goà »t dʼun accident heureux63. Ma thèse portait en effet sur les héros masculins des films hollywoodiens de divertissement (1978–2006) et à ce titre, jʼai eu lʼoccasion de voir un grand nombre de films dʼaction. Dans ce corpus, les hommes jouaient un rôle prépondérant et mon propos portait dʼailleurs sur la masculinité de ces hommes et leur apparent hiératisme corporel, à mon sens révélateur dʼune fragilité intrinsèque. Parmi ces films dʼaction, il sʼen est trouvé où les héros étaient des femmes (fig. 0.24).  fig. 0.24 : Sigourney Weaver dans Aliens (1986). En regardant ces quelques films, rares au regard de la production dʼensemble, jʼai pu alors dégager un petit corpus uni par un motif récurrent : des femmes dʼaction, violentes, qui manifestent leur héroïsme en cuisine. Le premier film de ce corpus est The Long Kiss Goodnight (1996), dans lequel joue Geena Davis, dʼailleurs co-productrice de films dʼaction-aventure avec son mari Renny Harlin. Dans ce film, une maîtresse dʼécole amnésique, Samantha Caine, a oublié son passé de tueuse. Elle vit dans une paisible petite ville avec son mari et sa fille. Alors que ses anciens collègues travaillent à la retrouver pour la tuer, elle retrouve peu à peu des souvenirs dans un lieu très spécifique : la cuisine. La scène montre Samantha en train de retrouver sa mémoire corporelle. Alors quʼelle prépare le repas familial, ses mains sʼagitent et elle fait soudain preuve dʼune immense dextérité. Comme doué dʼune vie propre, son corps sʼaffole et se met à couper le moindre légume qui passe à portée de main, tandis quʼelle sʼexclame : «  Cʼest ce que je faisais dans la vie ! Jʼétais chef !  »64. Puis, elle lance un couteau avec précision, qui reste planté dans le mur, à sa grande surprise, devant son mari médusé : clairement, Samantha était tout autre chose quʼune chef cuisinière. Lorsque les gangsters qui la poursuivent la retrouvent, ils tentent de la tuer, à nouveau, en cuisine : cette fois, lʼexpertise physique est plus assumée, mais la vie domestique nʼest pas loin, puisque Samantha finit par occire son adversaire en lui assénant une tarte au citron sur la tête (fig. 25). Jʼai commenté dans un article les implications dʼune telle scène, en analysant la manière dont la sortie de la cuisine faisait vibrer les catégories de genre (Pandelakis 2011). The Long Kiss a été un fil dʼAriane pour une démarche de recherche en design. Avec lui, jʼai tracé un chemin qui relie plusieurs cuisines de cinéma, cuisines ordinaires transformées en cuisines violentes par un déchaînement féminin qui se libère de lʼimpératif de douceur et de soin habituellement associés à la maternité.
fig. 0.24 : Sigourney Weaver dans Aliens (1986). En regardant ces quelques films, rares au regard de la production dʼensemble, jʼai pu alors dégager un petit corpus uni par un motif récurrent : des femmes dʼaction, violentes, qui manifestent leur héroïsme en cuisine. Le premier film de ce corpus est The Long Kiss Goodnight (1996), dans lequel joue Geena Davis, dʼailleurs co-productrice de films dʼaction-aventure avec son mari Renny Harlin. Dans ce film, une maîtresse dʼécole amnésique, Samantha Caine, a oublié son passé de tueuse. Elle vit dans une paisible petite ville avec son mari et sa fille. Alors que ses anciens collègues travaillent à la retrouver pour la tuer, elle retrouve peu à peu des souvenirs dans un lieu très spécifique : la cuisine. La scène montre Samantha en train de retrouver sa mémoire corporelle. Alors quʼelle prépare le repas familial, ses mains sʼagitent et elle fait soudain preuve dʼune immense dextérité. Comme doué dʼune vie propre, son corps sʼaffole et se met à couper le moindre légume qui passe à portée de main, tandis quʼelle sʼexclame : «  Cʼest ce que je faisais dans la vie ! Jʼétais chef !  »64. Puis, elle lance un couteau avec précision, qui reste planté dans le mur, à sa grande surprise, devant son mari médusé : clairement, Samantha était tout autre chose quʼune chef cuisinière. Lorsque les gangsters qui la poursuivent la retrouvent, ils tentent de la tuer, à nouveau, en cuisine : cette fois, lʼexpertise physique est plus assumée, mais la vie domestique nʼest pas loin, puisque Samantha finit par occire son adversaire en lui assénant une tarte au citron sur la tête (fig. 25). Jʼai commenté dans un article les implications dʼune telle scène, en analysant la manière dont la sortie de la cuisine faisait vibrer les catégories de genre (Pandelakis 2011). The Long Kiss a été un fil dʼAriane pour une démarche de recherche en design. Avec lui, jʼai tracé un chemin qui relie plusieurs cuisines de cinéma, cuisines ordinaires transformées en cuisines violentes par un déchaînement féminin qui se libère de lʼimpératif de douceur et de soin habituellement associés à la maternité.

Dans Kill Bill (2003), Beatrix Kiddo tue Vernita Green au milieu des céréales du petit-déjeuner dispersées sur le carrelage de sa cuisine -— puisquʼelle avait dissimulé dans les Kellogs de sa fille une arme à feu. Dans Mr. & Mrs Smith (2005), Angelina Jolie possède une cuisine high-tech, dans laquelle sont dissimulés, derrière les surfaces des fours, de véritables arsenaux, entre couteaux de chasse et fusils dʼassaut (fig. 26). fig. 0.26 : Dans Mr. & Mrs Smith (Liman, 2005), Brad Pitt et Angelina Jolie jouent deux espions qui se dissimulent réciproquement leur identité d’espion·ne en jouant au/à la parfait·e époux·se. Jolie posède une cuisine hi-tech, dont les surfaces dissimulent un arsenal. Dans le Serial Mom (1994) de John Waters, Katharine Hepburn décide de tuer quiconque oublie les politesses élémentaires dʼun bon voisinage : une de ses victimes est tuée avec des ciseaux de couture, quand lʼautre finit assommée par un gigot dʼagneau (fig. 0.27).
fig. 0.26 : Dans Mr. & Mrs Smith (Liman, 2005), Brad Pitt et Angelina Jolie jouent deux espions qui se dissimulent réciproquement leur identité d’espion·ne en jouant au/à la parfait·e époux·se. Jolie posède une cuisine hi-tech, dont les surfaces dissimulent un arsenal. Dans le Serial Mom (1994) de John Waters, Katharine Hepburn décide de tuer quiconque oublie les politesses élémentaires dʼun bon voisinage : une de ses victimes est tuée avec des ciseaux de couture, quand lʼautre finit assommée par un gigot dʼagneau (fig. 0.27).  fig. 0.27 : Dans Serial Mom (Waters, 1994), Katharine Hepburn tue ses voisins avec les outils de la parfaite femme au foyer, dont un gigot d’agneau.Même dans le Halloween (1978) de John Carpenter, Jamie Lee Curtis qui nʼest pas encore inscrite dans le programme dʼaction de True Lies (1994) invente le rôle de scream queen et se défend bec et ongles contre Mike Myers, mais toujours avec les outils de la bonne ménagère (une aiguille à tricoter, un cintre, fig. 0.28). Autrement dit, même en lʼabsence dʼune véritable «  scène en cuisine  », la vie domestique et ses menus travaux semblent hanter ces femmes qui sʼessaient par ailleurs à une véritable expérience de la violence (puisquʼelles se défendent, mais aussi, et souvent, tuent). Si, dans les années 2010–20, la présence au cinéma de femmes violentes pose moins question, il nʼest pas rare de recroiser ce motif de la ménagère découvrant sa propre violence intérieure : dans la série Orphan Black (2013 -), Alison Hendrix, pourtant simple femme au foyer, séquestre son propre mari en le menaçant avec un pistolet à colle, sorti de son nécessaire à scrapbooking65 (fig. 0.29).
fig. 0.27 : Dans Serial Mom (Waters, 1994), Katharine Hepburn tue ses voisins avec les outils de la parfaite femme au foyer, dont un gigot d’agneau.Même dans le Halloween (1978) de John Carpenter, Jamie Lee Curtis qui nʼest pas encore inscrite dans le programme dʼaction de True Lies (1994) invente le rôle de scream queen et se défend bec et ongles contre Mike Myers, mais toujours avec les outils de la bonne ménagère (une aiguille à tricoter, un cintre, fig. 0.28). Autrement dit, même en lʼabsence dʼune véritable «  scène en cuisine  », la vie domestique et ses menus travaux semblent hanter ces femmes qui sʼessaient par ailleurs à une véritable expérience de la violence (puisquʼelles se défendent, mais aussi, et souvent, tuent). Si, dans les années 2010–20, la présence au cinéma de femmes violentes pose moins question, il nʼest pas rare de recroiser ce motif de la ménagère découvrant sa propre violence intérieure : dans la série Orphan Black (2013 -), Alison Hendrix, pourtant simple femme au foyer, séquestre son propre mari en le menaçant avec un pistolet à colle, sorti de son nécessaire à scrapbooking65 (fig. 0.29). 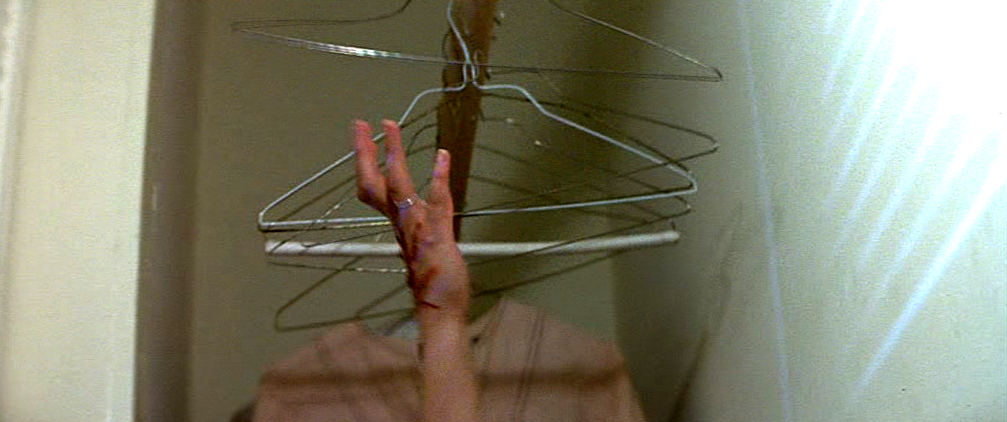 fig. 0.28 : Jamie Lee Curtis se défend dans Halloween (Carpenter, 1978) contre Mike Myers avec ce qu’elle peut : une aiguille à tricoter ou encore un cintre.
fig. 0.28 : Jamie Lee Curtis se défend dans Halloween (Carpenter, 1978) contre Mike Myers avec ce qu’elle peut : une aiguille à tricoter ou encore un cintre. fig. 0.29 : La série Netflix Orphan Black réactualise le motif de la femme au foyer pleine de ressources qui utilise ses outils de mère parfaite pour tuer : le personnage utilise ici ses fournitures de scrapbooking pour menacer son mari.Enfin, même quand les femmes possèdent des pouvoirs hors du commun, il nʼest pas rare quʼelles décident de se contenter de la cuisine. Dans Hancock (2008), les spectateurices découvrent au cours du film que lʼépouse dʼun des deux personnages principaux (un homme ordinaire) est en fait une super-héroïne vieille de trois mille ans, qui a choisi une vie simple et sans exploit. Elle va même jusquʼà feindre de ne pas savoir ouvrir les pots de confiture, alors quʼelle est capable de soulever des voitures. Cʼest bien sà »r en cuisine que le personnage de Hancock la teste pour découvrir sa vraie nature : il sʼemploie ainsi à lui planter une fourchette dans lʼépaule et à lui donner (dans une inversion intéressante du motif de la mégère) des coups de rouleau à pâtisserie (fig. 0.30).
fig. 0.29 : La série Netflix Orphan Black réactualise le motif de la femme au foyer pleine de ressources qui utilise ses outils de mère parfaite pour tuer : le personnage utilise ici ses fournitures de scrapbooking pour menacer son mari.Enfin, même quand les femmes possèdent des pouvoirs hors du commun, il nʼest pas rare quʼelles décident de se contenter de la cuisine. Dans Hancock (2008), les spectateurices découvrent au cours du film que lʼépouse dʼun des deux personnages principaux (un homme ordinaire) est en fait une super-héroïne vieille de trois mille ans, qui a choisi une vie simple et sans exploit. Elle va même jusquʼà feindre de ne pas savoir ouvrir les pots de confiture, alors quʼelle est capable de soulever des voitures. Cʼest bien sà »r en cuisine que le personnage de Hancock la teste pour découvrir sa vraie nature : il sʼemploie ainsi à lui planter une fourchette dans lʼépaule et à lui donner (dans une inversion intéressante du motif de la mégère) des coups de rouleau à pâtisserie (fig. 0.30). fig. 0.30 : Dans Hancock (Berg, 2008), le personnage éponyme interprété par Will Smith l’ignore, mais il est un héros agé de plusieurs millénaires. Plus étonnant encore, la femme de son impresario est elle aussi un héros immortel, qui fait mine de ne pas pouvoir ouvrir les pots de confiture pour préserver son secret.
fig. 0.30 : Dans Hancock (Berg, 2008), le personnage éponyme interprété par Will Smith l’ignore, mais il est un héros agé de plusieurs millénaires. Plus étonnant encore, la femme de son impresario est elle aussi un héros immortel, qui fait mine de ne pas pouvoir ouvrir les pots de confiture pour préserver son secret.
La cuisine, bien loin des champs de bataille, des buildings pris en otage ou des catastrophes naturelles qui constituent le décor habituel des films dʼaction, poursuit donc tout personnage féminin qui voudrait sʼessayer à faire «  comme les hommes  ». Ce retour ne sʼeffectue pas sur le mode de lʼassignation, ou en récompense du service rendu ; les héros féminins inventent et négocient plutôt avec ce pénible héritage,qui les limite, mais leur fournit aussi des clés pour naviguer, circuler, se réinventer. Dans un premier temps, jʼai donc été intéressé par lʼanalyse de Chris Holmlund des films Basic Instinct (1992) et Fried Green Tomatoes (1991). C. Holmlund explique que lʼusage respectif dʼun pic à glace et dʼune poêle pour commettre les meurtres dans les deux films solidifie lʼidée que la place des femmes est à la cuisine (1994, 32). Pour ma part, jʼai vu dans la découverte dʼun programme dʼaction en cuisine par des femmes une inspiration pour penser la versatilité et la puissance du lieu. Certes, la housewife hante le héros féminin ; mais cela est-il nécessairement une mauvaise chose ?

Dans un épisode récent de la série The Walking Dead (2010 -), le personnage tragique de Carol rencontre de manière intéressante le fantôme de la domesticité. La scène a pourtant lieu dix ans après une apocalypse zombie qui a ravagé le monde ; Carol y a perdu sa fille, et elle a muté de mère nourricière (et soumise aux coups de son mari) en tueuse solitaire et invincible. Cependant, elle revient ponctuellement à une vie plus calme en rencontrant un nouveau compagnon, Ezekiel, et en adoptant un enfant, quʼelle perdra aussi. Lors dʼune énième mission dans un bâtiment désaffecté, Carol, qui tient le choc de la perte de son enfant grâce à des médicaments, tombe sur un ouvrage situé dans les décombres : il sʼagit dʼun guide dʼéconomie domestique, Working from the Home: An Intro to Home Economics (fig. 0.31). Si lʼouvrage semble fictif, il constitue un vrai temps dʼarrêt dans la scène. Carol est interdite devant le livre, elle le tourne et le retourne, jusquʼà ce que la housewife qui figure sur la couverture avec sa petite famille parfaite finisse, dans une hallucination, par prendre ses propres traits. Si cette illusion sʼexplique ici par la prise de drogues, lʼimage rejoue ce trope bien connu de la femme dʼaction poursuivie par la domesticité. Jʼutilise le lexique du fantôme pour parler de ces représentations à dessein : les housewives qui apparaissent dans ces fictions ont une dimension spectrale, tel lʼange de maison que Woolf décrivait dans son célèbre texte (1929). On en croise aussi une variante postmoderne dans la description que donne Paul B. Preciado de la bourgeoise milanaise qui, dans un mouvement inverse, se souvient avoir été «  soldat et […] esclave sexuel dans lʼarmée de Résistance du Seigneur ougandais  » (2019, 189). P. B. Preciado argumente en effet que le monde peut être vu comme «  une compagnie de théâtre qui compterait un peu plus de 7,3 milliards dʼêtres humains  » (2019, 188) et dans lequel les rôles seraient échangeables et réversibles. Il décrit un mouvement qui nʼest pas sans rappeler le spectre invoqué par le guide dʼéconomie domestique de The Walking Dead : «  Un beau jour, alors quʼelle dégusterait une tranche de panettone avec un verre dʼasti spumante, lui reviendraient en tête quelques images de son ancien rôle : elle se souviendrait des scènes de massacre dans un camp de réfugiés soudanais […] Aujourdʼhui pleinement installé (sic) dans son rôle de milanaise, elle irait chercher un ibuprofène et un relaxant musculaire dans son armoire à pharmacie, puis sʼallongerait sur le sofa du salon, en attendant que ces souvenirs sʼestompent comme sʼils avaient été rêvés  » (Preciado 2019, 189).
Le guide dʼéconomie domestique de Carol, comme la rêverie de P. B. Preciado sur le soldat soudanais hantant la bourgeoise milanaise nous incitent à considérer autrement la question de lʼaction violente féminine. Si la plupart des films que jʼai cités montrent comment une femme dʼaction doit composer avec sa part domestique, le motif se retourne comme un gant pour nous révéler la part de violence déjà située dans la vie domestique. Du reste, dans les films dʼaction centrés sur un héros masculin, la violence est souvent comprise comme nettoyage66 : le héros, par les explosions quʼil déclenche ou dont il est victime, participe dʼune culture de la table rase (quand bien même, politiquement, la plupart des actioners des années 1980 se livrent à un tel exercice pour mieux maintenir le statu quo). La carrière dʼArnold Schwarzenegger peut se lire comme un vaste programme de nettoyage, puisquʼil utilise transporteurs et machine-outil pour faire place, vider lʼespace de ses constructions et de ses menaces ; il est dʼailleurs significatif quʼil ait joué dans un film nommé Lʼeffaceur (1996 ; Pandelakis 2013, 220–228). Autrement dit, les femmes héros de films dʼaction investissent un espace domestique qui est déjà violent (puisque lʼon parle bien de violences domestiques), mais peuvent aussi mobiliser des techniques (cuisine, nettoyage, etc.) qui ne sont même pas une forme de hacking. Samantha Caine, en utilisant une tarte au citron pour tuer, nʼaccomplit pas un geste absurde ; elle révèle la profonde réversibilité et fluidité des outils de la housewife. Ce principe est radicalisé dans Mr. & Mrs. Smith, puisque la cuisine dʼAngelina Jolie est conçue pour dissimuler les outils les plus destructeurs, par un jeu de surfaces occultantes et dʼescamots : le lisse du plan de travail et des placards dissimule tout un univers brutal. Cʼest ici quʼun fort lien au design me semble émerger, avec la question : peut-on imaginer des cuisines mobiles, fluides, paradoxales et inquiétantes, qui préparent en toute discrétion la libération de celles que le dispositif était censé enchaîner ? La cuisine hante les femmes, mais si la cuisine peut être réinvestie, retrouvée, revendiquée, redessinée… faut-il sʼen inquiéter, ou plutôt considérer quʼelle nʼest plus un espace univoque dʼoppression ?
Commencer un projet devrait toujours nous obliger à reposer la question : «  comment commencer un projet ?  ». Cʼest en tout cas la première pierre, à défaut de chemin, à laquelle nous renvoie Edward Said dans Orientalism (2003[1978]), un des ouvrages dont le questionnement méthodologique peut sembler bien éloigné dʼune recherche en design -— et pourtant :
[…] il nʼexiste rien de tel quʼun point de départ donné, ou simplement disponible : les commencements doivent être façonnés pour chaque projet, de telle manière à faire place à ce qui découle dʼeux67 (Said 2003[1978], 16).
Said sʼemploie ensuite à circonscrire son projet : après avoir établi quʼun travail encyclopédique sur lʼorientalisme est «  absurde  »68 (ibid.), il retire de la matière à son projet, à partir dʼune «  masse  » («  mass  ») par laquelle il admet être intimidé. Il est peut-être étonnant dʼamorcer une recherche de design en allant chercher mes outils chez un philologue. Pourtant, il est dans la tradition même de la recherche en design dʼhybrider ses méthodes. Presque comme le queer, qui résiste aux limitations de la définition, cette «  discipline  » du design travaille à sʼindiscipliner (Assouly 2006 ; Krippendorf 2006, 210 ; Mareis 2023, 33). Elle est impure ou peut-être définie par une absence de centre, qui lʼincite à se poser comme «  métadiscipline  » (Dautrey 2014, 236). Le design se cristallise en effet à lʼorée de la modernité69, au croisement des héritages des arts plastiques, des arts décoratifs, de lʼarchitecture. Il entretient une relation complexe avec la «  société industrielle  », au sein de laquelle il trouve sa «  possibilité  » (Huyghe 2018[2015], 17). Théoriser en design peut consister à croiser les outils de la philosophie, de lʼhistoire de lʼart, et depuis plus récemment ceux du cinéma (comme lʼa préconisé Alexandra Midal, ou comme je lʼai expérimenté avec mes camarades dans le projet CinéDesign70). Il semble dès lors difficile de ne pas parler de transdisciplinarité. Cependant, une distinction me semble importante, au regard du fil historique évoqué ci-dessus : le design, dans son impureté, ne participe pas dʼune transdisciplinarité ; il est lui-même une transdiscipline, cʼest-à -dire une discipline définie par un mouvement perpétuel de recherche de sources, dʼidées, de concepts qui lui sont extrinsèques -— comme les études queer et de genre, du reste. Poreuse à ses disciplines cousines, le design, en tant que discipline académique, combine une connaissance du projet comme méthode et une appétence pour la recherche (sous toutes ses formes) qui la rapproche en apparence de la recherche-création.
Mon étude nʼest pas une recherche-création. Cette expression désigne une recherche qui ne se matérialiserait pas seulement par un écrit théorique, mais aussi par une production et surtout par lʼarticulation singulière entre les deux : à ce titre, le trait dʼunion qui relie recherche et création est «  salvateur  » (Viguier & Virion 2024, 36). Ce nʼest pas lʼidée dʼune recherche biface qui me rebute, mais plutôt le concept de création, qui me semble décalé par rapport à mes objectifs, et peut-être à ceux de la discipline du design pour une grande partie. Lʼobjet des designers nʼest pas de créer, cʼest-à -dire de produire une forme ex nihilo, quoiquʼon puisse aussi objecter quʼaucune forme ne naît jamais de rien, par définition. Mais la distinction se situe ici : læ designer projette, cʼest-à -dire que iel sʼinsère dans une réalité (le monde réel cher à Victor Papanek, ou dʼautres mondes alternatifs) qui lui préexiste, lʼanalyse, sʼy frotte, sʼy perd peut-être (ou selon les mots de Pierre-Damien Huyghe, se «  dérout[e]  »â€¯; 2020[2015], 95), et y développe une série dʼhypothèses visant à sʼinsérer dans la situation donnée, et dans les problèmes quʼelle pose. Un exemple donné par Lucius Burckhardt dans Le design au-delà du visible (1991) permet de mieux comprendre la distinction. Le sociologue et économiste évoque ainsi une intervention de Christopher Alexander sur une situation banale, exemplaire de celles auxquelles sʼattellent les designers : des personnes patientent à lʼarrêt de bus, attendant quʼil passe. Près du bus, se trouve un distributeur à journaux, où les usager·es peuvent acheter leur périodique pour tromper lʼennui. Encore faut-il que le dispositif rende la monnaie, et ce, de façon rapide, afin que les passager·es ne ratent pas ledit bus. Mais Burckhardt se méfie de la «  pulsion design  », cʼest-à -dire du désir dʼintervention quʼengendre la situation. Il écrit donc :
Mais nous, nous nous immisçons dans le système : nous proposons de le simplifier en ramenant le prix des journaux à des sommes rondes ou bien en lançant des cartes dʼabonnement quʼil suffit de présenter au marchand de journaux – un arrangement, en tout cas, pour cette institution quʼest la distribution des journaux et des imprimés (1991, 18).
Cet «  arrangement  », qui nʼest pas un refus de faire, est au cÅ“ur de la logique de conception, et non de création, des designers. Parfois, le meilleur geste est celui qui consiste à infléchir un prix, plutôt que dʼimaginer les mécanismes compliqués dʼun distributeur de monnaie. Les designers ne devraient donc pas systématiquement viser à créer quelque chose qui nʼétait pas là , mais plutôt à prendre en compte une situation, en trouvant le moyen le plus juste – même si ce moyen, in fine, ne leur fait pas dessiner de nouvel objet, espace ou signe ou les fasse dessiner dʼune manière plus discrète que celle que lʼon attend dʼeux.
De plus, le concept de «  création  » est facilement associable à celui, aujourdʼhui dévoyé, de «  créativité  », lui-même souvent relié à lʼinjonction contemporaine à lʼinnovation (Masure, 2016). Lʼinjonction à lʼinnovation et à la créativité vont effectivement de pair, et répondent dʼune idéologie du potentiel individuel, qui incite les sujets à «  pren[dre] leur destin en main  » (Masure, 2016). Le chercheur en design Anthony Masure évoque ainsi les mots de László Moholy-Nagy en 1947, et rappelle que le design sʼinsère entre art et industrie pour penser les relations entre ces domaines, pour montrer ensuite que, dans le contexte dʼun design récupéré par la pensée managériale, la relation sʼhorizontalise et que le potentiel critique de la discipline sʼestompe et disparaît. Oli Mould ne dit pas autre chose dans son Against Creativity (2018). En sʼattaquant aux écrits de Richard Florida qui vante lʼémergence dʼune classe créative («  creative class  »), O. Mould met en évidence la manière dont le concept transversal et vidé de son sens de «  créativité  » permet en réalité dʼassouplir le code du travail au bénéfice des seuls acteurs économiques dominants. Le géographe pose ainsi quʼil «  est devenu clair que la rhétorique du travail créatif est simplement une ruse qui permet à des pratiques ‹ de lʼordre du travail › dʼenvahir nos vies sociales, nos vies de loisir, nos vies non-économiques  »71 (2018, 26). Plus loin, lʼauteur montre comment, dans des projets liés aux politiques publiques, la rhétorique de la créativité devient un outil du capitalisme managérial, et une manière dʼaugmenter la pression sur les services publics et leurs employé·es déjà au bord du burn out. Que ce soit dans la réforme de la NHS (lʼassurance maladie britannique) ou dans les bibliothèques (96–98), les politiques dʼaustérité en Angleterre ont valorisé la «  créativité  »â€¯; souvent, elle sʼincarne sur le terrain par la mise en compétition des ressources, y compris humaines. Les choses ne sont pas très différentes dans lʼuniversité française, qui par une suite de réformes, depuis la LRU (2007) jusquʼà la LPR (2020), instaure un financement conditionnel de la recherche évaluée en termes «  dʼexcellence  », elle-même souvent synonyme dʼune «  innovation  » aux critères à la fois serrés et flous, qui cadenassent la force de proposition des chercheur·ses, surtout en Arts, Lettres et Langues. Ainsi, je défendrai une recherche-projet en design, située, qui évalue sans cesse les rapports de pouvoir dans lesquels elle sʼinsère, qui prend acte des contradictions et paradoxes surgissant à lʼanalyse, et qui peut-être renonce à «  créer  » quoi que ce soit si ce nʼest pas la réponse la plus pertinente.
Si la question de la singularité de la recherche-création est utile, ou sʼil importe de comprendre comment la recherche dialogue avec la création dans certaines disciplines, il apparaît que dans le contexte du design ce lien nʼest pas à faire. Lʼeffort de théorisation souffre même, dʼune certaine manière, de ce que le lien soit déjà fait. Le design, comme discipline, fait donc plutôt face au dilemme consistant à dissocier des actes et des manières de faire qui sont étroitement liés dans leurs fondements. Au cÅ“ur de la recherche en design, on rencontre le projet (Mareis 2023[2014], 46), qui relève dʼabord dʼune attitude, comme je lʼai relevé chez Burckhardt et comme Moholy-Nagy le pensait avant lui (1947 ; Huyghe 2020[2015], 95). En voici à présent quelques composantes : la pratique de projet, cʼest lʼanalyse dʼun contexte, qui peut fonder la production ou en être le seul matériau. Cʼest le cas dans lʼ«  enquête-création  », qui est selon Nicolas Nova une forme de plus en plus fréquente aujourdʼhui des travaux de designers (2021, 21). La pratique de projet, cʼest donc lʼobservation, par laquelle les designers développent une proximité avec des besoins, mais aussi lʼanalyse culturelle dʼune époque, dʼun lieu, dʼun ou plusieurs groupes humains, des relations en place ; cʼest la divergence qui repose sur le foisonnement des hypothèses, tantôt verbales, tantôt dessinées, grâce à une démarche rigoureuse mais aussi à une part dʼintuition. Cʼest lʼaller-retour entre proposition et expérience, le test par le biais de la maquette dʼintention ; la finalisation et la pratique en atelier, la connexion à lʼindustrie, à lʼartisanat, au faire. Tout ceci participe de la pratique du projet, dʼune culture du projet. Cʼest avec cette posture que jʼentre dans le «  sujet  » des cuisines, que la culture du projet mʼinvite plutôt à considérer comme un contexte, un déjà -là .
On aura compris que ce projet-là a peu de choses en commun avec le «  projet  » dont la novlangue managériale se repaît. Pour autant, puis-je affirmer que le parcours que je propose relève de la recherche-création, ou même de la recherche-projet, si lʼon tient à se distinguer des autres arts ? Je ne vais pas ici proposer de plan de cuisine, de maquette de mobilier ou même dʼexposition (comme je lʼaurais pourtant souhaité, à un moment de cette recherche). La forme première de ce travail tient dans un livre imprimé, et dans le site Web qui en constitue la matière. Sa matière iconographique et les assemblages dʼimages parfois distantes sont aussi importants que le propos théorique en tant que tel. Au premier abord, mon travail de recherche en design sera donc plus immédiatement lisible comme théorie du design. En lʼabsence de projet «  concret  », du type même que mes collègues et moi-même demandons aux étudiant·es du master DTCT72, on pourrait donc ranger ce volume dans la catégorie «  théorie  », et cela serait sans doute assez cohérent. Toutefois, cet écrit entend sʼinscrire comme recherche en design, et pas seulement en théorie du design, dans lʼesprit des propos de Nigel Cross qui parle de «  manières de connaître par le design  » («  designerly ways of knowing  »)73 (Cross 2006, 54). Le travail dʼaccumulation dʼimages, et cette relation créative à lʼiconographie débordent déjà le seul champ de la théorie. La fabrication de dessins, de cartes, de cahiers dʼimages, au fil de la recherche me conduisent à me revendiquer, plutôt que dʼune recherche-projet (puisque la matérialisation de mon travail reste un peu en deçà ), dʼune pratique de la théorie en designer.
Enfin, il existe presque toujours dans un projet de recherche une dimension absurde, impossible. La tâche (universitaire comme domestique) apparaît comme trop importante, massive. Elle demande quʼon fasse place, voire, quʼon fasse le ménage dans les idées et les concepts. Cʼest aussi tout lʼenjeu de la méthodologie dessinée que jʼutilise en relais des outils théoriques classiques. Le geste de la carte de recherche fabrique aussi cette place. Tracer, cʼest mettre en évidence des blancs, des espaces, les lieux de lʼincertitude. Sur la carte géographique descriptive, les zones où le texte sʼétale sont aussi les zones où la ligne, et donc le dessin du territoire, doit sʼarrêter. Le dessin sert donc à la fois à délimiter, à accepter les zones blanches, et à fabriquer ses propres points aveugles74. Définir une recherche par ses vides, ses trous, est aussi une manière de queeriser la recherche.
Si «  le queer  » fait sujet (personnes queer, esthétiques du trouble, etc.), il engage aussi tout un héritage méthodologique, souvent étasunien, aujourdʼhui largement international. La pensée queer inaugurée nommément par Teresa de Lauretis, largement représentée par les travaux de Judith Butler, puise ses sources dans la french theory et son approche post-structuraliste (Foucault, Deleuze, Derrida). Depuis, de nombreux·ses auteurices se sont demandé comment théoriser de manière queer, puisque penser des thèmes ou idées queer avec des outils de pensée traditionnels constitue potentiellement une contradiction, habilement résumée par Audre Lorde lorsquʼelle indique quʼil est impossible de démonter la maison du maître avec les outils du maître (2018[1984], 16). Ici, une première masse textuelle émerge : quels textes choisir, pour penser le queer ? Il me semble que si lʼon admet que ce terme est dʼabord une manière de signaler le désir dʼune théorie faite acte, il ne peut y avoir de travail queer, ou sur le queer, qui ne produise sa propre définition du terme et de la méthodologie associée. Queeriser, cʼest sans cesse repenser les frontières mouvantes de ce que peut être le queer : en tant que «  théorie des anormaux  » (Preciado 2019, 103), la théorie queer invite à penser anormalement, en anormalité. Jack Halberstam décrit une telle méthodologie, qui se définit, quoique pas définitivement ou essentiellement, par une forme dʼhybridité :
Une méthodologie queer, dʼune certaine manière, est une méthodologie de fouille qui utilise différentes méthodes pour collecter et produire de lʼinformation sur des sujets qui ont été délibérément ou accidentellement exclus des études traditionnelles du comportement humain. La méthodologie queer tente de combiner des méthodes qui sont souvent présentées comme étant en contradiction, et elle refuse la pulsion académique qui vise la cohérence disciplinaire (1998, 13)75.
Penser en queerisant revient donc à sʼinstaller dans une forme dʼinconfort. Et si le sujet doit faire masse, notamment ceux du sexe et du genre, cʼest que le regard de recherche queer, celui qui émerge lorsquʼon «  chausse[…] des lunettes queer  » (Cervulle 2008, 14) fabrique lʼinfini de son sujet, en tisse la masse. Cʼest ce que suggère Halberstam, en lʼembrassant plutôt quʼen le fuyant, lorsquʼil nous invite «  à penser en termes de fractale et de géométries du genre  »76 (1998, 21) -— autrement dit, lʼespace à cartographier est infini, il foisonne à partir de motifs reconnaissables peut-être, mais prolifère et se multiplie. Libérée de la désirabilité du neutre et de lʼuniversel (encore quʼil soit important de ne pas y renoncer tout à fait ; Haraway 1988), la pensée queerisée accepte aussi bien de trouver dans ses objets ce qui est queer, comme de constituer en leur cÅ“ur des espaces queer. Les lunettes permettent la reconnaissance dʼun détail jusque là ignoré et, sans doute, des déformations : la pensée queer se distingue dans lʼattitude quʼon adopte avec elles, qui consiste à les trouver bienvenues.
Queeriser la méthodologie peut donc queeriser le sujet, ses contours -— mais avec quels outils aborder la question de lʼaménagement des cuisines et de son lien avec la domesticité comme creuset des normes sociales et de leur réinvention ? La relation à lʼuniversité (et la «  pulsion académique  » quʼelle peut fabriquer chez læ chercheur·se) produit en effet un ensemble de normes dans lʼapproche des savoirs et normalise les questionnements et leurs conclusions. Jʼen distinguerai deux dimensions : le format et le savoir universitaire, qui sont comme deux facettes dʼune même pièce.
Le format universitaire, avec lʼobligation de citation, les normes bibliographiques associées, la rhétorique argumentative, la méthodologie de la démonstration, et les règles de publication (lecture par les pair·es en double aveugle, par exemple) constituent un ensemble qui est garant de la rigueur scientifique. Cette liste de normes, non exhaustives, fait partie des outils que jʼai appris à manier à lʼuniversité, et qui constituent mon cadre habituel de pensée. Cependant, il me semble important de visibiliser, en même temps que ces outils, leurs effets sociaux et plus précisément leurs effets professionnels : sʼil est bien reçu et validé, sʼil correspond formellement et conceptuellement aux attentes de lʼacadémie, cet écrit me fera accéder à une Habilitation à Diriger des Recherches (donc la capacité à encadrer des thèses universitaires), qui elle-même pourra me donner accès à une qualification en tant que Professeur des universités, pour enfin, peut-être, accéder à un poste de Professeur, et aux reconnaissances sociale, académique et salariale associées. Sʼil peut sembler curieux, voire un peu «  meta  » dʼévoquer dans un texte ses effets socio-professionnels, cela me semble, étant donné mon approche, inévitable77. Comment queeriser une approche, faire plier les normes de pensée, quand lʼécrit qui sʼengage, quand bien même il ne se donne pas ce seul but, aura peut-être pour résultat dʼêtre apprécié comme document normé témoignant de ma capacité à rejoindre une classe sociale dite des «  professions intellectuelles supérieures  », en parlant justement de femmes qui, parce quʼelles restent «  à la maison  », nʼaccèderont jamais à ce statut, cantonnées à celui de la «  ménagère de moins de cinquante ans  », en dépit de la richesse de leurs idées ?
Il existe donc une attente quant au contenu, mais peut-être plus encore vis-à -vis de choses qui ne doivent pas se trouver dans un travail de cette nature. Dans un travail universitaire, on ne parle pas de soi, on ne parle pas de lʼacadémie elle-même, on ne parle pas de ce qui entoure le texte. Pour bien faire, il faudrait donc que jʼévite de parler de ma propre progression professionnelle, ou encore du processus de transition de genre qui est le mien depuis 2016. Jʼen parlerai, et je parlerai peut-être aussi à dessein de choses anecdotiques, marginales, méprisées -—  parce que ce sont elles quʼon trouve dans les cuisines. Et si je définis ce «  queer  » plusieurs fois, de multiples fois, même, à de nombreux carrefours de cet écrit, il me faut aussi imaginer, simplement, quʼune méthodologie queer peut inclure si nécessaire ce quʼon ne pensait pas trouver dans un écrit universitaire. Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha écrit quelques lignes qui me semblent instructives à cet égard, dans son propre ouvrage qui mêle théorie crip et conseils pratiques pour ne pas vomir dans le bus, lorsquʼon est une chercheuse indépendante désargentée qui sillonne les États-Unis :
Un travail culturel sérieux nʼest pas censé inclure une liste de produits sans parfum pour les cheveux bouclés, ou des instructions pour faire une tournée en étant malade mais sans trop souffrir, pas vrai ? Mais – rien à foutre78 (2018, 23).
Ce texte nʼest pas un texte, cʼest un futur livre, et en tant que chercheur en design, je me dois dʼimaginer quel genre de livre il sera, sur quelles tables, bureaux, sièges de bus ou de train il trouvera sa place. Je le fais à lʼimitation de Rosi Braidotti qui, dans son Portable Rosi Braidotti (2012), pense le format de son livre : un livre portable, un guide que lʼon peut emmener avec soi, un livre qui prenne place dans la vie, idéalement, aussi photocopillable quʼun livre de bell hooks. Ce livre, quand bien même il est trop gros (je le pressentais en 2018 et cʼest à présent confirmé), pour être aussi portable que celui de R. Braidotti, se donne dans cette annonce méthodologique un objectif : rester lisible. Il ne sʼagit pas de briser les normes pour le plaisir, mais de vérifier, à chaque instant, que mes étudiant·es pourront lire ce livre, ou au moins des fragments. Sʼinterrogeant sur les objectifs et la valeur de son travail, R. Braidotti demande à ses concepts sʼils sont «  fun ?  »79. Cʼest en effet une question trop souvent écartée des textes de recherche. Jʼaimerais que lʼon puisse sʼamuser, en lisant ce texte : non parce que cela permet (perspective utilitariste) de mieux apprendre, mais tout simplement parce que la pensée ne gagne rien à être isolée des plaisirs.
Voici donc pour lʼattitude ; reste à préciser la teneur exacte des sources que je vais mobiliser. À ce sujet, mon approche est résolument éclectique. Jʼai tendance à mobiliser des sources issues dʼune variété de disciplines, de contextes et de pays (malgré une certaine domination des sources étasuniennes). En cela, jʼapplique la méthode de lʼenquêteurice décrite par Nicolas Nova (2021) au niveau de lʼépistémologie. Comme les designers évoqués par N. Nova, je «  ratisse large  » (2021, 32) quitte à ce que certains rapprochements paraissent imprévus ou anachroniques. Une même approche caractérise la relation à mes objets dʼétude. En effet, ce travail repose également sur une attitude analytique, déconstruisant les imaginaires portés par une image, un objet, un dispositif. Lʼanalyse se fera comparative, et jʼeffectuerai des rapprochements entre des objets apparemment éloignés pour déceler des résonances. Lʼidée nʼest pas tant de comprendre lʼobjet de lʼanalyse en lui-même que de réinscrire, à la manière du Mnémosyne dʼAby Warburg les objets culturels (dont font partie les productions du design) dans un écosystème large dʼidées, gestes et paroles. Comme Warburg, du reste, je mobilise souvent des publicités qui me semblent intéressantes, dès lors quʼelles concrétisent de manière simple, reconnaissable, et avec une ambiguïté minimale, les mythes dʼune époque. Cʼest en cela quʼun regard de cartographe me semble tout indiqué : parce que la cuisine est un espace qui déborde ses propres murs, et sʼinvite sous de foisonnantes incarnations, queer et fractales.
Il me faut parler des outils de pensée eux-mêmes. Les écrits de Donna J. Haraway sont essentiels à plus dʼun titre : pensée féministe de la technologie, méthode des «  jeux de ficelle  » (2020[2016]) et exigence dʼune épistémologie située, quoique non absolutisée, font partie des apports qui vont mailler cet écrit. Du côté de la philosophie, je mʼappuierai également sur les travaux de Paul B. Preciado car sa méthodologie hybride, qui fait aussi bien la part du texte que de lʼimage, saisit des pistes queer dans des situations dʼusage, des actes, des gestes -— ce qui est précieux pour une recherche en design. P. B. Preciado est un des rares auteurs à articuler design, pensée du genre, des sexualités et des corps. Je lui emprunterai notamment son appréhension de problèmes socioculturels par le biais de la «  clé culturelle  »80 (2011[2010], 19), ce quʼon retrouve dʼailleurs dans le champ plus large des études culturelles, qui reste au fondement de mes propres travaux. Par ailleurs, les concepts de pharmacopornographie, la relecture du concept foucaldien de biopouvoir et lʼapproche de la politique du corps à travers des dispositifs du quotidien me seront précieux. Les outils apportés par Paul B. Preciado mʼaideront à penser les imaginaires de la domesticité, notamment avec son ouvrage Pornotopie (2011). Par ailleurs, jʼai déjà évoqué comment la philosophie, dont le travail de Sara Ahmed, me permettait de préciser lʼenjeu politique de mon travail : penser avec, dedans, jamais dans une position présupposée de surplomb.
Des appuis historiques seront indispensables pour évoquer lʼévolution de la conception des cuisines et le rôle attribué aux femmes dans leur aménagement. Je convoquerai tout particulièrement la somme de Dolores Hayden (The Grand Domestic Revolution, 1982) qui propose une critique de la privatisation et de lʼindividualisation du logis, et retraçant en contrepoint lʼhistoire oubliée des cuisines collectives et communales. Au sujet de la domesticité et du travail féminin en cuisine, il semble impossible de ne pas puiser dans le texte de Betty Friedan (The Feminine Mystique, 2013[1963]) qui a fondé une approche féministe du travail domestique des femmes. Cependant, jʼaurai à cœur de ne pas privilégier de facto ces textes pourtant célèbres et célébrés, mais de les lire à la lumière des critiques et réserves émises à leur égard par des autrices afroféministes comme bell hooks, tout en consultant des sources de théorie du design féministe (Buckley, Bonnevier). Cʼest aussi tout lʼenjeu de ce futur travail de cartographie : il ne sʼagit pas de solidifier des centres existants mais de travailler à les saisir immédiatement comme des points de vue partiels de la question quʼils sont censés épuiser. Jʼaurai donc recours à un corpus dʼouvrages féministes théorisant les fondamentaux du genre, des sexualités et de lʼoppression (Davis, hooks, Halberstam, Kosofsky Sedgwick, Preciado). Jʼutiliserai également des études plus spécifiquement dédiées au travail de service et la domesticité comme classe de travailleur·ses (Fraisse, Ibos, Anderson), que je mettrai en friction avec des études féministes matérialistes sur le travail (Jarrett, Federici, Gonzales & Neton) et des études sociologiques sur le partage des tâches (Singly et. al.). Je mʼattacherai également à convoquer des écrits dʼauteurices trans dont les points de vue créent de nouvelles lignes et des creux puissants dans les fractales du genre (Halberstam, Preciado, Serrano, Faye, Long Chu).
Je convoquerai également un corpus dʼouvrages de théorie du design (Huyghe, Nova, Mareis) et dʼhistoire du design (Brunet & Geel, Midal) qui connectent la discipline à des enjeux socioculturels larges en même temps que politiques – notamment ceux qui entourent lʼinstrumentalisation du design – de leur époque, en les associant à des travaux croisant design, féminisme et décolonialité (Kazi-Tani, White). Les ouvrages dʼarchitecture et de design portant spécifiquement sur la cuisine sont plutôt rares, mais ils existent, et il me faudra donc passer par le travail stimulant de Catherine Clarisse (Cuisine, recettes dʼarchitecture, 2004), dont le projet est à la fois extrêmement précieux sur le plan documentaire, mais aussi dans la méthodologie choisie, qui est celle de «  fiches-cuisines  » dédiées à des cuisines emblématiques dans lʼhistoire du design et de lʼarchitecture. Jʼévoquerai aussi le travail dʼhistorienne de Claire Leymonerie (Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (1945–1980), 2016), portant sur les objets industriels en France, et plus particulièrement lʼart ménager et ses salons, puisque la cuisine fait pour moi dispositif, dans le sens où un continuum se dessine entre ses murs et les objets qui lʼhabitent. Lʼouvrage dʼEllen Lupton, Mechanical Brides: Women and Machines from Home to Office (1993) me permettra également de comprendre le perfectionnement des objets du quotidien, et la manière dont ses logiques techniques influencent directement les usages propres à la domesticité et ses imaginaires, en prolongement dʼouvrages historiques de référence comme La mécanisation au pouvoir (1948) de Siegfried Giedion, que je revisiterai régulièrement dans ces pages. Ce «  livre de guerre comme dʼaprès-guerre  » (Brunet & Geel 2022, 92) permet de documenter lʼhistoire des cuisines modernes, en même temps que de balayer lʼidée dʼun progrès technique progressif, constant et univoque, en rendant visibles les remords, les détours et les contradictions dans lʼamélioration incrémentale des processus industriels.
Si je mobilise un très grand nombre dʼouvrages issus de disciplines aussi diverses que lʼhistoire, la littérature, les études culturelles, les humanités numériques, la philosophie, la sociologie, lʼanthropologie, la géographie, la théorie du cinéma et la théorie du design, je dois aussi, à défaut dʼun périmètre restreint, trouver un outil plus identifiable pour mʼorienter dans la masse de ce travail. Jʼai, en définitive, besoin moi-même dʼune boussole, et cʼest lʼouvrage de Giuliana Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (2002), qui me semble pouvoir jouer ce rôle. Dans ce travail, Bruno se donne pour objectif de rassembler des «  voyages intellectuels  » «  passant par la texture de [s]on corps  »81 (2002, 4). Ce «  voyage psychogéographique  » compose une cartographie dʼémotions à la manière de la Carte de Tendre, en confrontant des textes, films et Å“uvres dont les relations ne sont pas a priori évidentes. G. Bruno part dʼune histoire de la spatialité au cinéma, pour composer son ouvrage comme un bâtiment, une suite de pièces à habiter, dans lesquelles penser et méditer. Si lʼapproche générale de Bruno est un guide, le troisième chapitre de lʼouvrage mʼintéresse particulièrement en termes de méthodologie, puisquʼelle y questionne le concept de «  demeure  »82 en refusant la fixité que suppose le concept, afin de le lier à lʼidée de voyage et dʼerrance. Bruno explique dans cette partie de son travail (ou plus exactement, dans cette pièce de sa maison de pensée) quʼil est possible de déconstruire les dichotomies associées masculin-féminin et dehors-dedans, pour penser le domestique comme voyage, à travers des exemples cinématographiques. Dans ses analyses des films Now, Voyager (1942) et Craigʼs Wife (1936), Bruno expose la domus comme le lieu de «  nomadismes de genre  »83 (81) et rompt avec lʼidée dʼune domesticité opposée au voyage, grâce à la figure de la voyageuse, et de la maison comme voyage (86–87). Jʼutiliserai ces conceptions pour défaire les dichotomies que jʼai critiquées plus haut, et jʼadopterai plus globalement la méthode consistant à cartographier, parfois intuitivement une idée ou un concept, en rapprochant des objets hybrides, et en visitant les blancs qui les séparent. Chez Bruno, la pensée ne cherche pas à saisir lʼespace, mais plutôt à se spatialiser elle-même en manipulant ses objets. Bien que très différentes, les pensées de G. Bruno et P. B. Preciado se rejoignent aussi, dans la mesure où iels imbriquent leur cheminement théorique à une forme dʼautofiction84.
Je ne serai pas lʼobjet de ce livre, nʼétant pas moi-même housewife : mais, au fil de mes analyses, jʼessaierai de retrouver la piste de cette figure fantomatique, qui hante toute personne née sur les territoires féminins des cartes du genre. Lʼidée nʼest pas de placer fermement des épingles sur une carte, mais de la composer à mesure que jʼécris, de tracer des lignes. Comme lʼaffirme Rosi Braidotti, «  le challenge est de voir comment penser des process plutôt que des concepts  »85 (2012, 15). G. Bruno, comme R. Braidotti, mʼaideront donc à saisir des passages entre domesticité et non-domesticité, plutôt quʼà vouloir définir des concepts comme des zones étanches et sans point de contact. Cʼest même ce point de contact, cet espace liminaire quʼil me faudra considérer comme espace pourtant épais, à cartographier, un espace court, modeste, aussi restreint que celui qui sépare lʼévier du placard aux assiettes.
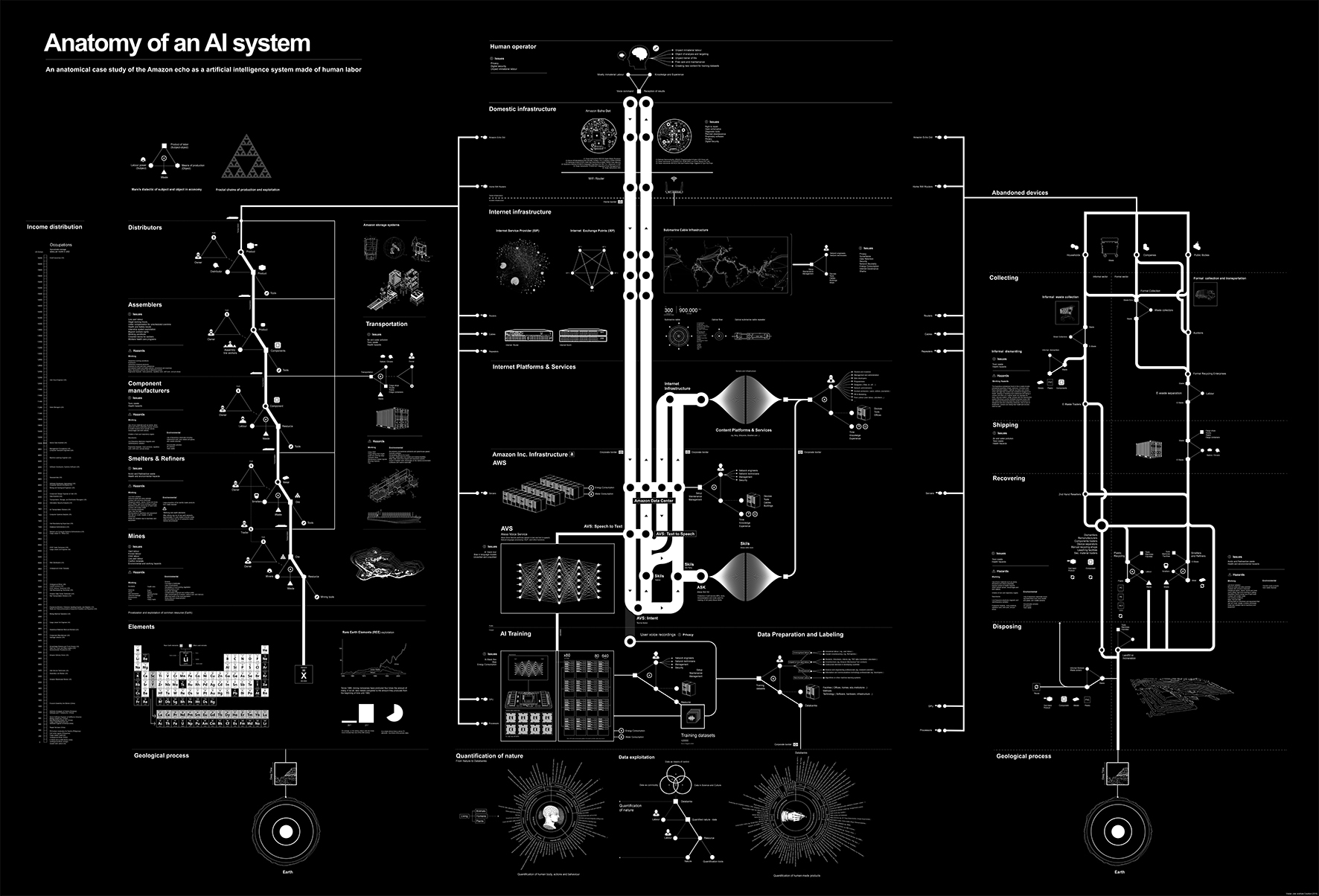
La carte Anatomy of AI (2018) de Kate Crawford et Vladan Joler me fournit un exemple ambitieux de ce vers quoi cette recherche tend. Sur cette carte (fig. 0.32) sont représenté·es lʼensemble des acteurs et actrices impliqué·es dans la création dʼune intelligence artificielle comme Amazon Echo, cʼest-à -dire un assistant vocal auquel demander de jouer de la musique, de donner le bulletin météo, etc. Cette carte ne se contente pas de lister des notions, mais elle reconstitue tout lʼécosystème technique, économique, social, politique et écologique qui est sollicité dans la production dʼun objet comme le Amazon Echo. Ce faisant, la carte constitue un élément de démonstration, puisquʼelle contredit lʼidée souvent invoquée dʼune «  dématérialisation  » ou dʼune «  virtualisation  » produite par le numérique.
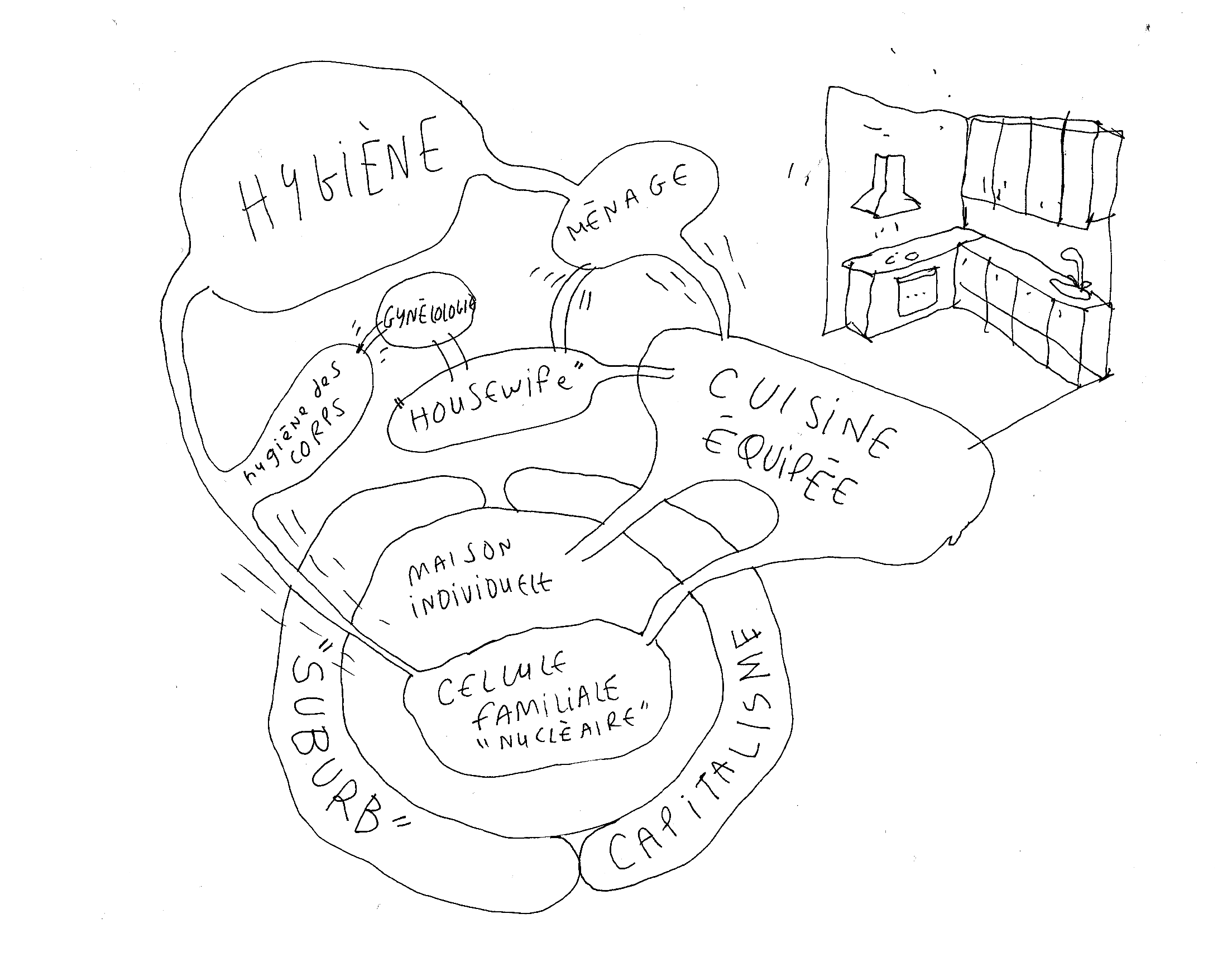
La carte révèle en effet que sous des aspects dʼobjet lisse, sans aspérité, dʼoù sort magiquement la voix de lʼassistant·e, existe tout un réseau dʼexploitations, de productions de déchets, dʼéchanges de valeur qui possède bien une réalité matérielle. Cette méthodologie de la carte heuristique (fin plutôt que moyen de la recherche, cependant) a été reprise par Kate Crawford dans Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power, 1500–2025 (2024), une carte qui établit les relations entre technologie et pouvoir sur plus de cinq siècles. Jʼenvisage donc également le travail de dessin comme un outil pour poser quelques premières intuitions (fig. 0.33), mais jʼaurai aussi à cÅ“ur de produire une carte qui révèle, déconstruit, met en friction.
Je dis ne pas être le sujet de cet écrit, parce que je ne le suis pas au sens attendu : je ne décrirai pas ma transition de genre, je ne décrirai pas ce qui fait de moi un sujet trans. Pour autant, je revendique bien une pensée située, mais située en cuisine autant quʼen transition. Être queer ne résume pas ma positionnalité : il me faut aussi prendre en compte le fait que je suis blanc, transclasse, plus ou moins valide, urbain, etc. Me positionner en cuisine nʼest pas ici revendiqué comme une exception, au contraire : ce travail veut excaver lʼhistoire oubliée des femmes en cuisine, mais aussi la tisser avec un travail théorique qui sʼaccomplirait depuis ce lieu. Ainsi jʼespère montrer que la recherche se fait aussi à la maison, quʼelle peut exister (et parfois doit, par la force des choses) dans un espace domestique, et plus exactement prendre place dans la cuisine. Au cours de lʼHistoire, la figure masculine de lʼécrivain a été portée par la fétichisation de son bureau. Nombre de bureaux dʼécrivains célèbres se visitent, et dʼaucuns y vont en pèlerinage (Trubek 2006). Lʼacte dʼécriture est souvent associé à cette enclave taillée dans lʼespace domestique : soit, dans cette conception masculine de lʼécrivain à la tâche, retiré loin de lʼépouse et de ses enfants bruyants ; soit, parce que les femmes elles-mêmes ont compris historiquement la nécessité dʼavoir une «  chambre à soi  » selon les mots de Virginia Woolf86. Mais lʼidée que les femmes, ou personnes assignées femme, doivent suivre le chemin masculin pour se tailler une place de travail intellectuel au logis peut aussi être remise en question. Fort de la lecture de bell hooks, on peut même dès à présent esquisser la forme dʼune cuisine dont il ne faille pas sortir à tout prix. Le documentaire dédié à Donna Haraway (Storytelling for Earthly Survival) et à son travail intellectuel en constitue un premier fil. Filmée à son bureau, la philosophe déclare (fig. 0.34) :
Jʼai écrit la majeure partie du Manifeste Cyborg ici […] parce quʼil y avait un rythme entre le travail physique, lʼécriture et beaucoup de bonne nourriture […] nous avons investi dans de bonnes plaques et un bon four à convection, très tôt87.

Cʼest quelque chose de ce continuum entre nourritures de lʼesprit et nourritures terrestres que je vise à retrouver dans mon travail. Non pas théoriser sur la cuisine, mais en elle et avec elle, à la manière de D. J. Haraway, qui, dans un même mouvement, lie son texte célèbre et son four à convection.
Lʼentreprise demeurant vaste, malgré les limites apportées par les murs de la cuisine, il existe toujours le risque de se perdre -—  voire, échec ultime, celui dʼécrire un torchon. Nʼest-il pas intéressant que lʼécrit raté porte ainsi le nom familier de ce carré de tissu versatile qui accompagne tant de tâches en cuisine, du séchage de la vaisselle à la couverture dʼun plat, en passant par la protection contre la chaleur, quand on saisit une casserole ? Peut-être quʼà rebours des connotations sexistes et classistes contenues dans cette expression, je peux imaginer un écrit qui porte en lui la souillure de lʼordinaire, le torchon se faisant noble, car multitâches, essentiel, en même temps que je peux prolonger une tradition féministe du détournement bien exprimée par le titre de la revue Le torchon brà »le (1971–73). Il existe dʼailleurs toute une tradition critique qui revendique cette écriture du collage, du bric et de broc, sans pour autant sacrifier la qualité scientifique. Walter Benjamin a ainsi consacré la figure du chiffonnier (Lumpensammler), dont la hotte sert de modèle pratique pour penser une écriture fragmentaire dans lequel le geste de collection produit une forme du sens (Berdet 2012). Cʼest donc une épistémologie du fragment que Benjamin défend, et que nous empruntons ainsi en lui rendant son envers féminin, celui de la boniche et de son torchon -— que lʼon mélangera bien volontiers avec les serviettes. De manière concrète, cette méthode du fragment impliquera un usage intensif de la note de bas de page. Cʼest pour cette raison que jʼai choisi la norme de citation auteur-date entre parenthèses (norme Chicago) : cette norme a le mérite de libérer lʼespace des notes des références bibliographiques, pour en faire un véritable espace liminaire, un espace second, queer, probablement, dans lequel sʼécrit un second ouvrage (cf. avant-propos). En cela, ce texte sʼinvente comme texte à amender, à compléter : il sʼécrit en laissant le blanc de la marge, à la manière dʼun livre de cuisine que les notes de la cuisinière habillent. Lʼidée est aussi, dans ce moment de vie de chercheur, dʼinvestir mes propres défauts méthodologiques comme autant de pistes créatives : lʼécriture de notes exhaustives sinon éléphantesques mʼa été reprochée, et je compte bien user de ce défaut.
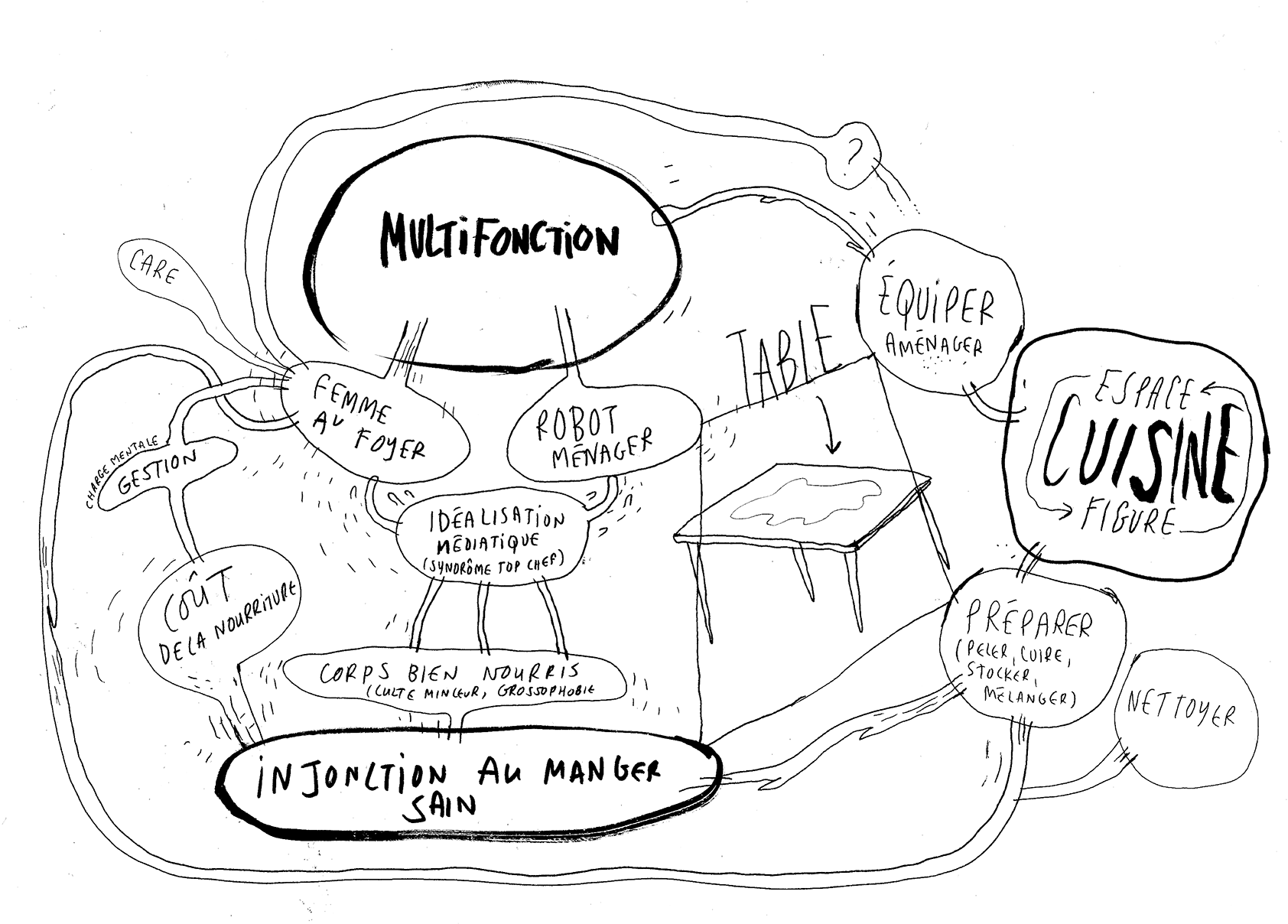
Peut-être est-il naturel, lorsquʼon cherche, de voir son sujet surgir en tous lieux. Avec la cuisine, ce phénomène ne peut être que décuplé : nos styles de vie occidentaux nous font manger trois fois par jour, et à moins de se nourrir exclusivement de plats livrés ou à la cantine (ce qui est le cas de certaines personnes, détenu·es, personnes hospitalisées, personnes en EHPAD), il faut bien se rendre en cuisine, ou près dʼelle. Cette précaution rappelée, il apparaît tout de même que la cuisine semble être partout. Elle ne maille pas seulement les existences, mais aussi les textes, la vie artistique et la vie des idées. Nous lʼavons vu, le four débarque dans la vie de Donna J. Haraway, soudain mobilisé comme une clé importante de son travail philosophique. Et puisque la philosophe nous enjoint à faire proliférer les jeux de ficelles, en voici un, traçant quelques liens (non exhaustifs) entre des cuisines où bouillonnent les concepts, reliés aux résistances précédemment citées de Bénédicte dans Les gens normaux (2013) ou du Tarot Delta Enduring. Lʼespace cuisine transporte avec lui une poétique : cʼest lʼénumération structurée de la recette, ou celle, désordonnée, du bric-à -brac des ustensiles et de la nourriture du garde-manger. Une esquisse se dessine dans une nouvelle de lʼautrice Joanne McNeil :
Considérez la cuisine. La cuisine est équipée de plaques chauffantes, de tasses et de cuillères, de tasses et de cuillères pour mesurer les morceaux, dʼun mixeur et dʼépices. Un évier. De lʼeau. Un micro-ondes. De lʼeau. Du lait et du beurre dans le réfrigérateur. De lʼeau. Des huiles. Des couteaux. Lʼeau. Lʼeau. Lʼeau du robinet. De lʼeau sans fin et sans limite. De lʼeau fraîche. De lʼeau pour se laver les mains. De lʼeau pour baigner un chat. De lʼeau pour nettoyer la vaisselle. De lʼeau pour le thé. Lʼeau pour boire. Lʼeau88 (2019, 40).
Cet extrait mʼintéresse parce quʼil introduit un récit spéculatif : au bric-à -brac ordinaire sʼajoutent lʼomniprésence et la centralité de lʼeau, nécessaire à toute activité culinaire, et bien sà »r à toute forme de vie. Ailleurs, ce nʼest pas le petit peuple des robots, ustensiles et pièces de mobilier qui retient lʼattention, mais un meuble emblématique : la table. Mettre les choses sur la table, de manière imagée, cʼest les engager pour le travail, les mettre à plat, les regarder à tête reposée pour les mobiliser. Quand la cuisine est queer du fait de ses occupant·es, sa table est le support dʼune résilience, comme chez David Wojnarowicz, qui écrit dans Close to the Knives :
Dans tout le pays, les malades du sida se transforment en éprouvettes humaines […] ils transforment leur cuisine en laboratoire, préparant des produits chimiques quʼils distribuent gratuitement à leurs amis et à des inconnus pour les aider à prolonger leur vie89 (2016[1991], 100).
On retrouve ici ce potentiel de la cuisine comme laboratoire -—  non celui de la cuisine scientifique, taylorisée, que jʼévoquerai en détail dans le chapitre III, mais un espace dʼexpériences. Cʼest le potentiel secret dʼun lieu qui nʼa pas été pensé initialement pour ce type de dissidences, et qui pourtant les accueille avec réussite. Quand il est question dʼautonomie, la cuisine nʼest jamais loin. Elle surgit aussi pour parler de soi, comme un lieu où lʼintrospection est facilitée. La professeure et autrice de self-help Brené Brown évoque ainsi le «  soi en cuisine  » ou «  kitchen table self  » pour désigner la partie la plus vulnérable des individus (2015). Proche de lʼen soi, la cuisine est aussi tournée vers le pour soi. Lʼauteur étasunien, trans, Thomas Page McBee écrit quant à lui :
Jʼétais fébrile, happé comme je lʼavais été lorsque, pré-testostérone, jʼavais eu la vision dʼun homme barbu et torse nu, assis à la table dʼune cuisine dans le futur, et jʼavais senti dans mes tripes que mon destin était de devenir lui (2018, 18)90.
Cette nervosité surgit au moment où lʼauteur vit de son propre aveu une crise face à sa masculinité, qui le conduira finalement à devenir boxeur. Avant dʼévoquer les entraînements et le ring, sa relation avec ce sport, et donc avec lui-même, est matérialisée par lʼimage du protège-dents qui bout sur le feu de la cuisine (Page McBee 2018, 19). À partir de ce fil, intime et personnel, on peut rejoindre la table de cuisine comme espace collectif. Ce sont ainsi les «  réunions autour dʼune table de cuisine  » que mentionne Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha dans les remerciements de son Care Work (2018, 9). La table de cuisine est aussi un élément concret du mobilier. Comme métaphore, elle produit alors, paradoxalement, un effet de réel. Elle nous invite dʼabord aux côtés des auteurices, plutôt que directement dans lʼunivers de leurs idées. Plus exactement, la table de cuisine nous installe en ce lieu où les idées des auteurices touchent à leurs vies. Parfois, la table est même lʼespace de la recherche théorique : les chercheuses Ellen Kohl & Priscilla McCutcheon interrogent ainsi leur positionnalité à travers ce quʼelles nomment une «  réflexivité de table de cuisine  » (2014). Traitée en contexte central, voire en support à la théorie, la table devient ce lieu où les deux géographes questionnent leurs relations respectives à la recherche, et notamment la manière dont les dynamiques de race affectent différemment leurs entreprises (Priscilla McCutcheon est noire et Ellen Kohl est blanche). Je lis dans cette récurrence de la table, au-delà de lʼaccident heureux ou du signe dʼune quotidienneté, quelque chose de son caractère «  instrument[al]  » (Genre 2017, 171), cʼest-à -dire quʼelle est capable de faire «  accomplir  » aux usager·es un ensemble de gestes, plutôt que de «  communiquer  » à leur sujet (172). Sa collaboratrice Hanika Perez (dans le studio a+b) évoque une approche similaire, quand elle mentionne le rôle, dans leur pratique, dʼune photo des Eames représentant une table en vue aérienne, accompagnée de la légende : «  à chaque fois que je mets la table, je designe quelque chose  »91 (Perez, Genre & Pandelakis 2021, 305). Enfin, cette idée de la table de cuisine, plutôt que du bureau académique, charrie bien sà »r des connotations de classe. Jʼen avais lʼintuition lorsque, enfant, je rêvais dʼun bureau comme celui de mes camarades, qui mʼaurait évité de faire mes devoirs dans la cuisine pendant que ma mère préparait le repas du soir. Cʼest dʼailleurs avec ce souvenir, celui dʼavoir les cahiers ouverts non loin des épluchures de légumes, que jʼamorce cet écrit92. La table nous place, nous ancre, en cuisine.
Le terme de cuisine a lʼinconvénient, en français, dʼêtre polysémique. Aussi est-il facile dʼécrire «  cuisine  » (comme pièce de la maison, espace) et de penser «  cuisine  » (pratique culinaire)93. Le Centre National de Ressources Lexigraphiques permet aussi de balayer les connotations hétérogènes du termes. Un objet se dira «  de cuisine  » lorsquʼil est de mauvaise qualité, mais on parlera aussi de «  cuisine  » pour désigner des «  basses manÅ“uvres  »[^cop]. Plus généralement, «  cuisine  » désigne les arrangements spécialisés liés à certains métiers (cuisine journaliste, cuisine diplomatique, etc.). Cʼest à la dimension dʼespace, qui attache le mot à une pièce du logis, que je mʼattacherai le plus. Bien sà »r, les cuisines servent à cuisiner : cependant lʼusage dʼun seul et même mot peut faire oublier quʼen cuisine, il se passe dʼautre chose que «  la  » cuisine, à commencer par le ménage quʼoccasionne tout déploiement de compétences culinaires. Pour commencer ce trajet, je tiens donc à préserver la cuisine comme masse. Dans les cuisines, on lave, on range, on fume, on discute, on se dispute, on fait ses comptes, et peut-être, aussi, cuisine-t-on. On y fait aussi, selon sa classe sociale et lʼespace disponible afférant, ses devoirs. En 2024, le contexte est plus que «  mà »r  » pour effectuer ce voyage : le féminisme connaît un certain regain depuis les années 2010 et, avec lui, la conversation sur le partage des tâches et le rôle de lʼéconomie domestique dans le capitalisme. En 2017–18 sʼest tenue à la Monnaie de Paris lʼexposition Women House, dont le titre cite explicitement la maison utopique de Miriam Shapiro et Judy Chicago en Californie en 1972. Malgré ce visible nouveau souffle, le salaire domestique, qui a pourtant été une question de la gauche militante américaine dans les années 1970, a été confisquée en France par lʼextrême droite. De nombreuses représentations, que jʼétudierai, évacuent la cuisine ou signalent sa possible obsolescence, souhaitée par des entreprises comme Deliveroo et UberEats, qui promettent de mettre au service des plus riches des majordomes à vélo ou en voiture pour leur livrer leur dîner (Pandelakis 2018). On parle beaucoup des sorcières, mais ce motif féministe reste en majorité un fantasme, et la figure est finalement peu investie comme figure de production et dʼexpérimentation. La cuisine est hyperprésente, dans la mesure où chacun·e peut devenir chef (notamment par le biais de la télé-réalité, ou encore dʼobjets multifonctions comme le Thermomix). En même temps, les débats actuels autour du féminisme, notamment en France, restent bloqués sur lʼidée dʼen faire faire moins aux femmes (comme si diminuer la charge horaire était de facto source dʼégalité), ou de les voir se réaliser dans lʼentreprise, et donc sur une place de marché. Comme je lʼai annoncé, mon projet consiste à questionner ce choix binaire entre quitter la cuisine et y rester. De même, je ne rejoins pas Catherine Clarisse lorsquʼelle espère dans son ouvrage sur lʼespace architectural des cuisines «  une plus agréable répartition des rôles  » (2004, 211) entre hommes et femmes. Le but nʼest pas de tempérer une quelconque guerre entre les sexes par une ambiance «  agréable  », mais dʼinvestir lʼespace de la cuisine dans toute sa dimension politique, ses paradoxes, ses possibles.
Mon horizon tient dans cette question : si quitter la cuisine est une impasse, et si y rester renvoie aux problèmes permanents de lʼaliénation du travail domestique gratuit et dévalorisé socialement, quel espace concevoir qui permette lʼautonomie ? Comment les sujets minorisés qui sont associés à la cuisine (les femmes, les personnes assignées femmes et, peut-être, les enfants) peuvent-ils lʼutiliser comme outil politique ? Comment les sujets minorisés qui en sont exclus (personnes queer, trans, etc.) peuvent-ils investir cet espace ? Que serait une cuisine rebelle ? Comment dé-domestiquer la cuisine ? Nos espaces «  tiennent  » nos identités (pour parler comme Monique Wittig) : peut-on imaginer que lʼespace de la cuisine devienne un espace dʼagentivité au-delà du reclaim et dʼœuvres dʼart contestataires ? Pourtant, jamais cette question ne fera fi de lʼexistant. Le premier travail, comme toujours en design sera de faire avec un déjà -là ou, selon les mots de Marielle Macé (2017), de «  considérer  ». Je ne serai pas lʼordonnateur dʼune quelconque «  cuisine du futur  » et autres espaces distants promis par lʼinnovation.
Si je nʼai pas composé cet ouvrage comme une cuisine, jʼai emprunté à G. Bruno sa logique, en plantant mon texte sur quatre piliers, à la manière dʼune cabane primitive94, et en plaçant au pied de chacun un objet-clé qui ouvre et porte la réflexion. On rencontrera ainsi un placard, un sac de nourriture à emporter, un tablier et un robot ménager. Enfin, un cinquième chapitre conclusif, transverse et buissonnier, ouvrira des brèches dans lʼédifice -— là , nous attendra la boniche (peut-être cyborg) du titre. Cette cabane solidement campée ne semble pas très queer au premier abord, et cela est volontaire. Queeriser ne doit pas être une excuse pour désorganiser sans but la pensée : aussi celle-ci est-elle arrimée, mais, grâce à ces balises, nous pourrons nous égarer et retrouver notre chemin.
Le voyage commence au premier pilier, où nous rencontrons le placard, symbole bien connu de la clandestinité homosexuelle et lesbienne, aujourdʼhui revendiqué par les personnes LGBTQIA+. Ce placard sʼouvre, et nous offre un socle, un point dʼappui. Je proposerai une épistémologie sexe/genre visant à comprendre ce que le terme de «   femme  » recouvre, puis je proposerai une définition critique plus étoffée du terme queer, après lʼavoir historicisé plus longuement que dans cette introduction. Ainsi outillé, je travaillerai une géographie à grande échelle (macro), tâchant de comprendre la complémentarité des points cardinaux homme/femme, recoupés par la distribution dedans/dehors. Je chercherai à localiser où, sur ce terrain, peuvent exister des espaces queer, et comment des dispositifs spatiaux précis (le placard, par exemple), ne situent pas queer et straight, mais articulent des passages entre lʼun et lʼautre.
En mettant au défi lʼidée dʼune stricte assignation des femmes en cuisine, jʼarriverai au deuxième pilier, où nous attendra un sac de nourriture à emporter. Celui-ci témoigne dʼune cuisine désertée, évidée, dans laquelle il ne se passe apparemment plus rien. Jʼenquêterai sur cette cuisine portée disparue, et mes pas me mèneront vers ses substituts, comme la cuisine professionnalisée ou détournée de sa fonction. Jʼexpliquerai comment la cuisine sʼest vidée et remplie régulièrement dans lʼhistoire de lʼOccident, et proposerai de suivre quelques améliorations (la gestion de la flamme) comme élément-clé permettant de comprendre lʼévolution matérielle et symbolique du lieu. Je montrerai aussi comment le travail domestique peut parfois migrer hors du logis, selon le motif connu de Mildred Pierce (1945).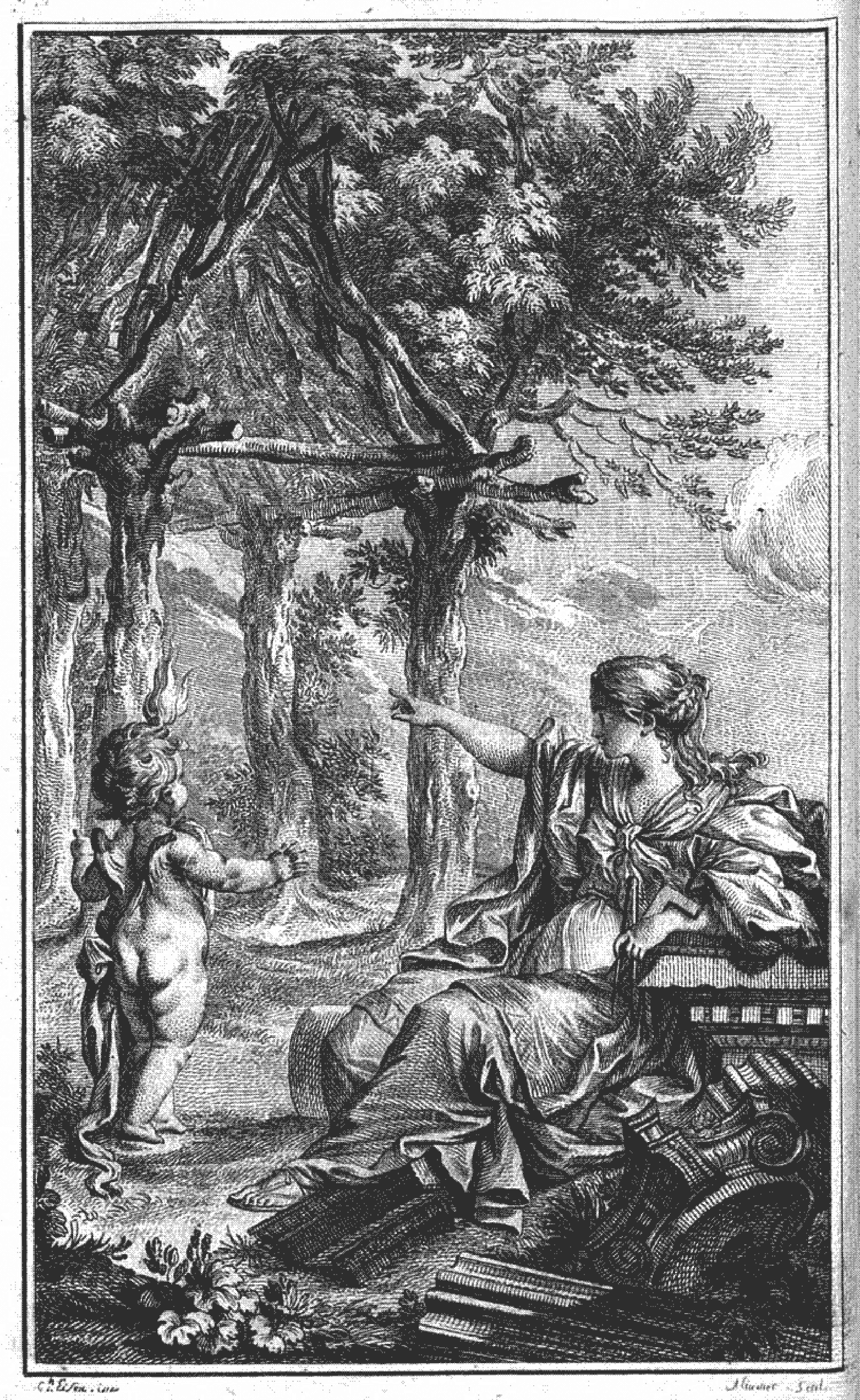 fig. 0.36 : Marc-Antoine Laugier est un abbé, théoricien de l’architecture français du XVIIIe siècle. Dans son Essai sur l’architecture (1753) il défend d’une architecture dépouillée de ses ornements superflus ou mensongers (comme les pilastres, qu’il honnit) pour un retour à la structure fondamental et primitive de la cabane, qu’il rapproche de l’architecture antique grecque. Je croiserai la cuisine hypermedia, à la fois cuisine-image dʼoù nʼémane aucune odeur de soupe, mais aussi cuisine «  connectée  », envahie dʼécrans et de circuits numériques, mieux externalisée par le biais des applications-majordomes. Jʼirai même jusquʼà la maison privée de cette pièce et tâcherai de comprendre ce que serait une domesticité sans cuisine, avant de revenir vers une domus usée, marquée par le confinement en période COVID et lʼassouplissement des frontières entre espace professionnel et espace domestique, jusquʼà lʼinvention dʼune domesticité autophage, qui dévore les autres espaces et leurs logiques95. Ensuite, jʼoublierai pendant un temps la cuisine individuelle bourgeoise, et irai chercher dʼautres espaces, particulièrement les cuisines communautaires et grassroots, qui sont une matrice souvent oubliée de la vie en cuisine. Nous laisserons le repas tout prêt, et retrouverons près du troisième pilier un habit, et donc un rôle à habiter.
fig. 0.36 : Marc-Antoine Laugier est un abbé, théoricien de l’architecture français du XVIIIe siècle. Dans son Essai sur l’architecture (1753) il défend d’une architecture dépouillée de ses ornements superflus ou mensongers (comme les pilastres, qu’il honnit) pour un retour à la structure fondamental et primitive de la cabane, qu’il rapproche de l’architecture antique grecque. Je croiserai la cuisine hypermedia, à la fois cuisine-image dʼoù nʼémane aucune odeur de soupe, mais aussi cuisine «  connectée  », envahie dʼécrans et de circuits numériques, mieux externalisée par le biais des applications-majordomes. Jʼirai même jusquʼà la maison privée de cette pièce et tâcherai de comprendre ce que serait une domesticité sans cuisine, avant de revenir vers une domus usée, marquée par le confinement en période COVID et lʼassouplissement des frontières entre espace professionnel et espace domestique, jusquʼà lʼinvention dʼune domesticité autophage, qui dévore les autres espaces et leurs logiques95. Ensuite, jʼoublierai pendant un temps la cuisine individuelle bourgeoise, et irai chercher dʼautres espaces, particulièrement les cuisines communautaires et grassroots, qui sont une matrice souvent oubliée de la vie en cuisine. Nous laisserons le repas tout prêt, et retrouverons près du troisième pilier un habit, et donc un rôle à habiter.
Le tablier nous transportera dans la domus, usine de production du genre et de la housewife, un modèle particulièrement féminin, mais aussi à queeriser et à expérimenter. Dans la poche du tablier, se trouvera un écheveau quʼil faudra dérouler. LʼAnge de la maison victorien sʼinvitera chez la housewife américaine dʼaprès-guerre, pour aller chercher les théoriciennes de lʼéconomie domestique et leurs contradictions (Catharine Beecher, Christine Frederick, Lillian Gilbreth), entre féminisme revendiqué et conservatisme appliqué. Elles feront face au féminisme de la seconde vague et à son invitation apparente à quitter la cuisine, temporisés par un cortège dʼactivistes noires ou lesbiennes qui inventent dʼautres de manières dʼêtre et de faire en cuisine, plutôt que de sʼattaquer au plafond de verre. Ici, le logis sera questionné en tant quʼautre usine du capitalisme. Ce sont ses productions secrètes qui mʼintéresseront, notamment, la Blancheur produite par la lessive comme par les rapports de subordination. Il sʼagira aussi de mettre lʼorganisation de la cuisine à lʼépreuve des usages, pour comprendre ce quʼest une tâche domestique, et comment on peut en penser lʼorganisation. Science ou corvée, le travail domestique devra être questionné comme travail : apparemment plus loin du design, nous nous trouverons en fait en son cÅ“ur, puisque la ménagère, si elle est reconnue comme ouvrière, peut être partie prenante dʼune industrie, plutôt que consommatrice de ses productions. fig. 5 : «  Quarantinology  » est un dossier de la revue en ligne Strelka. Pendant le confinement, les chercheureuses Philip Maughan, Tigran Kostandyan,
Liudmila Gridneva, Julia Gankevich et Eduardo Castillo Vinuesa ébauchent des mini-scénarios dystopiques radicalisant les principes du confinement. Parmi ceux-ci, ce «  cubicle communalism  » (ou «  communalisme du box  »), dans lequel iels imaginent que la génération Z — la dernière génération — investit des open spaces désertés et y inventent une vie en communauté.
fig. 5 : «  Quarantinology  » est un dossier de la revue en ligne Strelka. Pendant le confinement, les chercheureuses Philip Maughan, Tigran Kostandyan,
Liudmila Gridneva, Julia Gankevich et Eduardo Castillo Vinuesa ébauchent des mini-scénarios dystopiques radicalisant les principes du confinement. Parmi ceux-ci, ce «  cubicle communalism  » (ou «  communalisme du box  »), dans lequel iels imaginent que la génération Z — la dernière génération — investit des open spaces désertés et y inventent une vie en communauté.
Il faudra donc nous mettre à lʼœuvre, et le quatrième pilier, avec son robot ménager, nous invitera à nous retrousser les manches. Cet outil nous donnera la possibilité de faire et dʼagir. Nous aborderons la cuisine en concepteurice, et tâcherons de comprendre comment fonctionne le petit peuple de la cuisine, cʼest-à -dire, lʼensemble des appareils ménagers censés «  libérer  » les femmes. Tandis que lʼabsence de réalisation de cette promesse ne me retiendra guère, je mʼefforcerai de déconstruire les imaginaires qui lui sont associés. En quoi le robot ménager incarne-t-il le rêve dʼun demain idéal ? Comment les futurs du passé peuvent-ils éclairer notre quête actuelle dʼune «  cuisine du futur  »â€¯? La cuisine intégrée, équipée, sera déconstruite pour être mieux comprise, et la housewife elle-même, élément de mobilier parmi dʼautres, sera désarticulée. Plus quʼun placard, la ménagère deviendra elle-même un robot, voire un cyborg. Cette housewife robotisée, biotechnique, sous Xanax et hormones, revampée en Desperate Housewife des années 2000 et momtrepeneur96 bloguant ses recettes peut nous effrayer. Comme figure, elle tient peut-être au creux de ses mains lʼesquisse dʼun programme pour les designers, mais pour penser à la boniche, il est trop tôt. Pour lʼheure, il nous faut dʼabord sortir du placard, à moins que son fond ne sʼescamote, et ne nous catapulte dans des territoires queer à inventer.
«  At bottom, everyone is a sissy  »
Andrea Long Chu, Females, 2019, p. 74.
«  […] PENDANT QUE LʼOCÉAN MONTE ON ASSISTE À UNE FÉMINISATION DE LA PAUVRETÉ = FÉMINISER SIGNIFIE RENDRE EXTRÊMEMENT VULNÉRABLE; EXPOSER AU DÉMANTÈLEMENT, AU RÉASSEMBLAGE; ÊTRE CONSIDÉRÉE MOINS COMME UNE TRAVAILLEUSE QUE COMME UNE DOMESTIQUE, ÊTRE SOUMISE À DES EMPLOIS DU TEMPS MORCELÉS QUI FONT DE TOUTES NOTIONS LIMITÉES DU TEMPS DE TRAVAIL UNE FARCE; MENER UNE EXISTENCE À LA LIMITE DE LʼOBSCÉNITÉ, DÉPLACÉE, QUI PEUT SE RÉDUIRE À LA SEXE […]  »
Élodie Petit, Fiévreuse Plébéienne, 2022, p. 69.
La couche de maquillage […] devenait toute collante, un masque de boue chaude bouchant tous les pores pour que notre âme ne sʼéchappe pas par ses orifices chaque fois quʼon nous frappait. Le visage tout entier devenait un masque, le plus beau des masques, avec des traits trans plus réels encore que nos propres traits, conçus pour un autre monde, un monde meilleur, où lʼon pouvait être pleinement ce masque-là .
Camila Sosa Villada, Les vilaines, 2019, p. 113.
De lʼinsulte au tract Queers Read This, en passant par la migration vers la théorie amorcée par T. de Lauretis, nous avons brièvement parcouru lʼhistoire du terme «  queer  » dans lʼintroduction qui précède. Il est généralement admis que «  queer  » sʼoppose au normatif : mais cette localisation (selon le motif qui relie marge et centre), si elle est apparemment simple, cache en réalité un territoire plus vaste. Proposer dʼexplorer la cuisine avec un prisme queer (plus spécifiquement, transféministe) nécessite donc de cartographier la notion. Penser le queer, cʼest faire face à une bibliographie colossale. Depuis la conférence de T. de Lauretis en 1990, ce sont des milliers dʼouvrages théoriques, dʼarticles de recherche, de fanzines et de brochures qui ont proliféré dans le monde en faisant usage du terme, sans parler des Å“uvres de fiction. De plus, cartographier «  le  » queer engage une géographie plus vaste que la pensée du queer.
Être queer, en tant quʼindividu, implique de manipuler des espaces multiples, qui se superposent et parfois contredisent les cartographies officielles, reconnues, imposées par les espaces vécus. Il peut sʼagir dʼune note mentale, destinée à nous rappeler, si lʼon est trans, que les toilettes de tel café ne sont pas adaptées, parce quʼelles risquent de nous outer, de nous exposer à des violences (Bonté, 2022) ; ce peut être un art de la conversation avec ses collègues, destiné à ne pas évoquer sa conjointe, si on est lesbienne ; ce peut être une manière de gérer son habillement, rendu banal pour le milieu du travail, plus flamboyant les week-ends. Ces stratégies dʼadaptation à un espace défini par les dominant·es ne se limitent pas aux sujets LGBTQIA+ : les femmes ont bien sà »r depuis longtemps appris à naviguer dans la ville, entre catcalls et risques dʼagression et les personnes noir·es témoignent de stratégies similaires pour habiter ces «  white spaces  » dont les codes et lʼorganisation bénéficient avant tout aux blanc·hes (Anderson 2015). Si depuis le «  tournant spatial  » des sciences humaines97, les questions philosophiques et théoriques sont volontiers élaborées en des termes géographiques, il se trouve que ma problématique porte sur une typologie dʼespace et engage dès lors doublement la notion de géographie. En premier lieu, la cuisine est un espace concret, qui se compose, se structure, se conçoit, sʼutilise, sʼhabite ; en second lieu, la cuisine existe comme un espace symbolique, et cette deuxième dimension maille complètement la première dʼidées, de représentations, dʼimaginaires, de projections et de récits. Ces deux composantes, étroitement tissées, peuvent aussi constituer deux extrémités de lʼanalyse dans lesquelles nous tâcherons de ne jamais complètement nous égarer : soit une prise uniquement matérielle, qui oublie que la géographie nʼest pas uniquement affaire de mètres carrés et de volumes concrets, soit une approche au contraire tout abstraite, la réduisant à un espace symbolique et faisant de la cartographie une nébuleuse de concepts ou de mots-clefs.
La méthodologie des clés culturelles chère à Paul B. Preciado (2011[2010], 19) peut nous aider à atteindre une synthèse entre les deux postures. La clé culturelle est à la fois concrète, en tant que cas délimité, mais elle est aussi reliée au champ de références qui la traverse. Ainsi, elle permet dʼaccéder de manière à la fois précise et articulée à un objet dʼétude. Cʼest le placard qui me servira de clé culturelle dans les pages qui vont suivre, comme annoncé dans lʼintroduction qui en fait le premier «  pilier  » de ma réflexion. Utilisé de manière célèbre par Eve Kosofsky Sedgwick dans son Épistémologie du placard (2008[1990]), cet élément du mobilier constitue un puissant marqueur symbolique dans les vies gays, puis queer, tout en étant un objet de mobilier qui occupe une place importante dans lʼhistoire du design. Le placard métaphorise les vies queer et lʼobligation du secret qui les traverse depuis lʼinvention du concept dʼhomosexualité au XIXe siècle. En anglais, lʼexpression «  to be closeted  » signifie «  être au placard  »98, cʼest-à -dire tenir secrètes son identité ou ses pratiques homosexuelles. Le placard nʼest pas seulement une incarnation de la discrétion ; il organise un rapport entre dedans et dehors, particulièrement matérialisé dans lʼexpression désormais populaire de «  coming out  », qui désigne lʼacte par lequel les personnes queer nomment leur identité ou orientation à leur entourage. Souvent spectacularisé par la culture populaire qui fait de cette annonce un moment unique et marquant dans le temps, le coming out est plutôt, si lʼon en croit les personnes concernées, un processus jamais achevé, dont la possibilité se renouvelle sans cesse et impose des choix répétés : se dire ou ne pas se dire ; évaluer les risques de se dire ; savoir comment le faire pour être compris ; indiquer aux récepteurices de lʼacte ce quʼiels peuvent, ou non, dire à leur tour99 (Eribon 2012 [1999], 152–55). Le placard offre ainsi une porte maintes fois empruntée, ce dont témoigne dans une certaine mesure la littérature de fiction. La revue Dirty Furniture nous permet dʼen avoir un aperçu ancré dans la culture design. La publication structure en effet chacun de ses numéros autour dʼun objet dont elle analyse lʼhistoire et les imaginaires. Dans son quatrième numéro, après la table et le canapé, cʼest le placard qui est sélectionné pour lʼanalyse.
Dans son article «  Dimensions Unknown  », lʼécrivain de fiction Alan Roberts questionne le placard depuis ses représentations fictionnelles, particulièrement dans The Lion, the Witch and the Wardrobe de C. S. Lewis (1950). Dans cette représentation, et celles quʼelle a inspirées (du Time Bandits de Terry Gilliam à Harry Potter), le placard se fait portail : il permet aux héros de lʼhistoire dʼaccéder à un monde de merveilles, distinct de lʼordinaire de la chambre dans laquelle il se tient100. Pour A. Roberts, ce ne sont pas seulement le banal et le fantastique qui sont mis en contact grâce au portail magique quʼouvre le placard, mais les univers du «  moderne-mondain  » et du «  médiéval-magique  »101 (Roberts 2018, 47). Il écrit :
le placard est lʼartefact parfait pour médier [ces deux univers] car il est les deux : il est moderne dans le sens où chaque maison moderne en possède probablement un ; mais en tant quʼéquipement de la maison il est ancien, comme le coffre, le tabouret ou le lit à baldaquin  » (ibid.)102.
Le placard organise donc le secret auquel les personnes LGBTQIA+ sont contraint·es mais il est aussi traversé par dʼautres promesses, dont celle, et ce nʼest pas anodin, dʼaccéder à un monde fantasmatique ou utopique -— un lieu «  over the rainbow  » (pour citer à nouveau Judy Garland) pouvant dès lors se trouver autant en sortant du placard, quʼen y retournant pour lʼhabiter103.
Lʼomniprésence du terme «  coming out  » et son codage comme acte courageux et incontournable dans les biographies gays et lesbiennes (et plus récemment trans*, intersexes, asexuelles, bien que les implications sociales et psychologiques ne soient pas les mêmes) impliquent que le trajet proposé par le placard est centripète. Le placard nʼexisterait que pour être quitté104 : pourtant, la fragmentation du coming out dans la vie, la navigation des espaces straight, et la création dʼespaces alternatifs «  safe  » ou créatifs supposent que le placard peut aussi sʼhabiter. Par ailleurs, lʼancrage de mon propos dans la discipline du design induit de saisir le placard dans sa matérialité, et pas seulement comme une métaphore. Il existe ainsi un paradigme du placard dans lequel la tension intérieur/extérieur est symboliquement investie, mais aussi des placards effectifs, des jeux de coffres et de portes qui peuvent concrètement organiser les passages entre hétéro et straight, mais aussi entre public et privé, ou normal et abject (pour parler comme Judith Butler). Des expressions quotidiennes comme «  remiser au placard  » ou encore «  pousser sous le tapis  » sont des indices de la centralité de nos espaces matériels et plus particulièrement de notre mobilier dans la régulation de nos identités et de nos comportements. Leur architecture, leurs murs, leurs pièces et leurs armoires participent dʼune fabrique de normalité liée à celle de son pendant, lʼinnommable, lʼAutre, lʼabject. Katarina Bonnevier analyse en ces termes la maison E.1027 conceptualisée et habitée par lʼarchitecte Eileen Gray :
E.1027 est une maison remplie de secrets, de poches dans les murs, de passages coulissants, de replis tentants. Lʼarchitecture de Gray cache en même temps quʼelle révèle. Elle est ouverte aux quatre vents en même temps que refoulée [closeted]105 (2005, 162).
K. Bonnevier commente ensuite la E.1027 comme une architecture de lʼambiguïté : les plans ne rendent pas compte de tous les espaces cachés et dérobés quʼils contribuent pourtant à ériger ; la typologie du boudoir (pièce féminine par excellence, ainsi que libertine) est retournée sur elle-même pour devenir un espace central et public dans le dispositif ; enfin, selon le même principe dʼinversion106, le rapport extérieur/intérieur est troublé par des cloisons mobiles qui font du balcon un espace de réception, et projettent le living-room à lʼextérieur (Bonnevier, 2005, 163–169). Mais le point le plus important pour mon analyse se situe sans doute dans lʼusage de placards et dʼespaces dérobés, qui selon K. Bonnevier façonnent des «  couches dʼintérieurs dans les intérieurs  »107 (172). Lʼarchitecture queer de Gray ne renverse pas seulement les binarités (comme intérieur/extérieur), elle fait voler en éclat la stricte bicatégorisation entre ces termes. Eve Kosofsky Sedgwick engage le même travail dans son Épistémologie du placard, lorsquʼelle indique sʼintéresser davantage à «  la manieÌ€re dont opeÌ€rent certaines cateÌgorisations, sur ce quʼelles accomplissent et sur les relations quʼelles creÌent, plutoÌ‚t que sur ce quʼelles signifient essentiellement  »108 (1990, 27).
Il existe donc un ordre du placard, mais toute analyse du placard doit sʼabstenir de solidifier cet ordre. Une approche de design permet dʼéviter cette essentialisation : en effet, un objet se comprend dʼabord en acte, dans ses usages, dans les multiples appropriations quʼil permet et dans les désobéissances (celles-là mêmes que Michel de Certeau nommait «  tactiques  » chez les consommateurs de la culture) quʼil autorise. Le chercheur Michael Brown estime que la géographie permet aussi dʼaccéder à cette matérialité du placard dans Closet Space: Geographies of Metaphor from the Body to the Globe (2000, 3), ouvrage dans lequel il affirme ne pas ancrer son épistémologie dans le seul registre métaphorique. Ouvrir le placard à lʼusage permet de le désencastrer de la seule fonction de seuil à franchir -— quand bien même ce franchissement occasionnerait une variété dʼattitudes corporelles. Il est ainsi intéressant de noter que si le placard (comme métaphore) nʼest pas lʼobjet premier de Judith Butler, iel le croise néanmoins lorsquʼiel réexamine son épistémologie du genre et du sexe dans Bodies That Matter (1993). Suite à la parution de Gender Trouble (1990), J. Butler a en effet été critiqué* pour avoir présenté le genre, et plus précisément la performance de genre comme un acte libre et accessible disponible à chacun·e (je reviendrai ultérieurement sur cet aspect, puisquʼil me semble que lʼauteurice ne dit rien de tel). Iel précise donc, trois ans plus tard :
Si jʼavançais que les genres sont performatifs, cela pourrait signifier que je pense que lʼon se réveille le matin, parcourt son placard ou un espace plus ouvert à la recherche du genre de son choix, quʼon endosse ce genre pour la journée, puis quʼon rende lʼhabit à sa place la nuit venue109 (1993, x).
Si les corps altérisés sont fréquemment invités à rester au placard, le propos de J. Butler nous inspire un pas de côté : il y a aussi des rayonnages dans les placards, des tringles, et sur ceux-ci, des habits. Le placard nʼest pas un espace vide attendant quʼon y pousse les monstres et autres freaks. Il peut être bien garni, mais ne permet pas pour autant à quiconque le souhaite dʼendosser le genre choisi ; car le genre, nous le verrons, est une fiction coproduite par ses participant·es, qui demande un geste mimétique et répétitif, ainsi quʼune validation externe. Toutefois, il serait erroné de dire que les individus sont totalement privés dʼagentivité dans ce contexte. Mettre une robe nʼéquivaut pas systématiquement à être reconnue comme femme dans lʼespace public, même si choisir cette robe permet dʼéprouver ou dʼaffirmer un genre. Cʼest un choix disponible, qui peut pour certaines prendre la forme dʼune obligation (les femmes dont on attend quʼelles soient féminines, par exemple), dʼun plaisir ou dʼune transgression. Les genres ne sont pas des costumes prêts à lʼemploi, que lʼon peut choisir librement, mais les vêtements (résultats de processus de design textile) ouvrent des possibles, notamment combinatoires, un réservoir pour «  faire du genre  », quand bien même les résultats et la réception échappent de fait largement à leurs émetteurices. En somme, le placard nʼest pas seulement un lieu façonné par le design, mais aussi le réceptacle dʼautres objets de design. On peut vivre le placard, sortir du placard, ou y prélever des outils : dans tous les cas, ces dimensions «  espace  » et «  objet  » participent à faire le genre.
Que recouvre cette expression de «  faire le genre  »â€¯? Cʼest une des questions centrales de ce chapitre, quʼil nous faudra résoudre. Une dernière dimension du placard doit cependant être nommée avant que ce trajet épistémologique sʼamorce plus franchement : la chercheuse Maude-Yeuse Thomas pointe ainsi que le «  cadre pathologisant  » dans lequel évoluent les personnes trans au début des années 2000 «  fabriqu[e] des placards à multiples fonds  » (2013, 129). Lʼobservation de M.-Y. Thomas sʼentend de manière critique : commentant les fringothèques110 mises à disposition dans les UEEH (Universités dʼÉté Euroméditerranéennes des Homosexualités), elle observe que les personnes trans, pourtant victimes fréquentes de violences de genre, investissent peu, ou pas, cet espace dédié à lʼexpérimentation. Je devine, dans ces «  multiples fonds  », une critique de lʼinscription gay/lesbienne du paradigme du placard : sortir du placard (si toutefois cela est souhaité) peut revenir, dans un jeu de poupées gigognes, à pénétrer dans un autre. Cette idée des fonds multiples intéresse déjà pour sa connexion aux fringothèques : comme chez J. Butler, le placard nʼapparaît pas sans les habits. En outre, lʼidée du double fond peut aussi être valorisée, car le placard nʼest prison que dans la mesure où il peut aussi jouer le rôle de refuge. Pensé comme un lieu de repli, un espace safe, le placard à double, triple, ou multiple fond devient un lieu stratégique (tactique) de préservation de soi. Cʼest en ce sens que les chercheuses Lisa Hardie et Lynda Johnston parlent dʼun «  placard mobile  »111 pour désigner la place de la musique dans la vie des lesbiennes néo-zélandaises. Dans ce contexte, le placard ne figure pas un espace dont il faut sortir, mais un lieu protecteur à investir, pour vivre et sʼéprouver. Les chercheuses parlent même dʼun «  placard musical  »112 qui désigne lʼespace privilégié que découpent certaines pratiques dʼécoute musicale chez des lesbiennes qui ne sont pas «  out  ». Elles expliquent ainsi :
[…] des lesbiennes nouvellement ‹ out › peuvent construire des foyers safe en ‹ se réfugiant dans la musique ›. Au-delà des murs de la maison, des espaces publics safe peuvent être fabriqués en utilisant la musique comme ‹ placard musical ›113 (2018, 128).
Il convient donc de ne pas donner une signification fixe au placard, quand bien même ce motif (fait paradoxal) existe pour «  fixer  » des identités et leur recevabilité dans lʼespace public. Le placard peut protéger ou enfermer ; il peut être domestique, mais sa dimension métaphorique lui permet de sʼinscrire de manière externe au foyer, voire dans des matérialités inattendues (comme la musique) ; il nʼinvite pas forcément un mouvement de sortie, et ladite sortie pourrait bien conduire ses occupant·es à découvrir des jeux de fonds et double fonds qui en redoublent le pouvoir. À moins que ce fond ne sʼescamote pour dévoiler une utopie queer, à la manière des placards magiques dans les récits pour enfants. Voici quelques-uns des foisonnements quʼautorise bien malgré lui le motif apparemment voué au poliçage de sexe, de genre et dʼorientation sexuelle du placard.
Deux observations sʼimposent avant que nous nʼinvestissions des géographies queer marquées par ce régime du placard -— et parfois construites contre, tout contre celui-ci. Premièrement, comme le soutient Michael Brown, la dimension métaphorique et matérielle du placard permet de distribuer celui-ci selon des échelles très différentes : la pièce de la maison, le quartier, la ville, etc. Parler dʼun «  effet placard  » permet dʼappréhender cette pièce de mobilier comme métaphore, sans la détacher de ses multiples incarnations matérielles. La deuxième précaution mʼest inspirée par Katarina Bonnevier qui rappelle que le placard nʼest pas le seul modèle spatial de lʼhomosexualité, et met en garde ses lecteurices quant au fait quʼ«  insister sur le placard limite lʼespace queer à une dichotomie entre lʼhétérosexualité et lʼhomosexualité  »114 (2005, 175). Je ne souscris pas intégralement à cette affirmation, puisque le placard, nous lʼavons vu, est marqué par une tension plus générale entre le domestique et le monstrueux. Néanmoins, cette invitation à ne pas réduire un jeu dʼoppositions à sa métaphore la plus connue semble relever dʼune prudence bienvenue. Je garde cet aspect à lʼesprit alors que je souhaite ici connecter le placard à ses effets : pourquoi faut-il sortir du placard ? Quels présupposés sous-tend la sortie du placard ? Et quels sont les effets de ces valeurs incarnées par le placard sur une géographie queer ?
Quʼest-ce qui sort dans le coming out ? Quel est le contenu de cet acte dʼénonciation, et quels espaces contribue-t-il à définir ? Se dire gay et lesbienne, cʼest a priori dire une orientation sexuelle, indiquer une préférence pour un certain type dʼindividu. Le terme dʼorientation sexuelle désigne dʼailleurs mal tout ce qui est recouvert par ladite orientation : lʼactivité sexuelle, mais aussi le désir, lʼattirance romantique, les conceptions de lʼamour et des relations quʼil cristallise. Mais le fait apparemment simple de se dire gay ou lesbienne115 repose sur tout un ensemble de présupposés : les individus éprouvent tous du désir sexuel ; ce désir sexuel est plutôt fixé sur une typologie dʼindividus ; ce désir est principalement caractérisé par ce choix typologique ; la distinction typologique concerne le sexe de lʼindividu. Autrement, il nʼest pas possible dʼexaminer le coming out sans investir toute lʼépistémé sexe/genre qui sous-tend les notions de lesbianisme ou dʼhomosexualité. Le coming out sʼinscrit aussi plus largement dans une économie générale de la sexualité, que Michel Foucault a dissociée de la répression pour lʼidentifier au contraire comme une «  incitation réglée et polymorphe aux discours  » (1976, 47). Refusant lʼhypothèse que la société qui lui est contemporaine hérite dʼun dispositif de censure autour des questions de sexualité116, Foucault avance un argument -—souvent repris depuis -—selon lequel cʼest au contraire sur une prolifération de discours au sujet de la sexualité que sʼappuie le pouvoir depuis le XVIIe siècle. Et ces discours règlent aussi bien lʼordre des plaisirs admis que la somme des sexualités, gestes et identités apparemment honnies par la société bourgeoise occidentale, mais quʼelle encourage pourtant dans les «  dispositifs de saturation sexuelle  » (62) que sont les pensionnats, les écoles, les hôpitaux, etc. Foucault écrit ainsi :
Lʼimplantation des perversions est un effet-instrument : cʼest par lʼisolement, lʼintensification et la consolidation des sexualités périphériques que les relations du pouvoir au sexe et au plaisir se ramifient, se multiplient, arpentent le corps et pénètrent les conduites. Et sur cette avancée des pouvoirs, se fixent des sexualités disséminées, épinglées à un âge, à un lieu, à un goà »t, à un type de pratiques (66).
Il nʼexiste donc pas une norme qui, en se solidifiant, exclut de facto ce qui nʼest pas elle, mais plutôt, et au contraire, une approche exhaustive, encyclopédique, des perversions qui constituent en creux la norme. Et si la société bourgeoise fait «  proliférer  »117 les discours sur le sexe, cʼest pour mieux instaurer une «  police des énoncés  » (26) et cadrer (mais pas limiter) la manière dont le sexe doit se dire (la politique de «  lʼaveu  », dit Foucault). Cet ordre discursif de la sexualité est, selon le philosophe, constitutif de la sexualité elle-même. Le désir du discours redouble le plaisir sexuel lui-même, le prépare, le cadenasse :
En créant cet élément imaginaire quʼest ‹ le sexe ›, le dispositif de sexualité a suscité un de ses principes internes de fonctionnement les plus essentiels : le désir du sexe – désir de lʼavoir, désir dʼy accéder, de le découvrir, de le libérer, de lʼarticuler en discours, de le formuler en vérité (207).
Le désir dʼune sexualité, de dire la sexualité, se fonde donc sur le principe ordonnateur de la vérité. La sexualité est en effet vérité sur lʼindividu, et la vérité de la sexualité (quelles pratiques, quelles personnes, quels lieux, etc.) est liée au plaisir quʼelle procure, et constitue même un de ses plaisirs premiers :
Peut-être cette production de vérité, aussi intimidée quʼelle soit par le modèle scientifique, a-t-elle multiplié, intensifié et même aussi créé ses plaisirs intrinsèques […] : plaisir à la vérité du plaisir, plaisir à la savoir, à lʼexposer, à la découvrir, à se fasciner de la voir, à la dire, à captiver et capturer les autres par elle, à la confier dans le secret, à la débusquer par la ruse ; plaisir spécifique au discours vrai sur le plaisir. Ce nʼest pas dans lʼidéal, promis par la médecine, dʼune sexualité saine, ni dans la rêverie humaniste dʼune sexualité complète et épanouie, ni surtout dans le lyrisme de lʼorgasme […] quʼil faudrait chercher les éléments les plus importants dʼun art érotique lié à notre savoir sur la sexualité (il ne sʼagit là que de son utilisation normalisatrice) ; mais dans cette multiplication et intensification des plaisirs liés à la production de la vérité sur le sexe (1976, 95).
En suivant Foucault, la vérité nʼest pas seulement un principe organisateur de la sexualité, mais une fonction du plaisir. Ici, jʼaimerais avancer que lʼargument puisse être étendu de la vérité de la sexualité à la vérité de la sexuation. La sexualité hétérosexuelle repose avant tout sur la vérification de la vérité du partenaire ; la séduction, telle quʼelle est représentée dans les médias populaires -— et même dans de nombreuses cultures de niche -—consiste à se présenter comme un «  vrai  » homme, une «  vraie  » femme. Plus encore, celui qui entre en relation avec une «  vraie femme  » assoit par là même le fait quʼil est lui-même un «  vrai homme  ». Le passage à une structure «  biopolitique  » (Foucault 1978, 274–75) implique que la norme importe plus que la Loi. Cette norme concerne les corps, la manière dont ceux-ci doivent se mouvoir, vivre, aimer, travailler, interagir. En outre, si lʼon suit J. Butler, elle est constitutive des corps : un corps qui nʼest pas normé ne reçoit pas le statut de corps, ou alors celui de corps «  abject  » (1993, 3), une figure repoussoir qui sert à renforcer un peu plus la légitimité et la désirabilité des corps qui respectent la vérité de leur sexe. Il faut dʼailleurs bien lire «  vérité de leur sexe  » comme le rapprochement de deux idées (la vérité, le sexe) : en effet, ce nʼest pas tant que le sexe doit être vrai, mais bien quʼil est, par une formidable concaténation, vérité.
Ces propos théoriques peuvent facilement sʼéprouver dans la plus ordinaire des conversations. Les personnes trans, en rompant le pacte de vérité de la sexuation des corps (en refusant leur immuabilité, par la transition), se retrouvent souvent aux prises avec la nécessité de dire leur sexualité, en raison de lʼassociation stricte que la culture occidentale opère entre sexuation et sexualité. Lʼun ne va pas sans lʼautre, puisque lʼun (la sexuation) produit lʼordre de lʼautre (la sexualité). La personne trans peut alors adopter deux postures face à cette incitation à se dire : soit elle confirme que sa sexualité a changé, et confirme par là lʼhétérodirectionnalité du désir, ainsi que la stricte production de la sexualité par la sexuation ; soit elle affirme que son désir reste identique mais celui-ci sera alors automatiquement requalifié comme lesbien ou homosexuel, mettant souvent lʼinterlocuteur dans lʼembarras : si le choix dʼobjet était possible dans lʼhétérosexualité, pourquoi vouloir «  changer  »â€¯? Pour le dire plus clairement : les femmes trans sont souvent sommées de confirmer leur désir pour des hommes, étant entendu que ce désir hétérosexuel est constitutif des femmes. Elles auront beaucoup plus de mal à sʼaffirmer comme lesbiennes, dʼautant plus dans un contexte de durcissement essentialiste des identités (jʼy reviendrai ci-après). Un homme trans ayant été hétérosexuel prétransition aura sans doute toutes les peines du monde à faire reconnaître son désir (apparemment constant, du simple point de vue du choix dʼobjet) pour des hommes comme désir homosexuel. Ces contradictions montrent bien à quel point la notion dʼorientation sexuelle et ses contenus (les «  personnages  », pour parler comme Foucault, de la lesbienne, du gay, etc.) sont dépendants dʼun ordre lisible de la sexuation. Une géographie queer implique donc de traverser les multiples acceptions du terme «  queer  », mais aussi de rendre compte de tout ce qui queerise, de tout ce qui prolifère en sʼextrayant de la norme. Sans vouloir réduire le queer à des pratiques individuelles, ni même à la sexualité, il semble incontournable dʼévoquer les personnages queer que crée le franchissement des frontières de genre, race et classe. Par ailleurs, les modalités selon lesquelles la sexuation est considérée comme le plus petit dénominateur à partir duquel les individus peuvent être classés, compris et appréhendés ont une longue histoire. Aussi la cartographie qui se déploiera dans ce chapitre examinera-t-elle non seulement la manière dont les sciences (biologie, anatomie, médecine) ont imposé le modèle sexué comme grille dominante de description des humains, mais aussi comment ce que jʼappelerai une mystique de la science118 a empêché que ce paradigme soit réévalué, quand bien même, nous le verrons, il a existé une riche tradition de remise en cause de la binarité de sexe.
Je souhaite ici signaler deux données contextuelles qui rendent cette discussion intrinsèquement polémique. Premièrement, il existe toute une littérature populaire de self-help (développement personnel), dédiée aux questions de sexe et de genre. Ces guides prolongent la tradition des guides de séduction et de bonne conduite, et sʼemploient à expliquer les problèmes de relations amoureuses hétérosexuelles sous le prisme dʼune différence sexuelle lue comme fondamentale. Men are from Mars, Women are from Venus de John Gray, paru en 1992, en est lʼexemple le plus connu. Dans cet ouvrage, J. Gray pose que «  les ‹ valeurs › des hommes et celles des femmes sont essentiellement dissemblables  » (21) et utilise ce présupposé pour inventer des modes de comportement permettant une meilleure compréhension entre les personnes, conçue comme compréhension entre les sexes, ces derniers étant considérés comme fondamentalement «  opposés  ». Gray demande à ses lecteurices dʼimaginer que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et quʼelles et ils ont oublié ces origines célestes pour vivre sur Terre119. Cette métaphore, dont découle le prisme sexiste de lʼouvrage, expliquerait lʼorigine de la discorde. Cet ouvrage très connu en a inspiré de nombreux autres120, comme Why Men Donʼt Listen and Women Canʼt Read Maps (2000) de Allan & Barbara Pease, suivi (entre autres) de Why Men Can Only Do One Thing at a Time & Women Never Stop Talking (2003) ou encore Why Men Want Sex & Women Need Love (2009). On pensera aussi au Men Are Like Waffles, Women Are Like Spaghetti (2017) de Pam et Bill Farrell, dont le titre savoureux met en évidence la formule sur laquelle se fondent tous ces ouvrages : en substance, la différence sexuelle est métaphorisée pour atteindre un contraste homme/femme maximal. Peu importe que les hommes soient des hommes parce quʼils viennent de Vénus, ou parce quʼils sont analogues à des gaufres dans leur désir de compartimentation : cʼest la différence et le caractère apparemment irréconciliable entre deux types dʼindividus qui fournissent leur matière à ces ouvrages et qui permettent dʼinstaller la promesse, telle celle de John Gray, «  de mieux nous comprendre  » (dans les sous-titres respectifs des ouvrages) ou chez les époux Farrell de «  comprendre et savourer nos différences  »121. Il est clair ici que ces ouvrages dʼopinion mettent en Å“uvre une pensée circulaire : la mésentente entre hommes et femmes prouve leur différence, et la réconciliation nʼest possible quʼen acceptant ladite différence. Fâchés ou réconciliés, peu importe : hommes et femmes ne peuvent exister que sous le patronage de ce différentialisme. Ces ouvrages ne sont dʼailleurs pas intégralement des tissus de mensonges : leur force réside même dans leur capacité à nommer des éléments de discorde quʼon pourrait aussi bien trouver dans un ouvrage féministe (les disputes autour de la vaisselle, du manque dʼécoute, etc.). Cependant, les anecdotes sont traitées sous un prisme dépolitisé, qui détache totalement les relations interpersonnelles des rapports de pouvoir et des violences systémiques. On pourrait balayer ces ouvrages dʼun revers de main : toutefois, leur succès en librairie est révélateur dʼune demande au sujet des relations hommes/femmes, autrement dit, dʼun désir de vérité à lʼendroit de la sexuation.
Ce corpus dʼouvrages quʼon pourrait rattacher à la pop psychology a été depuis complété par une nouvelle vague dʼécrits qui puise notamment dans les neurosciences pour enfin trouver un principe explicatif satisfaisant de la différence. Depuis Brain Sex (1989) de David Jessel et Anne Moir, de nombreux·ses chercheur·ses se sont attaché·es, non à décrire les différences entre hommes et femmes, mais les différences entre un cerveau masculin et un cerveau féminin. La philosophe et psychologue Cordelia Fine explore cette relecture de la différence de sexe au prisme des neurosciences. Elle évoque ainsi une somme dʼouvrages à succès, comme The Female Brain (2006) de Louann Brizendine ou Why Gender Matters (2005) de Leonard Sax qui situent la différence sexuelle au niveau du cerveau. C. Fine critique leur argumentaire en posant que lʼesprit nʼest pas «  une entité discrète enveloppée par le cerveau  »122 (2010, xxvi). Elle pointe le fait que dans ces études, le cerveau est pensé comme une entité autonome, détachée du milieu vivant qui pourtant contribue à façonner nos idées, nos perceptions et nos biais, comme lʼont montré de nombreux travaux en psychologie sociale. Il est donc capital de reconnaître que la recherche de la vérité du sexe est transversale : si elle est plus lisible pour le grand public du côté des rayons de développement personnel, la recherche scientifique nʼest pas en reste. Le chercheur Jeffrey W. Lockhardt estime ainsi que plus de 1100 articles scientifiques ont été publiés en 2021 sur la différence sexuelle, tandis que les agences nationales de la santé aux États-Unis (NIH ou US National Institutes of Health) ont choisi «  lʼétude du ‹ sexe comme variable biologique ›  »123 comme critère de leurs attributions de financement, dont le budget sʼélève à 41 milliards de dollars (2022).
Les fictions des origines interstellaires de lʼhumanité et le goà »t pour les neurosciences prolongent un discours beaucoup plus ancien sur la différence sexuelle qui, selon les époques, se fixe sur des éléments divers, réifiés (le plus souvent corporels) en sites de la différence sexuée. Au début du XXe siècle, la découverte des Å“strogènes et de la testostérone, et de leur rôle dans le développement de caractères sexués secondaires constitue ces hormones comme sites privilégiés de la différenciation sexuelle ; les parties génitales, aussi, sont un site fréquent de cette inscription -— bien quʼil nʼen soit pas toujours allé de la sorte (Laqueur, 1992[1990], 86). Les lectures se suivent, ne sʼexcluent pas entre elles. Le philosophe Thierry Hoquet nous dit ainsi que «  [lʼ]ʼessentialisme était chromosomique au début de la génétique puis est devenu génique dans les années 1990  » (2016, 197). Il conclut à lʼissue de son exposé que «  [l]e sexe est une affaire de développement. Aucun élément discret, caché au cÅ“ur de nos cellules, nʼen tient seul la clé ultime et définitive  » (198). Cordelia Fine lui fait écho lorsquʼelle affirme que «  nos hormones répondent à la vie que nous menons, brisant la division erronée entre la biologie interne et notre environnement externe. Ainsi, nous ne devrions pas être surpris·es dʼapprendre que ce ne sont pas seulement les hormones des mères qui changent pendant la transition vers la parentalité, mais aussi celle des pères  »124. Les récits de la différence, scientifiques ou non, ont toutefois au moins un mérite : ils mettent en évidence que la quête de vérité que nous associons en Occident à la sexuation des corps est indissociable dʼune quête de lʼorigine unique, qui, lors de nouvelles découvertes, conduit à la réification de fragments de corps, censés contenir le principe organisateur de nos différences (quʼil sʼagisse de parties génitales, dʼhormones, de cerveaux). Peu importe la réalité de la différence, ce qui importe, cʼest de la saisir, et en la localisant, de confirmer son statut de principe incontestable. Cette réaffirmation tautologique de la différence ne contrarie pas seulement toute méthodologie scientifique qui se respecte : elle a des conséquences culturelles et sociales, puisque la différence sexuée organise nos vies. À lʼépoque contemporaine, le discours de la différence sexuée a nourri deux mouvements réactionnaires sur lesquels il convient de sʼarrêter, puisquʼils occupent une place médiatique conséquente, et contrarient le projet de géographie queer auquel je mʼattelle — jʼen arrive donc ici au second point contextuel quʼil me semble important de signaler.
Le début des années 2010 a connu deux mouvements conservateurs, que lʼon pourrait qualifier de backlashes125 ; bien quʼils possèdent une dimension internationale, dans la mesure où lʼon peut en rencontrer des avatars dans plusieurs pays occidentaux, ils sont plus lisibles dans le cas de la montée réactionnaire et homophobe pro-famille en France (avec la Manif «  pour tous  ») et dans le cas des femmes cisgenres transphobes en Angleterre. En 2012, en France, dans le contexte du projet de loi du «  Mariage pour Tous  » proposé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, un mouvement opposé à lʼaccès des couples lesbiens et gays au mariage se constitue, réunissant une frange conservatrice, souvent de confession catholique, qui revendique la naturalité du couple hétérosexuel et refuse lʼaccès au mariage pour les personnes LGBTQIA+ ainsi que leur droit à la parentalité -— bien que celle-ci ait déjà été un fait dans de nombreux cas, et non une simple possibilité comme cela est parfois affirmé. À lʼoccasion des débats à lʼAssemblée Nationale, et des manifestations du groupe La Manif pour tous, cʼest la naturalité des différences de genre qui est réaffirmée. Loin dʼêtre une seule opposition contextuelle à un projet de loi, les manifs de «  La Manif  » servent de catalyseur à un ensemble dʼidées conservatrices, parmi lesquelles la stricte division de lʼhumanité entre les catégories «  homme  » et «  femme  » ou encore la sacralité du mariage hétérosexuel et son association essentielle à la procréation (elle-même pensée comme moyen de prolonger la division sexuée, en éduquant garçons et filles selon leurs rôles à venir). Une affiche du groupe présente ainsi les silhouettes dʼun petit garçon et dʼune petite fille, identifiables par leurs atours respectifs de chevalier et de princesse, sous lesquels un slogan affirme : «  Pas touche à nos stéréotypes de genre !  ». La phrase a pu faire sourire à lʼépoque, puisque la formule reconnait, malgré son emphase, la nature stéréotypique des rôles de genre représentés ; néanmoins, ce type de représentations sʼappuie sur un discours bien rodé confondant sexe et genre, rejetant du côté de la «  théorie du genre  » les encombrants questionnements associés à ces notions, pour mieux affirmer une nécessaire binarité, en lien quasi systématique avec lʼenfant. Ici représenté·e en guerrier ou princesse, il ou elle est figuré·e sur un autre visuel comme la fusion de ses deux parents126, tandis que le texte de lʼaffiche réclame : «  Un père – Une mère – Droit de lʼadopté  ». Il y aurait beaucoup à dire sur ce mouvement, et les dommages quʼil a occasionnés pour les personnes LGBTQIA+ ; je lʼévoque ici pour souligner comment ce combat visant à réserver le mariage aux personnes hétérosexuelles était lié, du fait même de leurs militant·es, aux questions de genre, de sexe, et à la naturalité supposée de certaines formes de vie (famille hétérosexuelle reproductive, re-produisant des hétérosexuel·les). Cette naturalité est toujours étroitement associée à la vérité : lʼhétérosexualité est la vérité de la famille, la famille est la vérité de lʼhétérosexualité, et tous ces invariants se renforcent dans un gigantesque discours circulaire, qui sous des dehors affirmatifs (être pour la famille, pour tous) vise en réalité à lʼexclusion du champ social de tout ce qui nʼest pas conforme à son programme normatif.
Par ailleurs, la plus grande visibilité des personnes trans dans lʼespace public, notamment médiatique, depuis les années 2010, a entraîné un fort backlash de «  féministes  » se définissant comme «  radicales  » et désignées comme «  TERFs  » (Trans Exclusionary Radical Feminists) par leurs détracteurs (dont je fais partie). Sʼintéresser aux TERFs semblera peut-être nous éloigner de la Manif pour Tous – en réalité, le déplacement sur lʼéchiquier politique nʼest pas si important. Le mouvement TERF puise ses fondements dans le féminisme différentialiste des années 1970, dont les militant·es conservent quelques arguments choisis, sans les réexaminer (la violence masculine associée au pénis, lʼidée dʼune nature féminine déterminée par le corps). En effet, les TERFs acceptent lʼidée dʼune construction sociale des comportements, mais rejettent en revanche la possibilité de questionner le sexe, qui leur apparaît comme une distinction biologique fondamentale. Dans ce raisonnement paranoïaque, les femmes trans ne peuvent trouver leur place dans les milieux féministes, puisquʼelles seraient «  en réalité  » des hommes. Elles sont dépeintes de manière routinière comme des hommes déguisés, infiltrés, utilisant les atouts de la féminité pour pénétrer des espaces féministes et violer leurs résidentes. Les hommes trans, quant à eux, sont bien vus comme des hommes, ou en tout cas, leur simple volonté dʼêtre identifiés comme tels leur vaut dʼêtre également exclus de ces cercles «  féministes  ». Les hommes trans sont alors vus comme des traîtres à la cause, ayant choisi de rallier lʼennemi masculin et donc patriarcal. Dans leur cosmologie, ce ne sont pas le sexisme et les violences patriarcales qui sont le premier danger pour les femmes. La simple existence des personnes trans constitue pour elles une violence, puisquʼelles croient que rendre plastiques les catégories de genre équivaut à une perte identitaire pour les femmes. À cet égard, le fait pour une femme trans de se présenter comme femme leur apparaît comme le vol de caractéristiques qui sont les leurs par fait de naissance. Leur conception aristocratique du féminisme ne repose donc pas sur lʼidentification de situations dʼoppression partagées, mais sur un refus de la complexité ancré dans lʼanatomie. Quʼimporte que le féminisme ait été notamment fondé par le «  on ne naît pas femme, on le devient  » de Simone de Beauvoir (1986[1949], 13) : être femme, pour les TERF, consiste dʼabord à être femelle -— ce qui, même au niveau de la biologie est extrêmement simpliste et réducteur. Au-delà de la focalisation sur les personnes trans, le «  terfisme  » sʼintègre très bien dans les discours dʼextrême droite et leurs valeurs que sont la haine de lʼartificialisme et de lʼillusion, opposés à lʼidentité stable et souhaitable de toute chose. Cette absence de «  vérité  » (et donc de probité morale) est projetée sur un ou plusieurs ennemis identifiables dont lʼéradication permettrait la purification du corps social (en continuité avec le corps féminin pur qui en assure la reproduction).
Pourquoi évoquer ces questions dans un ouvrage consacré au design des cuisines ? Ce lieu, en tant quʼespace assigné aux femmes, sera investi dans les pages à venir comme un espace dʼautonomie inattendu, expérimental, peut-être révolutionnaire. Aussi mʼest-il impossible dʼignorer que le champ de forces dans lequel je me situe est traversé, dʼun côté par la volonté de réaffirmer un ordre où les femmes sont «  naturellement  » associées à la domesticité et, dʼautre part, par le désir totalitaire de verrouiller la catégorie de «  femme  », et dʼen faire un outil de lutte réservé aux plus privilégiées. La cuisine que je souhaite imaginer ne sera pas le lieu dʼun retour ; les personnes potentiellement concernées par cette réappropriation seront celles-là mêmes qui ont subi lʼassignation aux affaires domestiques, les femmes, donc, à la condition que cette catégorie ne soit pas mobilisée comme un invariant ou un concept-frontière permettant de policer les plus vulnérables. Il serait même plus juste de dire que mon projet théorique sʼadresse aux victimes du sexisme, plutôt quʼà des femmes. Cette dernière phrase pourra irriter, car qui est victime du sexisme, sinon les femmes ? Mon exploration de cette catégorie visera précisément à montrer son instabilité, et son opérabilité partielle dans les luttes politiques, particulièrement dans le contexte du backlash LMPT et TERF qui est le nôtre.
Lʼobjectif de ce chapitre sera triple : premièrement, défricher lʼépistémé sexe/genre, de manière aussi synthétique que possible, afin de comprendre le fonctionnement de ces catégories, et la manière dont elles informent la catégorie de femme dont je ferai souvent usage dans cet écrit ; deuxièmement, la définition de «  femme  » me servira à mieux comprendre le fonctionnement de la binarité de genre et du système politique et relationnel dont elle est le fondement, le patriarcat ; enfin, ainsi outillé dʼune compréhension plus fine des binarités structurantes de la culture occidentale contemporaine (du «  centre  »), je tâcherai de voir en quoi il est possible de queeriser ces invariants. Ceci me conduira à poser une définition critique du terme «  queer  », définition qui ne sera pas stable, solide, mais plutôt plastique, souple, sans être floue ou gazeuse. Lʼidée sera de visibiliser ce que jʼentends par queer (y compris des idées contradictoires) et de caractériser mon projet de réappropriation de la cuisine par le design grâce à cet appareil théorique. Tout au long de ce parcours, je me référerai à un travail de dessin spatialisant ma compréhension du sexe, du genre, du queer. Ce travail de dessin lui-même participe dʼune «  queerisation  » du concept de géographie souvent mobilisé (quoique brillamment) par des auteurices qui nʼinvestissent pas les possibles spatiaux des arts visuels, notamment du dessin ou de lʼécriture dessinée. Cette géographie queer vers laquelle je tends ne demande pas «  où est le queer  », mais tâche à la manière dʼune carte de Tendre dʼen répertorier les points saillants, avec la conscience aiguë que ce territoire se définit davantage par sa capacité à être traversé de tremblements de terre et glissements de terrain que délimité par un véritable périmètre. Ce seront donc des accidents quʼil me faudra cartographier ; et jʼinvite les lecteurices à se perdre sur ce territoire, plutôt quʼà y tracer de nouvelles frontières127. On croisera dans ces pages des théoricien·nes attendu·es sur les questions de sexualité (Michel Foucault), de biologie du sexe (Stacy Alaimo, Thomas Laqueur, Anne-Fausto-Sterling, Priscille Touraille, Nancy Tuana) de genre (Judith Butler, David Gauntlett, Erving Goffman, Nicole-Claude Mathieu, Paul B. Preciado, Eve Kosofsky Sedgwick, Beverly Skeggs) ou encore des écrits féministes (Colette Guillaumin, Andrea Long Chu, Donna J. Haraway, Monique Wittig), certains dédiés aux questions de transidentité (Emmanuel Beaubatie, Jack Halberstam, Julia Serano, Riki Wilchins). Jʼaurai à cÅ“ur de mettre en friction ces pensées reconnues, incontournables avec des écrits plus récents, notamment dʼactivistes et artistes diffusant leurs travaux sur les réseaux sociaux (Shon Faye, Laboria Cuboniks, Juliet Drouar, Marguerin Le Louvier, Barbara Métais-Chastanier). Ce choix sʼexplique par la volonté de reconnaître les apports conséquents du travail militant de mouvements queer/féministes, travaux qui sont souvent invisibilisés par les contributions universitaires quand bien même elles viennent a posteriori (hooks, 2020[2000], 40). Il me semble également que des écrits moins théoriques (quoique sérieux et argumentés) voient leurs auteurices ancrer plus volontiers leur acte dʼécriture dans un cadre pragmatique, orienté vers lʼaction, la conception de lois, dʼactions collectives ou de projets de soutien, qui sont une matière cruciale pour forger de nouveaux concepts. Et dans la mesure où je mʼinscris dans la discipline du design, il semble nécessaire de toujours examiner comment, dans les usages, les concepts que manipule la théorie trouvent à sʼincarner. Ce désir doit être doublé dʼune précaution : lʼidée ici nʼest pas dʼépuiser le contenu des catégories composant les binarités. La tâche serait infinie, et sans doute un peu stérile. La dimension relationnelle propre aux catégories importe en effet plus que les catégories elles-mêmes (Wittig 2013[2001], 41) ; aussi stimulant que soit lʼexercice de définition des catégories, il finit sans doute par faire le jeu de lʼintention catégorielle initiale. Enfin, je convoquerai également un corpus dʼétudes queer (déjà présent dans mes énumérations ci-dessus) pour questionner la partition homo/hétéro (Sara Ahmed, Leo Bersani, Didier Eribon, Teresa de Lauretis, Muriel Plana) et investirai en conclusion la question du temps et de lʼespace queer (Gloria Anzaldúa, José Esteban Muñoz, Ricardo Rodriguez Robles, Elisabeth Wilson).
Lʼintitulé de ce chapitre est probablement trop ambitieux : comment réaliser un tel paysage dans ces pages, qui nʼont pas pour objet premier la résolution de cette question ? Quel fil tirer dʼabord de lʼécheveau sexe-genre pour en comprendre les ramifications ? Commençons peut-être par des faits simples, à défaut dʼêtre tout à fait universels : pour une personne vivant en France (en Occident, peut-être128), il est très difficile dʼéchapper au genre. On devrait même dire, plus précisément, quʼil est difficile dʼéchapper au «  genrage  », notamment le procédé linguistique par lequel nous nous situons, les un·es et les autres, dans une réalité de genre. À titre personnel, au cours de ma transition, jʼai vu se rejouer un micro-drame dans le genre à chaque fois que je rentrais dans un commerce. On me disait au choix «  Bonjour Monsieur  » ou «  Bonjour Madame  » (plus rarement, «  Bonjour  », ce qui aurait pourtant eu le mérite de résoudre les incertitudes et risques dʼimpolitesse)129. Dans cet exemple anecdotique, deux actes sont liés sinon imbriqués : reconnaître ma présence, en tant quʼêtre humain, partenaire social, client·e ; reconnaître que jʼai un genre. Pour moi, la nature hautement processuelle de cet acte est évidente à chaque fois que mon interlocuteurice hésite ou se trompe ; pourtant, nous sommes toustes concerné·es par ces minuscules actes de reconnaissance dans le genre, quand bien même lʼhabitude et la certitude tendent à rendre ces processus interactifs et relationnels tout à fait transparents. Mon exemple de la boutique est volontairement restreint : il concerne le niveau de lʼidentité qui me fait voir, au choix, un homme ou une femme. Mais le genre est plus quʼun système dʼétiquetage : la bicatégorisation implique quʼun contenu se tient derrière lʼétiquette. Quels que soient les indices qui conduisent læ boutiquièr·e à me genrer au masculin (stature, signes corporels, vocaux, vêtements, choix de coiffure, etc.), cette reconnaissance primitive dʼun genre sʼaccompagne dʼun ensemble dʼimplicites concernant ma nature, mon comportement, lʼattitude que lʼon adoptera avec moi, ce quʼil est possible ou non de me dire, et ainsi de suite. Le système de genre, tel que je lʼévoque par le prisme dʼune expérience commune semble donc être caractérisé par deux aspects saillants : il est bicatégoriel (il nʼexiste pas dʼalternative concrète à «  Madame  » et «  Monsieur  ») et il implique une somme de savoirs, plus ou moins définis, plus ou moins partagés sur ce que ces catégories homme/femme supposent de lʼindividu.
Nous savons donc genrer, et nous apprenons très tôt à le faire pour fonctionner socialement. Aujourdʼhui, les tenants du backlash (tour à tour identifié comme anti-mariage pour tous, anti-woke, anti-islamo-gauchistes… selon la nomenclature du moment permettant de démoniser lʼadversaire) aiment à parler dʼune «  théorie du genre  ». Opérant sur une traduction incorrecte de «  gender theory  » (dont le singulier recouvre une multiplicité dʼécoles de pensée, plutôt quʼun projet idéologique distinct), ces pensées conservatrices nient un fait essentiel : nous opérons toustes, conservateurices comme personnes dites «  wokistes  » sur la base dʼune théorie du genre, la nôtre. Cʼest-à -dire que nous nous faisons toustes une idée de ce quʼest le genre et de la manière dont il doit fonctionner, quand bien même nous ne le conscientisons pas. Chaque théorie du genre propre à lʼindividu doit beaucoup à des conceptions et idées collectives, de même quʼà lʼexpérience. Ainsi une personne ayant rencontré des individus trans aura peut-être une définition moins restrictive de ce que recouvrent les catégories «  homme  » et «  femme  »â€¯; ou, au contraire, paniquée par ce que cette rencontre suggère de lʼétat de ses catégories, tiendra à réaffirmer une différence stricte et une définition très policée de qui «  mérite  » dʼêtre reconnu·e comme homme ou femme. La réalité désignée par les termes homme/femme est si épaisse quʼun arbitrage a été historiquement effectué entre le fait biologique et le fait social. Ce sont les deux réalités désignées par les termes de sexe (la manière dont le corps est sexué, à la naissance) et de genre (tous les attentes et comportements sociaux accolés aux identités de «  femme  » et «  homme  »). On a coutume de désigner cette double réalité sexe/genre par le couplé donné/construit. La distinction a été établie pour la première fois par lʼanthropologue Margaret Mead en 1935 dans son ouvrage Sex and Temperament in Three Primitive Societies, entre sexe biologique et comportement social. Le terme anglophone de «  gender  » est utilisé dès les années 1950 par le médecin controversé John Money130 qui le popularise davantage dans les années 1970 (Fausto-Sterling 2000, 4 ; 66 ; Beaubatie 2021, 30). La difficulté théorique ne réside pas en réalité dans la définition de «  sexe  » et «  genre  ». On arrive en effet assez bien à distinguer ce qui peut être donné (avoir un utérus, un vagin, ses règles, etc.) de ce qui peut être construit (être appelée «  Mademoiselle  », mettre du rouge à lèvres, porter des jupes, etc.). En revanche, cʼest la relation qui existe entre sexe et genre et la nature que lʼon accorde à cette relation (fixe, mouvante, produite, etc.) qui est déterminante pour la constitution dʼune théorie individuelle et collective du genre.
Que le genre soit produit, quʼil relève dʼune expression qui peut être plus ou moins gommée, soulignée, voire outrée, semble être un fait assez bien admis par le grand public, en Occident, en 2024 (et sans doute depuis quelques années). Lʼexistence même dʼun poliçage de genre en est la preuve : lorsque la tenue dʼune femme est jugée «  peu féminine  », ou au contraire quʼun homme est jugé «  efféminé  », cʼest bien que lʼon juge de choix stylistiques, de présentation corporelle, qui nʼont rien dʼinvariants naturels. Cʼest plutôt lorsquʼon sʼattaque aux espaces que recouvrent ces parapluies «  sexe  » et «  genre  », et à la relation entre les deux termes qui en découle, que les choses se corsent. Je mettrai ainsi en évidence quatre grands pôles servant de socle à nos théories collectives du genre, en mentionnant à chaque fois la position qui est ménagée pour les personnes trans au sein du système en question. En effet, il me semble que la manière dont les personnes trans sont perçues par la société constitue un indice puissant quant à nos représentations sur le sexe, le genre, et sur les fonctions et valeurs associées à ces notions. Bien entendu, il existe sans doute plus que quatre articulations possibles entre les deux concepts ; néanmoins, il est possible de reconnaître au moins ces quatre approches saillantes :
Le genre reflète le sexe, et même, doit le refléter. Cʼest la position la plus conservatrice. De ce point de vue, «  sexe  » et «  genre  » sont quasiment analogues et sont pensés dans une forme de continuité complète. Cʼest la raison pour laquelle la Manif pour tous peut écrire sur ses affiches «  Pas touche à nos stéréotypes de genre !  ». La dimension stéréotypée ne leur apparaît pas comme un problème puisquʼelle est lue comme la cristallisation naturelle, cʼest-à -dire inévitable, du sexe par le genre. On se trouve bien ici dans le contexte dʼun «  rapport expressif  » entre le sexe et le genre (Goffman 1979, 3 ; Bourcier 2002, 6), sauf que dans ce cas, lʼexpression est considérée comme directe, sans ambiguïté ou écart entre le signifiant et signifié. Le paradigme conservateur repose donc à la fois sur lʼidée dʼun «  vrai  » genre (nous sommes des hommes ou des femmes, par notre naissance) et du genre comme vérité (il nʼexiste pas de distinction entre ce qui est donné et ce qui est construit, puisque ce qui est construit se contente dʼémuler ce qui est donné). En outre, un impératif moral sʼadjoint à la continuité sexe-genre : il est admis que des formes de discontinuité existent (sexualité non hétérosexuelle, expression de genre ambiguë , voire contraire à celle qui est attendue) mais elles sont perçues comme déviantes et non valides131. Dans cette «  théorie  », les personnes trans sont perçues au mieux comme malades (elles se trompent sur leur propre nature), au pire comme duplices (elles trompent les autres sur leur propre nature). Ainsi les personnes trans, pour les tenants de cette idéologie, doivent être soignées, écartées ou supprimées132.
Le genre exprime le sexe, et des écarts entre lʼexpression sociale et le donné corporel sont possibles, et parfois désirables. Cette vision est plus progressiste (le genre nʼest pas une fatalité découlant du sexe, vérité de lʼindividu) mais ne renonce pas totalement au différentialisme. Elle correspond au «  constructivisme modéré  » identifié par Priscille Touraille (2011, 87) qui se caractérise par la volonté de tracer une «  frontière nette  » entre ce qui relève du sexe ou ce qui tient du genre. Dans ce modèle, on peut critiquer à loisir lʼoppression de genre et les attentes formulées à lʼendroit de tel ou tel genre. On peut critiquer les injonctions genrées (par exemple «  un garçon ne doit pas pleurer  ») mais sans remettre en question le fait quʼil y ait des hommes et des femmes, par nature. Cette vision permet aussi potentiellement dʼinclure les personnes trans qui peuvent choisir lʼexpression de genre qui leur convient, et accéder aux chirurgies nécessaires pour corriger la réalité irréductible du sexe. Il existe des activistes et auteurices trans dont la pensée a pu rejoindre cette approche : Julia Serano, par exemple, ne parle pas dans ses premiers écrits de supprimer le genre ou de le dépasser. Elle distingue plutôt un «  genre expérientiel  »133 distinct du genre social et du sexe biologique pour défendre la validité des transitions (2016[2007], 225).
Le genre comme le sexe sont tous deux construits et ne peuvent être réduits à une seule réalité. Cʼest la position quʼont développée les études queer en déconstruisant le genre, et notamment les écrits de Judith Butler. Pour ellui, il nʼy a pas de réalité de sexe qui ne soit saturée par les stéréotypes de genre. Lʼapproche est intéressante, parce quʼelle renonce à lʼidée quʼil y aurait des réalités non sociales. Par exemple, on parle souvent de la taille des hommes et des femmes, comme exemple inattaquable de la différence irréductible entre deux types dʼindividus. Priscille Touraille explique que cette réalité nʼest pas aussi «  naturelle  » quʼil y paraît, et que la norme de couple qui veut quʼun homme cisgenre se reproduise avec une femme cisgenre plus petite que lui a favorisé la prévalence de certains gènes dans lʼespèce -— faisant apparaître un fait social (les hommes préfèrent des femmes plus petites, en vertu des valeurs patriarcales qui romantisent la domination) comme un fait naturel (2008). Le constructivisme radical sʼaccompagne en général dʼun projet politique : trahir le genre (chez Preciado, par exemple), le «  hacker  », le subvertir, pourquoi pas le détruire, multiplier les identités disponibles jusquʼà ce que les catégories «  homme  » et «  femme  » apparaissent comme nulles et non avenues. Pour le communisme révolutionnaire qui se fonde sur lʼapproche féministe, le genre «  doit être anéanti lors du processus révolutionnaire  » (Gonzalez 2022[2012–13], 20).
Le genre comme le sexe sont des constructions sociales, mais pas au même titre ; sexe et genre ne sont pas des termes équivalents et désignent des réalités quʼil convient de distinguer. Cʼest la position de Priscille Touraille qui critique lʼ«  épistémologie constructiviste radicale  » (2011, 87) -— en gros, la position décrite ci-dessus -—dans la mesure où elle lui semble relever dʼun égarement épistémologique. P. Touraille trouve ainsi dommageable le fait de nier «  [l]ʼexistence dʼune matérialité des corps indépendante de la pensée  » (2011, 88) tout en affirmant avec Judith Butler que «  le sexe est du genre de part en part  » (Butler 2005, 71 ; Touraille 2011, 88). Le travail de Touraille a le mérite dʼinvestir le corps, là où un constructivisme radical réussit à mettre en évidence une forme dʼarbitraire du genre (après tout, quʼest-ce qui est vraiment masculin ou féminin ?) au prix dʼune négation partielle dʼune différence pragmatique (sʼil nʼy a pas de différence entre masculin et féminin, comme on lʼentend parfois, pourquoi les personnes trans se fatiguent-elles à transitionner ?). Aussi ne sʼagit-il pas tant pour P. Touraille de distinguer des réalités séparables sexe/genre que de nommer la nécessité de garder un concept de sexe, ce que la position constructiviste, si elle est exagérée et dogmatisée, peut éventuellement refuser au titre que «  tout est du genre  ».
Il paraît assez clair que la première position, réactionnaire, voire fasciste, qui repose sur une ignorance stratégique des derniers travaux sur le genre et le sexe, ne nous occupera guère ici — nous lʼavons déjà exposée et critiquée précédemment. En revanche, lʼarbitrage entre les trois autres visions est plus difficile, dʼautant plus que je les ai artificiellement isolées, et quʼelles existent plutôt comme de grands nuages dʼidées aux frontières poreuses. La seconde position pêche par sa timidité, et peut-être par son association à un moment historique. Lʼidée de critiquer les constructions genrées en maintenant la paroi étanche qui isole une réalité de sexe a été très populaire pendant la période du féminisme de seconde vague, même si des voix se sont rapidement élevées pour en contester les évidences (Colette Guillaumin) et que des textes antérieurs auraient permis dʼenvisager dʼautres fondements (les écrits de Simone de Beauvoir, notamment). Jʼécarte donc la deuxième position, puisquʼelle ne permet pas de saisir, comme le montre P. Touraille, les relations de production mutuelle «  non discursive  » (2011, 96) entre sexe et genre, qui interviennent notamment lorsque des normes de genre (former un couple avec plus grand ou plus petite que soi) produisent le sexe (par la reproduction de certaines caractéristiques génétiques). La position que jʼaimerais faire apparaître pour guider ce travail constitue un hybride des troisième et quatrième positions. Mon objectif nʼest pas de tracer des contours fermes autour des notions de «  sexe  » et de «  genre  »â€¯: il convient plutôt de réévaluer ces concepts en fonction du travail qui est effectué, sans envisager mettre un point final à ces questionnements. Cʼest de toute façon peu souhaitable, dans la mesure où les sciences de la vie ne comprennent pas encore complètement la manière dont la sexuation opère sur les corps des humains et que notre compréhension du sexe comme du genre est appelée à changer.
La troisième position, largement inspirée par Judith Butler, possède le mérite de saisir toute réalité (corporelle, sociale, culturelle) comme inséparable dʼun contexte de réception, cʼest-à -dire du fait social et culturel. Le constructivisme ne pointe pas nécessairement lʼartificialité des catégories de genre (encore quʼelle le peut) mais elle montre quʼil nʼexiste pas de réalité ex nihilo qui préexisterait aux rapports sociaux, et avant cela, linguistiques. Judith Butler montre ainsi que chercher un phénomène hors-langage revient à se placer soi-même dans une forme dʼouroboros logique :
faire référence naïvement ou directement à un objet extra-discursif requerra toujours la délimitation première de lʼextra-discursif. Et dans la mesure où lʼextra-discursif est délimité, il est formé par le discours même duquel il essaie de se libérer134 (Butler 2014[1993], 11).
Mais comme toute position, celle-ci comporte ses angles morts, ou une forme de disponibilité à des appropriations excessives et malheureuses. En disant quʼil nʼexiste pas de réalité du sexe qui ne soit aussi produite dans le langage, J. Butler ne dit pas que la réalité du sexe se résume à une réalité linguistique. Or, cʼest bien lʼimpasse dans laquelle le constructivisme des études queer sʼégare parfois135, comme le pointe Priscille Touraille (2011). J. Butler insiste dʼailleurs sur les risques inhérents à sa démarche, et précise que :
Le débat entre constructivisme et essentialisme manque ainsi complètement lʼenjeu de la déconstruction, dans la mesure où cet enjeu nʼa jamais été de dire que ‹ tout est construit discursivement › ; cet argument, quand il est amené, appartient à une forme de monisme ou de linguisticisme qui nie la force constitutive de lʼexclusion, de lʼeffacement, de lʼenfermement violent, de lʼabjection et de son retour disruptif à lʼintérieur même des termes de la légitimité discursive136 (Butler 2014[1993], 8).
Aussi, il est important de ne pas utiliser la dimension construite du sexe par le discours comme un principe organisateur total : le risque est de perdre la réalité du corps, et, comme le montre P. Touraille, de réduire la catégorie de «  sexe  » à un synonyme de «  genre  », distinction dʼimportance pour analyser la manière dont les corps sont constitués, matériellement et culturellement. Elle observe ainsi que :
Lʼusage généralisé du terme «  sexué  » dans les publications de sciences sociales pour qualifier la construction sociale du corps ne permet pas de faire la distinction entre les traits quʼun individu peut transmettre génétiquement à sa descendance (les seins, par exemple) et une péniplastie, quʼil ne transmettra jamais (Touraille, 2011, 95).
On pourrait aussi dire dans le même esprit que «  perdre les représentations biologiques faisant autorité sur le sexe, qui produisent des tensions productives avec le genre, revient à perdre beaucoup trop  »137 (Haraway 1988, 591). Autrement dit, il nous faut à la fois considérer que nos corps existent dans un continuum linguistique, et même que le langage solidifie ce qui est peut-être perçu comme un corps ; tout à la fois, le corps nʼest pas réductible à ces processus linguistiques. Cette position, paradoxale (il y a du corps en dehors du langage mais tout ce qui fait corps est saturé de processus linguistiques et discursifs) sʼappréhende particulièrement bien si on sʼoutille de méthodologies de design. En design, la question de lʼêtre ou de la nature des choses se déplace sur la question de lʼusage, du corps en acte, et donc se connecte à lʼhéritage matérialiste de la praxis. Reconnaître quʼil existe une réalité du sexe indépendante de la sexuation par les discours (lʼassignation à la naissance, par exemple) ne revient pas à essentialiser des caractères sexués, indépendamment des processus historiques et sociaux (Touraille 2011, 95). Plutôt, une position sur sexe et genre informée par le design permettrait de saisir les processus physiques et discursifs comme entremêlés et reliés par le principe du feedback : il nʼexiste pas de phénomène physique qui ne déclenche de saisie dans le domaine linguistique, pas plus quʼil nʼexiste de réalité conceptuelle qui puisse rester détachée du fait social. La question de la primauté de tel ou tel phénomène peut rapidement être écartée dès lors quʼon sʼintéresse aux usages, cʼest-à -dire au genre et au sexe en acte : comment fonctionnent-ils ? Comment sʼarticulent-ils, et surtout, avec quels effets pour les participant·es ?
La synthèse que je vais opérer entre constructivisme radical et matérialisme trans sʼinspire des travaux de féministes proches des sciences de la vie, comme Donna Haraway ou Elizabeth A. Wilson138. En effet, un des défauts du constructivisme radical revient à supposer que les sciences produisent automatiquement des cadres de lecture conservateurs. Elizabeth A. Wilson montre ainsi quʼen refusant les conclusions essentialistes et déterministes issues dʼanalyses scientistes, les théoricien·nes féministes se sont éloigné·es des sciences de la vie, plutôt que des thèses quʼelles critiquaient et qui en faisaient mauvais usage. Elle propose ainsi de montrer que la biologie est «  beaucoup plus dynamique que ce que les féministes ont supposé  »139 (2015, 5), tout en refusant les analyses déterministes. Elle affirme également que «  la biologie nʼest pas synonyme de déterminisme et la socialité nʼest pas un synonyme de transformation  »140 (9). Plutôt que de dissocier fermement des catégories (sexe/genre) et des aires de spécialité qui seraient plus à même de sʼen saisir (science de la vie/sciences sociales), nous allons donc à nous intéresser aux processus dynamiques qui fabriquent lʼindividu, plus particulièrement les femmes, au sein dʼusages et de pratiques particulièrement localisés dans les cuisines domestiques. De surcroit, mʼinscrire dans cet héritage de biologistes féministes ou dʼhistoriennes des sciences me permet dʼouvrir la question sexe/genre à un ensemble plus vaste de catégories qui contribuent à déterminer la manière dont nous nous comportons, dont nous nous comprenons nous-mêmes et dont nous interragissons. Donna Haraway défend ainsi lʼidée selon laquelle le genre, le sexe et la race ne sont pas des catégories indépendantes, préparant le terrain pour une analyse intersectionnelle plus large et plus pertinente :
Le genre et la race nʼont jamais existé séparément et nʼont jamais concerné des sujets pré-formés dotés dʼétranges génitoires et de couleurs bizarres. La race et le genre relèvent de catégories entrelacées, à peine séparables sur le plan analytique, extrêmement protéiformes, relationnelles141 (1997, 30).
E. A. Wilson dit «  dynamique  », Haraway propose «  relationnelle  », jʼavance «  feedback  » pour isoler un terme plus aisément reconnaissable dans lʼanalyse qui suivra : le genre, le sexe, la race, mais aussi la validité, la classe, lʼâge, les caractéristiques physiques sont autant de catégories à lʼ«  utilité stratégique  »142 (Haraway 1988, 594) qui, si elles sont dissociables de contextes précis pour lʼélaboration conceptuelle, ne doivent jamais cesser dʼêtre comprises comme des réseaux de sens en acte, des catégories qui nourrissent les usages autant quʼelles en résultent. Si le constructivisme nous propose de ne jamais regarder le monde sans saisir les processus discursifs qui déterminent sa mise en visibilité et en présence, il sʼagit moins pour nous dʼen déduire une qualité intrinsèquement abstraite du réel, quʼune dimension de réalisation par le langage, donc par des logiques relationnelles et processuelles. En somme, il nʼexiste pas dʼexpression unilatérale de genre, pas plus que le genre nʼest un concept unilatéral qui informerait des réalités, fussent-elles préexistantes ou dépendantes de cette qualification. Pour cette raison, jʼutiliserai souvent lʼexpression sexe-genre qui, si elle est un peu lourde, a le mérite de ne pas trancher immédiatement, dans telle ou telle analyse, ce qui relève dʼune catégorie ou de lʼautre, mais propose plutôt de considérer comme un continuum les manières dont le corps «  possède des traits sexués  » (Touraille 2011, 90). Lʼexpression sexe-genre recouvre la manière dont ces traits peuvent être renforcés par des comportements sociaux (la taille analysée par P. Touraille) ou lus à leur lumière, et enfin, la façon dont une «  hexis  » de genre (Bourdieu 1979, 193 ; Touraille 2011, 93) va venir encore travailler le corps. Mon énumération ici nʼa aucune valeur chronologique ou hiérarchique, et cʼest bien tout lʼenjeu : toutefois, il faut bien se placer à un endroit du cercle afin dʼen faire le tour.
Un dernier point mérite quʼon sʼy attache : la définition, à partir dʼune réalité ordonnée par les rapports de sexe-genre dʼun projet post-genre, ou de destruction du genre. Celui-ci nʼest pas systématiquement invoqué par les théoricien·nes des études queer, mais on le voit apparaître, ici et là , avec différents enjeux. Dans certains cas, il correspond à une problématique dʼidentité liée à la place des personnes non binaires dans la société. Pour ces personnes, lʼexistence de marqueurs M ou F à lʼétat civil, ou encore lʼusage de formules comme «  Monsieur  » ou «  Madame  » ne fait pas de place à leurs identités de genre143, voire en récuse la possibilité. Si on admet que le sexisme opère sur la base des stéréotypes de sexe-genre, il semble inévitable que seule une abolition de ces catégories et, dʼune certaine manière, un effacement de leur contenu soient la condition dʼune possible révolution féministe et queer. Cʼest un peu ce que suggère Juliet Drouar lorsquʼiel écrit que «  les militant·e·s queer […] se passent très bien des vocabulaires ‹ homme / femme ›, utilisent ‹ transpédégouine › et cʼest un acte politique des vies et du langage  » (2021, 130). Se passer des termes «  homme  », «  femme  », pourquoi pas ? À titre expérimental, comme manière dʼessayer dʼautres formes de vie, voire comme «  style de vie  » (Macé 2016) choisi pour soi-même, il peut sʼagir dʼune approche intéressante. Le collectif Laboria Cuboniks fait quelque peu écho à J. Drouar lorsquʼiels écrivent :
Quand la possibilité de la transition devint réelle et connue, la tombe sous le sanctuaire de la Nature se fissura et de nouvelles histoires -— bruissantes de futurs -—échappèrent au vieil ordre du ‹ sexe › […] Le temps est maintenant venu de détruire complètement ce sanctuaire et de ne plus sʼincliner devant lui en sʼexcusant piteusement du peu dʼautonomie qui a été gagnée144 (2018, 45).
Ce vocabulaire est séduisant : «  détruire  » lʼordre sexe-genre, ou, sur les pancartes des manifestations et les publications des réseaux sociaux, «  brà »ler  » le patriarcat. Si ces formulations possèdent leur place comme slogan, parce quʼils fédèrent des communautés et donnent de la force à celleux qui les composent, jʼavoue ne pas y trouver complètement mon compte, a fortiori quand il sʼagit dʼintroduire ce projet dʼécriture et de conception dʼune cuisine queer et féministe. Que faut-il brà »ler pour brà »ler le patriarcat ? Le siège de Total ? LʼÉlysée ? Un abattoir Charal ? Les hommes ? Certains hommes ? Ce nʼest pas clair. Dans le même esprit, comment «  détruire  » le sanctuaire de la Nature évoqué par Laboria Cuboniks ? Par ailleurs, nʼexiste-t-il pas des personnes pour qui les termes «  homme  » et «  femme  », tout chargés quʼils soient, restent des catégories habituelles, processuelles aussi, donc appropriables ? Parler dʼhommes et de femmes revient-il à mobiliser des «  catégories figées  » et à «  naturalis[er]  » celles-ci143:1 (Gonzalez & Neton 2022[2012–2013], 10) ? Jʼai en mémoire des conversations avec des personnes trans notamment, plus particulièrement des femmes trans, qui ont dà » se battre pour être reconnues comme femmes. Ce nʼest pas à dire quʼêtre femme ou homme est la destination obligatoire de toute transition de genre. On peut être non-binaire, comme je lʼévoquais plus haut, et il ne sʼagit pas ici dʼévaluer des identités, dʼestimer celles qui seraient légitimes ou non. Plus généralement, on ferait sans mieux de détruire, plutôt que le genre, le lien qui relie identité, valeur et pouvoir. Dans cet esprit, justement, pourquoi vouloir se départir de catégories qui, en plus de posséder une permanence et une réalité dans nos esprits, peuvent encore être des espaces de vie, sinon des terrains de jeu ?
Cʼest pour ces raisons, notamment, que je suis assez sceptique vis-à -vis de lʼidée de «  dégenrer  » nos environnements. Dégenrer, en tant que stratégie, ne mʼinspire pas grand-chose, parce que jʼobserve, notamment dans mon cours Queer[ed] Design, que lʼabsence de genrage lisible tend souvent, au niveau des esthétiques, à préparer un retour au neutre qui nʼest jamais un neutre, mais plutôt un masculin qui ne dit pas son nom. Jʼai pu voir, depuis 2016, des étudiant·es se livrer à des analyses144:1 hissant des objets fort critiquables au rang de productions subversives, au prétexte que ceux-ci nʼétaient ni roses ni bleus et donc «  unisexe  ». Il existe toute une somme de projets de mode «  agenre  » ou «  dégenrée  » dont lʼesthétique se veut minimale, impersonnelle145. Le dépouillement formel est censé être synonyme, dans ces projets, dʼabsence de genrage. Or, si on prend sexe-genre comme un système reposant sur un feedback, de tels vêtements existeront pour des usager·es : ils seront portés par des corps, possédant des «  traits genrés  » et des «  habitus genrés  »146 (Touraille 2011, 93) ; ces corps seront vus et lus en fonction dʼun bagage culturel contingent à lʼépoque, à lʼaire géographique, à la subjectivité des regardeur·ses, etc. Ponctuellement, les projets révolutionnaires qui appellent à «  dégenrer  » tel ou tel processus ne sont pas dénués dʼintérêt. Dégenrer les toilettes, par exemple, nous incite à nous interroger sur la manière dont les toilettes existantes participent à construire le genre et même le sexe sur un mode essentialiste, alors même que ce lieu est destiné à accompagner une fonction corporelle (la déjection) qui peut être vue comme universelle. Il existe également des expériences visant à «  dégenrer  » lʼéducation, tel cet·te enfant canadien, Storm, dont les parents avaient très publiquement refusé dʼannoncer le sexe-genre (Poisson 2011). Mais en imaginant que ces expériences soient couronnées de succès (ce qui est loin dʼêtre le cas, le backlash étant violent dans ces deux cas), elles ne peuvent effacer lʼhéritage historique du genre. On peut éventuellement décaler le genre dans une expérience présente, mais on ne peut provoquer une amnésie collective de ce que celui-ci nous fait ou nous a fait, de la manière dont nous avons été construit·es comme homme ou femme, des dimensions subjectives qui découlent des modes de socialisation. Et pour les personnes qui trouvent dans ces catégories un repos, ou une forme dʼadéquation, il semble quelque peu autoritaire dʼimposer un système qui fasse fi de ces mots, qui les prend, dʼune certaine manière, comme des catégories intrinsèquement oppressives alors quʼelles pourraient être déplacées et requalifiées. Lʼapproche cartographique dans laquelle je mʼinscris permet peut-être dʼéchapper à ces impasses147 que sont lʼimposition de comportements genrés, lʼidéal de destruction du genre ou lʼaporie pour qui refuse ces deux attitudes. Plutôt que de détruire quoi que ce soit, lʼapproche spatiale identifie des zones de creux, des espaces tampons, des franges que lʼon peut investir, dans la lignée des «  hétérotopies  » telles que les définit Michel Foucault (2004[1967], 17). Et pour que la marge puisse être investie, il faut reconnaître (à la manière dʼune reconnaissance, dans le langage martial) le champ de forces en présence, comme le propose Riki Wilchins lorsquʼelle écrit ce descriptif succinct de lʼappareil sexe-genre148 :
- Tout le monde doit être dans une boîte.
- Il y a seulement deux boîtes.
- Personne ne peut changer de boîte et personne ne peut être entre les deux.
- Vous ne pouvez pas choisir votre boîte (2010, ix).
On peut en effet, plutôt que de décrire ce que sont le sexe et le genre, montrer comment ils opèrent, cʼest-à -dire comment le système «  sexe-genre  » est indissociable dʼun ordre sexiste et patriarcal. Ici le propos de Wilchins fait écho à celui de Anne Balsamo, pour qui le genre est «  un concept frontière  » (1996, 9). Social, inné, construit, discursif -— le genre (ou le dispositif sexe-genre) est dʼabord un processus qui consiste à tracer une ligne dans le sable ou selon les mots de Wilchins, à créer des boîtes et un régime de règles qui les entoure. Pour cette raison, en designers, nous allons nous interroger sur la manière dont ces boîtes sont fabriquées afin de les démonter, les remonter, les recomposer. Nous commencerons par voir comment le concept de Nature peut informer et travailler la notion de genre, avant de nous attaquer à la catégorie «  femme  » sur laquelle repose notre questionnement.
Plutôt que de pratiquer un arbitrage donné/acquis qui permettrait de démêler lʼécheveau sexe-genre149, il sʼagit à présent de déplacer le regard sur la manière dont le concept de Nature informe ces catégories, non seulement de manière super-structurelle (pour dissocier ce qui est naturel de ce qui serait social) mais aussi de façon interne aux concepts et valeurs (pour décider de qui est trop ou pas assez naturel, pour assigner une valeur aux individus en fonction de leur connexion à «  la Nature  »). On devine assez bien ici comment sexe-genre nʼest pas le seul système de catégories opérant de cette manière, et comment la race ou les processus de racisation vont également reposer sur ce concept. Plus encore, sexe-genre et race sʼentremêlent fréquemment en se fondant sur cette idée de Nature, pour en accepter lʼoracle ou en rejeter la fatalité, au choix, et en attribuant une valeur morale à des attitudes plus ou moins «  naturelles  ». Il convient de mobiliser les travaux de Colette Guillaumin à cet endroit, puisquʼelle permet dʼintégrer la question de la race à la question du genre (et en France, elle a été pionnière sur ce point) mais aussi, une fois lʼindividu «  femme  » arrachée à cette supposée condition naturelle, préférer une compréhension du groupe «  femmes  » comme classe plutôt que comme espèce.
En 1978, dans son article «  Pratique du pouvoir et ideÌe de Nature (2) Le discours de la Nature  », la sociologue Colette Guillaumin analyse la manière dont lʼidée de Nature informe la constitution des catégories de genre, sur plusieurs plans. Tout dʼabord, elle observe la manière dont, à son époque150, les femmes sont, dans les actes ou le langage, renvoyées à un statut de propriété et comment leurs caractéristiques corporelles, plutôt que dʼêtre la cause de leur annexion, vont en réalité devenir le signe de cette nécessaire expropriation. C. Guillaumin écrit ainsi que «  les caractéristiques physiques de ceux qui sont appropriés physiquement passent pour être les causes de la domination quʼils subissent  » (1978, 6). La théoricienne rend visible un pouvoir patriarcal dont lʼefficace repose sur des énoncés au centre desquels lʼidée de Nature fait figure de colonne vertébrale. Ce concept fonctionne à la fois de manière généraliste (la nature des choses, qui est plus exactement lʼordre des choses, comme le montre Guillaumin151) et plus spécifiquement, construit la relation de pouvoir, dans la mesure où les dominant·es et les dominé·es (ici, les dominées) sont distingués par leur relation plus ou moins proche, plus ou moins déterminante à la Nature. Dans les mots de Colette Guillaumin : «  les dominés sont dans la Nature et la subissent alors que les dominants surgissent de la Nature et lʼorganisent  » (1978, 25) ou, plus efficacement encore, «  [t]ous les humains sont naturels mais certains sont plus naturels que les autres  » (13).
Concomitant à lʼidée de Nature comme principe ordonnateur et essentiel, le principe de différence opère dans une logique circulaire que C. Guillaumin met en évidence et qui pourrait être résumé comme suit : les hommes et les femmes sont différents car la Nature les a faits ainsi (le fait naturel fabrique la différence) ; par ailleurs, ce qui apparaît comme étant différent est nécessairement le signe dʼune Nature à lʼœuvre, dʼun «  programm[e] à lʼinteÌrieur la matieÌ€re vivante  » (10) (la différence est constitutive du fait naturel). Il ne sʼagit pas pour autant de dire que ces deux termes sont équivalents, mais plutôt quʼil existe une liaison logique à la fois descendante et ascendante qui sécurise leur connexion, et in fine, la permanence dʼun ordre sexe-genre solide et hiérarchisé. Ce substrat idéologique a des conséquences aussi paradoxales que funestes. Lʼordre naturel, cet ensemble de «  réalités anatomo-physiologiques  » (Guillaumin 1978, 24) est si naturel quʼil convient de le maintenir… même sʼil est «  naturellement  » imparfait. Cʼest le pan du «  naturalisme conservateur  » pensé par le philosophe Clément Rosset : dans cette idéologie, la Nature nʼest pas ce qui est, mais ce qui a été et doit être restauré (Rosset 2011, 310). Cʼest ainsi quʼon entendra souvent dire, parfois dans un même souffle, que la Nature ne fait que deux sexes, homme et femme (souvent en réponse à des argumentaires de personnes non-binaires qui tentent de faire exister leur position), et quʼil est important dʼopérer les personnes intersexes à la naissance pour leur éviter dʼêtre mal socialisé·es et de souffrir de cette indétermination (Petit 2018, 8). Autrement dit, «  la Nature  » est un signifiant flottant qui désigne avant tout un ordre souhaité, relevant dʼune «  pensée dʼordre  » où «  les choses eÌtant ce quʼelles sont, cʼest-aÌ€-dire certains groupes (ou un groupe) en appropriant dʼautres (ou un autre), cela fait fonctionner correctement le monde, il convient donc que cela reste ainsi, ce qui évitera le renversement des valeurs vraies et des priorités éternelles  » (Guillaumin 1978, 10). Lorsque la Nature produit des hommes et des femmes, alors on la réifie comme ordre inévitable, sanctuaire (pour parler comme Laboria Cuboniks) à ne surtout pas profaner ; mais que la Nature produise autre chose (ce quʼ«  elle  » fait, puisque entre 1 et 3.5 % des naissances produisent, que cela nous plaise ou non, autre chose que des hommes et des femmes stricto sensu ; Fausto-Sterling 2000, 51–53), alors la Nature (paradoxe suprême !) doit être techniquement, culturellement corrigée pour rester «  naturelle  ». Cʼest ainsi que les corps illisibles ou «  abjects  » (Butler 1993, 3) des personnes intersexes subissent le joug du «  chausse-pied chirurgical  »152 (Fausto-Sterling 2000, 8)153.
Dans ces idéologies naturalistes, cʼest moins la Nature qui importe, ou encore les «  réalités anatomo-physiologiques  » que lʼordre différentiel que le concept charrie avec lui. Mais la différence ne sépare pas deux catégories de manière équivalente : au contraire, elle constitue un de ces pôles comme le naturel, le tacite, lʼévident, fabrique la catégorie avec la matière du truisme, à plus forte raison que son opposé nʼest pas seulement différent de lui, mais quʼil incarne la différence. Lʼénoncé «  homme ≠femme  » produit fréquemment une hiérarchie en même temps quʼune distinction ; mais la différence est davantage localisée dans le mot «  femme  » que dans le sème «  ≠  ». Colette Guillaumin note ainsi avec humour quʼon ne peut pas «  être différent tout seul  » (1978, 14), mais que, pourtant, cʼest un peu ce qui se produit dans les discours essentialistes sʼappuyant sur le sexage par la Nature. En effet, «  [s]i les femmes sont différentes des hommes, les hommes eux ne sont pas différents […] les hommes, eux, sont les hommes  ». On observe les effets de cette pensée sexiste dans le langage quotidien. On parlera ainsi de «  coupe du monde de football  », sans préciser quʼil sʼagit de la coupe du monde de football masculine. À lʼopposé, un match disputé par une équipe féminine sera systématiquement nommé comme événement de football féminin. Cette transparence de la catégorie dominante, consacrée comme neutre (et dominante parce que neutre, donc plus proche de lʼuniversel) dépasse les questions de genre : être blanc·he, cisgenre, de classe moyenne, valide, hétérosexuel·le nʼexige pas de se nommer.
Eve Kosofsky Sedgwick explique bien le fonctionnement de cette relation asymétrique et co-productive entre deux termes opposés, lorsquʼelle évoque lʼopposition entre hétérosexualité et homosexualité. Elle écrit :
les cateÌgories preÌsentes dans une culture donneÌe en tant quʼoppositions symeÌtriques binaires […] subsistent en fait dans une relation tacite plus instable et dynamique selon laquelle la relation entre les termes A et B nʼest pas symeÌtrique, le terme B eÌtant subordonneÌ au terme A. Toutefois, la signification du terme A, valoriseÌ au niveau ontologique, deÌpend simultaneÌment de sa subsomption sous le terme B et de son exclusion de ce meÌ‚me terme. La question de la prioriteÌ de la cateÌgorie supposeÌe centrale ou de celle supposeÌe marginale dans chaque dyade est ainsi inexorablement instable, une instabiliteÌ causeÌe par la constitution du terme B en tant quʼaÌ€ la fois interne et externe au terme A154 (1990, 10).
La binarité sexe-genre fait donc plus que couper lʼhumanité en deux : elle produit un régime dʼintelligibilité des corps, dans lequel certains corps sont marqués par le régime de la différence quʼils contribuent à produire (les corps féminins), rendus inintelligibles et donc nécessaires à scruter et étudier. Delphine Gardey et Ilana Löwy écrivent à ce propos :
De lʼhomme ou de la femme, le vrai sujet de nombre de préoccupations scientifiques cʼest «  la femme  », et de cela découlent deux choses : que les femmes sont ces êtres étranges qui sont à comprendre cʼest-à -dire à contenir, à maîtriser ; quʼelles sont en même temps cette étrangeté radicale, à la fois la différence et le sexe […]  » (2000, 11).
La continuité établie entre Nature et différence -— étant entendu que la différence ne sépare pas les hommes et les femmes autant quʼelle situe les femmes (comme être différent, comme Autre) -—est un effet des études scientifiques qui sont aussi légitimées par leur propre travail de différenciation. Autrement dit, plus la science parvient à fabriquer des «  sites  » (Gardey & Löwy 2000, 12) de différenciation (selon les époques : le squelette, le crâne, les parties génitales, les hormones, lʼADN, le cerveau, etc.), plus elle légitime son entreprise de documentation de cette différence. Je reviendrai plus avant sur les effets des disciplines scientifiques comme la biologie ou la médecine sur notre compréhension du sexe-genre. Je souhaite dʼabord observer ce que fait ce paradigme de la différence à notre appréhension du monde. Erving Goffman voit deux effets de cette coupe systématique entre homme et femme sur le mode de la différenciation radicale. En premier lieu, le principe de la différence associe des qualités aux groupes homme/femme et efface ce faisant des occurrences peut-être plus rares sur le plan du nombre, mais néanmoins existantes. Ainsi, on dira que les hommes sont robustes et les femmes frêles, écartant par ce motif le fait de lʼexistence des hommes frêles et des femmes robustes (Goffman 1977, 321). Inversement, le motif de la différence réduisant toute possibilité dʼécart avec celle que représente la relation entre deux groupes donnés, il sera facile de supposer une homogénéité du groupe «  homme  » et du groupe «  femme  », gommant ainsi toutes les variations propres à un groupe dʼindividus, au motif de leur première identification comme «  homme  » ou «  femme  ». Eve Kosofsky Sedgwick fait écho à ce dernier point quand elle écrit :
Le frère et la sœur, le ou la meilleur(e) ami(e), le ou la camarade de classe, le parent, lʼenfant, lʼamant(e), lʼex, nos familles, nos amours ou nos ennemi(e)s, pour ne pas mentionner nos relations étranges avec le travail, le loisir et lʼactivisme révèlent que même ceux et celles avec qui lʼon partage tout ou partie de nos positionnements sur ces axes grossiers peuvent tout de même être suffisamment différents de nous, et suffisamment différents entre eux, pour sembler être dʼune espèce différente (1990, 22)155.
Fonder notre connaissance du monde sur la division homme/femme comme grand principe organisateur obscurcit les points communs partagés par ces deux groupes, et invisibilise les différences à lʼintérieur dʼun groupe donné, ce qui peut avoir pour conséquence des choix politiques désastreux. Si on part du principe que la division sexuée est le grand principe ordonnateur de nos sociétés (que lʼon associe cette division à un fait construit, donné, ou un mélange des deux), on tendra à ignorer la manière dont dʼautres divisions affectent la constitution dʼun groupe, et ce, même si on le fait pour protester contre lʼoppression du groupe dominé. En des termes simples, cela signifie que lʼon considérera toujours «  la Femme  » comme opprimée, sans égards pour ce que sa blancheur, sa minceur, sa classe ou son orientation sexuelle peuvent créer de rapports de force avec dʼautres femmes, ou même avec dʼautres hommes156. Le principe ordonnateur de la différence qui travaille la coupe homme/femme est donc aussi, en son envers, un mécanisme de production de la similarité, de lʼuniformité. Erving Goffman montre bien comment ces deux facettes peuvent être combinées pour conforter le système sexe-genre (dont il parle comme dʼun «  opium des masses  »157 ; 1977, 315) en utilisant au choix et de manière interchangeable la différence ou la similitude pour ancrer un comportement genré. Ainsi, un homme pourra «  refuse[r] les tâches domestiques sur la base de son sexe alors quʼil identifiera tout manque dʼentrain de la part de sa femme à un trait spécifique de sa personnalité  » (2004, §66)158. Cet ensemble de savoirs qui constitue lʼépistémologie commune sexe-genre tire ainsi sa force de sa capacité à être renforcée par tout phénomène isolé qui sera immédiatement vu comme une émanation du principe organisateur ; et dans le cas où ce phénomène isolé ne corresponde pas au cas général attendu, il sera aisément balayé comme une variation non significative, une exception, voire une bizarrerie permettant de policer le genre de la personne en question (une femme très musclée, par exemple, pourra se voir dénier son appartenance au groupe «  femmes  »). Dʼautres faits marquants découlent de ce fonctionnement : la catégorie «  femmes  » devient difficile à documenter, et les différences qui la composent tout aussi difficiles à visibiliser tant sʼimpose «  une similitude de toutes les femmes comme Femme  »159 (De Lauretis 1986, 14–15) tandis que dʼautres binarités, y compris celles plus apparemment inoffensives qui opposent des qualités, des valeurs, plutôt que des groupes humains, deviennent des «  allégories implicites des relations entre hommes et femmes  »160 (Sedgwick 2008[1990], 34). Erving Goffman tend dʼailleurs à rapprocher toutes les formes de domination et dʼoppression du «  complexe parent-enfant  »161 (1987[1976], 4), ce qui est dʼautant plus lisible dans la manière dont les dominant·es vont adopter des comportements infantilisants pour définir leurs subalternes comme tel·les.
Revenons une dernière fois sur la versatilité du modèle différentialiste, capable dʼaccorder des sens différents à ses énoncés afin de préserver ses catégories, plutôt que la cohérence de leurs contenus. Jʼai écrit plus tôt que le principe de la différenciation et la référence à une Nature déterministe se connectaient selon la logique du renforcement mutuel. Cependant, même le lien des femmes à la Nature (ces individus «  plus naturels que dʼautres  », dirait C. Guillaumin) est sujet à des inversions paradoxales. En apparence, hommes et femmes sont distincts de par leurs natures respectives, celle dʼun être culturel pour les hommes, celle dʼun être naturel, entièrement déterminé par le fait biologique, pour les femmes (Mathieu 1973, 48–49 ; Guillaumin 1978, 22 ; de Beauvoir 1976[1949], 268). On peut penser à de nombreuses situations ordinaires où la nature, toute-puissante, est perçue comme la source dʼun comportement féminin. Le fameux «  Tʼas tes règles ?  » est un des énoncés les plus puissants qui permettent de réduire au silence les femmes (ne rien dire, cʼest approuver ; contester, cʼest démontrer quʼon est en proie à ses émotions) en les renvoyant au déterminisme corporel. Mais dans lʼHistoire, cette association homme-culture et femme-nature connaît des variations. Ainsi, aux États-Unis, au début du XXe siècle, lʼimplication croissante des hommes dans la vie domestique et lʼaccès de certaines femmes à une socialité plus intense fait craindre aux commentateurs de lʼépoque une féminisation des jeunes garçons162. La figure de la «  sissy  »163 émerge comme contre-modèle de masculinité puisque lʼinsulte (avec dʼautres comme «  nancy boy  ») sʼapplique à des jeunes hommes perçus comme efféminés. Teddy Roosevelt sʼempare notamment de sa propre expérience de garçon appelé «  sissy  » pour se construire une persona dʼhomme fort, dʼancien avorton devenu cowboy fringant (Studlar 1996, 31). Dans cette économie discursive, le retour à la Nature permet de renouer avec sa masculinité, sa force, son intuition, une forme de connexion intrinsèque aux éléments par opposition aux univers féminins de la ville, de la maison, des institutions intellectuelles perçues comme anti-viriles. Ici, lʼopposition à lʼœuvre est moins homme/femme que masculin/féminin. Cette dernière catégorie désigne moins les femmes que des hommes pas assez hommes, parce quʼils sont, au choix, de la côte est, urbains, éduqués, intellectuels… ou gays. Le sociologue Emmanuel Beaubatie pointe également ce phénomène dʼinversion des contenus des valeurs qui nʼaffectent pas lʼordre des valeurs lui-même. Lorsquʼil analyse les écarts entre les opérations génitales des personnes trans MtF et des personnes trans FtM164, il observe que les chirurgien·nes sʼintéressent plus volontiers à la construction dʼun vagin quʼà celle dʼun pénis. Il écrit que «  [t]out se passe comme si les hommes ne pouvaient être des hommes que par nature  » (2021, 41), précisant bien que cela «  ne contredit pas nécessairement la thèse dʼautres théoriciennes qui […] avancent que ce sont les femmes qui sont constamment renvoyées à une prétendue nature, là où les hommes symbolisent davantage la culture  » (42).
En réalité, la division sexe-genre sʼaccommode très bien de toute une somme de signifiants flottants (Nature, Culture, Technique, Domesticité, etc.) quʼelle manipule en opposition en leur attribuant des valeurs en fonction des associations. Si une femme est associée à la Nature, ce sera pour mieux lui rappeler son destin procréatif, sa soumission aux cycles et aux caprices de son utérus. Que des hommes sʼassocient à la Nature, alors ils y puiseront la force primitive de nos ancêtres des cavernes, le nez de pointer et lʼagilité du lion. De la même manière, les stéréotypes racistes sʼemploient régulièrement à associer les Noir·es à un excès de Nature (animalisation, exoticisation, association à un manque de manières, de savoir-vivre, de propreté) tandis que les discours anti-trans prêcheront au contraire le «  naturel  » des relations hétérosexuelles et de lʼordre genré, caricaturant les personnes trans et leurs transitions comme un excès de technologie malvenu en ces temps de nécessaire reconnexion à Gaïa, dans le contexte de lʼeffondrement écologique. En somme, la bicatégorisation, comprise comme lʼensemble des couples des binarités disponibles et indexés sur la division homme/femme sʼordonne sur des énoncés récurrents, mais lʼordre réalisé est précisément souverain par rapport aux énoncés qui le produisent. Et si le signifiant «  Nature  » est extrêmement central, cʼest peut-être que lʼobjet central de cet ordre genré, moins que la différenciation, revient à savoir «  qui a le contrôle de la capacité de reproduction distincte (biologiquement) des femmes  »165 (Sedgwick 2008[1990], 28).
Nous avons montré ici comment «  homme  » et «  femme  » émergent comme des catégories naturelles (nature qui affecte un peu plus les femmes), que le genre est chargé dʼexprimer sur la base de caractéristiques sexuelles vues comme des invariants, pour, enfin, produire une hiérarchie (lʼindividu masculin étant lʼindividu, le cas normal, et le féminin, sa variation imparfaite). Ces trois aspects sont ceux que Robyn Dembroff retient pour définir le patriarcat et jʼutiliserai dès lors cette expression comme substitut ponctuel de la formule «  système sexe-genre  ». La solidité de la différenciation, comme son aspect versatile, hautement stratégique, implique que «  [p]our le patriarcat, nous faisons toustes mal le genre  »166 (Faye, 2021, 222). Avant dʼexaminer comment les sciences de la vie se sont construites, entre autres, sur lʼélaboration de cette différence, je vais mʼattarder sur un exemple tiré de la pop culture qui montre la manière dont le sexe (plutôt que le système sexe-genre, dans ce cas) se rattache à lʼidée de vérité et il est produit comme telle dans des énoncés scientifiques.
Faire le genre. Voilà une expression peut-être maladroite, mais qui a le mérite de sortir de la hiérarchie trop souvent associée à la performativité. Performer son genre implique un corpus dans lequel lʼindividu vient piocher ce qui lui convient pour se dire ; «  faire le genre  » implique peut-être la même chose, mais son aspect vague permet aussi dʼimaginer quʼen puisant dans un existant, plus ou moins partagé, lʼindividu contribue au corpus. Bien sà »r, même Judith Butler qui a inspiré ces lectures performatives du genre, pose, nous lʼavons vu, que la performativité ne suppose pas une totale agentivité du sujet. Avoir la capacité de se genrer, dʼinventer «  son  » genre, est une possibilité qui toujours se frotte au monde vécu et à la réception de ce genre par les autres. Et si nous faisons toustes mal le genre, comme le dit Shon Faye, certain·es, plus que dʼautres, voient leurs performances invalidées, avec les risques que cela comporte. Ceci tient au critère principal selon lequel la performance de genre est jugée dans les sociétés occidentales : lʼadéquation de la présentation de genre au sexe supposé de la personne -— et il apparaît ici à quel point la précaution de Priscille Touraille est précieuse. Nous avons en effet besoin de pouvoir distinguer ces concepts, car lʼexpérience ordinaire repose sur la structuration de sens quʼils produisent. Ainsi, lʼétude de cas à venir, plutôt que de tracer les contours clairs des catégories sexe/genre va montrer comment celles-ci sont fonction dʼun appareillage épistémologique plus vaste, dont la pierre angulaire est le concept de vérité. Ce concept de vérité fonctionne (au sens plein, puisquʼil va avoir un effet matériel sur les corps abjects, minorisés) comme trait dʼunion entre les catégories sexe-genre. Dès lors, il mʼimporte moins dʼarbitrer ce qui dans ces catégories (que jʼestime nécessaires, comme Priscille Touraille) est construit ou donné, que de les désindexer du régime de vérité qui gouverne les corps. Une représentation médiatique récurrente me semble un excellent cas à étudier pour comprendre comment opèrent ces mécanismes.
En 2021, le documentaire Disclosure, diffusé sur Netflix, entreprend dʼexposer la représentation de personnages transgenres à lʼécran et dʼarticuler celle-ci aux luttes politiques de cette minorité. De nombreuxes acteurices trans témoignent de leur expérience, à la fois en tant que spectateurices enfants et adultes et aussi en tant que professionnel·les du cinéma et de la télévision, auteurices, etc. Des universitaires tel·les que Susan Stryker ou encore des personnalités liées à des ONG comme le GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), à lʼexemple de Nick Adams, commentent des extraits des films -— finalement relativement rares, au regard de la production disponible -—qui mettent en scène des personnes trans, ou alors des formes de travestissement qui peuvent être interprétées comme des représentations de la transidentité. La question de la vérité comme régulateur de la relation sexe-genre est sans cesse présente dans ces représentations, et le documentaire a le mérite de les explorer en profondeur. Le journaliste Tiq Milan évoque par exemple la manière dont la dissonance entre le genre montré et le sexe perçu est un levier comique récurrent. Dans ce cas, la performance est en quelque sorte acceptée parce quʼelle ne fonctionne pas : lʼabsence de continuité sexe-genre apparaît alors comme une performativité ratée, et vise à déchaîner lʼhilarité. Mais comme le note Milan, ce type de représentations renforce «  lʼidée que les [personnes trans] sont juste comiques […], [quʼelles] se déguisent dans le but de faire rire  »167. Lʼenvers de la performance ratée serait, logiquement, la représentation réussie : mais celle-ci nʼest pas pour autant présentée comme positive. Dans lʼimaginaire cisnormatif qui repose sur la continuité sexe-genre, la performance de genre accomplie (qui produit donc la continuité), lorsquʼelle est accomplie par une personne trans, est vue comme mensongère, voire potentiellement dangereuse. Cet aspect a été nourri ad nauseam par un ensemble de représentations (par exemple, Dressed to Kill, 1980 ou Le silence des agneaux) où les femmes trans sont représentées comme des hommes déguisés, qui utilisent le travestissement pour accomplir des actes criminels. En lʼabsence dʼautres représentations, ce type de figures finit par rendre indissociables transidentité féminine et compulsion meurtrière. On retrouve des échos de cet imaginaire dans les discours TERF qui associent les femmes trans utilisant les toilettes pour femmes à des prédatrices qui cherchent à infiltrer les espaces des «  vraies  » femmes. Il est ironique que ces «  féministes  » ne voient pas quʼelles reproduisent le cliché sexiste de la femme menteuse, séductrice et manipulatrice, quʼelles déplacent sur un autre groupe minorisé. Les femmes trans sont dʼailleurs atteintes par une forme de double peine à cet endroit : elles sont vues comme dissimulatrices parce que femmes et parce que trans (Faye 2021, 246). Dans ce modèle, la transidentité est étroitement associée à la tromperie, et il y a tromperie parce que lʼexpression de genre de la personne trans est perçue comme voilant la vérité de son sexe. Par conséquent, un grand nombre de contenus médiatiques représentent les personnes trans en les réduisant à un point de contact entre vérité et mensonge. Avoir de lʼespace à lʼécran revient à devoir performer, non pas son genre, pour ces personnages, mais une forme de révélation (le vrai sexe devenant un indice de la transidentité). Lʼactrice Jen Richards analyse ainsi cette obligation de révélation (ou de «  disclosure  », qui donne son nom au documentaire) :
[j]e déteste assez lʼidée de la révélation, dans le sens où cela présuppose quʼil y a quelque chose à révéler. Cela renforce le présupposé selon lequel il existe un secret qui est caché, et que jʼaurais la responsabilité de le dire aux autres. Et cela présuppose que lʼautre personne pourrait avoir une sorte de problème avec ce qui doit être révélé, et que leurs sentiments importent davantage que les miens168.
La récurrence des représentations de révélation renforcent en effet lʼidée que la révélation est nécessaire, et quʼelle possède un contenu : la performance de révélation, comme spectacle de la vérité, produit lʼexistence de cette vérité.
La vérité nʼexiste cependant pas de manière isolée : les multiples représentations de révélations assignent une valeur à cette vérité de la transidentité, et elles indiquent des lieux où se produisent ces vérités. Disclosure aborde ainsi les multiples films et séries télévisées où un personnage trans (souvent des femmes, mais pas toujours) est forcé à révéler ses parties génitales pour confirmer les soupçons de son entourage. Dans le cas de fictions avec des hommes trans ou des femmes performant le genre masculin, la révélation peut être spontanée bien quʼabsurde : dans Yentl (1983), Just One of the Guys (1985) ou encore Albert Nobbs (2011) des femmes travesties en hommes ouvrent spontanément leur chemise pour «  révéler  » leur véritable nature169. Dans les deux cas, la transidentité est située dans cette performance et ne peut se détacher de lʼidée dʼune essence vraie, au moins préexistante, sinon concomitante à lʼidentité souhaitée. Jʼaimerais proposer ici lʼidée que la performance de vérité se situe moins dans le corps des personnes trans que dans le corps des personnes cis qui assistent à la révélation. Nick Adams observe dans Disclosure que, plutôt que représenter les personnes trans, «  Hollywood [nous] a appris à réagir face aux personnes trans  »170. Un extrait suscite lʼémoi parmi les personnes interviewées : il sʼagit dʼun passage du film Soap Dish (1991) dans lequel, de manière classique, une femme trans est outée devant son entourage (sans que son corps soit publiquement exposé, cependant). Une multiplicité de réactions est saisie par une série de plans de coupe : une femme sʼévanouit, des hommes restent figés la bouche ouverte, et un dernier homme (interprété par Robert Downey Jr.) réprime un haut-le-cÅ“ur dans sa manche. On assiste ici à la triade des réactions classiques face à lʼouting trans.
La seconde incarne la surprise de manière assez générique, tandis que la première et la troisième sont très spécifiquement des réactions corporelles non contrôlées. Indépendamment du contexte ici évoqué, il sʼagit de manifestations physiques qui peuvent être socialement condamnées, en tant quʼelles connotent la forte émotivité des femmes, ou quʼelles engagent des fluides corporels perçus comme sales (le vomi). Mais ici, lʼaspect mécanique, automatique, de ces réactions est absolument nécessaire. Les personnes trans font face quotidiennement à un rejet de leur personne qui est construit par les représentations collectives entourant le binôme sexe-genre. Ces représentations possèdent une dimension éminemment discursive  : il sʼagit dʼun ensemble de discours, de savoirs, qui ont été appris. Nous avons appris à reconnaître une «  nature  », à identifier celle-ci comme ce qui est naturel, ce qui est bon. Or, ces films effacent la dimension discursive, épistémologique même, de la transphobie : si lʼon vomit, si lʼon sʼévanouit, cʼest bien quʼil ne sʼagit pas dʼun problème dʼidée, dʼintellect, mais dʼun problème de corps. Ce ne sont pas les personnes cis qui rejettent les personnes trans, non, cʼest leur corps, leur corps codé comme naturel qui reconnaît lʼautre comme contre-nature, soit en refusant de le regarder (évanouissement, soit disparition de la possibilité relationnelle) soit en la rejetant comme un corps sale, souillé (le vomissement) (Ahmed 2014a, 83 ; 93).
Le vomissement nʼest pas seulement une représentation marginale dans Soapdish : cʼest un motif classique, réservé aux femmes trans, qui apparaît selon le documentaire dans plusieurs films et séries comme The Crying Game (1992)171, Naked Gun 33 â…“: The Final Insult (1994), Family Guy (2010), The Hangover Part II (2011) ou Ace Ventura: Pet Detective (1994). Dans ce dernier film, la révélation se fait même par deux fois, et de manière particulièrement violente : dans un premier temps, Jim Carrey vomit, se lave les dents compulsivement et utilise une ventouse de toilettes pour purifier sa bouche suite à la révélation ; dans un second temps, le public est élargi lorsque le tucking172 du personnage est affiché en gros plan, entraînant des vomissements collectifs en série. Il est important de noter que ces représentations nʼexistent pas de manière isolée. Ces dernières années, la pratique du «  gender reveal  » sʼest diffusée sur les réseaux sociaux (fig. 1.1). Aux États-Unis, la naissance dʼun bébé est souvent fêtée lors dʼune baby shower, qui est une fête, souvent en non-mixité féminine, où la future maman reçoit des cadeaux et réalise des activités en lien avec lʼheureux événement. Cette pratique sʼest dʼailleurs diffusée en Occident au-delà de son pays dʼorigine. La simple terminologie du «  gender reveal  » renseigne sur lʼidéologie sexe-genre convoquée. En effet, connaître le sexe du bébé avant sa naissance est possible depuis lʼinvention de lʼéchographie.

Cette connaissance est dʼailleurs toute relative, puisque cʼest la présence ou absence dʼun pénis qui est observée, et on sait aujourdʼhui que la sexuation des corps est distribuée sur «  dix couches qui peuvent ne pas toujours se prêter à une lecture unifiée  » (Hoquet 2016, 69 ; voir aussi Fausto-Sterling 2012[2000], 19). Néanmoins, cette interprétation de la sexuation est immédiatement associée à un genre : il nʼest pas question que lʼenfant soit autre chose que ce qui a été vu sur son corps, bien que son corps ne soit pas encore visible, stricto sensu. Le sexe-genre identifié fait ensuite lʼobjet dʼune mise en scène plus ou moins élaborée : il peut sʼagir de cupcakes dont lʼintérieur révèle un cÅ“ur rose ou bleu en fonction du sexe de lʼenfant ; dans certains cas, le spectacle est plus élaboré et fait appel à des fumées ou autres effets pyrotechniques173. La pratique est si populaire que «  gender reveal party  » se substitue parfois à la traditionnelle expression baby shower. Autrement dit, célébrer une grossesse, célébrer une future vie, passe inévitablement par une performance qui tisse étroitement vie nouvelle, sexe déterminé et révélation dʼune vérité. On pourrait même aller plus loin et dire que dans lʼéconomie sexe-genre révélée par ce type de représentations (du vomi réactif face aux femmes trans au petit théâtre du genre de bébé), quʼil nʼest pas de genre qui n’est un reveal. Les formes dʼannonce, la visibilité, les codes visuels du genre -— en somme, son esthétique -—sont une condition première de son existence comme catégorie conceptuelle.
Il en résulte une économie relationnelle dans laquelle toute variance de genre (même minime, comme une femme cis qui serait trop peu féminine) est condamnée en vertu dʼune fétichisation du «  vrai  » qui condamne en retour lʼartifice. Souvenons-nous des mots de Foucault, cité plus tôt, qui évoque «  le désir du sexe – désir de lʼavoir, désir dʼy accéder, de le découvrir, de le libérer, de lʼarticuler en discours, de le formuler en vérité  ». Foucault parle du sexe comme sexualité, bien entendu : mais au regard de notre analyse, il semble que la vérité du sexe comme pratique, qui doit se dire, se rendre visible, nʼest finalement pas si éloignée de la vérité de la sexuation. Nos conceptions sexe-genre sont en effet marquées parce que jʼappellerais une esthétique de vérité : paradoxalement, cʼest la production la plus spectaculaire, la plus mise en scène, qui permet de jouir dʼune vérité vue comme La Vérité, car elle est vérité de la Nature. Le gender reveal est une expression pop de lʼexigence de vérité foucaldienne. Son propos (la population est un ensemble exclusif dʼhommes et de femmes cisgenres) dépend dʼesthétiques de vérité (le spectacle de la révélation se faisant plus spectaculaire pour signifier le plus vrai) et dʼémotions de vérité : sʼévanouir, vomir, rire sont la pyrotechnie propre aux corps cis, la performance de dégoà »t signant lʼéchec de la performance de genre.
Cette performance est une production dʼauthenticité en miroir qui vient qualifier ce quʼelle reflète ; elle dit, en substance : «  si je suis dégoà »té, cʼest que tu es dégoà »tant ; ma réaction, physique, est vraie puisque mon corps la produit comme il produit mon sexe, lui authentique à la différence du tien  ». Ce nʼest pas un hasard si la culture queer sʼest particulièrement déployée dans les ballrooms new-yorkais, où les jeunes LGBTQIA+ (qui ne portaient pas encore ce nom) performaient des identités de genre, classe et race permettant dʼéchapper à leurs réalités sociales aux contours limités par la violence et le rejet. Le critère de ces performances était la «  realness  », soit le décalage de la vérité comme outil politique. Nous verrons que cette vérité du genre vient également se fixer sur des catégories, comme «  homme  » ou «  femme  ». Pour que le sexe soit la vérité de lʼindividu, il faut sʼaccorder sur ce qui est un «  vrai homme  » ou une «  vraie femme  »174. Dans la mesure où mon travail porte sur lʼespace féminin de la cuisine, cʼest surtout la notion de «  vraie femme  » qui mʼintéressa ci-après, étant entendu quʼelle est indissociable du concept de «  vrai homme  » et que lʼhétéronormativité implique que les individus, dans la relation romantique, co-affirment et co-produisent leurs genres respectifs. Avant dʼinvestir cette catégorie de «  femme  », il me faut encore explorer un autre domaine dans lequel lʼesthétique de vérité se déploie. Si la révélation spectaculaire du sexe-genre semble trouver une place toute trouvée dans les arts du spectacle, les sciences du vivant ne sont pas en reste, à plus forte raison que le registre spectaculaire est constitutif de leurs méthodes174:1.
Lʼordre sexe-genre est en général défendu avec fermeté en invoquant deux degrés de savoir : celui, intuitif et commun du bon sens (évidemment que les hommes et les femmes sont différents, cela se voit bien), et celui, élaboré, constitué et faisant autorité, des sciences du vivant. Or, nous avons vu, en évoquant le sort réservé par la médecine aux personnes intersexes (voir infra., **), que la science se situe dans une curieuse relation dʼinterface avec ses objets : elle institue une position de surplomb par rapport à eux, en même temps quʼelle nourrit les recherches qui modifient ou corrigent cette Nature. Mais plus discrètement aussi, les sciences distinguent deux niveaux, entre ce qui est Naturel, mais ouvert à la modification technique (réparer un handicap, guérir le cancer) et ce qui est Naturel et intouchable pour cette raison (la sexuation des corps, par exemple). La manière dont le système sexe-genre nous apparaît vient aussi de ce que les sciences du vivant se constituent elles-mêmes comme étant séparées de leur objet et donc objectives. Ce terme dʼobjectivité, qui met en difficulté les approches féministes et situées (Haraway 1988) est constitutif de la mystique de vérité que jʼidentifiais plus tôt à partir de lectures de contenus médiatiques pop. Un des principes de cette mystique de vérité est de montrer celle-ci comme évidente, cʼest-à -dire, aussi nue que les représentations de corps masculins et féminins dans les livres dʼanatomie. Le degré zéro de la représentation impose le savoir comme vrai, mais relève dʼune construction élaborée. Ruth Hubbard observe ainsi :
Le prétexte selon lequel la science est objective, apolitique et possède une valeur neutre est profondément politique car il voile le rôle politique que la science et la technologie jouent dans le soulignement des structures de pouvoir dans la société175 (2001[1989], 159).
Il est intéressant de voir comment la science, discipline ou ensemble de disciplines capables de produire du savoir, est bien désignée comme indissociable de ses apports technologiques (comme chez D. Haraway qui parle de «  technoscience  »176, dʼailleurs ; 1997, 1) . On pourra me répondre que ce texte est assez daté : en effet, lʼépistémologie, la philosophie, la sociologie et lʼhistoire des sciences ont depuis montré à maintes reprises comment les sciences sont des savoir situés, dont les conclusions dépendent en partie des personnes qui effectuent les expériences, de leurs biais cognitifs et dʼopinion -— par exemple chez Bruno Latour et Steve Woolgar (1988) ou Donna Haraway (1997). Ruth Hubbard (2001) comme Ian Hacking (2008) insistent sur lʼimportance de la vie de laboratoire et ses influences externes, comme les programmes militaires, dans la mesure où ceux-ci ont des conséquences sur les protocoles expérimentaux, et donc sur le savoir produit. Dʼune certaine manière, ces faits sont connus par les scientifiques. Le célèbre principe de Heisenberg ne dit finalement pas autre chose : le savoir en formation est perméable. Mais peut-être est-il plus souvent reconnu que cette perméabilité tient aux conditions dʼexpérimentation (une sorte de dehors, de contexte spatial) plutôt quʼaux savoirs préexistants des scientifiques.  fig. 1.2 : Dans cet ouvrage d’anatomie pour les enfants, on observe une variété dans les ethnicités représentées, mais la partition garçon-fille est toujours présente. De plus, les corps sont majoritairement valides et minces.Si lʼon suit Delphine Gardey & Ilana Löwy, le premier savoir sur lequel sʼappuient les chercheur·ses en sciences est lʼidée même quʼil existe une «  Nature  » et que celle-ci est connaissable par les moyens de la recherche. Aussi les deux autrices nous mettent-elles en garde contre la tentation de renvoyer la science non-objective à un fait passé plus ou moins distant, qui permettrait dʼencaisser la critique portée aux savoirs non situés tout en refusant de se situer dans la science en train de se faire. Elles écrivent :
fig. 1.2 : Dans cet ouvrage d’anatomie pour les enfants, on observe une variété dans les ethnicités représentées, mais la partition garçon-fille est toujours présente. De plus, les corps sont majoritairement valides et minces.Si lʼon suit Delphine Gardey & Ilana Löwy, le premier savoir sur lequel sʼappuient les chercheur·ses en sciences est lʼidée même quʼil existe une «  Nature  » et que celle-ci est connaissable par les moyens de la recherche. Aussi les deux autrices nous mettent-elles en garde contre la tentation de renvoyer la science non-objective à un fait passé plus ou moins distant, qui permettrait dʼencaisser la critique portée aux savoirs non situés tout en refusant de se situer dans la science en train de se faire. Elles écrivent :
il ne saurait plus être question de regarder les savoirs dʼalors comme des productions non scientifiques en envisageant implicitement quʼils pourraient être réparés par la rationalité dʼaujourdʼhui, mais de regarder, hier comme aujourdʼhui, en quoi ces discours et ces pratiques étaient/sont tenus pour scientifiques (2000, 11).
Les imprécisions ou biais du fait scientifique ne relèvent donc pas dʼun défaut de rationalité, mais tiennent à toute entreprise de constitution de savoirs. Dès lors, il importe de se désidentifier de lʼobjectivité, pour nous interroger sur les manières dont nous objectivons le réel (Haraway 1997, 24–25). La création de savoir, quʼelle relève des sciences dures ou de celles, dites molles, dont relève cet écrit, est justement création plutôt que dévoilement de faits cachés préexistants, qui attendaient patiemment leur heure pour être dévoilés par læ scientifique (dʼailleurs, le plus souvent, le scientifique). Comme le rappelle le Biology & Gender Study Group177 (soit «  le Groupe dʼétude sur la biologie et le genre  »), le fait que la science soit une entreprise créative implique de la critiquer en tant que telle (1989, 183). fig. 1.3 : Les poupées Barbie et Ken produites par la firme Mattel éludent la question des génitoires, mais pas complètement. Ken possède une bosse, et Barbie, un vague pli. Appliquée à notre propos, cette observation suppose de ne pas seulement affirmer que le sexe est construit, mais de décrire les processus précis qui permettent dʼen constituer la réalité. Ces processus ne sont pas étrangers au design. Par exemple, le fait de choisir deux personnages caucasiens de «  garçon  » et «  fille  », présentés comme opposés, pour une anatomie pour enfants participe de cette construction orientée (en design éditorial, en design curatorial, fig. 1.2), tout comme le fait dʼattribuer à une Barbie un entrejambe lisse et à Ken une «  bosse  » (en design des jouets, fig. 1.3), ou de représenter «  lʼHomme  » et la «  Femme  » comme les deux unités composant lʼhumanité sur le disque transporté par la sonde Voyager, destiné à dʼéventuels extraterrestres (en design dʼarchives, fig. 1.4). Je donne ici des exemples proches du design, mais les philosophes des sciences ont plus généralement analysé les textes de recherche scientifique, en traitant de leurs composantes littéraires afin de révéler les processus créatifs qui fondent leurs enseignements en même temps que leurs objets.
fig. 1.3 : Les poupées Barbie et Ken produites par la firme Mattel éludent la question des génitoires, mais pas complètement. Ken possède une bosse, et Barbie, un vague pli. Appliquée à notre propos, cette observation suppose de ne pas seulement affirmer que le sexe est construit, mais de décrire les processus précis qui permettent dʼen constituer la réalité. Ces processus ne sont pas étrangers au design. Par exemple, le fait de choisir deux personnages caucasiens de «  garçon  » et «  fille  », présentés comme opposés, pour une anatomie pour enfants participe de cette construction orientée (en design éditorial, en design curatorial, fig. 1.2), tout comme le fait dʼattribuer à une Barbie un entrejambe lisse et à Ken une «  bosse  » (en design des jouets, fig. 1.3), ou de représenter «  lʼHomme  » et la «  Femme  » comme les deux unités composant lʼhumanité sur le disque transporté par la sonde Voyager, destiné à dʼéventuels extraterrestres (en design dʼarchives, fig. 1.4). Je donne ici des exemples proches du design, mais les philosophes des sciences ont plus généralement analysé les textes de recherche scientifique, en traitant de leurs composantes littéraires afin de révéler les processus créatifs qui fondent leurs enseignements en même temps que leurs objets.
Les membres du Biology & Gender Study Group ainsi que Nancy Tuana montrent comme lʼétude de la reproduction humaine est informée par des récits dont les qualités narratives ne sont pas des à -côtés négligeables. Au contraire, ces éléments fondent le principe de la coupe sexuée et se nourrissent par ailleurs de représentations genrées préexistantes.
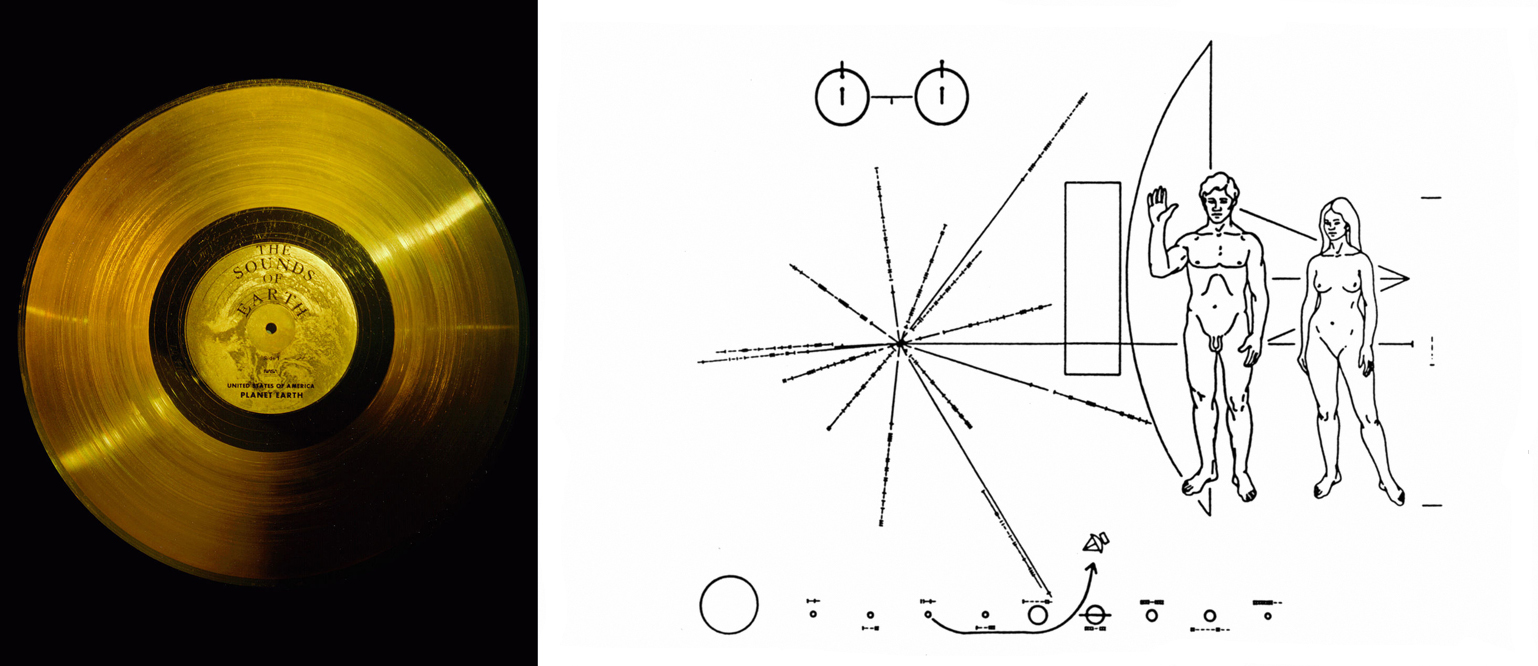
Nancy Tuana analyse ainsi les récits de la fécondation ovule-spermatozoïde, et montre que les présupposés de genre qui marquent ces représentations préexistent à la découverte du fonctionnement exact des gamètes, depuis Aristote et Galien. Dans les écrits dʼAristote, les femmes sont présentées comme des véhicules passifs : ce sont les hommes qui, comme le charpentier avec le bois de la chaise, donnent forme à une matière inerte (Tuana 1989, 150). Par ailleurs, la différence sexuée nʼest pas fonction des parties génitales ou des hormones, comme aux XIXe et XXe siècles, mais dépend dʼune différence de température, entre le corps masculin, chaud, et le corps féminin, dont la froideur ne lui permet pas de «  cuire  » sa semence (Tuana 1989, 149). Galien reprend cette idée du corps féminin manquant de chaleur, et des hypothèses inexactes (comme celle de gonades masculines reliées à la veine cave et à lʼaorte, et bénéficiant dʼun sang clair, contrairement au sang impur alimentant lʼutérus) résisteront longtemps aux observations pourtant contradictoires effectuées lors de dissections (Tuana 1989, 156). 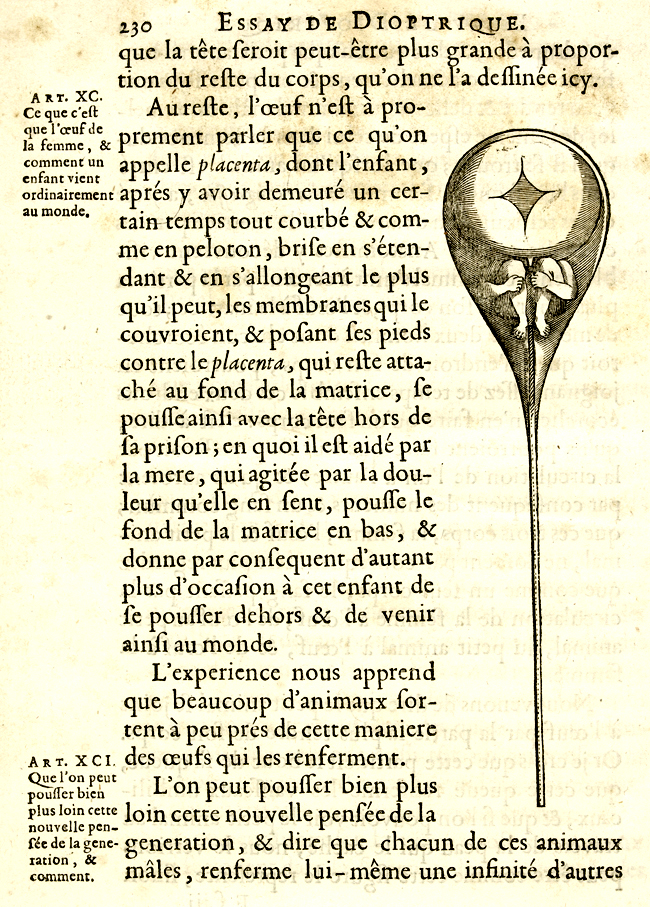 fig. 1.5 : Représentation du petit homme embarqué à bord d’un spermatozoïde par Nicolaus Hartsoeker (1656–1725). En 1694, cette illustration accompagne son Essay de Dioptrique.
fig. 1.5 : Représentation du petit homme embarqué à bord d’un spermatozoïde par Nicolaus Hartsoeker (1656–1725). En 1694, cette illustration accompagne son Essay de Dioptrique.
Au XVIIe siècle, la découverte des spermatozoïdes suscite un ensemble nourri dʼhypothèses relevant de la thèse de la «  préformation  » (Tuana 1989, 163). Dans ce paradigme, toutes les parties dʼun tout sont déjà présentes dans la forme primitive de lʼorganisme. Une des plus célèbres modélisations de cette idée (peut-être parce quʼelle est très amusante pour un regard contemporain) est celle de Nicolaus Hartsoeker, qui imagine un petit embryon microscopique niché dans la tête du spermatozoïde (fig.1.5). Ainsi, la reproduction est encore vue comme un travail où lʼhomme apporte lʼessentiel du matériel génétique. Le corps féminin est considéré, tout au plus, comme un habitacle dans lequel se développera lʼindividu -— préformé dans le corps masculin178. La reproduction nʼest pas lʼaffaire conjointe dʼhommes et de femmes, mais lʼactivité dʼhommes qui se reproduisent au travers de corps féminins.
Dans lʼouvrage dans lequel figure cette contribution de Nancy Tuana et quʼelle dirige par ailleurs, Feminism & Science, apparaît un texte du Biology And Gender Study Group qui permet de mieux saisir encore la manière dont les récits de la reproduction humaine sont genrés et contribuent à fonder une épistémologie sexuée. Le groupe observe la manière dont les chercheurs (surtout des hommes) se sont intéressés à la détermination du sexe de lʼenfant et aux causes environnementales qui permettrait de le détecter, voire de le déterminer. Mais la suite de leur propos mʼarrête davantage, puisquʼil montre comment des découvertes a priori «  objectives  », soit lʼexistence de spermatozoïdes ou dʼovules, sont passées à la moulinette du genre, pour venir renforcer lʼidée de la différence sexuée. Iels disent, non sans humour, que les «  ‹ contes du sperme ›constituent un sous-genre fascinant de la science-fiction  »179 (1989, 174) alors quʼils analysent des textes scientifiques et de vulgarisation. Iels expliquent ainsi comment le spermatozoïde (plutôt que le groupe de spermatozoïdes, dʼailleurs, alors quʼun éjaculat en produit en moyenne une centaine de millions) est casté dans un récit héroïque, proche du monomythe de Joseph Campbell (1973[1949], 175–176). Le spermatozoïde ne doit pas seulement féconder lʼovule, mais vaincre lʼenvironnement hostile de lʼutérus. Ce qui frappe ici, ce nʼest pas seulement à quel point la relation entre deux gamètes rejoue la violence naturalisée de la relation hétérosexuelle (le viol requalifié en conquête), mais la différence de nature accordée aux deux protagonistes : le spermatozoïde apparaît comme un personnage à part entière, doté de personnalité, tandis que lʼovule est un espace, une page blanche plutôt quʼune personne. Quand lʼovule est personnifié, il incarne des rôles que nous ne connaissons que trop bien :
Dans une image, nous voyons la fertilisation comme une sorte de viol collectif martial, tandis que les membres de lʼarmée masculine guettent lʼœuf passif. Dans une autre image, lʼœuf est une prostituée, attirant les soldats comme un aimant, soit lʼimage classique de la séduction et la justification du viol […] Cependant, une fois pénétré, lʼœuf devient la dame vertueuse, fermant sa porte aux autres prétendants. Seulement alors lʼœuf, parce quʼil a fusionné avec un spermatozoïde, est sauvé de son endormissement pour devenir actif180 (1989, 176).
Ces représentations des gamètes puisent dans des univers genrés patriarcaux, mais leur fréquence aide également à fixer lʼidée que la différence de genre est avant tout une différence de sexe. En associant des natures déterminées, opposées, dès lʼorigine de la vie et au plus petit niveau cellulaire, les récits des sciences de la Nature proposent un modèle totalisant, duquel il nʼest pas possible de sʼextraire sur le plan du temps (puisquʼil en a toujours été ainsi, depuis notre conception) et de lʼespace (puisquʼil en est ainsi partout, jusquʼau plus petit niveau de la cellule). Le Biology And Gender Study Group montre ainsi comment ce récit fondamental de la procréation contamine ensuite dʼautres domaines de la science, plus éloignés a priori de la constitution de la différence sexuelle. Un généticien raconte ainsi la relation entre noyau cellulaire et cytoplasme comme une relation de couple hétérosexuel (1989, 179), tandis que la discipline de la chimie organique est saturée par des références à la pénétration qui assignent des rôles masculin/féminin à ses objets181 (182). Emily Martin, pour sa part, montre comment les valeurs qui sont associées au spermatozoïde et à lʼovule affectent également le corps mâle et le corps femelle182 tout entiers. Tandis que les hommes «  produisent  » des spermatozoïdes, selon un processus qui déclenche lʼadmiration des scientifiques, les femmes (Martin 1991, 486) «  se délestent  » dʼun ovule par mois183. E. Martin dégage ainsi tout un lexique de la dégénération et de la décrépitude employé pour décrire le comportement physiologique de lʼanatomie vagin-utérus-ovaires. Lʼovule est passif, «  à la dérive  » tandis que le spermatozoïde est «  streamliné  »184 (489), et quʼimporte si déjà dans les années 90 des recherches tendaient à montrer que le paradigme de la pénétration conquérante nʼétait pas adéquat pour décrire la fécondation chez lʼhumain (Martin 1991, 493). Toutefois, E. Martin montre que même de nouvelles recherches peinent à échapper au paradigme narratif dominant de lʼovule comme «  demoiselle en détresse  », sauvée par le spermatozoïde (491 ; 498). Tout se passe comme si lʼobjectif de découverte des sciences expérimentales butait sans cesse sur le langage et les représentations quʼil charrie : la reproduction humaine est sexuée matériellement, mais la complexité de ses opérations se trouve simplifiée par des récits préexistants comme celui de la rencontre amoureuse hétérosexuelle «  naturelle  ».
La clé ne se situe peut-être pas uniquement dans le protocole expérimental renouvelé, mais dans une approche résolument politique des sciences, qui prennent acte de leur pouvoir de normalisation et des biais quʼelles permettent de créer et plus encore de solidifier. Elsa Dorlin convoque ainsi le travail de Sandra Harding pour affirmer que :
il faut admettre que les positionnements des scientifiques ne sont pas tous également valables, cʼest-à -dire également ‹ objectifs ›. Seuls ceux qui répondent aux exigences dʼune science démocratique le sont. Ainsi, Sandra Harding considère quʼ‹ il est faux de croire que la méthode scientifique requiert lʼélimination de toutes les valeurs sociales dans les processus scientifiques ›. Autrement dit, Harding fonde lʼobjectivité scientifique sur une définition de la démocratie, réellement anti-sexiste et anti-raciste (2008, §17).
Une conséquence possible dʼun tel discours, identifiée par Elsa Dorlin, est lʼabandon de toute objectivité. Elle est en quelque sorte concomitante dʼune vision constructiviste radicale : tout est construit, rien nʼéchappe à nos biais de représentations, lʼobjectivité est donc impossible. Mais tout lʼenjeu dʼune science féministe consiste à ne pas abandonner la possibilité dʼune objectivité, ou, en tout cas, à penser des processus dʼobjectivation adéquats, destinés à un savoir «  démocratique  » comme le demande Sandra Harding. Cette dernière parle également dʼ«  objectivité forte  »185 (Harding 1993 citée par Dorlin 2008, §16) et évoque Donna Haraway pour qui le problème est peut-être davantage éthique quʼépistémologique (1991, citée par Dorlin 2008, §17, note 41). En relisant le texte antérieur de D. Haraway sur les savoirs situés, on constate que la question devient épistémologique du fait de ses implications éthiques. Refuser lʼobjectivité, en tant quʼelle constitue lʼémanation dʼun regard faussement neutre, Blanc, patriarcal, peut sʼentendre mais revient à faire adopter une attitude totalisante (totalitaire ?) en fait dʼune autre. Au prétexte que la connaissance est biaisée, toute entreprise de connaissance est marquée du sceau de la subjectivité, de la relativité. D. Haraway nous met en garde contre ce phénomène :
Nous avons démasqué les doctrines de lʼobjectivité parce quʼelles menaçaient notre sens émergent dʼune subjectivité et dʼune agentivité historiques collectives ainsi que nos représentations de la vérité, et nous nous sommes retrouvé·es avec une excuse de plus pour ne pas apprendre la physique post-newtonienne et une raison de plus pour abandonner la bonne vieille pratique dʼautonomie féministe consistant à réparer nos propres voitures. Ce sont juste des textes, de toute façon, alors laissez-les aux garçons186 (1988, 578).
Plutôt que de trancher entre objectivité transcendante et constructivisme versant dans le relativisme, D. Haraway propose un regard encorporé187 (1988, 582), une pensée située permettant la connaissance, mais qui nʼévacue pas le bon sens, les faits et leur observation. Ces thèses importent au-delà des seules considérations épistémologiques, ou de leur intérêt pour lʼhistoire des sciences. Elles comptent pour les designers (et notamment celleux qui sʼaventurent en cuisine) dans la mesure où la science se rend palpable, dans nos usages, dans les techniques dont elle favorise lʼémergence188.
La pensée située défendue par D. Haraway permet de sortir de lʼornière dans laquelle peut nous placer une critique féministe du point de vue omniscient des dominant·es, et de la valeur dont elle se pare, celle de lʼobjectivité. Elle permet aussi de poser une relation au monde qui autorise la critique des catégories régulatrices que sont «  homme  » et «  femme  » dans la mesure où «  [l]e monde ne parle pas pour lui-même, pas plus quʼil ne disparaît à la faveur dʼun maître décodeur189 (Haraway 1988, 593). Tout le propos de la philosophe vise ainsi à émettre la possibilité de cartographies (sa métaphore du regard lorgnant vers la représentation cartographique) qui nʼimplique pas un regardeur en surplomb, ou situé en dehors de ses objets, mais une multiplicité de points de vue qui soient dans le monde, avec lui -— ce que Stacy Alaimo nomme «  trans-corporéité  »190, soit le point de contact entre le corps et son environnement (Alaimo 2008, 238). Cet appel à penser des continuités entre lʼentreprise de connaissance et ce qui est à connaître évoque dʼautres unions conceptuelles souhaitées par D. Haraway. Les sciences du vivant construisent le concept de Nature en lui attachant la génération dʼune humanité sexuée, donc biface, mais à lʼintérieur du «  sexe  », nous lʼavons vu, ce sont les femmes qui incarnent la Nature, et les hommes la culture. Panser la fracture opérée par le système sexe-genre, cʼest aussi par effet dʼécho sʼintéresser à ces «  divisions meurtrières entre nature, culture et technologie ou encore entre organisme, langage et machine  »191 (Haraway 2020[2016], 258). Renoncer à la vérité de la Nature ou à la Nature comme vérité ne nous condamne pas à la page blanche, plutôt à des sutures stratégiques, des endroits de réparation entre des concepts disjoints par la pratique de la catégorie. Penser des continuités permet de les observer, aussi. Paul B. Preciado évoque ainsi la «  puissance performative  » de la science (2008, 33) en reliant celle-ci, au-delà des seuls énoncés, à des «  artefacts vivants  » (ibid.). Il ne sʼagit pas seulement de créer des objets, des prothèses, des substances psycho-actives, mais de créer la fiction dʼun corps naturel à partir de celles-ci. Il en résulte que :
La grande réussite de la technoscience contemporaine est de transformer notre dépression en Prozac, notre masculinité en testostérone, notre érection en Viagra, notre fertilité / stérilité en Pilule, notre sida en trithérapie. Sans quʼil soit possible de démêler ce qui vient en premier, de la dépression ou du Prozac, du Viagra ou de lʼérection, de la testostérone ou de la masculinité, de la pilule ou de la maternité, la trithérapie ou du sida (2008, 33–34).
Ces croisements impurs entre corps et chimie, entre corps et prothèse sont souvent recodés comme «  naturels  » lorsquʼils paraissent reproduire lʼordre de la Nature (lorsque les Å“strogènes sont prescrits aux femmes cis fertiles, par exemple). Sʼil y a une «  vérité du sexe  », nous dit P. B. Preciado, elle «  nʼest pas dévoilement, elle est sexdesign  » (35). Son analyse a ainsi le mérite de tracer des liens continus entre la production de savoirs et la production dʼappareils qui vont légitimer ces savoirs. Oserait-on aujourdʼhui critiquer un fait a priori évident, comme le fait que les Å“strogènes soient des hormones «  féminines  »â€¯? Cette connaissance vient-elle de notre connaissance assidue de lʼendocrinologie, ou de pratiques collectives, parmi lesquelles la consommation considérable dʼœstrogènes par les femmes cisgenres en âge de procréer ? Lʼépistémologie issue des sciences du vivant construit donc son concept de la Nature en lien avec des techniques de renforcement du fait naturel. Notre concept du sexe, de la partition homme/femme est indissociable des prothèses diverses qui appareillent de façon différenciée hommes et femmes. Cet appareillage binaire a plus à voir avec nos représentations, des mythes collectifs quʼil nous faut renforcer, quʼavec une quelconque pragmatique. Sans quoi, comme le rappellent P. B. Preciado et Juliet Drouar, on prescrirait sans problème de la testostérone aux femmes cisgenre, pour combattre les troubles hyposexuels ou la dépression (Preciado 2008, 178–79 ; Drouar 2021, 43–44), ou on accepterait que des sportives présentent de hauts taux de ladite hormone avant une compétition (Fausto-Sterling 2000, 1 ; Drouar 2021, 43). Ainsi, tout le propos que jʼai développé précédemment sur la notion de «  Nature  », et que je mʼapprête à reprendre au sujet des orientations sexuelles et du concept de «  femme  » ne vise pas à abandonner ces termes, mais au contraire, à les repeupler. Nous avons en effet besoin de «  croyances biologiques hétérogènes  » (Haraway 2020[2016], 293), dʼune réécriture féministe et queer de ce que le concept de Nature recouvre (Alaimo 2008, 240) et plus encore, de ce quʼil implique. Et si dans le partage sexué cʼest «  la Femme  » qui incarne ce quʼil y a de plus naturel dans la Nature, il convient de nous interroger sur ce territoire à la fois matériel et conceptuel, social et culturel, que découpe le mot, dʼautant plus que les sciences de la vie ont solidifié la différence des femmes, en même temps quʼelles ont consacré leur place dʼobjet dʼétude privilégié (Gardey & Löwy 2000, 11).
Je parle de la place des femmes en cuisine, et je définis bien le terme «  cuisine  ». Il semble alors entendu quʼil faut définir le terme de femme. Comme pour tous les termes apparemment évidents, la tâche est en réalité immense, surtout une fois que lʼon a préparé le terrain en le dynamitant, comme je lʼai fait en pointant la circularité du système sexe-genre. Mon travail sʼinscrit dans une approche queer, et lʼapport des études queer, dans leur majorité, consiste à déconstruire les catégories homme/femme, parfois à les déclarer obsolètes et à souhaiter leur disparition. Jʼai déjà émis quelques éléments de prudence à cet endroit (cf. infra., p. XX). À présent, lʼexploration de cet espace «  femme  » sur notre cartographie queer doit sʼeffectuer dans ce même esprit : tracer des zones habitables, plutôt que des contours nets qui rejettent ou excluent certaines personnes, reproduisent des formes de domination. Mais de quel concept partir ? La femelle qui constitue un des pans de la reproduction sexuée humaine ? La femme opposée à lʼhomme dans les statistiques sur le marché du travail, le partage des tâches domestiques ou les violences sexuelles ?
La Femmeâ„¢, variante de la Femme®192 rencontrée chez Barbara Métais-Chastanier (2018), cet idéal féminin apparemment naturel et évident, en réalité, très délimité, correspondant à une féminité bourgeoise, blanche, valide, mince, occidentale, auquel toutes les petites filles se comparent dès le plus jeune âge193 ? Des autrices aux fondements du féminisme, comme Virginia Woolf, ont refusé de définir le terme (2014[1928], 2). Les féministes matérialistes contemporaines, nourries par les théories queer, sont formel·les : «  La ‹ Femme › est une construction sociale  » (Gonzalez 2022[2012–13], 25). Et Simone de Beauvoir, qui a tant inspiré les mouvements féministes de la seconde vague se pose la question aux prémices du Deuxième Sexe : «  Y a-t-il même des femmes ?  » (1976[1949], 13), puis «  quʼest-ce quʼune femme ?  », question à laquelle elle choisit de répondre de manière situationnelle, à partir de la différenciation dans les processus socioculturels (conversation ordinaire, représentation dans les arts). Autrement dit, les épistémologies féministes se donnent pour première tâche de décaler la question de ce «  quʼest  » la femme, en refusant son essence comme son unicité. Mais refuser lʼessence ne revient pas à se départir de la catégorie, quand bien même on sʼengage dans un fort travail de désessentialisation. Ainsi, Monique Wittig, célèbre pour son affirmation selon laquelle «  les lesbiennes ne sont pas des femmes  » (2013[2001], 67) justifie toutefois son usage du terme «  féministe  »â€¯:
Que veut dire ‹ féministe › ? Féministe est formé avec le mot ‹ femme › et veut dire ‹ quelquʼun qui lutte pour les femmes ›. Pour beaucoup dʼentre nous, cela veut dire ‹ quelquʼun qui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe ›. Pour de nombreuses autres, cela veut dire ‹ quelquʼun qui lutte pour la femme et pour sa défense › -— pour le mythe, donc, et son renforcement. Pourquoi a-t-on choisi le mot ‹ féministe ›, sʼil recèle la moindre ambiguïté ? Nous avons choisi de nous appeler ‹ féministes ›, il y a dix ans, non pas pour défendre le mythe de la femme ou le renforcer ni pour nous identifier avec la définition que lʼoppresseur fait de nous, mais pour affirmer que notre mouvement a une histoire et pour souligner le lien politique avec le premier mouvement féministe (50–51).
Plutôt que de remplir la boîte «  femme  », observons les mouvements de balancier qui traversent la catégorie : on la convoque, pour désigner un groupe opprimé, une classe de sexe (Guillaumin 2016[1978]) ; on le rejette, en tant quʼil est constitutif de ladite oppression. À lʼintérieur du terme même, les contradictions grouillent, le terme relevant dʼun «  non-être  », du «  paradoxe dʼêtre à la fois captive et absente du discours, dʼêtre toujours le sujet de la conversation, mais inaudible en soi, inexprimable, dʼêtre le sujet du spectacle et dʼêtre non-représentée et non-représentable, invisible mais constituée en objet et la garantie de la vision ; dʼêtre un être, enfin, dont lʼexistence et la spécificité sont simultanément imposées et refusées, niées et contrôlées  »194 (De Lauretis 1990, 115). Mais se débarrasser du mot «  femme  », nʼest-ce pas prendre le risque de le voir approprié par dʼautres, défini stratégiquement par lʼoppresseur (hommes dominants, masculinistes) et les ennemies politiques (TERF) ? Virginia Woolf en fait lʼexpérience, lorsquʼelle observe le nombre dʼouvrages qui ont été écrits par des hommes au sujet des femmes, «  des hommes sans apparente qualification si ce nʼest quʼils ne sont pas des femmes  »195 (Woolf 2014[1928], 31). Peut-être faut-il donc accepter, plutôt que le poids dʼune catégorie, le mouvement tour à tour centripète et centrifuge qui caractérise son appropriation, ou son rejet. Le fait que la catégorie «  femme  » dérange, titille, tout autant que son absence ou sa suppression, indique que le terme recouvre plusieurs dimensions. Ce sont ces facettes multiples que je vais à présent tâcher dʼexposer et dʼarticuler.
La notion de «  sujet excentrique  »196 de Teresa de Lauretis peut nous guider dans cette entreprise. Dans son article de 1990, la philosophe inscrit la question «  quʼest-ce quʼune femme ?  » dans la catégorie historique et politique de la «  conscience féministe  »197. La conscience nʼest pas le seul site où émerge et se complique ce terme de «  femme  »â€¯; elle fait en réalité partie dʼun ensemble plus complexe, «  la nexus langage/subjectivité/conscience  »198 (1990, 115). Tout lʼeffort de Teresa de Lauretis dans ce texte consiste à tordre lʼexigence féministe dʼidentification à un rôle, qui devient identification à un mouvement pour produire des formes de désidentification. Il sʼagit de «  reconceptualis[er] le sujet comme mouvant et multiplement organisé au travers dʼaxes variables de la différence  »199, que peuvent être la classe, la race, etc. (116). Le double mouvement (rapprochement/éloignement) est constitutif de cette conscience féministe telle que la formule De Lauretis. Elle implique de se reconnaître comme sujet dʼune oppression, puis dʼune lutte, tout en se dégageant dʼune vision simpliste ou unitaire dans laquelle le sujet (soi) ne serait qu’opprimé. La position de T. De Lauretis est donc intersectionnelle, mais paraîtra sans doute aussi intellectuelle, fonction de la situation sociale spécifique dʼune personne universitaire et lettrée. Mais il nʼen est rien. Lʼétude ethnographique que Beverly Skeggs réalise en 1997 auprès de femmes britanniques inscrites dans des formations Sanitaire et Social200 montrent que les enquêtées sont très conscientes de leur position de sujet «  femme  », quʼelles en saisissent les dimensions associées de performance, dʼartifice, de résistance (111). Par ailleurs, B. Skeggs utilise son terrain pour montrer que la catégorie «  femme  » existe toujours «  sous des surcouches dʼautres catégorisations, comme la classe ou la race  »201 (1997, 115).
Ainsi, on pourrait décrire la conscience féministe comme une percée qui sépare le «  sujet excentrique  » (un soi complexe, différent de la catégorie occupée) dʼune figure «  femme  » qui condense cette catégorie de sexe qui «  tient bien les femmes  » (Wittig 2013[2001],43), connexe aux scripts de genre qui rassemblent les diverses injonctions faites aux femmes par le patriarcat, y compris jusque dans la définition des féminismes essentialistes qui sʼadressent, plutôt quʼà la classe politique concernée par le terme «  femme  », aux «  femmes comme elles doivent être : blanches, hétérosexuelles, soumises et de classe moyenne  » (Preciado 2008, 293). Cʼest ce quʼon pourrait appeler, à la fois dans un souci de simplification et dans une volonté dʼévocation, la Femmeâ„¢, avec Barbara Métais-Chastanier (2018).
Parler de Femmeâ„¢, cʼest identifier un ensemble dʼinjonctions faites aux femmes et se mettre en capacité de les critiquer. Paul B. Preciado en donne un aperçu dans sa longue énumération intitulée «  Quelques codes sémiotechniques de la féminité appartenant à lʼécologie politique pharmacopornographique  »â€¯:
[…] Lʼhonneur des vierges, la Belle au bois dormant, la boulimie, le désir dʼenfant, la honte de la défloration, la Petite sirène, le silence face au viol, Cendrillon, lʼimmoralité ultime de lʼavortement, les gâteaux, savoir faire une bonne pipe, le Lexomil, la honte de ne pas lʼavoir encore fait, Autant en emporte le vent, dire non quand on veut dire oui, rester à la maison, avoir des petites mains, les ballerines dʼAudrey Hepburn, la codéine, prendre soin de ses cheveux, la mode, dire oui quand on veut dire non, lʼanorexie, savoir en secret que celle qui te plaît vraiment cʼest ta copine, la peur de vieillir, la nécessité dʼêtre constamment au régime, lʼimpératif de la beauté, la kleptomanie, la compassion, la cuisine, la sensualité désespérée de Marilyn Monroe, la manucure […]202 (2008, 112–13).
Le féminisme permet de décaler «  femme  » de lʼessence vers la conscience. Le texte de P. B. Preciado, pour sa part, me semble être un exemple dʼune conscience féministe au travail, capable de nommer son programme dans sa part culturelle, médiatique, sociologique, mythologique (etc.) et de le rendre visible comme un entrelacement de détails, de pratiques et de grands récits qui ensemble forment un montage de parties interdépendantes, se nourrissent et se renforcent entre elles pour former ce monolithe injonctif de la Femmeâ„¢. «  Être femme  » ne peut être défini comme un ensemble fixe dʼexpériences, mais comme un ensemble dʼéléments que tout sujet «  femme  » rencontre dans sa vie, et quʼelle vit de manière plus ou moins limitante, selon, aussi, les autres oppressions quʼelle traverse. Lʼinjonction à la beauté et à la minceur, sʼil concerne toutes les femmes (et même les sujets assignés femme, jʼy reviendrai) ne les opprime pas toutes de la même manière. Lʼune pourra être évincée dʼune carrière intéressante à cause de son apparence physique, lʼautre sera agressée ; une autre encore trouvera dans la performance traditionnelle de la féminité un moyen de surmonter dʼautres oppressions (par exemple transphobie, validisme, etc.) ou au contraire, vivra cette injonction comme une sorte de double peine (par exemple, quand le racisme et la Blancheur imposent et redoublent les injonctions à la féminité). Une autre, sans doute blanche et bourgeoise, ne verra pas dans ces demandes des injonctions, mais plutôt des outils stratégiques pour négocier avec les hommes et se distinguer dʼautres femmes (femmes non-blanches, lesbiennes, trans, pauvres, handicapées). Ainsi, la Femmeâ„¢ nʼest pas un ensemble anecdotique de contenus qui seraient révélateurs du sexisme : il est lʼoutil même par lequel les femmes sont opprimées, même si elles le sont à des degrés divers. Cʼest un levier de poliçage des corps : la Femmeâ„¢ sert à créer des écarts, à juger qui est «  femme  », ou qui ne lʼest pas, ou pas assez. Ne pas être femme, ce nʼest pas nécessairement être homme, dʼailleurs : on peut être jugée comme devant être femme en fonction de son sexe, mais pas assez femme en vertu de son genre203 -— dʼoù lʼutilité, encore une fois, de préserver ces termes comme catégories dʼanalyse.
Le fait que le genre et sa performance soient policés implique que le genre fasse lʼobjet dʼun apprentissage. Ainsi, tous les contenus qui représentent le genre, des performances de genre, leur réception et les émotions qui les accompagnent peuvent aussi fonctionner, principalement ou de manière secondaire, comme des contenus pédagogiques sur ce quʼil convient de faire ou non de son genre, ou avec son genre. Emmanuel Beaubatie parle ainsi de «  renforcement différentiel  » (2021, 91) pour évoquer la manière dont lʼentourage des petits garçons et petites filles valorisent les enfants dont les comportements genrés sont perçus comme appropriés. Cʼest un des plus grands paradoxes des cultures genrées : le genre est vu comme découlant «  naturellement  » du sexe mais, pour autant, cette expression «  naturelle  » est soumise à lʼapprobation des pair·es, qui pourront valider, ou non, lʼappartenance de genre sur la base de cette expression. Le mot dʼappartenance importe : il ne sʼagit pas seulement dʼêtre, mais plus encore dʼêtre rattaché·e à un groupe. Lʼactiviste Shon Faye observe que ces questions ne concernent pas seulement le genre, mais lʼappartenance à des groupes politiques, comme les LBGT+, acronyme dont la définition historique, descriptive, nʼa pas découragé certain·es lesbiennes et gays les plus conservateurices de parler négativement des personnes trans, et de se réclamer dʼun mouvement (les LGB) qui accepterait toute orientation sexuelle, en renforçant toutefois lʼassignation sexuée. En évoquant cette question, S. Faye parle de lʼidentité comme dʼune «  carte de membre  »204 (2021, 199). Lʼimage convoquée par cette terminologie me semble intéressante pour parler des questions de genre et de la dimension processuelle de la validation des performances genrées. En effet, une carte de membre a la caractéristique de pouvoir être révoquée. Ainsi, on pourrait opposer les expériences dʼune femme trans à qui on refuse lʼaccès aux toilettes des femmes, et dʼune femme cis à qui on dit quʼelle doit avoir des enfants, sans quoi elle ratera sa vie. En réalité, ces deux femmes vivent des événements qui ont la même racine : la catégorie «  femme  » est mobilisée comme un outil pour contrôler leur existence. On leur refuse la carte de membre Femmeâ„¢.
La Femmeâ„¢, en posant un modèle unique à partir duquel les femmes sont jugées, crée aussi des fractures au sein de possibles coalitions féministes. On peut échouer partiellement dans la performance de la Femmeâ„¢, cʼest même inévitable : dès lors, une stratégie possible (vouée à lʼéchec sur les plans politiques et éthiques) consiste à cibler un groupe de femmes moins femmes que soi. Femmes racisées, voilées, pauvres, handicapées, trans, stériles, ou au contraire mère de nombreux enfants : toutes ces femmes peuvent à lʼenvi être convoquées pour créer une forme de distinction et, en retour, de validation par les pair·es. Il existe des événements historiques qui illustrent cette question de lʼappartenance. Le Womyn Festival est un festival de musique qui sʼest tenu dans le Michigan entre 1978 et 2015. Il est associé à des polémiques célèbres, car ses organisatrices en ont refusé lʼaccès à des femmes trans. En les voyant selon un prisme essentialiste, les dirigeantes du festival ont aussi affirmé que leur événement était réservé aux «  womyn-born womyn  » ou «  femmes nées femmes  »205 (Wilchins 1997, 109–114 ; Halberstam 2018, 108–109). Autrement dit, le mouvement de réappropriation amorcé par le mot nouveau devient encore un autre moyen de policer lʼaccès à une catégorie. Cette stratégie fait écho à un tweet de lʼautrice J. K. Rowling, qui revendique sa position de personne «  gender critical  » hostile aux personnes trans, et plus particulièrement aux femmes trans. Le 6 juin 2020, elle cite un article qui évoque une initiative dédiée aux «  personnes menstruées  », et commente :
‹ Les personnes menstruées ›. Je suis sà »re quʼil y avait un mot pour désigner ces gens. Voulez-vous bien mʼaider ? Des famp ? Des phummes ? Des vemmes ?206
Je trouve saisissant que le choix de renoncer à «  woman  », et au contraire, celui dʼinsister sur son usage (en le limitant par la même occasion) qui, là encore, peuvent paraître deux attitudes opposées, relèvent en fait du même conservatisme transphobe et sexiste. Pour cette raison, je suis réticent à lʼidée dʼabandonner le terme. Je pense en effet à la précaution proposée par Donna Haraway, au sujet dʼun autre mot, celui de «  parent  », quʼelle estime «  bien trop important pour que nous lʼabandonnions à nos opposants  » (2020[2016], 293). Ne pas renoncer à certains concepts nous place (nous, féministes) cependant dans une situation difficile. Si nous nous refusons à nous défaire de «  femme  », il faut en penser lʼusage et visibiliser tout ce que la catégorie façonne et régule, le «  diffracter  » (Cervulle 2008, 19). Comme «  trans  », comme «  gay  », ou «  noir·e  », «  femme  » nʼest pas un «  terme stable  » (Yala Kisukidi 2020). Le mot nʼest pas seulement un régulateur de genre, comme le suggère mon emprunt de La Femmeâ„¢ à Barbara Métais-Chastanier. La féminité nʼest pas définie par «  les femmes  », ou même par «  les hommes  ». Historiquement, elle est un marqueur de classe et de race : ce sont par exemple les femmes bourgeoises blanches qui, au XVIIIe siècle, définissent des habitus de femme (gestes, vêtements, hexis corporelle) pour se distinguer dʼautres femmes subalternes (Skeggs 1997, 99).
Par ailleurs, la différence de sexe-genre nʼest pas vue comme un invariant dans la culture étasunienne coloniale. Comme lʼexplique lʼhistorienne Gail Bederman, «  les hommes et femmes sauvages (cʼest-à -dire, non-blanc·hes) étaient vu·es comme presque identiques, mais les hommes et femmes des races civilisées avaient vu lʼévolution de différences sexuées prononcées  »207 (1997, 25). Des délimitations similaires produisent la Femme en produisant une féminité de classe, lorsque «  des femmes de la classes ouvrière ont été codées comme naturellement saines, robustes et résistantes (tout en étant vues, paradoxalement, comme les vecteurs dʼinfections et de maladies) à lʼopposé de la fragilité physique des femmes middle-class  »208 (Skeggs 1997, 99). Les travaux historiques et sociologiques sur le système sexe-genre montrent ainsi que ces catégories sont intrinsèquement co-construites et quʼil importe de les saisir de manière intersectionnelle. Lʼune (le genre) nʼest pas le «  dérivé  » de lʼautre (la classe) (Gonzalez 2022[2012–13], 26). Il nʼest pas de concept de «  femme  », pas plus que de représentations culturelles injonctives (La Femmeâ„¢) ou potentiellement libératoires («  womyn  » ou le plus récent «  womxn  ») qui ne soient dissociables de la race et de la classe. Cʼest aussi le sens du «  ne suis-je pas une femme ?  » («  Ainʼt I a Woman?  ») lancé par Sojourner Truth dès 1851 à lʼassemblée réunie à Akron, Ohio, pour discuter des droits des femmes. La militante afro-descendante avait alors réussi à tordre le cou aux arguments sexistes des hommes dans la salle, mais aussi à «  exposer les biais de classe et le racisme du nouveau mouvement des femmes  »209 (Davis 1981, 55). Ce mot de femme possède donc son utilité politique, pour peu quʼon rende visible la manière dont lʼaccès à celui-ci peut être normatif. Au besoin, dʼautres figures peuvent lʼaccompagner, en faire proliférer les possibles -— aucun ne requiert lʼabandon du terme «  femme  », mais plutôt, un geste de décalage qui permet le foisonnement. Paul B. Preciado en propose une petite liste dans son écrit sur les savoirs vampires :
la ‹ frontera › et ‹ la peau › de Gloria Andalzua, la ‹ batârde › et la ‹ malinche › de Cherri Moraga, le ‹ cyborg ›, le ‹ coyote ›, le ‹ virus ›, le Modest_Witness, lʼOncoMouseÔ(sic), le FemaleManÓ(sic) de Donna Haraway, ‹ le sujet nomade › de Rosi Braidotti, ‹ lʼintellectuelle organique › dʼAurora Lewis, la ‹ mimesis déviée › de Hommi Bhabha, le ‹ drag › et la ‹ citation subversive › de Judith Butler, le gender blending de Kate Bornstein, ‹ lʼhermaphrodyke › de Del Lagrace Volcano, ‹ le gode › ou ‹ la prothèse › de Preciado, la ‹ trans-formation  » de Terre Thaemlitz…Toutes ces notions délégitiment la pureté, la téléologie et lʼunidimensionnalité des savoirs produits par les représentations de la modernité sexo-coloniale. (2005, §4)
Le terme «  femme  » peut conduire à se décaler vers «  cyborg  » ou «  sujet nomade  », tout comme il peut être la base dʼune coalition. Cʼest donc moins la redéfinition qui nous intéresse, que de questionner la relation aux mots et la manière dont nous les investissons, pour préférer à la «  carte de membre  », qui régule les comportements, lʼévocation dʼun espace où se rassembler, se côtoyer (si on estime lʼexpression du «  toustes ensemble  » galvaudée). Pour Lola Olufemi, le mot «  femme  » est «  une coalition stratégique, un terme parapluie sous lequel nous nous rassemblons pour faire des demandes politiques. Il peut être mobilisé au service de celleux qui, si on leur donnait le choix, sʼidentifieraient autrement. Dans un futur libéré, il nʼexistera peut-être plus du tout  »210 (in Faye 2021, 260 ; Olufemi 2020, 65). Si lʼon retrouve lʼidée de la disparition du terme «  femme  », on voit que chez L. Olufemi, elle nʼest pas un objectif politique. Lʼactiviste et autrice Shon Faye livre cette citation dans le contexte dʼune réflexion sur la place des personnes trans dans le mouvement féministe. Elle rappelle quʼêtre trans ne signifie pas automatiquement lʼabolition des catégories de genre -— catégories qui sont dʼailleurs multiples : vouloir la disparition du mot «  femme  » implique aussi la disparition du mot «  homme  ». S. Faye rappelle enfin la centralité de lʼorganisation, plutôt que dʼun consensus autour des catégories. En somme, nous défendons ici avec cette autrice, entre autres, la priorité des objectifs politiques sur les revendications identitaires. Cʼest encore une position qui ne peut que se renforcer au contact des méthodologies de design : penser le système sexe-genre doit nous attirer vers une pragmatique qui permette des conversations, des rassemblements, des alliances stratégiques, et non dʼultimes gatekeeping et arc-boutements autour des mots.
Il en résulte également que le féminisme nʼa pas vocation à structurer dʼautres mouvements dont il serait la branche parente dominante. Le transféminisme -— tout comme les luttes anti-racistes, lesbiennes, gays, anti-validistes, anti-islamophobie, anti-capitalistes (etc.) -—nʼest en effet pas «  un mouvement rival, ni une subdivision du féminisme  » (Faye 2021, 240). Ainsi, quand je parlerai plus avant de «  femmes  », je ferai référence au groupe hétérogène que lʼon nomme comme tel, rassemblé par une expérience commune du sexisme, et qui pourra posséder un utérus (ou pas), être en capacité de reproduction (ou pas), être en relation avec des hommes (ou pas), être assigné·e à la cuisine et au care des enfants (ou pas), etc. Chaque fois que ce mot apparaîtra, ce sera comme une catégorie résolument instable, un précipité qui menace toujours de déborder de son éprouvette.
Et si cela semble trop flou, quʼon pense que mes précautions oratoires (les «  ou pas  ») nʼempêchent nullement dʼobserver les faits et les conditions matérielles des vies de femmes (le pluriel étant ici important). Enfin, si le terme «  femme  » dérange, quʼon pense quʼici, plutôt que La Femmeâ„¢, il invoque une coalition de meufs211, rassemblé·es par leur expérience du sexisme et des oppressions auxquelles il sʼarticule.
Un dernier pas de côté importe avant de détricoter ce qui dans ce système sexe-genre fondé sur la différence (la différence étant incarnée par le pôle féminin, soit «  la femme  ») participe de la division hétéro/homo. Autrement dit, la dernière partie de ce texte ne se propose pas de changer de sujet, mais plutôt de focale : ce seront dʼautres binarités à lʼœuvre, ou plutôt, nous regarderons les mêmes binarités sous un autre angle pour constater que les logiques sont similaires, puisque lʼabject, jusquʼici incarné par le féminin, est aussi le terrain de lʼhomosexualité -— à moins que lʼhomosexualité nʼapparaisse comme une énième cristallisation de la misogynie. Mais pour éclairer cette place du féminin dans lʼhomophobie, et donc dans la culture à la fois sexiste et hétéronormative (on pourrait dire sexiste parce quʼhétéronormative), je souhaite aborder le travail dʼAndrea Long Chu, une autrice qui pose moins la question de la «  femme  » que du «  féminin  ». Quoique ce terme de «  féminin  » ne soit pas non plus tout à fait exact : il traduit imparfaitement le terme anglophone «  female  », qui devrait peut-être plutôt, surtout dans le contexte de ses écrits, être traduit par «  femelle  »212, même si le féminisme nous enjoint à une certaine prudence à lʼégard dʼun terme qui, en français, possède des connotations animalisantes et un potentiel essentialisant. A. Long Chu annonce ainsi la thèse de son ouvrage Females (2019), un petit opuscule rafraîchissant sur les questions de genre et de sexe, dont la réflexion se fonde sur une lecture située de la pièce Up Your Ass213 (1965) de Valerie Solanas :
lʼêtre femelle est un sexe universel défini par la négation de soi, contre lequel toutes les politiques, y compris féministes, se rebellent. Pour le dire plus simplement : tout le monde est femelle, et tout le monde déteste ça (2019, 11)214.
Si A. Long Chu parle de femelle, elle ne limite pas son propos à la sexuation. Pour autant, sa théorie me semble être une piste cruciale pour éviter le «  cul-de-sac  » opposant essentialisme et constructivisme (Cervulle 2008, 18). En effet, lʼautrice définit comme «  femelle  » «  toute opération psychique où le soi est sacrifié pour faire place aux désirs de lʼautre  »215 (2019, 11). Il semblerait donc que cet être-femelle ne soit biologique quʼen apparence, puisque la figure ici découpée évoque le rôle social de la mère, et de toutes les femmes qui sʼépuisent en actes de care pour leur entourage. Mais A. Long Chu va plus loin, en décrivant toutes les situations dans lesquelles le soi devient «  lʼincubateur dʼune force étrangère  »216 (ibid.). Elle précise que la «  femaleness  » dont elle parle ne tient pas plus au sexe quʼau genre (12), et quʼelle est «  ontologique  » plutôt que «  biologique  »217 (ibid.). Être, dit A. Long Chu, cʼest être femelle : ainsi, «  toutes les femmes sont des femelles, mais toutes les femelles ne sont pas des femmes  »218 (12). A. Long Chu développe sa thèse dans un second temps. Une fois affirmé que tout le monde est femelle, A. Long Chu pose également que «  tout le monde déteste ça  »219 (13). Lʼapproche de Long Chu lui permet de sortir dʼune vision différentielle du genre. Elle ne nie pas quʼil existe socialement des hommes et des femmes (ce qui serait absurde !), ni même du sexisme. Cependant, la place polarisée du féminin, qui recouvre le groupe «  femme  », se trouve ici désaxée. En effet :
Le genre ne se résume pas aux attentes misogynes quʼune femme [female] internalise, mais il est aussi le processus dʼinternalisation lui-même, le doux suicide du soi au nom des désirs de lʼautre, du narcissisme de lʼautre (2019, 35)220.
La pensée de A. Long Chu a de nombreuses implications. Elle revisite le motif de lʼenvie du pénis, cher à Freud, et le retourne (presque littéralement, sur le plan anatomique) en «  envie de la chatte (sic)  »221 (25). Elle développe :
le complexe de castration est facilement confondu avec la peur dʼêtre castré ; en fait, cʼest la peur de chacun·e, dʼavoir été castré·e, et dʼaimer ça. Lʼenvie de la chatte nʼest ainsi pas lʼopposé exclusif de lʼenvie du pénis, mais un désir universel par-dessus lequel cette dernière envie se développe comme une formation réactive : tout le monde fait de son mieux pour vouloir le pouvoir car, au fond, personne nʼen veut du tout.
Deux idées intéressantes peuvent découler de la lecture de A. Long Chu ; premièrement une compréhension plus complexe, moins binaire, des processus de genrage, qui nous sera utile pour comprendre lʼhétéronormativité ; deuxièmement, un autre regard sur le sexe.
Concernant le premier point, la lecture de A. Long Chu a le mérite de rompre avec une lecture oppositionnelle du genre. Je lʼai pourtant soutenue dans ces pages : il est vrai que les femmes se construisent en opposition aux hommes, et réciproquement. Mais A. Long Chu suggère de regarder autrement cette construction binaire et oppositionnelle. En effet, les hommes ne se construisent pas tant en opposition aux femmes quʼen opposition à cet «  être-femelle  » qui est leur lot, mais pas comme un féminin minoritaire, complémentaire de leur masculinité majoritaire. Cet être-femelle nous affecte toustes : il concerne un lieu de désir, une manière de se laisser saisir par lʼautre, dans lʼattraction, de se décaler de ses envies pour céder à celles de lʼautre (sexuellement, mais pas seulement). Être-femelle, cʼest être bottom, soumise, passive222, cʼest devenir «  chochotte  » (A. Long Chu dit en anglais «  sissy  »223, 73–74) car «  ce nʼest pas seulement que tout le monde a une image érotique de soi comme féminine [female] -— même si cʼest le cas -—mais que lʼassimilation de toute image érotique est, par nature, femelle [female]  »224 (2019, 74). «  Femelle  » est donc lʼhorizon de toute position de désir (qui paradoxalement consiste à nier à ce désir, à se faire objet du désir de lʼautre), en même temps que, dans la culture occidentale, ce quʼil ne faut pas être. Andrea Long Chu adopte ici une posture provocatrice dans la mesure où, chez les femmes, ce refus dʼêtre «  femelle  » peut trouver à sʼincarner dans une posture féministe -— qui sʼoppose à la misogynie tout en exprimant celle-ci (14). En un sens, ces propos font écho à Julia Serano lorsque celle-ci critique «  le présupposé féministe qui veut que ‹ la féminité soit artificielle ›  », y lisant une approche «  narcissique  » qui «  situe invariablement les femmes non féminines comme ayant une ‹ connaissance supérieure ›  »225 (338). Prendre en considération notre «  être-femelle  » commun et la détestation que nous éprouvons pour elle serait ainsi une piste pour déconstruire la transmisogynie (Serano 2016[2007] 14–15) -— cette forme spécifique de misogynie qui cible les personnes trans, en particulier les femmes trans, souvent épinglées car elles reproduiraient une féminité vue comme outrée, parodique, trop séduisante, trop sexuelle, trop patriarcale, trop capitaliste, et, surtout ne leur «  appartenant  » pas par lʼassignation de naissance.
Un second point peut nous aider à consolider cette piste. Cet «  être-femelle  », tel que je lʼai décrit jusquʼà présent, semble surtout renvoyer à un ensemble dʼinjonctions, à une forme du désir, autrement dit, à des caractéristiques culturelles plutôt que biologiques, indépendamment de ce que peut suggérer ce vocable de «  femelle  », a fortiori en français. Pourtant, lʼintuition de A. Long Chu croise des faits biologiques de manière parlante ; lʼautrice en prend dʼailleurs acte en évoquant les recherches dʼAlfred Jost, un endocrinologue français dont les recherches ont établi que «  lʼêtre-femelle  » nʼest «  pas seulement un sexe, mais le sexe par défaut du fÅ“tus mammifère  »226 (Long Chu 2019, 45). Elle trouve des traces de ces savoirs chez le gynécologue Marci Bowers, un des premiers médecins à pratiquer la vaginoplastie, pour qui cette opération (qui permet de construire un vagin à partir des tissus du pénis) revient à un état antérieur, à «  rembobiner la cassette  »227 (Long Chu 2019, 46) plutôt quʼà créer un corps différent. Enfin, elle évoque les travaux du célèbre John Money lorsque ce dernier sʼintéresse au syndrome dʼinsensibilité aux androgènes. Le médecin sʼenthousiasme de voir que chez les sujets qui ne répondent pas à la testostérone, «  les Å“strogènes testiculaires marchent très bien pour fabriquer une femelle [female]  »228 (Money in Long Chu 2019, 47). Il écrit également :
Tel est le pouvoir dʼÈve qui se tapit, pour toujours emprisonnée, y compris chez celui qui a la barbe la plus fournie, la voix la plus grave, chez lʼhomme le plus héroïquement androgénisé et le plus macho dʼesprit !229 (Money in Long Chu 2019, 47).
Andrea Long Chu commente avec humour : «  sait-il seulement ce quʼil dit ?  »230. Car, en effet, les implications sont immenses sur le plan épistémologique. Lʼêtre-femelle de A. Long Chu nʼest pas seulement une variation sur le genre ou un renversement des conceptions freudiennes. Cette clé nous emmène en réalité sur un chemin où le genre peut être complètement diffracté -— plutôt que supprimé. Historiquement, le fait que le développement femelle sʼeffectue «  par défaut  » a plutôt été interprété selon le motif de la passivité du féminin, face à un masculin actif (The Biology And Gender Study Group, 1989). Mais on peut considérer cet être-femelle commun, effectif sur le plan de la biologie de lʼembryon, dʼune tout autre manière. Elle invite pour commencer, à regarder lʼanatomie comme un continuum, à préférer un regard saisissant des corps divers, rassemblés par un héritage charnel commun, concomitant aux mille particularités associées à la génétique, au développement, aux influences environnementales. Le développement embryonnaire en est le meilleur exemple. Nous sommes si habitué·es à distinguer les individus sur la base du sexe, ou plutôt, sur une de ses manifestations particulières quʼest la forme des génitoires (Hoquet 2016, 73), quʼon oublie le matériau biologique commun aux pénis et aux vulves (Fausto-Sterling 2000, 50). Anne Fausto-Sterling explique ainsi que «  le pli urogénital embryonnaire reste soit ouvert pour devenir des lèvres vaginales ou fusionnent pour devenir un scrotum  »231 : ainsi, plutôt que dʼopposer des appareils génitaux apparemment différents, on pourrait les considérer comme deux versions, deux incarnations dʼun même matériau fondamental232. Le récit de la différence sexuée ne résiste pas à lʼobservation scientifique dont elle se réclame pourtant. Il est possible dʼimaginer une lecture du sexe, indépendante du genre, qui ne transforme pas ses observations en projections de destins, sur un mode déterministe. Sʼil y existe une réalité commune, comme le proposent souvent les tenants dʼun universalisme pour qui le terme «  Homme  » désigne justement lʼensemble de lʼespèce humaine, le mot de «  femelle  » serait bien plus approprié pour la nommer. Il est probable quʼune telle proposition ne rencontre que de lʼopposition, de la part des plus masculinistes comme des féministes. La résistance à reconnaître ce fondement femelle, féminin, comme position existentielle commune est rendue inévitable par la place quʼoccupe la masculinité dans nos sociétés. Et si «  les limites de la tolérance ont toujours quelque chose à voir avec les limites de la masculinité  » (Beaubatie 2021, 93), cʼest que le féminin constitue face à elle la figure repoussoir ultime. Lʼêtre-femelle de Long Chu me semble en effet faire écho à cet espace de lʼabject quʼévoque Paul B. Preciado, quʼil nomme comme «  le Sud  »â€¯:
Le Sud nʼest pas un lieu, mais plutôt lʼeffet de relations entre pouvoir, connaissance, et espace. […] Dans lʼépistémologie occidentale, le sud est animal, féminin, infantile, tarlouze. Le Sud est potentiellement malade, faible, stupide, incapable, paresseux, pauvre […] Dans le même temps, le Sud est lʼendroit où se déroule lʼextraction capitaliste : le lieu où le Nord capture énergie, sens, jouissance et valeur ajoutée. Le sud est la peau et lʼutérus. Lʼhuile et le café. La chair et lʼor (2019, 290–291).
Par lʼêtre-femelle, par le Sud, comment mieux comprendre ce que veut dire être une femme ? Si tout le monde est femelle, alors le groupe des femmes, aussi hétérogène soit-il, comprend tous les sujets à qui on assigne cet état pourtant universel. Le groupe des femmes nʼest pas un groupe dʼutérus, un groupe dʼindividus déterminés par les hasards de la génétique ou de la naissance, comme les plus conservateurs aimeraient nous le faire croire : cʼest le groupe-déversoir sur lequel la société occidentale loge ce quʼelle identifie comme plus abject. Passivité, pauvreté, saleté, stupre, lucre, sexualité, sont autant dʼétats et de valeurs associés, parfois en souterrain, au féminin compris comme femelle. Cela nʼempêche nullement quʼil existe des expériences de femmes qui puissent être acceptées, voulues, revendiquées. Il existe sans doute des plaisirs infinis à être une femme, mais aussi à faire la femme, la performer, la rejeter aussi, quand la catégorie et ses impératifs sont trop encombrants. Comme nous le dit Andrea Long Chu : «  Itʼs OK to want gender  »233 (Goldfarb 2018). Et peu importe que ce genre souhaité soit féminin, masculin, ou tout ce qui peut composer le spectre entre, en dessous, et au-dessus de ces deux pôles : être genré, comme se genrer, relève toujours dʼune forme dʼobjectification (Long Chu 2019, 36). En effet, comme lʼobserve Andrea Long Chu :
lʼaffirmation selon laquelle le genre est construit socialement sonne creux depuis des décennies, pas parce quʼelle est fausse, mais parce quʼelle est terriblement incomplète. En effet, cʼest une vérité triviale que dʼobserver quʼun certain nombre de choses est socialement construit, de lʼargent aux lois, en passant par les genres littéraires. Ce qui fait que le genre est le genre -— la substance du genre, si lʼon veut – est le fait quʼil exprime, à chaque fois, les désirs dʼun·e autre. Le genre a donc une relation complémentaire à lʼorientation sexuelle : si lʼorientation sexuelle est de manière basique lʼexpression sociale de notre sexualité, alors le genre est de manière basique lʼexpression de la sexualité de lʼautre. Dans le premier cas, on prend un objet ; dans le second, on est un objet. Du point de vue du genre, donc, nous sommes toustes des blondes stupides (Chu 2019, 35–36)234.
Sʼil est parfois de bon ton de dissocier le genre de lʼorientation sexuelle, lʼépistémologie que je propose ici de visibiliser et co-construire aurait intérêt à saisir ces réalités de manière conjointe. Je vais donc ici me déplacer sur la carte du genre, ou plutôt, lever le nez, pour percevoir que les territoires «  Homme  » et «  Femme  » que jʼobserve depuis le début sont, en plus dʼêtre irrigués par un puissant et unique fleuve «  Femelle  », couverts par un ciel de nuages re-distribuant, par le jeu des désirs et des pratiques sexuelles, la lisibilité de leurs périmètres.
Nous venons de parcourir les territoires du genre, et en fait de frontières, nous avons découvert des capillarités, des sols communs, des formes de continuité spatiale entre les catégories. Le duo homme/femme semble à la fois coulé dans le marbre, quand on observe les pratiques sociales et le jeu des injonctions, et fluide, dès lors que lʼon remonte le fil supposé des différences inébranlables. Au-delà de la seule nature du partage binaire, il nous faut interroger ses ramifications. Dans quelle mesure le partage homme/femme est-il renforcé, nourri, redoublé par le couple hétéro/homo ? La question mérite dʼêtre située dans le contexte global de cette étude. Tout lʼenjeu consiste à définir «  queer  », un terme que lʼon associe bien volontiers au fait de troubler les catégories, ou de redistribuer celles-ci. Jʼai entrepris un travail heuristique autour du système sexe-genre qui, sʼil semble un peu long, est absolument nécessaire pour éviter les lectures dépolitisées du queer. Jʼai revendiqué en introduction le fait que le concept de queer contienne une puissance de trouble qui dépasse les seules binarités du genre, des sexes et du sexe -— mais je me méfie aussi des usages qui associent strictement «  queer  » à la subversion235, comme si le mot possédait un pouvoir incantatoire et avait la capacité de rendre politique ce qui ne lʼest pas.
En résumé, on ne peut pas parler du queer sans savoir ce quʼil queerise, ne serait-ce quʼhistoriquement. Je mʼattacherai donc ici à relier les binarités de genre aux binarités qui structurent les comportements sexuels, même si ces liens ont tardivement été reconnus par les recherches françaises en sciences sociales (Clair 2013).
Hétéro/homosexuel sont des concepts historiquement récents, rattachés à la notion parente dʼorientation sexuelle. À supposer que les humains possèdent une orientation sexuelle (plutôt que des désirs, des pratiques, des cultures de la sexualité), comment sʼarticule-t-elle aux catégories sexe-genre précédemment évoquées ? Je montrerai ainsi que cette place abjecte, repoussoir, ce lieu de la différence quʼincarne le féminin (qui voile peut-être le fait que tout le monde est femelle) est redoublé par lʼespace de lʼhomosexualité, quʼelle soit masculine ou féminine – bien que lʼhomosexualité masculine et lʼhomosexualité féminine ne troublent pas le genre au même titre236. En miroir, le neutre transparent incarné par le masculin est équivalent dans son fonctionnement à lʼhétérosexualité. Je vais ainsi tâcher de montrer que la naturalisation du sexe travaille à naturaliser les comportements sexuels -— à moins que ce ne soit lʼinverse -—et mʼappliquerai à examiner le contenu de ces catégories hétéro/homo que le queer est censé troubler, car on peut en effet être gay sans être queer (Plana 2015, 30). En effet, je me garderai de définir une primauté dans le jeu des causes et des effets (en gros, de trancher un débat qui structurellement redouble celui de lʼœuf et de la poule), visant au contraire à rendre manifestes un jeu de définitions mutuelles entre sexe et sexualité, dont les réalités sont «  enchevêtr[ées]  » (Beaubatie 2021, 132). La question de ce qui vient en premier -— si tant est que quelque chose vienne en premier -—est presque indifférente pour cette étude : cʼest lʼefficace du sexe et du genre qui doit nous mobiliser ici. Ainsi, cʼest encore lʼesthétique de vérité, nous le verrons, qui apparaîtra comme la pierre angulaire de ce système hétéronormatif sans lequel il nʼy aurait point de placard, ni de coming out. Nous reviendrons alors sur cette idée de sortie du placard, et, en en ayant mieux compris le fonctionnement, nous serons enfin prêt·es à rencontrer lʼidée du queer, et surtout, la praxis que ce terme engage, à lʼendroit dʼun design repensé des espaces domestiques, dont la cuisine.
Aujourdʼhui, lʼactivisme LGBTQIA+ produit des formes diverses qui travaillent à déconstruire les présupposés pouvant toucher aux personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, intersexes, asexuelles, etc. Cʼest dʼabord aux États-Unis quʼapparaissent des supports pédagogiques qui tentent de modéliser graphiquement sexe, genre, attraction sexuelle, etc.
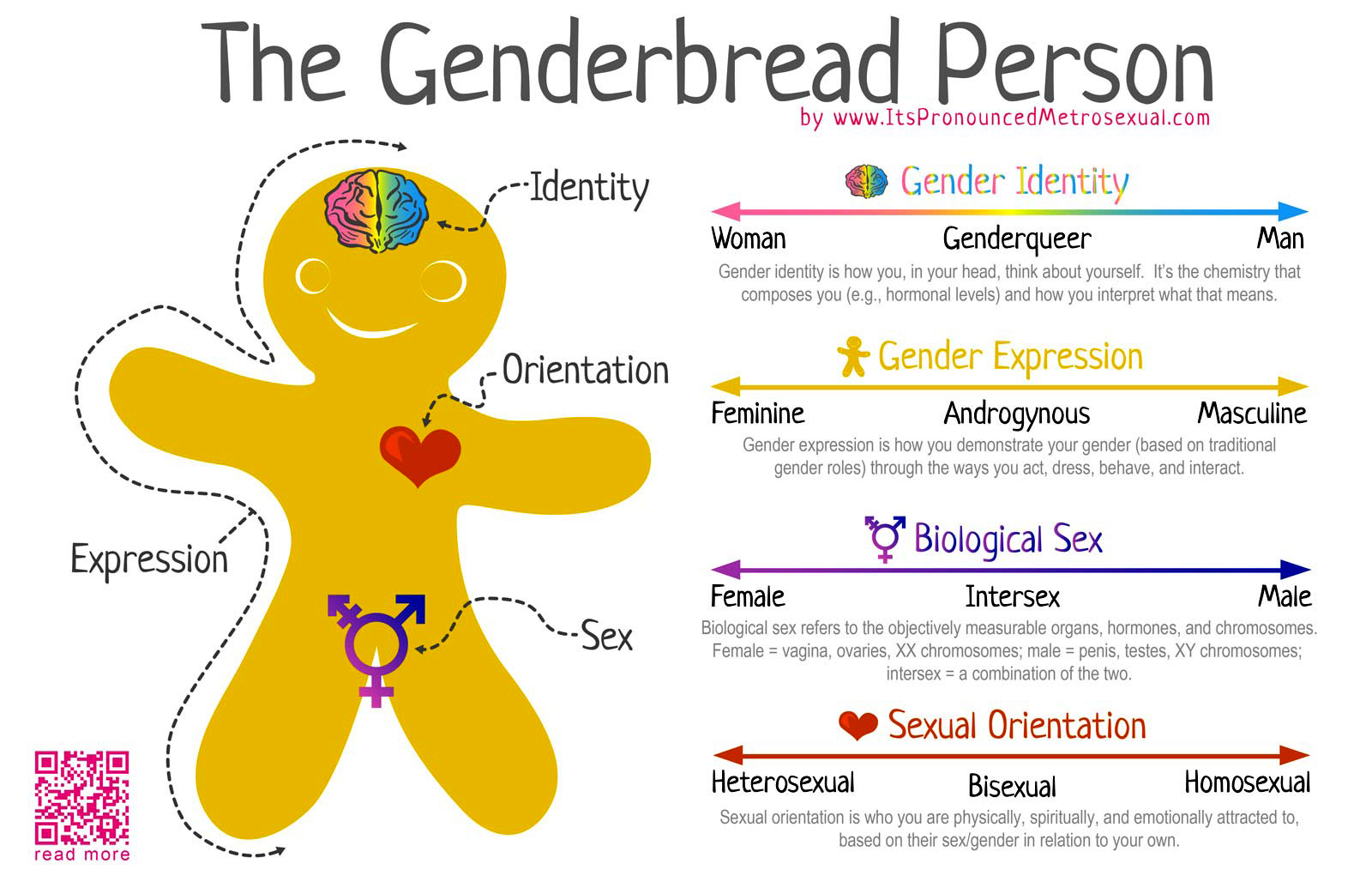
The Genderbread Person (ou en français du Québec, la Personne Gingenre) est une représentation graphique (donc une production de design) formalisée par lʼéducateur Sam Kellerman dʼaprès des posts anonymes diffusés sur la plateforme Tumblr237, et utilisés dans ses ateliers de sensibilisation avec lʼéducateurice Meg Bolger (fig. 1.6). Cette image est dʼailleurs régulièrement réactualisée en fonction des retours des usager·es.
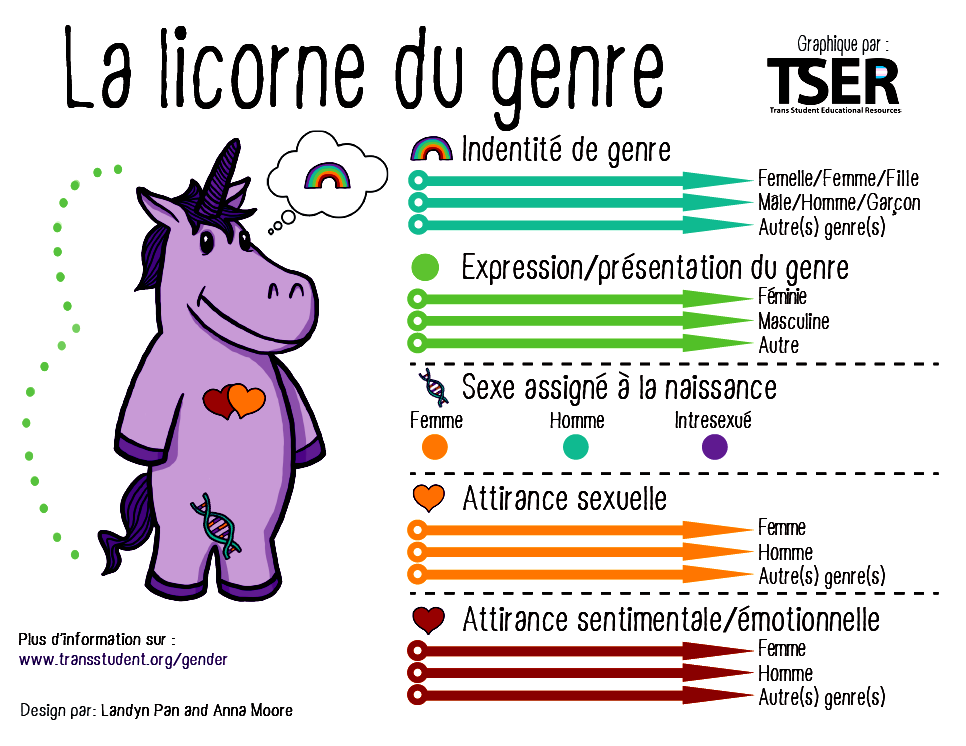
Elle ressemble au projet de la Licorne du Genre («  Gender Unicorn  ») dessinée par Anna Moore en 2015 pour les TSER (Trans Student Educational Resources, fig. 1.7). Ces supports visent à démêler ce quʼun prisme hétéronormatif fait passer pour évident et continu. Par exemple, un homme regardé avec un prisme essentialiste apparaît comme sexué mâle, comme personne masculine, comme homme hétérosexuel, et ces trois aspects (sexuation, genre, sexualité) seront souvent considérés comme évidents et en continuité lʼun avec lʼautre. Les schémas de la Personne Gingenre ou de la Licorne du Genre distinguent clairement la sexuation, le genre et la sexualité. On pourrait même leur reprocher de le faire de manière un peu trop exclusive, si on nʼavait à lʼesprit que ces représentations sont dʼabord des outils et des supports à conversation : ils nʼont pas pour objectif de figer des réalités, mais de permettre à des individus de nommer leur expérience. Dans des versions récentes, ces représentations distinguent même identité et expression de genre, ainsi qu’attirance sexuelle et attirance émotionnelle. Jʼutilise ainsi régulièrement ces outils dans mes cours : ils permettent dʼintroduire les catégories sexe-genre de manière aisée, et invitent les étudiant·es à considérer comment iels sʼidentifient pour elleux-mêmes, ou peut-être à se désidentifier. Ce processus de prise de conscience, réalisé en dehors et en complément des cours, me semble important pour nourrir leur réflexion sur un design queer. Cependant, cette clarté, bienvenue au début dʼun processus dʼapprentissage, appelle une complexification qui vise à éviter de réifier les catégories formées -— dʼautant plus que le design graphique les isole sur le plan visuel, et peut autant figer des concepts que le langage. Il existe dʼautres visualisations, comme la Gender Map (ref, fig. 1.8) ou les illustrations de Mapping your Sexuality (ca. 2015, fig. 1.9) qui, au prix dʼune forme de clarté, tissent de manière plus fluide et plus engageante les réalités sexe-genre-sexualité.
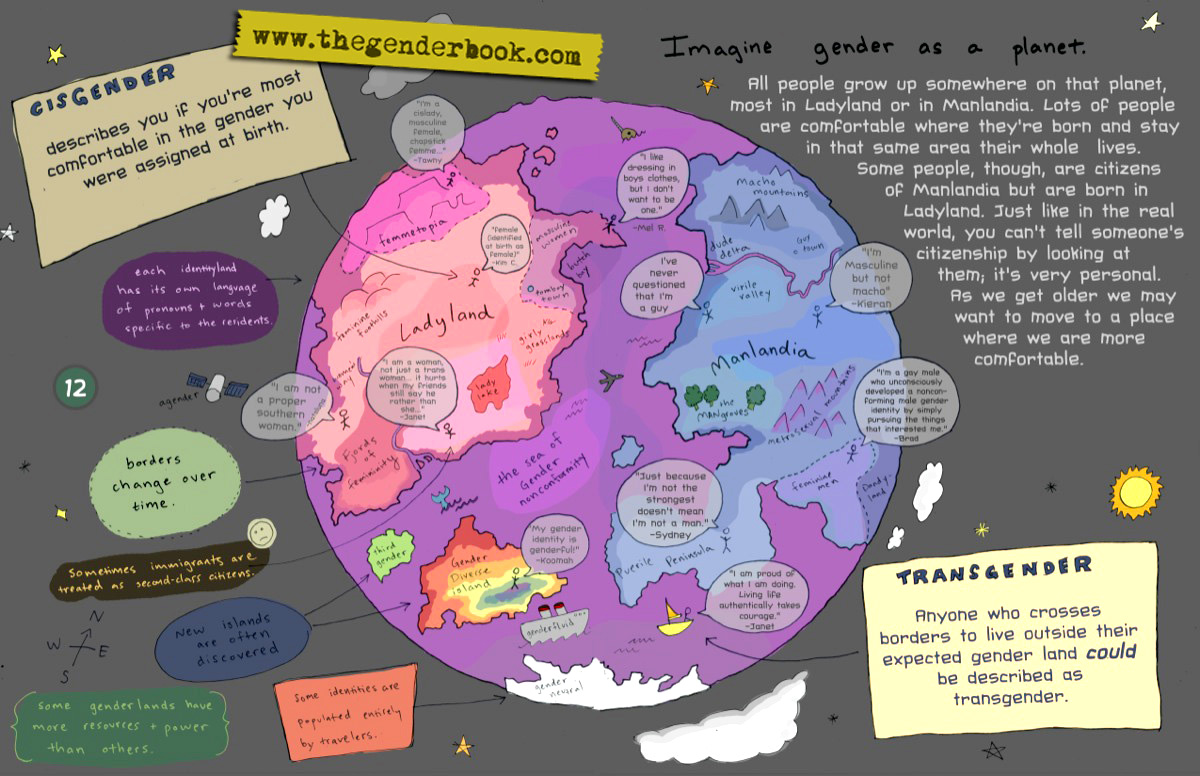
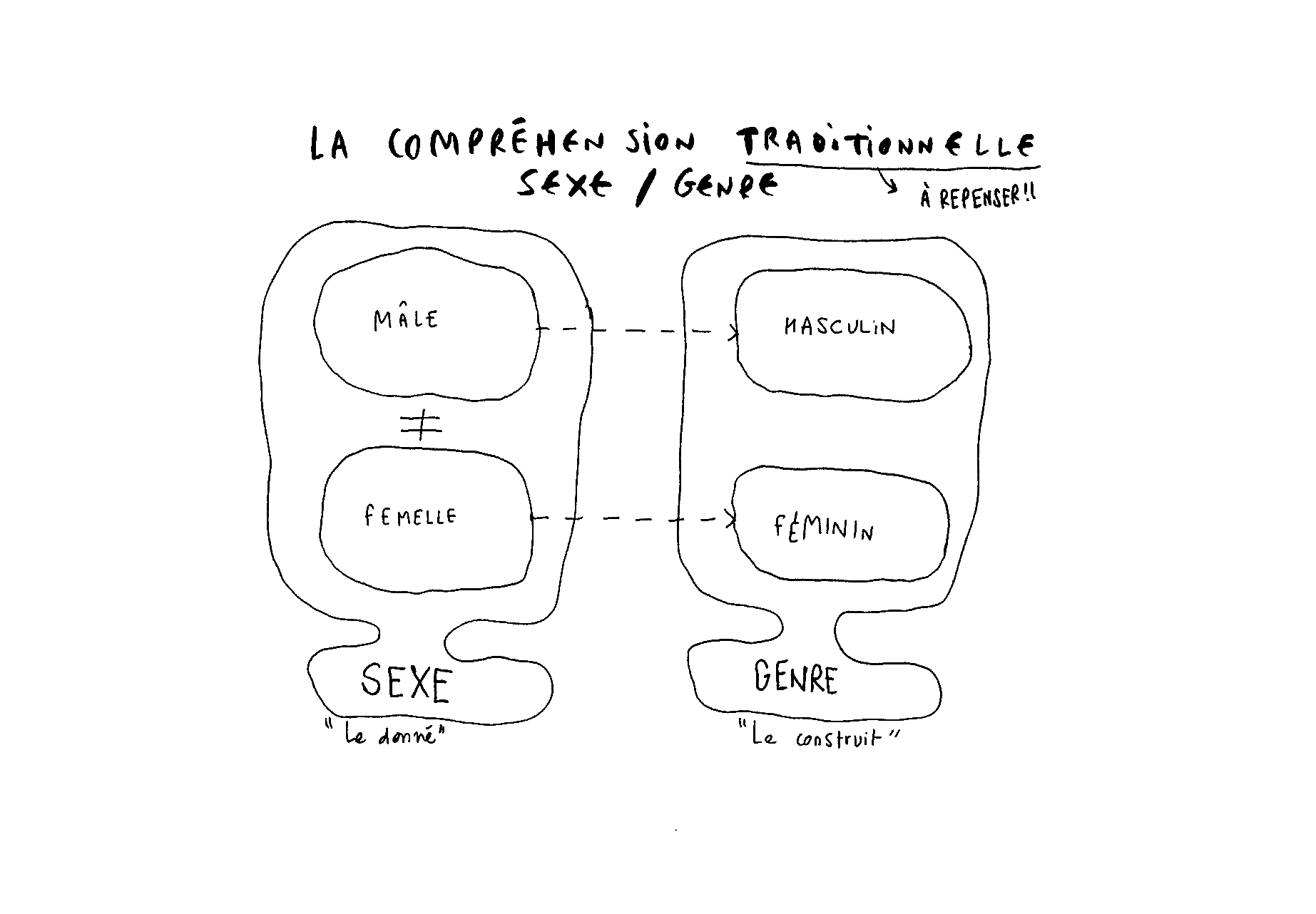
Jʼai également tâché, au fil des conférences et des cours, de proposer des représentations dessinées de lʼécheveau sexe-genre (fig. 1.10). Il me semble toujours difficile dʼéchapper à cette tension entre clarté et figement.
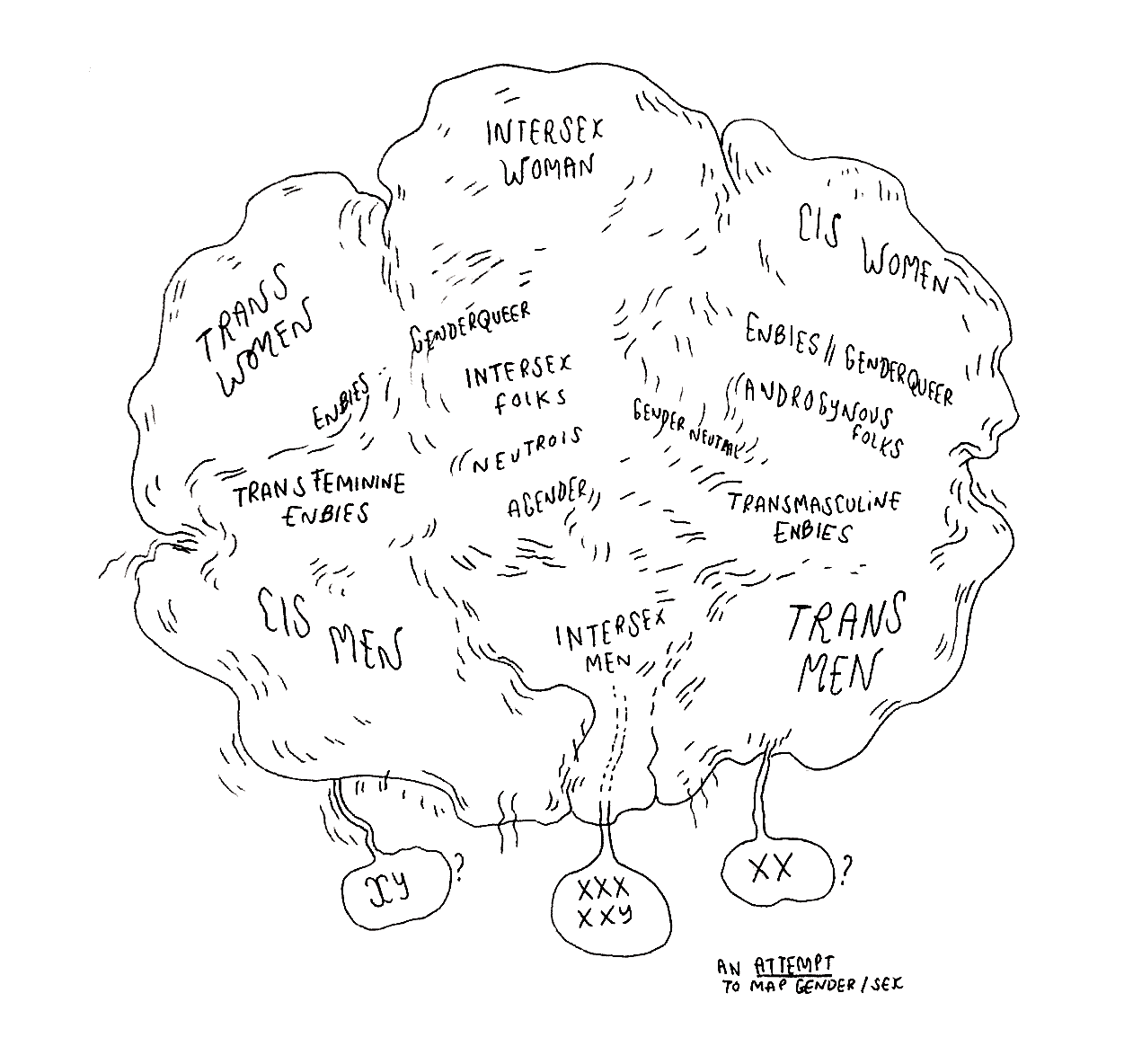
Plus le dessin est lisible, plus il semble solidifier des catégories et surtout des limites entre celles-ci. Ma stratégie de contournement, sur les plans pédagogique et scientifique, a consisté à multiplier les images, plutôt que de chercher à produire le visuel ultime. Les projets de la Personne Gingenre ou de la Licorne du Genre ne doivent pas non plus être interprétés comme des visuels de référence, mais plutôt comme des outils disponibles à la relecture, même si leurs choix graphiques ne rendent pas ceci complètement évident.
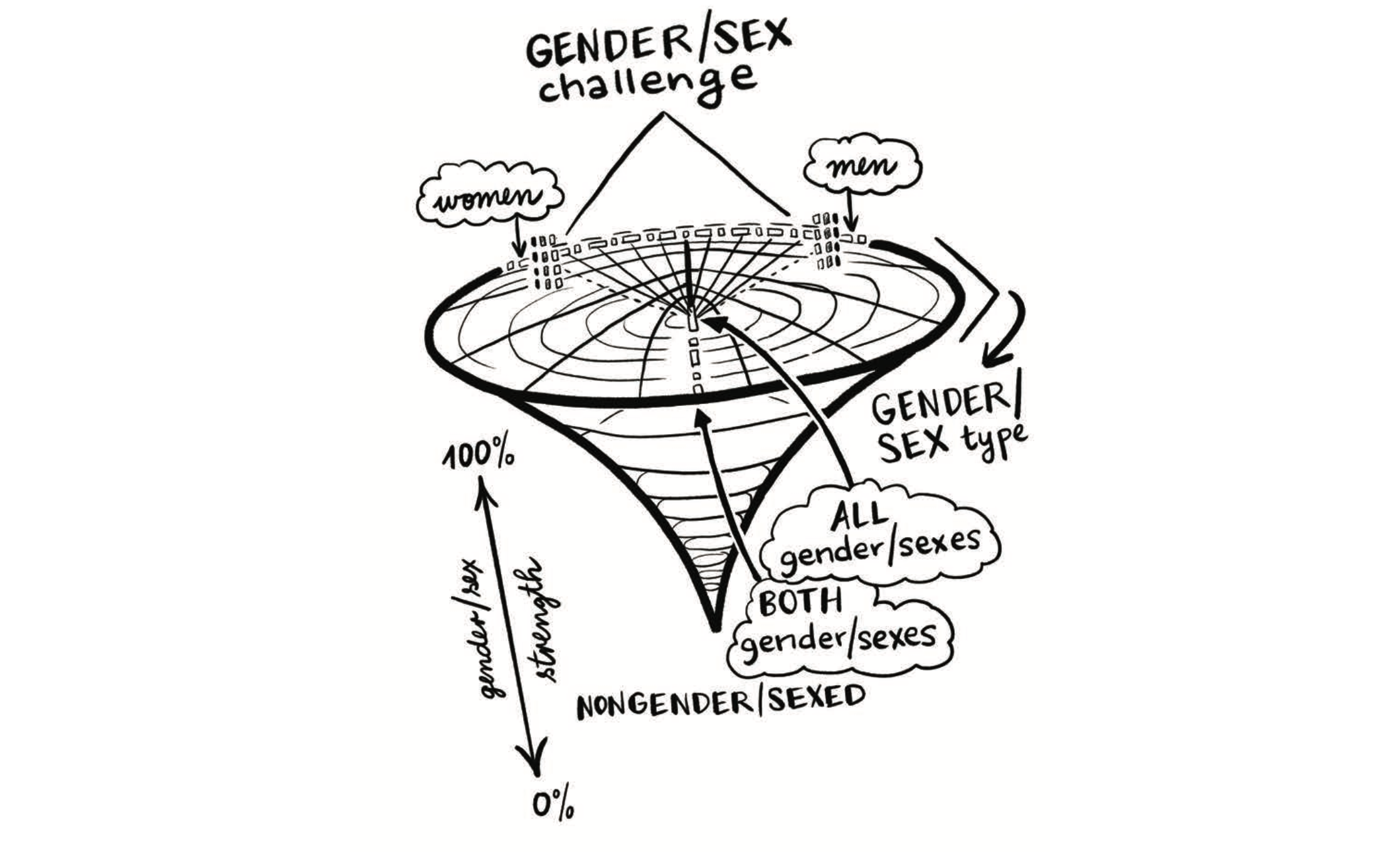
Mapping Your Sexuality, en faisant le choix du noir et blanc, évoque le cahier de coloriage et rend manifeste la possible appropriation des lecteurices.
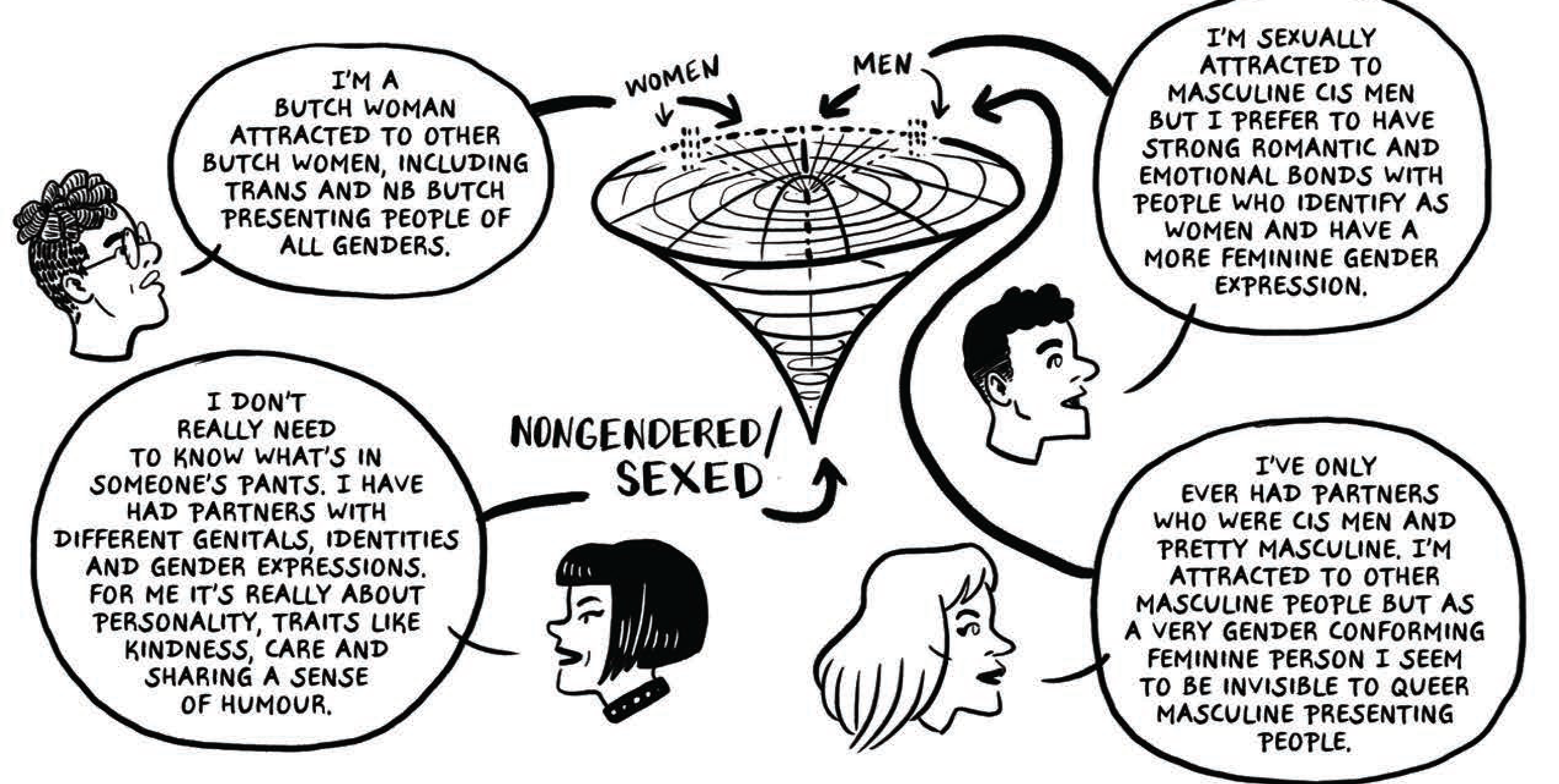
De plus, les schémas, clairs ou non, sont toujours accompagnés de personnages parlant dʼexemples dʼexpériences possibles (fig. 1.11), ce qui invite à considérer les textes comme des postulats devant être réévalués en fonction des situations, des subjectivités. Ces images héritent des travaux des années 90–2000 sur le genre et les sexualités, notamment du modèle performatif propre à Judith Butler. David Gauntlett expose ainsi comment la philosophe a fait muter notre perception de la triade sexe-genre-sexualité. Il recourt dʼailleurs à des schémas, montrant comment les trois termes sont dʼabord pensés comme co-dépendants (fig. 1.12) avant dʼêtre dissociés entre trois pôles étanches (fig. 1.13) : la réalité du corps, de lʼidentité, des désirs (2008, 148–149).
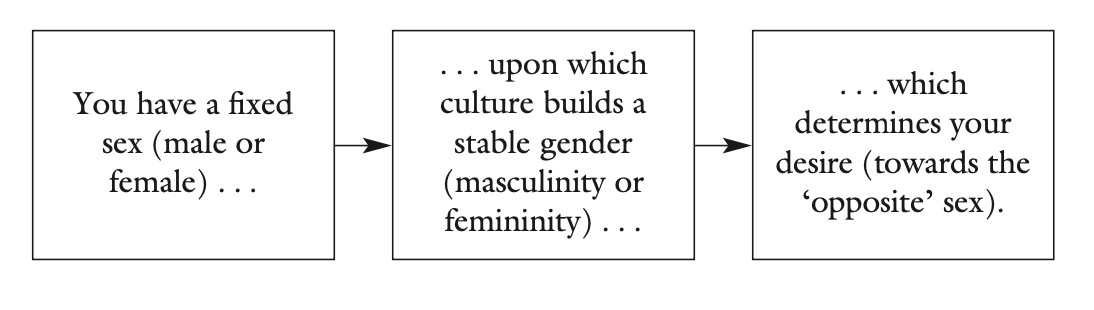
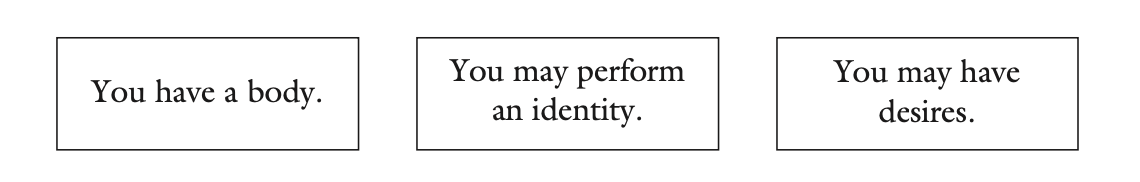
Ces divisions, comme les curseurs de la Licorne du Genre, ne sembleraient peut-être pas très queer à des lecteurices découvrant ces travaux. On peut en effet légitimement se demander ce quʼil y a de queer à réinscrire les corps et les identités dans autant de catégories. Toutefois, il faut aussi comprendre ces entreprises de clarification au regard des représentations hétéronormatives des personnes et identités queer. Sʼintéresser aux personnes queer telles quʼelles sont perçues par le «  straight gaze  », cʼest voir des confusions entre homme gay et femmes trans, observer que «  trans  » est conçu comme une identité de genre, ou encore un «  troisième sexe  », tandis que les personnes intersexes sont oubliées dans la description, ou pire encore, décrites comme des «  hermaphrodites  ». On a aussi longtemps supposé que les personnes trans étaient hétérosexuelles, et le respect de cette orientation sexuelle a souvent été un moyen du gatekeeping opéré par les soignant·es responsables des transitions. Autrement dit, les entreprises de clarification existent parce que les personnes queer, longtemps réduites au silence et empêchées de parler de leurs expériences, ont été représentées selon un prisme normatif qui écrase abusivement les catégories sexe, genre et sexualité lʼune sur lʼautre. Tout comme jʼai insisté précédemment sur la relation complexe qui existe entre sexe et genre, et sur la nécessité de préserver les deux termes, je vais conserver les trois catégories sexe, genre, sexualité, telles que D. Gauntlett les fait apparaître en lisant J. Butler. Rebecca Jordan-Young, dans un entretien238, évoque bien la particularité de ce système à la fois visiblement tripartite et particulièrement emmêlé, en le désignant comme un «  fil à trois brins  » (Jordan-Young interviewée par Mozziconacci 2015, 106) :
Sur le plan conceptuel, on peut séparer le sexe, le genre et la sexualité – cʼest utile de les dissocier – mais sur le plan ontologique, ce nʼest pas clair. Je ne suis pas en train de dire que dans la réalité, ils constituent des domaines objectivement séparés et je ne pense pas non plus quʼil sʼagit de parties dʼun domaine universel ou ‹ objectivement réel › du sexe. Je pense que ce sont des constructions qui nous aident à comprendre comment nous divisons lʼexpérience humaine, que ce sont différentes façons dʼappréhender des dimensions de la vie (Jordan-Young interviewée par Mozziconacci 2015, 107).
Il est ainsi utile de préserver les catégories mais dʼenvisager leur tissage sur le plan de lʼexpérience. Les modalités de cet entrelacement permettent peut-être de séparer un prisme hétéronormatif de ses éventuelles alternatives. Ainsi, R. Jordan-Young évoque la manière dont lʼhétéronormativité implique «  que les corps qui ont certains types de parties devraient aller avec certains types de désirs pour dʼautres corps avec dʼautres types de parties et quʼils devraient également aller avec un ensemble de façons dʼêtre dans le monde  », ce quʼelle nomme le «  forfait tout compris […] du sexe, du genre et de la sexualité  »239. Il convient ainsi de préserver des spécificités sans réifier des essences, et de considérer comment lʼeffort catégoriel, lorsquʼil est imposé aux individus et appliqué à un cadre pragmatique, peut créer des effets politiques néfastes.
En effet, Jack Halberstam évoque cette possible dérive lorsquʼil invite à ne pas séparer trop strictement les lesbiennes butch des hommes trans, renonçant ponctuellement à décrire les fictions de genre «  butch  » et «  homme trans  », pour nommer la fiction qui les enveloppe (cʼest-à -dire, nommer comme fiction), celle des «  distinctions claires  »240 (1998, 153). Il ne renonce pas à nommer des différences (dans les corps, les attitudes, les choix médicaux, vestimentaires), mais observe que «  de nombreux corps sont bizarrement genrés dʼune manière ou dʼune autre  »241 (153). Lʼidée nʼest donc pas de renoncer aux catégories, mais de faire usage de celles-ci pour complexifier le regard, plutôt que de le simplifier. J. Halberstam montre ainsi comment séparer les lesbiennes butch des hommes trans stimule la «  stigmatisation mutuelle  » (Beaubatie 2021, 45) : soit les premières peuvent voir les seconds comme des traîtres, incapables dʼincarner la masculinité sans changer socialement de genre, voire comme des complices du groupe dominant des hommes ; soit les seconds méprisent les premières, vues comme des hommes trans incomplets, refoulant leur nature trans ou incapables dʼabandonner leur privilège cisgenre pour transitionner242 (Halberstam 1998, 144). Ce nʼest pas tant, comme lʼaffirme E. Beaubatie, que J. Halberstam estime que les deux identités «  ont leur place sur ce quʼil nomme le ‹ continuum › de la masculinité  » (Beaubatie 2021, 45), mais que ce continuum (fig. 1.14) donne faussement lʼimpression que certains marqueurs permettraient dʼétablir une différence claire, voire essentielle entre les deux groupes.
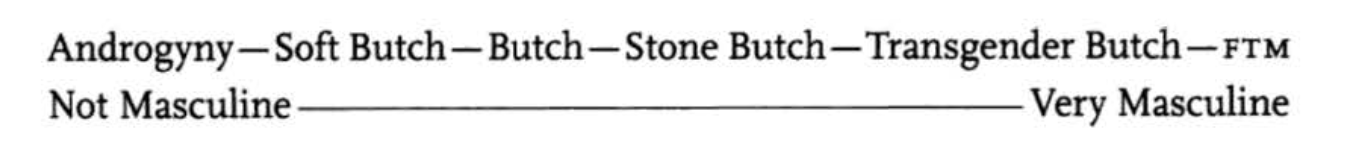
Ainsi, «  le modèle du continuum évalue mal la relation entre lʼaltération corporelle et le degré de masculinité  »243 (Halberstam 1998, 151). Ainsi, des lesbiennes butch ou stone butch peuvent prendre de la testostérone, tandis que des hommes trans sʼy refuseront, ou nʼauront pas accès à ce traitement. Le flou des catégories se renforce pour qui cherche à faire dʼune part lʼhistoire des lesbiennes butch, et de lʼautre celles des hommes trans. Que dire dʼune «  femme  », qui a vécu toute sa vie en tant quʼhomme ? Quʼiel a effectué ces modifications dans le but dʼaccéder à une carrière alors proscrite pour les femmes ? Quʼiel est un homme trans ne possédant pas alors le vocabulaire pour se nommer ? Il nʼexiste pas, historiquement parlant, de distinction claire entre la déviance de genre et la déviance sexuelle (Halberstam 1998, 161). Aussi, mon attitude à lʼégard de cette question reprend-elle celle que jʼai élaborée pour la catégorie «  femme  » ou pour la distinction sexe-genre : je conserverai ces termes distincts pour nommer des réalités, en évitant de déduire une essence de lʼexistence des catégories. Lʼefficace de ces termes doit toujours, il me semble, être située du côté de la coalition politique. Ou, comme lʼaffirme Isabelle Clair :
Il sʼagit […] de faire une distinction analytique entre genre et sexualiteÌ, en pensant aussi que certaines pratiques sociales ne sont compreÌhensibles quʼen prenant en compte leur intersection (2013, 113).
Ce sera lʼapproche que je tâcherai de mettre en œuvre dans les lignes qui suivent.
Il sʼagit ici dʼexaminer la binarité hétéro/homo : ces deux préfixes suggèrent le suffixe «  -sexualité  », si efficacement dʼailleurs que le langage courant tend à lʼéluder. Même si un mot comme «  homosocial  » existe, il est évident que le terme «  homo  » évoque lʼhomosexualité, ou lʼhomosexuel·le, plutôt que cette dernière variation linguistique. Aussi, jʼaimerais ici faire lʼhypothèse que les termes «  homosexualité  » et «  hétérosexualité  » sont des termes produisant un effet de voilement, limitant apparemment les identités quʼils désignent à un régime dʼattirance, quand ils sont en réalité étroitement associés au système sexe-genre. On me rétorquera que «  homo  » et «  hétéro  », issus du grec ancien, qui signifient respectivement «  le même  » et «  lʼautre  » se rapportent au choix dʼobjet en fonction du sexe : mais il sʼagit précisément ici de sexuation, et pas nécessairement de sexualité, même si nos conceptions des pratiques érotiques, en Occident, tendent à associer de manière très étroite désir et pratiques sexuelles, sexuation et sexualité (et on pourrait ajouter, amour). Nulle part ce fait dʼune homosexualité dépassant le champ des pratiques sexuelles nʼest plus lisible que dans lʼexpérience subie de lʼinsulte (Eribon 2012 [1999], 90). Il est assez clair, en effet, quʼun homme cisgenre peut être traité de «  sale pédale  » même sʼil ne se livre pas à ce moment précis à des actes sexuels, ou même à une forme de séduction. Il semble même que cʼest dans le domaine des interactions sociales les plus ordinaires que ces insultes sont proférées, et si elles suggèrent un comportement de la personne ciblée (tu es homo, tu couches avec des hommes), elles peuvent sʼappuyer sur toute une somme dʼindices non sexuels, même pas sexués, mais plutôt de lʼordre du genre (performance vestimentaire, vocale244, gestuelle, attitudes, habitus… la liste est sans fin) -— voire même, ce sont les «  niveaux apparemment les moins sexuels de lʼexistence personnelle  »245 qui sont ainsi saisis (Sedgwick 2008[1990], 2). Au-delà de lʼexpérience de lʼinsulte, il nʼest pas sà »r quʼil soit souhaitable de réduire lʼhomosexualité à la sexualité, ce qui équivaut à la réduire à des actes sexuels. Didier Eribon nous met en garde contre cette tentation, dans la mesure où, pour lui, cela «  revient à laisser de côté toutes ces expériences individuelles intensément vécues dans lesquelles il nʼest pas besoin que des actes aient été pratiqués pour que lʼidentité soit construite – parfois inconsciemment – autour de leur possibilité*  »* (2012 [1999], 79). Ainsi, même sʼil est possible et méthodologiquement intéressant de séparer sexe, genre, sexualité, jʼapprocherai ici lʼhomosexualité, le lesbianisme, la bisexualité et leurs variantes comme des espaces (vécus, de représentation) où sexe et sexualité sont saturés par le genre. Ceci me permettra de documenter la relation entre genre et sexualité, tout en ne réduisant pas lʼhomosexualité (comprise dans son sens le plus général) comme relevant de la seule sexualité.
Historiquement, nous lʼavons mentionné, la variance sur le plan de la sexualité a souvent été interprétée comme une variance de genre. Il est à présent bien connu que le terme «  homosexualité  » apparaît de manière tardive en Occident, et quʼil précède dʼailleurs celui dʼ«  hétérosexualité  ». Didier Eribon nous rappelle dans ses Réflexions sur la question gay que le paradigme psychiatrique de lʼinversion (qui saisissait les homosexuel·le·s comme des «  inverti·es  ») est souvent double, et désigne tout autant une «  inversion intérieure du genre (une âme de femme dans un corps dʼhomme ou dʼhomme dans un corps de femme  » quʼune «  inversion extérieure de lʼobjet du désir  » (2012 [1999], 125). Aussi ces «  deux grands ordres discursifs, qui doivent être distingués pour la clarté de lʼexposé, ne sont-ils jamais totalement séparés lʼun de lʼautre  » (126). En effet, un des projets de recherche les mieux financés au sujet de la variance sexuelle aux États-Unis sʼintitulait le «  Feminine Boy Project  »â€¯: mené dans les années 1980, il a mené à la publication de The ‹ Sissy Boy Syndrome › and the Development of Homosexuality246 par Richard Green en 1987 (Serano 2016[2007], 129). Julia Serano observe au sujet de ces recherches quʼelle rassemble sous le terme parapluie dʼ«  effimimanie  »247 quʼelles ont en commun une obsession pour la féminité masculine et quʼelles ont tendance à «  écraser lʼune sur lʼautre lʼexpression de genre féminine, lʼhomosexualité masculine et la transsexualité MTF  »248 (ibid.). Ainsi, comprendre le binôme hétéro/homo nécessiterait de comprendre comment lʼhomosexualité met en crise le binôme homme/femme sur lequel lʼhétérosexualité sʼappuie. Toutefois, lʼhomosexualité ne met que partiellement en crise ce binôme homme/femme : tout au plus, en rendant possible un choix dʼobjet qui ne repose pas sur une altérité supposée (les hommes pour les femmes, les femmes pour les hommes), elle fait dévier la compatibilité de ces deux identités ; mais elle est bien vite rattrapée par cette partition, soit parce que tous les homosexuels hommes (par exemple) sont vus comme des hommes efféminés, ou féminisés, soit parce quʼà lʼintérieur du champ social gay, il existe des distinctions entre «  vrai  » gay féminisé (souvent codé comme passif) et gay viril (codé comme actif) (Prieur 1996, 77). De même, il est courant dans les représentations des lesbiennes, y compris par elles-mêmes, de voir une distinction entre les «  fems  » et les «  butches  » (Feinberg 2004[1993], 31). Ces dernières adoptent des codes masculins249, et parfois, dans le cas des «  stone butches  », sont plus actives dans la relation sexuelle, au point de refuser leur propre gratification (Halberstam 1998, 120). Et si ces rôles peuvent correspondre à des goà »ts, des pratiques, des penchants, la culture hétérosexuelle a tôt fait de les resituer comme des appartenances de genre ayant la même force quʼune sexuation : ainsi, il a longtemps été courant, au sujet des gays et des lesbiennes, dʼentendre demander «  qui fait lʼhomme  » et «  qui fait la femme  », sous-entendu, qui est actif sexuellement (pénétrant), et qui est passif (pénétré). Lʼhétéronorme impose ainsi une forme de genrage dont la logique est liée à lʼacte sexuel hétérosexuel lui-même codé comme «  naturel  », dans la mesure où il est associé à la reproduction : la pénétration du vagin par le pénis. Et si je refuse ici de juger des goà »ts ou des penchants individuels, je reste assez surpris par le poids de cette partition actif/passif (ou sa variante top/bottom) dans les discours contemporains sur les pratiques sexuelles, y compris et parfois surtout dans des milieux queer, comme si le «  ou… ou bien  » de lʼordre binaire hétérosexuel devait à tout prix persister, y compris dans des arrangements qui en font éclater les ordres sexués et genrés. Thierry Hoquet résume ainsi la manière dont lʼhomosexualité, comme matrice de production du genre, est parcourue de contradictions :
Dʼune certaine manière, les homosexuels ont également été enrégimentés par la bicatégorisation. En apparence, ils la renforcent : ils recherchent le même sexe quʼeux et utilisent donc la bicatégorisation comme une table dʼorientation ; mais on peut dire également quʼils en sapent les fondements dʼau moins deux manières : en ce quʼils la vident de lʼhétérosexualité obligatoire qui en est le corollaire nécessaire ; en ce quʼils subvertissent les catégories de féminin et de masculin qui sont les éléments constitutifs de la bicatégorisation (2016, 64).
On voit bien ici que lʼhomosexualité, quʼelle soit une identité, une somme de pratiques, une culture ou tout cela à la fois repose sur un paradoxe : définie comme lʼattirance pour le même sexe, elle suppose un concept de la sexuation qui sʼordonne autour du même et du différent, soit la partition homme/femme. Tout à la fois, elle correspond à des individus (gays, lesbiennes) dont le genre vibre par le jeu des identifications et des pratiques, plus lisiblement encore que chez les hétérosexuel·les250 -— il en résulte que lʼhomosexualité, par la fabrication (entre autres !) dʼhommes féminins et de femmes masculines participe à désarticuler le «  rapport intrinsèque  » entre féminité/masculinité et femelle/mâle (Mathieu 1977, 52). Lʼhomosexualité peut donc être mobilisée pour défaire lʼidée que le genre découle automatiquement du sexe. La psychiatrie et la justice ont réglé cette question en faisant des gays et des lesbiennes des déviant·es de genre, qui doivent être pathologisé·es et criminalisé·es, pour être mieux soigné·es ou condamné·es (ou les deux). Cette saisie des gays et des lesbiennes comme sujets déviants permet ainsi de resolidifier lʼordre du sexe qui semblait menacé, en utilisant la figure du gay (surtout celle de la folle) et celle de la lesbienne (surtout celle de la butch) comme figures-repoussoirs face auxquelles apparaissent plus nettement les «  vraies femmes  » et les «  vrais hommes  ». Cʼest ainsi que la secousse initialement infligée à lʼordre sexe-genre par lʼhomosexualité (comme culture et somme de comportements) est retournée comme un gant pour consolider la norme, et sa pierre angulaire, la vérité et ses esthétiques. La catégorisation homme/femme suppose en réalité un ordonnancement de type vrai homme/vraie femme, centre autour duquel gravite une somme de rôles de genre plus ou moins acceptables. Isabelle Clair explique :
la norme heÌteÌrosexuelle, croiseÌe avec la prise en compte de lʼasymeÌtrie entre les groupes de sexe, agit sur les individu?e?s pour deÌfinir leur position dans leurs groupes respectifs : selon lʼopposition entre «  vrais mecs  » (au centre) et «  peÌdeÌs  » (aÌ€ la peÌripheÌrie) pour les garçons, et entre «  putes  » (stigmate collectif) et «  filles bien  » (position distinctive) pour les filles  » (2013, 110).
Mais la norme hétérosexuelle ici ne fonctionne pas seule : elle est elle-même traversée par une coupe, opposée au pôle de lʼhomosexualité qui lui offre ses contre-modèles contre lesquels appuyer son modèle du «  vrai  ». On pourrait dire, pour aller vite : sʼil y a des hommes et des femmes, cʼest parce quʼil y a des pédés ou des gouines251. Ou, plus précisément : les hommes et les femmes ont besoin des pédés et des gouines pour être, puisque la sexuation repose sur une bonne performance de genre, et soutient in extenso le fait dʼêtre vu ou non comme humain (Butler 2014[1993], 8). Si aujourdʼhui, la vision du gay comme «  homme féminin  » et de la lesbienne comme «  femme masculine  » semble en légère perte de vitesse dans les imaginaires collectifs, il semble que les personnes trans constituent un objet de choix pour réancrer, si besoin était, les principes sexués nécessaires à la permanence de la culture hétéronormative. Cʼest au fond la même rhétorique condamnant moralement lʼartifice (ou toute caractéristique perçue comme artifice) qui permet aux discours conservateurs de disqualifier la transidentité et les personnes trans. Mais cette disqualification nʼest pas un effet de bord de la culture hétéronormative : rejeter les faux hommes et les fausses femmes est plutôt constitutif dʼun ordre qui se fonde sur la validation de genre. Autrement dit, la folle et la butch (pour ne citer que ces deux figures) constituent des zones intenses de codage de ce qui est inacceptable pour lʼordre hétérosexuel ; mais de manière plus discrète, ces deux figures renforcent lʼidée quʼil existe bien des hommes et des femmes. La copie, ou lʼimitation, même lorsquʼelle est signalée comme ratée, participe à renforcer la supériorité de lʼoriginal, et plus encore, lʼidée quʼil existe un original. Cʼest en cela que la figure de la folle -— par exemple -—est tout aussi intense pour le genre masculin (quʼelle signale en creux) que pour le genre féminin (quʼelle pointe comme authentique). De même, lʼhétérosexualité affecte les femmes, et plus précisément les femmes hétérosexuelles, en habillant lʼoppression de genre dʼune domination hétérosexuelle. En effet, et cʼest peut-être une des raisons pour lesquelles il est si difficile de diffuser les idées féministes, lʼoppression liée au sexe-genre des femmes est quasiment indissociable de son enrobage dans le privilège cishétérosexuel : accepter dʼappartenir à la classe des femmes, de sʼidentifier à celle-ci, cʼest se voir accorder le privilège du genre authentique. À défaut dʼêtre dominante par rapport aux hommes cishétérosexuels, les femmes cishétérosexuelles peuvent ainsi jouir dʼun statut de semi-dominée, puisque le système qui les déclare subalternes leur ménage tout de même une place, par rapport à des sujets qui nʼen sont pas (personnes «  déviantes  » dans leur genre ou leur sexualité)252.
Parler des normes de sexe, genre et dʼorientation sexuelle est ainsi nécessaire pour comprendre les rapports de pouvoir quʼelles font exister, et pour envisager des tactiques pour les désamorcer (voire les abolir). Concernant lʼhétérosexualité, la difficulté est finalement identique à celle que nous avons rencontrée en tâchant dʼen découdre avec le système sexe-genre : elle se donne à lire comme évidente, «  naturelle  »â€¯; elle est le «  point aveugle  » de la culture occidentale (Tin 2008, §1). En posant un ordre sexué quʼelle contribue à renforcer, lʼhétéronorme obéit à une logique circulaire : ses actes sont bons parce quʼils combinent deux termes qui sʼopposent (homme/femme), ces deux termes sont «  vrais  » parce que lʼhétérosexualité existe. Lʼacte de reproduction, souvent invoqué comme argument irréfutable en faveur dʼune naturalité de lʼhétérosexualité, nʼest pas tant reproduction dʼindividus que reproduction dʼun système genré à travers eux. Pensons seulement au terme «  choix du roi  » qui renvoie aux couples hétérosexuels ayant eu, en se reproduisant deux fois, un garçon et une fille : ce ne sont pas seulement les générations qui doivent se perpétuer, mais la lisibilité du genre, et à travers lui, cette «  vérité  » irréfutable dʼune sexuation lisible et exclusive. Mais des arguments simples mettent à mal cette naturalité de lʼhétérosexualité. Louis-George Tin écrit :
à supposer que lʼon puisse ainsi expliquer le caractère hétérosexué de la reproduction biologique, il est sans doute plus difficile de rendre compte du caractère hétérosexuel de lʼorganisation sociale. De fait, une fois la copulation accomplie, il nʼy a pas de nécessité apparente à ce que le couple se maintienne, et cʼest effectivement ce qui se passe chez la plupart des mammifères, qui se séparent rapidement, comme le montrent dans lʼensemble les études dʼéthologie (2008, §5).
Il fait ainsi écho, théoriquement autant que méthodologiquement, à Eve Kosofsky Sedgwick qui «  [sʼ]étonn[e]  » que :
parmi les treÌ€s nombreuses dimensions par lesquelles lʼactiviteÌ geÌnitale dʼune personne peut eÌ‚tre diffeÌrencieÌe de celle dʼune autre (dimensions qui incluent la preÌfeÌrence pour certains actes, certaines zones et certaines sensations, certains types physiques, une certaine freÌquence, certains investissements symboliques, certaines relations dʼaÌ‚ge ou de pouvoir, certaines espeÌ€ces, un certain nombre de participant(e)s, etc., etc., etc.), un seul, le genre du choix dʼobjet, soit apparu au tournant du sieÌ€cle et soit resteÌ la dimension deÌnoteÌe par la cateÌgorie deÌsormais omnipreÌsente de lʼ‹ orientation sexuelle ›253 (2008[1990], 30).
Il est en effet étonnant que la sexualité soit comprise de manière majoritaire, peu questionnée, sous le prisme de la possession de certains génitoires et de leur prétendue compatibilité – compatibilité qui, comme L.-G. Tin nous le rappelle, nʼa de nécessité que de façon très circonscrite dans une vie humaine. «  Point aveugle  » chez L.-G. Tin, «  opacité  » chez Sedgwick (2008[1990], 30) : les effets de vérité de la norme hétérosexuelle sont soutenus par des esthétiques (gestes, représentations, formes culturelles, etc.) dont lʼartificialité est voilée par une forme dʼignorance volontaire. Il en résulte que les hétérosexuel·les possèdent ce que jʼappellerai, à la suite de Sedgwick, le «  privilège épistémologique de lʼignorance  » (2008[1990], 27)254. Des collègues chercheureuses ont pu me reprocher cette formule, au motif que lʼignorance, selon elleux, nʼest jamais un privilège : il est probable que leur lecture reposait sur une représentation de «  lʼignorance  » comme un état subi, associé à des formes de précarité et de manque dʼaccès aux savoirs. Or, je parle ici dʼune forme dʼignorance volontaire, dʼune épistémologie du point aveugle qui escamote sa propre dimension de système tout en perpétuant la centralité du Vrai et de son corollaire, la Vérité -— ce qui amène également à accorder une position épistémologique privilégiée face à la Vérité aux personnes hétérosexuelles (Halperin 1997[1995], 8). Étant plus «  vraies  », les hommes et femmes hétérosexuel·les seraient aussi plus outillés, ou naturellement mieux disposés à établir la Vérité, et ce, quel que soit le domaine.
À cette vérité gonflée dʼévidences, selon laquelle il existerait des hommes et des femmes parce que la Nature lʼa voulu ainsi, il faudrait opposer la lecture qui suit. La compréhension de la sexualité selon les schèmes binaires hétéro/homo fait partie de la production du genre, production qui nourrit en retour ses propres soubassements : sʼil existe des hommes et des femmes, et que les individus ne peuvent appartenir quʼà ces deux catégories, il est dʼautant plus aisé de penser la compatibilité entre ces deux pôles que leur emboîtement symbolique est matérialisé par la sexualité pénétrative. En produisant lʼhomosexualité (à travers ce qui nʼest pas elle), lʼhétérosexualité produit sa marge mais aussi le terme opposé dont elle a besoin pour fonctionner : soit comme repoussoir (ce quʼil ne faut pas faire, la sexualité antinaturelle, lʼerreur dʼassociation), soit comme copie imparfaite (le couple homo vu comme une variation, avec lʼun·e qui «  fait lʼhomme  », et lʼautre «  la femme  », dans les couples gays comme lesbiens, que lʼon autorisera éventuellement à avoir des enfants pour reproduire le modèle de la famille nucléaire). Le tableau suivant nous permet de synthétiser nos réflexions, plus particulièrement les jeux traditionnels dʼopposition entre identités, réalités corporelles, pratiques et cultures du sexe et de lʼamour.
| straight | gay| lesbienne | |||
| sexes opposés | même sexe | |||
| sexualité génitale pénétrative exclusivement | anus féminin disponible éventuellement | sexualité non pénétrative et/ou non génitale | anale pénétrative | prothèses sexuelles | kinks | |||
| mariage | exclusivité | promiscuité |cruising | polyamour (?) | |||
| reproduction, famille futuriste | stérilité de facto, pas de famille / famille dysfonctionnelle |famille alternative | |||
| sexualité découlant de lʼamour | sexe pour le sexe |
Je souhaiterais enfin mettre en évidence trois conséquences découlant de ces observations. Tout dʼabord, cette architecture sexe-genre devrait peut-être, si ce nʼétait par égard pour les formules un peu lourdes, être renommée «  sexe-genre-hétérosexualité  ». En effet, il est nécessaire, après avoir repéré le point aveugle, de refaire le point et dʼen écarter le flou. Pas de système sexe-genre sans hétérosexualité pour le renforcer. À ce système est reliée la centralité de la famille comme mode organisationnel majeur en Occident  : je ne veux pas parler de manière générale de la famille comme agencement dʼindividus, mais de manière précise, comme ordre patriarcal bourgeois, solidifié autour de la nécessaire reproduction, du dévouement des femmes à leur progéniture et de lʼautorité «  naturelle  » des parents sur les enfants depuis au moins le XIXe siècle. Jʼai parlé dʼune architecture sexe-genre-hétérosexualité, à dessein : ce système repose sur des points aveugles autant quʼil sʼincarne dans des murs. Parler de la cuisine, comme je projette de le faire à partir du chapitre suivant, implique de parler de pratiques domestiques qui découlent dʼattentes de genre. Selon cette perpétuelle mécanique circulaire, lesdites pratiques domestiques participent aussi à produire le genre. Faire le ménage, passer le balai, préparer un bon repas à son mari qui rentre du travail, sʼoccuper des enfants alors quʼon rentre soi-même dʼune journée chargée au travail… sont autant de comportements assignés au groupe des femmes, mais qui peuvent participer de performances de genre, voire même de figures du genre féminin. La fée du logis (idéal), la boniche (figure repoussoir), la bonne mère (idéal imposé et intériorisé) sont de telles figures. Les queeriser implique tout autant dʼimaginer des comportements de trahison à leur égard, que dʼenvisager comment dʼautres identités genrées (pédé dʼintérieur, lesbienne U-Haul, etc.) peuvent être multipliées tout en ayant pleinement conscience, et il sʼagit là de ma seconde observation, que ces identités ne sont pas automatiquement oppositionnelles. On peut en suivre le programme ou a minima lʼintention, sans pour autant réifier de nouveaux comportements souhaitables de genre. En effet, lʼhomosexualité nʼest pas intrinsèquement subversive (Plana 2015, 30), et dans un contexte où se déploient des discours homonationalistes (cf. infra., p. XX), elle peut même sʼincarner dans un nouveau modèle normatif. Jʼai également montré que la charge subversive de lʼhomosexualité est indissociable du renforcement quʼelle produit de lʼordre sexué : en même temps que lʼhomosexuel·le démolit lʼidée dʼune inévitable hétérosexualité, iel peut consolider lʼidée dʼune sexualité lisible sous le prisme de la sexuation.
De ce paradoxe émerge mon troisième et dernier point : cʼest peut-être la bisexualité, ou son double contemporain, la pansexualité255, qui menace le plus lʼinévitable ordre hétérosexuel. Ceci expliquerait pourquoi les bisexuel·les sont invisibilisé·es avec autant de force, que ce soit par la culture hétérosexuelle (qui renvoie leurs expériences à une «  phase  » dont le choix dʼobjet exclusif serait lʼissue) ou par certaines cultures gays et lesbiennes (pour qui tout partenariat non homosexuel équivaut à un retour à lʼhétérosexualité). Le plus grand impensé de lʼhétéronormativité, qui se diffuse, on lʼaura compris, jusque dans lʼhomosexualité, est celui dʼune sexualité qui ne repose pas dʼabord sur la sexuation ou même le genrage de ses participant·es. Une telle sexualité nʼempêcherait nullement de se dire gay, futch, tata, butch, pédale, fem, lipstick lesbian ou bien dʼautres choses encore ; elle détacherait même ces rôles dʼune stricte identification de sexe ou de genre, pour les faire proliférer. Mon usage du conditionnel peut donner ici lʼimpression que je découpe un possible du genre, sinon un de ses possibles. Mais cette circulation des identités nʼest pas une utopie : elle existe déjà , pour peu quʼon regarde un peu les comportements sexuels et les discours sur ceux-ci. Partout dans la culture hétérosexuelle affleure la possibilité de son autre, lʼhomosexualité. En 1996, Annick Prieur lʼobserve dans son terrain avec les travestis mexicains qui évoquent «  ces heterosexuales qui aiment baiser les hommes  » (77) ; bien plus tard, les poèmes de Marguerin Le Louvier évoquent un «  vieux gars  » qui fréquente les tasses, venu se faire «  pomp[er] après la bà »che  » le jour de Noë l256 (2021[2019], 287). Le poète évoque régulièrement cette perméabilité des espaces gays aux hommes «  hétérosexuels  », par exemple dans son texte «  Les lois fondamentales de la biologie  » où il écrit que «  lʼhétérosexualité nʼexclut pas le désir homosexuel […] non seulement elle ne lʼexclut pas mais elle lʼappelle  » (2021, 238). Et du côté des homosexuels, la question de lʼidentité homosexuelle nʼest pas moins brà »lante. En 2022, jʼai ainsi vu passer le tweet dʼun Étasunien, blanc257, qui se demandait si après dix années dʼabstinence sexuelle plus ou moins choisie, il pouvait encore se dire gay. La question mʼa paru très intéressante, dʼautant plus quʼelle émanait dʼun lieu rarement visible dans les discours médiatiques, celui de la misère sexuelle gay, puisque cʼest plutôt la promiscuité et la fréquence des relations sexuelles, la culture des backrooms et des tasses, qui sont retenues comme des emblèmes dʼune «  culture gay  », y compris par les intéressés. Le tweet évoque malgré lui la vieille question visant à élucider si lʼhomosexualité est innée ou acquise. Ainsi, une personne qui définirait lʼorientation sexuelle comme un choix dʼobjet répondrait sans doute à lʼauteur du tweet quʼil est encore gay, au même titre quʼun homme qui nʼa pas encore couché avec un autre homme mais qui le désire. Toutefois, la désidentification de lʼauteur du tweet vis-à -vis de lʼidentité impliquée par sa sexualité témoigne de la complexité, sinon de la catégorie «  homosexuel  », au moins des relations possibles à celle-ci, y compris et peut-être surtout lorsque le temps entre en compte.
Quʼest-ce qui est gay, straight ? Est-ce le désir, les actes, les actes répétés, et dans ce cas, quel nombre dʼoccurrences pourrait-il être significatif ? Il semble assez vain de chercher à localiser lʼhomosexualité ou le lesbianisme. Quand je parlerai plus avant dʼhomosexuels, de lesbiennes, de personnes bisexuelles, je parlerai ainsi davantage de positions. Cette position peut-être constituée par soi-même, par lʼautre ; elle peut être solidifiée par la performance, lʼinsulte, le reclaim, lʼaction politique, un style de vie ; mais elle est une localité bien plus quʼune essence. Je conclurai ainsi mon propos en répondant à la question initiale. On dit que les homosexuel·les sortent du placard : mais quʼest-ce qui sort du placard, exactement ? Pour répondre, il me faut retourner au système sexe-genre. Se dire gay, lesbienne, bi, pan, relève dʼune geste qui sʼinscrit inévitablement dans le régime de la vérité des corps. Cela revient à dire : «  je ne suis pas une vraie femme  », «  je ne suis pas un vrai homme  », «  je nʼaime pas comme vous  ». Sortir du placard semble donc revenir à sortir de lʼhétérosexualité, plus que dʼun lieu du secret. Le placard, je lʼavais suggéré, est à double fond : il faudra donc sortir au moins une seconde fois. Sorti·e de lʼhétérosexualité, le sujet queer doit encore sortir de ce que lʼhétérosexualité fait à lʼhomosexualité, cʼest-à -dire, sʼextraire de cet ordre de la vérité du sexe. Sortir du placard repose donc sur un paradoxe, puisquʼil revient à dire «  jʼaime les personnes du même sexe que le mien  » (du moins pour les gays et les lesbiennes) mais à résister aux conceptions de la sexuation que cette affirmation charrie. Dans la mesure où lʼhétérosexualité repose sur un ensemble dʼesthétiques de Vérité, sortir de ses confins implique de quitter ce régime de Vérité. Coming out, cʼest donc sʼextraire de la Vérité pour rentrer en artifice. Cela éclaire les expériences subjectives du coming out, notamment le fait que lesdits coming out sont souvent répétés, et que ceux-ci ne sont jamais perçus comme «  bons  ». David Halperin note par exemple lʼéchec inévitable du coming out en reliant celui-ci à ses dimensions temporelles :
Le placard est un lieu impossiblement contradictoire, car lorsque vous faites votre coming out, il est à la fois trop tôt et tard […] Quel que soit le moment où vous faites votre coming out, il est déjà trop tard, car, si vous aviez été honnête, vous lʼauriez fait plus tôt258 (Halperin 1997[1995], 35).
Il existe une citation célèbre, indà »ment attribuée à Oscar Wilde, sans auteurice identifié·e, qui dit que «  tout en ce monde est question de sexe, sauf le sexe lui-même, qui est une question de pouvoir  »259. À la suite de ce long parcours dans lʼarchitecture sexe-genre-hétérosexualité, et à la lumière de cette dernière observation de D. Halperin, on pourrait presque dire que tout est question de genre, sauf le genre lui-même, qui est une question de Vérité. Sortir du placard revient tout autant à sortir dʼun mensonge (celui qui nous présuppose hétérosexuel·les) quʼà sortir, et cela a sans doute plus de force, de la Vérité comme principe organisateur de nos vies. Ainsi, le placard nʼest pas un lieu triste dʼenfermement, mais la figure puissante dʼun mouvement toujours renouvelé. On sort du placard, on sʼen arrache, et on pénètre sans doute dans de nouveaux placards quand on quitte les anciens. Lʼarchitecture en construisant les cuisines érige des identités et des comportements, tout aussi paradoxaux que ceux quʼimplique le placard. Ériger un mur, cʼest séparer, mais aussi créer la possibilité de la transgression par son franchissement. Cʼest avec cette idée que je vais à présent tâcher de définir, non pas «  le  » queer, mais la praxis queer qui sera la mienne dans les pages à venir, qui visera à ménager des mouvements entre les espaces, les identités, plutôt quʼà délimiter des espaces où peut advenir la contestation.
Parler du queer revient à effectuer un trajet. Ce chemin, je le suis annuellement, de manière aussi réglée quʼun pèlerinage, lorsque je dispense mon cours Queer[ed] Design à lʼUniversité Toulouse -— Jean Jaurès. Tout au long de ce parcours, je pose avec les étudiant·es quelques cailloux, que jʼai déjà semés dans le chapitre introductif de cet ouvrage : queer, terme anglais signifiant à lʼorigine «  étrange, troublant  », devient une insulte au XIXe siècle, avant dʼêtre revendiquée (reclaimed) dans un contexte de luttes, et dʼêtre remobilisé par les études universitaires (cf. infra. p. XX), au point de devenir un terme à lʼusage international, désignant des identités, des luttes, des esthétiques, qui est perméable à une certaine réappropriation commerciale (Halperin 1997[1995], 114). Pour éviter les lectures dépolitisées du terme «  queer  », il me semble souhaitable de ne pas idéaliser un queer vaguement synonyme de «  trouble  », un «  nʼimporte quoi de la liberté absolue  » (Plana 2018, 17), dʼen faire une sorte de tampon qui permettrait dʼestampiller dʼun label les Å“uvres, les dispositifs, les personnes, les actions politiques véritablement subversives. Le premier enjeu dans le fait de penser spatialement le queer se situe là  : queer nʼest pas un label, ni une qualité, cʼest bien davantage une ligne, une saignée que lʼon trace dans un ordre normatif. Et cette spatialité se rencontre dʼailleurs dans lʼétymologie du mot. William Sayers en retrace la courbe en reliant «  queer  » à lʼirlandais moderne : le terme proche de «  cuaire  »260 signifie ainsi «  la torsion, qualité de ce qui est tordu ou creux  »261 tandis que lʼadjectif correspondant «  cuar  » signifie «  tordu, de travers, courbé, rond, circulaire, creux  »262 (FocloÌir Gaedhilge agus BeÌarla et le Dictionary of the Irish Language, cités par Sayers 2005, 17). Les deux termes proviennent de lʼirlandais Moyen et de lʼirlandais Ancien «  cuÌar  » qui renvoie aux mêmes qualités, et qui aurait migré vers lʼanglais moderne. Il faut bien sà »r se garder dʼimaginer que lʼétymologie dʼun terme en constitue la vérité ou en détermine les usages futurs (Sayers, 2005, 17). Mais il est intéressant de remonter la généalogie queer un peu plus loin que son sens dʼavant lʼinsulte, pour le relier, comme le fait W. Sayers, à la racine indo-européenne «  keu-  » («  un arc, une flexion, une incurvation, une arche, un creux  »263, Pokorny 1959–69, cité par Sayers 2005, 17), non loin de lʼAllemand «  quer  » qui indique un mouvement oblique (18). En dʼautres termes, est queer ce qui nʼest pas droit ; ou plutôt, pour rompre avec lʼessentialisme éventuellement suggéré par le verbe être, faire le queer cʼest marcher de travers, suivre un mouvement de pli, de torsion. La métaphore spatiale ne nous libère pas complètement dʼune possible essentialisation du queer. Car à défaut dʼessentialiser, on peut localiser : ainsi la cartographie queer que je vise ici ne consiste nullement à tracer des contours trop fermes autour de la notion, ni même à la situer abstraitement dans un motif de type marge/centre. On se rappellera ainsi quʼen géographie, «  la marge est la conséquence dʼune relation avec un lieu  » (Raffestin 2016, 117). On peut bien sà »r prendre conscience dʼune position marginale : cela est même la base de bien des textes féministes et queer. Mais si on admet que post-modernisme et queer ont en commun le «  culte des marges  » (Plana 2018, 33), alors une forme de prudence est de mise, afin de ne pas fétichiser des espaces ou des positions ou de fabriquer un «  baromètre de la résistance  », «  un test pour déterminer à quel point une pratique ou une autre est radicalement transformative ou réellement queer, afin quʼil y ait enfin un savoir faisant autorité sur le sujet et sa discipline  »264 (Halperin 1997[1995], 115).
De même, au sujet du queer, est-il peut-être plus prudent de commencer par un aveu dʼéchec. Il existe une bibliographie fantastique dʼouvrages relevant de la «  théorie queer  », et il me serait impossible de nʼen lire que la moitié. Cependant, chaque fois que jʼai ouvert un livre se réclamant, de près ou de loin, de la ou des théorie(s) queer(s), jʼai vu à lʼœuvre ce même travail de définition qui se refuse à définir, en vertu du paradoxe que le concept de queer porte en lui : insaisissable, politique, flou, il résiste à la qualification stricte ; mais se refuser à lui donner le moindre contenu, cʼest aussi prendre le risque de la dépolitisation265, dʼun grand relativisme, dʼun «  tout se vaut  » (qui ne vaut justement pas grand-chose dans une entreprise théorique) et enfin dʼun possible rapt. La bibliographie convoquée, dont on a vu quʼelle était immense, est aussi asymétrique : on trouvera plus facilement des productions écrites en anglais quʼen français. Définir, cʼest donc faire face à un double échec potentiel : échec à définir, échec à lire tout ce qui pourrait lʼêtre pour faire la définition la plus complète, cʼest-à -dire la plus informée par lʼhistoire du terme. Il nous faut alors faire un pas de côté, préférer le faire à lʼêtre. Queeriser, faire du queer, entrer en queer sont des postures sans doute plus puissantes. On peut également se demander, très simplement, ce que fait le queer ou ce que font les études queer. La définition que je vais proposer ci-après (si elle mérite encore cette dénomination) sera processuelle, toujours en mouvement, et associera une modalité, un mouvement et une nécessité. La modalité oriente le regard ; le mouvement propose une attitude, et enfin, la nécessité traverse lʼaction amorcée en regardant et en agissant.
Pour regarder le queer obliquement, je propose de le considérer selon le mode de la plasticité. Je ne pense pas ici au concept tel quʼil est investi par la discipline des arts plastiques, mais plutôt aux qualités du matériau plastique tel quʼil est travaillé par lʼindustrie. Les plastiques se distinguent par la multiplicité de leurs états, mais ne sont pas pour autant informes, et peuvent aussi être figés, solidifiés. Le matériau plastique peut être liquide, résistant ; il peut être poisseux ou lisse, cassant ou résistant, en expansion ou contenu. Il existe dans les identités comme dans les politiques queer des vibrations de lʼêtre, des changements dʼétat, qui me semble en relation avec la plasticité, telle que la définit Catherine Malabou pour qui est plastique tout «  ce qui est susceptible de recevoir comme de donner la forme  » (2005, §10). «  Situé[e] entre le modelage sculptural et la déflagration  » (Malabou 2005, §13), la plasticité permet comme le queer de donner forme, mais aussi de déformer et de reformer -— voire de faire tout cela à la fois. On observera toutefois que, malgré sa pensée dʼune subjectivité plastique (en passant par Hegel, Derrida, Levinas), Catherine Malabou lit chez les «  multitudes queer  » lʼespoir dʼune «  mutabilité infinie  » (Malabou 2009, 113–114). Cette réduction du queer à un couteau suisse ou la représentation des personnes queer comme étant perdues, changeantes pour le plaisir, participe des définitions dépolitisées et hors-sol du queer que jʼai évoquées plus haut. Muriel Plana commente dʼailleurs ces propos sur un autre front, en précisant que les études queer ne cherchent pas à détruire lʼessence et ne «  renoncent pas à penser  » (Plana 2018, 21). Il nous faut donc mobiliser le queer sur un mode plastique, avec toute lʼaffordance que C. Malabou donne à ce mot, mais en oubliant peut-être que la plasticité du queer, si la philosophe lʼa localisée, lui est apparu comme un excès plutôt quʼun aboutissement du paradigme.
Vient ensuite le mouvement, ou, pour parler en designer, la démarche : porté par les lignes qui précèdent, jʼattaque ici plutôt que lʼessence lʼidentité, et propose de considérer toute entreprise queer comme un geste de désidentification. Ce dernier touche le queer lui-même : lorsquʼEmmanuel Beaubatie dit que «  lʼun des apports essentiels des études queer est de questionner les normes sexuelles et genres à partir de leurs marges  » (2021, 34), jʼacquiesce ; mais je suis aussi immédiatement tenté dʼimaginer un mouvement qui permet de ne pas réduire le queer aux questions de genre (ce quʼen toute rigueur Emmanuel Beaubatie ne fait pas puisque son approche est intersectionnelle). Quʼil sʼagisse de théorie ou dʼindividus, rien nʼest jamais strictement queer, ou pour être plus clair, LGBTQIA+. Il faut en effet résister à cette tentation dʼun queer totalisant, qui deviendrait une clé de lecture unifiante, faisant disparaître dʼautres catégories de compréhension (validité, race, classe, etc.). Pour autant, il serait absurde dʼaffirmer trop frontalement que queer nʼest pas une identité. Il existe bien, après tout, la possibilité pour tout individu de se dire queer, et je ne verrais guère dʼintérêt dans une théorie qui sʼefforcerait de retirer cette possibilité aux personnes, ou de policer lʼusage de ce mot. Aussi vais-je développer ci-dessous une approche du queer comme reposant sur un mouvement de désindentification, étant entendu que se désidentifier ne signifie pas ne pas avoir dʼidentité, nʼêtre rien, ou être en changement permanent au gré des humeurs (comme le suggère Agnès Giard, cf. note 166). La dialectique entre identité queer et nécessaire désidentification posée, jʼen viendrai au socle de la définition, la nécessité dʼhistoriciser, au sens de lʼHistoire (collective) et des histoires (trajectoires individuelles).
Au cÅ“ur du backlash adressé aux personnes LGBTQIA+ et défenseureuses de la justice sociale depuis le début des années 2000, se trouve la catégorie, dans le monde anglophone, des «  identity politics  », que lʼon peut traduire en politiques de lʼidentité. Parmi les reproches adressés par les conversateurices et théoricien·nes dʼextrême droite aux personnes LGBTQIA+, on rencontre lʼidée dʼune volonté dʼexceptionnalisme individualiste, matérialisée par des expressions dérogatoires comme celle de «  special snowflake  » («  flocon de neige unique  »), facilement adressée sur les réseaux sociaux dès quʼune personne témoigne dʼune difficulté liée à sa position dans la société. Cette invective permet aux intéressé·es dʼinvisibiliser une situation de minorisation pour en faire une pose, une posture, une demande individuelle et vaniteuse dʼattention. La critique des politiques de lʼidentité comporte également des soubassements racistes : une personne identifiée peut facilement être saisie comme identitaire, ce qui, en France notamment, peut lʼexposer à une critique du communautarisme qui oublie bien facilement que les communautés se forment dʼabord en réponse à une situation dʼoppression. Mais la critique de lʼidentité et de lʼidentification nʼémane pas seulement de la droite et de lʼextrême droite. Dans les milieux queer également, et peut-être à cause de ces récupérations faciles par les conservatismes, lʼidentification stricte à des catégories identitaires a fait lʼobjet dʼun long travail critique. En 1995, Leo Bersani écrit ainsi dans Homos :
Toute tentative pour stabiliser lʼidentité est intrinsèquement un projet disciplinaire […] Conçu comme un acte de résistance à lʼoppression homophobe, le projet de construire une identité gay est lui-même suspect. Cette identité nʼest-elle pas à son tour exclusive, parce que limitée à la classe moyenne, blanche, et de gauche ? Par sa cohérence même, une identité gay délibérément conçue sur le mode de lʼopposition ne fait que répéter les analyses restrictives et immobilisatrices quʼelle vise à combattre (1998[1995], 3)266.
Lee Edelman lui fait écho lorsquʼil écrit au sujet plus général de la «  queerité  », que celle-ci ne «  peut jamais définir une identité ; elle ne peut que lʼinquiéter  » (2013, 306)267. On pourrait alors imaginer que «  queer  » possède, par rapport à dʼautres catégories qui lʼont historiquement précédée, une sorte de position privilégiée pour se désidentifier. Cʼest en tout cas ce que quʼaffirment certain·es penseur·ses pour qui «  lʼacronyme LGBT… fixe des individus dans des groupes stéréotypés comme gay, lesbienne, etc. ; tandis que queer permet une analyse qui se veut critique et séparée de ces identités individuées  »268 (Cottrill 2006, 360). Sauf que dans les faits, que lʼon parle dʼindividus, dʼusages, dʼidentifications personnelles ou collectives, les catégories LGBTQIA+ et queer ne sont pas étanches. Il est même présomptueux dʼimaginer que des acceptions strictes sont attachées à ces deux termes et quʼelles les distinguent. Judith Butler lʼobserve, quand iel commente la manière dont la mobilisation du queer sʼest précisément faite dans un contexte dʼidentification. Dans une interview avec Sara Ahmed, iel dit :
avoir été désorienté* par lʼémergence des études queer en tant quʼaffirmation ‹ dʼidentités queer ›, comme cela a pu arriver à certains endroits en Europe. Maintenant, les gens disent ‹ je suis queer ›, et au moment où est née la théorie queer, je suis quasiment sà »r* que personne ne pensait que ‹ queer › devrait être une identité, mais devrait plutôt nommer quelque chose de lʼinsaisissable ou de lʼimprévisible trajectoire dʼune vie sexuelle269 (Butler interviewé* par Ahmed 2016, 8).
Læ philosophe nomme ici le queer à partir de ses intentions historiques. Mais la précaution qui suit est précieuse :
Je comprends que dans certains contextes la demande de reconnaissance au sein des structures institutionnelles et publiques est immense, et quʼune façon dʼaccomplir cela est dʼétablir une identité. Mais dans la mesure où une solide partie de la théorie queer a été orientée contre le poliçage de lʼidentité, la demande dʼidentité, la demande dʼavoir une identité et dʼen montrer une, est un peu étonnante pour moi. Mais, en même temps, je dois me demander : pourquoi ne devrions-nous pas être interloqué·es par les directions prises par un terme comme ‹ queer › ? Il a voyagé en tous sens, et qui sait quelle sera sa prochaine permutation270 (Ahmed 2016, 8).
La volonté dʼen finir avec les politiques de lʼidentité bute donc sur une contradiction : briser avec lʼautorité du nom (queer, mais pas seulement) peut facilement devenir une injonction et impliquer un contrôle de lʼusage des noms en question.
Un pas de côté permet dʼenvisager la question autrement. Faut-il sʼidentifier ? Nous avons établi que cela nʼétait pas souhaitable, et que le projet épistémologique du queer consistait précisément à se dés-identifier dʼune norme. Mais queer, quoi quʼon en pense, peut fonctionner comme une catégorie. Il est même fréquent que son efficace soit externe au sujet, indépendamment de ce quʼil ressent. Être identifié nʼest pas, comme le croient les conservateurices, un mouvement individuel et autonome des êtres, mais bien un mouvement centrifuge qui affecte la subjectivité, du dehors, notamment par des interactions sociales comme le harcèlement, lʼostracisation ou lʼinsulte (Eribon 2012). Une limite est concomitante à ce phénomène : être nommé, ou même se nommer (pour peu quʼon le puisse), implique de composer avec les identités disponibles. Jack Halberstam rappelle ainsi que lʼidentité queer présuppose un concept transnational largement informé par une «  gayness  » occidentale (2012, 122–23). Enfin, sʼidentifier, même de manière distante, peut facilement réinstituer des binarités strictes entre marge et centre, et assigner à des groupes des fonctions, comme celle de la subversion pour les personnes LGBTQIA+ et de la normativité pour les personnes hétérosexuelles (Sullivan 2003, 49).
Lors dʼune conférence en 2020, jʼai présenté des travaux sur les interfaces numériques et la manière dont elles contenaient et poliçaient les identités (comprises au sens civil, institutionnel) des personnes queer, trans en particulier271. Un intervenant, suite à ma présentation, me fit ainsi la réflexion suivante : «  Si jʼai bien compris, on est tous un peu queer ?  ». Je nʼavais rien dit de tel, mais lʼobservation est commune, et se retrouve dʼailleurs dans les discours afférents au handicap (Kazi-Tani 2018, 64). La remarque possède un mérite au moins : elle signale un devenir potentiel de «  queer  », lorsquʼil est si détaché de tout contenu quʼil devient un signifiant flottant, applicable à presque tout, cʼest-à -dire, à rien. Il convient ainsi de mobiliser «  queer  » comme pouvoir dʼagir, en le réinscrivant dans un rapport de force, tout en ne réifiant pas un «  nous  » contre «  eux  », ni en réifiant un Autre plus ou moins imaginaire comme repoussoir (Garcia 2009, 17). Cette problématique de lʼidentification devrait dʼailleurs, au regard de notre parcours précédent, être resituée. Ce nʼest pas tant le terme queer qui fait problème que son acolyte, le verbe «  être  ». Jʼaimerais ici proposer dʼautres regards sur ce terme, qui permettent de sortir des impasses associées à lʼidentification, tantôt excessive, tantôt nécessaire (notamment face à la dilution des propos). Deux approches peuvent être associées, et celles-ci se recoupent. Cʼest dʼabord le concept de «  fêlure  » (en anglais, «  splitting272) proposé par Donna Haraway qui offre un chemin de traverse bienvenu :
On ne peut pas ‹ être › soit une cellule, soit une molécule -— ou une femme, une personne colonisée, un·e travailleureuse, et ainsi de suite -— si on vise à voir et voir depuis ces positions de manière critique. ‹ Être › est bien plus problématique et plus contingent (1988, 586)273.
D. Haraway propose ce concept de fêlure dans une visée épistémologique : sa question concerne les modes de connaissance et la manière dont les sujets regardent le monde. Mais sa réflexion possède des implications pour les processus de subjectivation, individuels ou collectifs. Plus que fêlure, splitting raconte lʼacte de fêler, de se séparer, ce qui converge avec la lecture queerisée que fait Muriel Plana de la distanciation brechtienne. M. Plana pointe une confusion fréquente : la distanciation nʼest pas la distance, et il est probable que sʼidentifier soit dʼabord nécessaire pour que le geste de distanciation fonctionne (2022, 371). Elle précise, dans la même intention, quʼidentité et identification ne sont pas des termes équivalents. On peut donc avoir une identité… sans y adhérer totalement. Cʼest ce que la chercheuse nomme comme «  trouble  », et qui ne se réduit pas à une confusion. Ceci fait écho à la définition de lʼidentité homosexuelle proposée par David Halperin, celle dʼune «  identité sans essence  »274 (1997[1995], 61). Lʼidée de Halperin nʼest pas de vider le mot de son sens, mais dʼinscrire les sujets homosexuels – mais on pourrait dire, queer – dans une «  position  » «  relationnelle  »275. Une telle position a deux conséquences au moins. Tout dʼabord, elle implique de repenser les formes de collectifs qui peuvent sʼagréger à partir de sujets queers, ou même autour du terme «  queer  » comme identifiant. Christen Garcia sʼappuie ainsi sur les travaux de Leo Bersani et Ulysse Dutoit (dans Forms of Being: Cinema, Aesthetics, Subjectivity, 2004) qui évoquent dans leurs analyses le concept de «  totalité  » («  allness  ») pour désigner une «  communauté construite sur lʼanonymat et tenue ensemble par lʼabsence dʼindividualité et de leadership  »276 (Bersani & Dutoit 2004, 165 ; Garcia 2009, 22). Sur la base de cette étude, C. Garcia observe que ce sens du collectif, cette «  éthique relationnelle  »277 (Bersani & Dutoit 2004, 135), «  représente une absence qui est radicalement négative  »278 (Garcia 2009, 22). Lʼimpulsion de négativité à lʼendroit de lʼidentification du collectif, concomitante à celle des individus, est aussi inspirée par les travaux de Lee Edelman. Investir les identités sur un mode relationnel possède une seconde conséquence, relative à la première. Se constituer en collectif désindentifié est un rempart à la constitution de nouveaux «  Autres  » délimités par le «  nous  », aussi queer soit-il. Le chercheur Ricardo Robles écrit ainsi, porté par une volonté quʼil nommera plus tard comme «  anti-taxonomique, anti-descriptive  » (2022) :
il conviendrait que nos productions théoriques transféministes ne soient pas centrées sur la re-reformulation dʼun «  nous  » qui laissera toujours cruellement quelquʼun en dehors (quʼil ait la forme dʼune soupe de lettres, de la «  transness  », des dites «  multitudes queer  », «  queer of color  », de la classe sociale des femmes ou de «  women and fems  », etc.) ; mais plutôt sur la reformulation de nos façons de nous relationner, nos rapports avec le conflit : non pas dʼun point de vue du développement personnel à la Mr. Wonderful, encore moins de «  joie militante  » comme jʼai pu le lire cent mille fois sur instagram. Le conflit, la négativité et même la violence sont nécessaires, plus que jamais, dʼun point de vue politique. Or, le conflit doit se poser en termes de discours, non pas en des termes identitaires  » [les caractères en gras sont de lʼauteur] (Robles 2021).
Au sujet de la violence, je laisse la question en suspens, celle-ci étant complexe. En revanche, je souscris ainsi à lʼidée dʼune désidentification, et identifie chez R. R. Robles des arguments stratégiques, politiques, en faveur dʼune telle projection. Cependant, je me demande aussi si consacrer la désidentification comme geste ultime, queer, ne réplique pas le même type de binarités que celles quʼelle prétend abolir. En effet, même si R. R. Robles ne le nomme pas ainsi, il se peut que cette idée portée par une éthique de lʼ «  anti-description  » puisse, in fine, reproduire des hiérarchies entre «  vrais sujets politiques désidentifiés  » et sujets pas assez queer, pour qui les catégories font encore quelque chose. Et cʼest par ce point que je conclurai ici cette partie consacrée au mouvement qui doit animer la définition de queer (mouvement qui précède la modalité, et préfigure la nécessité) : se désindentifier ne signifie pas ne pas pouvoir se dire. Nommer, mobiliser des catégories, ne sont pas nécessairement des gestes réifiants qui congèlent nos réalités. Je pense par exemple aux parcours trans, à cet égard. Je sais quʼil existe des personnes pour qui le discours du «  jʼai toujours été une petite fille  », ou encore «  je suis au fond de moi un garçon  » fonctionne, ou à tout le moins, produit quelque chose. Ainsi, je souscris à lʼidée de la désidentification, à la condition quʼelle nʼait pas pour effet de bord la re-création de frontières entre bons queers déconstruits et queers «  traditionnels  ». R. R . Robles le nomme, en quelque sorte, en déplaçant la catégorie de lʼidentité vers le discours. Mobiliser une catégorie ne devrait pas signifier que lʼon fusionne avec elle -— sans parler du temps, qui sera ci-après notre objet, qui déplace lʼindividu, les collectifs, les sociétés, et qui est amené à faire vibrer le contenu des catégories.
Jʼai évoqué la modalité nécessairement plastique du terme «  queer  ». Jʼai ensuite esquissé un mouvement, ayant trait à lʼidentité, ou aux identités queer, qui devrait sʼinscrire dans une forme de désidentification pour trouver leur justesse politique (à condition que celle-ci ne devienne pas une nouvelle injonction). Il me reste donc à donner une visée à ce projet, que jʼai nommée précédemment comme nécessité. Celle-ci se tient du côté de lʼHistoire, et constitue le rempart à toutes les réappropriations quʼune définition flottante du queer autorise. Ici, nous pouvons nous rappeler que «  alors quʼil peut y avoir une réticence à dire ce que queer ‹ est ›, il existe certainement des suppositions quant à ce que ‹ queer › fait  »279 (Giffney & Hird 2008, 5). Oublions un instant le fait de «  se dire  », pour simplement «  dire  »â€¯: queer. Il sʼagit dʼun acte qui convoque une, ou plusieurs cultures, des faits, des esthétiques, peut-être des personnes -— en un mot, «  queer  » est rattaché à une histoire. Sara Ahmed parvient en quelques phrases à retranscrire cette charge dʼévocation :
Queer : un mot avec une histoire. Un mot qui a été lancé comme une pierre ; ramassé et jeté sur nous, un mot que nous pouvons revendiquer pour nous. Queer : bizarre, étrange, inconvenant, dérangé, dérangeant. Queer : un sentiment, un mauvais pressentiment ; se sentir queer comme sentir venir la nausée. Quand nous pensons à ce que ce mot a rassemblé, nous nous rassemblons autour du mot. Cʼest une assemblée fragile280 (Ahmed 2016).
Queer est donc un terme plein, en même temps quʼune puissance de négativité. Cʼest pour réconcilier des états aussi contradictoires que je suis passé par le concept de «  plasticité  », même si on a vu comment la célèbre définition de C. Malabou ne convenait quʼà demi. Pour autant, la plasticité est cruciale pour approcher le poids de queer, non comme une somme à dérouler, mais comme la nature de ce qui est plastique par son inscription même dans le temps. Muriel Plana nous rappelle justement que la «  plasticité du concept  » de queer est ce qui «  en conditionne également lʼhistoricité  ». Elle développe ainsi :
ce qui était queer hier ne lʼest plus forcément aujourdʼhui ; ce qui nʼétait pas considéré comme queer il y a dix ou vingt ans peut lʼêtre devenu à nos yeux extrême-contemporains, de plus en plus nourris et sensibilisés par les études de genre (2015, 10).
La définition de queer nʼest pas seulement mouvante en vertu de ses dimensions épistémologique et politique, elle lʼest aussi par lʼhistoire -— quʼil sʼagisse de la grande «  Histoire  » (étant entendu que les personnes queer en ont souvent été effacées) ou des histoires individuelles qui tissent celle-ci. Le queer, souvent associé à une charge de subversion contre le normal, possède aussi quelque chose de lʼavant-garde ; sans doute, pour cette raison, partage-t-il avec le post-modernisme «  des mythes et des idéologies comme le post-anthropocentrisme, la critique de lʼhumanisme et de lʼuniversalisme, la mise en cause du Sujet de lʼaction […], la critique du politique […], le soupçon sur la totalité, la dé-hiérarchisation des valeurs entre savant et populaire, lʼéloge du pouvoir et la liberté des corps et des affects, la performance et la performativité, le culte des marges, lʼidéalisation éventuelle des dominés […] et la restauration de normes -— par lʼidée de la transgression comme norme -—dans les subcultures  » (Plana 2018, 33). Bien entendu, le queer est également en rupture avec le post-modernisme, comme le montre plus avant Muriel Plana dans Fictions Queer (2018, 36–44). Le propos de M. Plana porte sur les esthétiques, plus précisément sur celles que lʼon peut rencontrer dans les fictions (en arts de la scène, mais pas seulement). Aussi, est-il intéressant de frotter ce questionnement sur la dimension avant-gardiste du queer aux travaux dʼElisabeth Freeman. La chercheuse critique la manière dont «  queer  » semble toujours devoir se conjuguer au futur :
Les tendances dominantes de la théorie queer ont tendu à privilégier lʼavant-garde. À un moment dans ma vie de chercheuse en culture et théorie queer, jʼai pensé que le but du queer était dʼêtre toujours en avance sur les transformations sociales. Selon ce modèle, il semblait que les queers vraiment queers pourraient dissoudre les formes, désintégrer les identités, mettre à plat les taxinomies, mépriser le social et même répudier intégralement le politique […] À présent je pense que le but pourrait bien consister à être à la traîne par rapport aux possibilités sociales existantes ; dʼêtre intéressé par la queue de comète, de vouloir se baigner dans le crépuscule de toute chose qui a été déclarée inutile. Car, alors que lʼantiformalisme queer mʼattire à un niveau intellectuel, je me sens émotionnellement portée par un désir pour ce-qui-nʼest-pas-assez-queer qui nous ramène en arrière à des moments antérieurs, en avant vers des utopies embarrassantes, sur les côtés à des formes dʼêtre et dʼappartenir qui semblent, à première vue, complètement banaux281 (2010, xiii).
Plusieurs éléments sont ici très précieux. Tout dʼabord, E. Freeman nous permet de réaffirmer la nécessaire méfiance que lʼon doit entretenir avec un queer par trop synonyme de subversion, et qui devient même le nom de lʼinjonction à celle-ci. Ensuite, il importe de remarquer que chez E. Freeman, le retour au passé a quelque chose dʼun peu honteux : il est même contre-intuitif. Il ne porte pas en lui la nostalgie glorieuse que lʼon peut parfois lire dans les théories plus normatives, officielles, qui se réclament des vieilles lunes académiques ou dʼune nostalgie pour une époque meilleure, «  où lʼon savait penser  ». Replier le queer sur son antériorité, cʼest potentiellement découvrir des chapitres gênants, des identités poussiéreuses, ou au contraire des figures prometteuses (de Jeanne dʼArc282 à Marsha P. Johnson283, de Madeleine Pelletier284 à Marie-Pierre Pruvot285, en passant par James Barry286 et Kosen Takahashi287) quʼil peut être tentant dʼassocier à une étiquette à une autre, en fonction de notre référentiel queer, par ailleurs occidental et contemporain. On pourrait juger ces classements anachroniques, mais là nʼest pas mon propos. Vu tout mon développement au sujet des identités, il semble évident à ce stade que la question de qui «  était  » trans ou queer il y a 200 ou 300 ans mʼimporte peu. Plutôt, je souhaite utiliser la pensée dʼE. Freeman pour montrer comment le temps travaille autrement la notion de queer, notamment parce quʼelle nous connecte à une histoire, quʼici, jʼoserai peut-être nommer comme la nôtre.
La capacité à se relier à une histoire est elle-même une attitude située dans une époque : jusquʼà très récemment encore, les personnes queer se voyaient refuser lʼaccès à la conservation de leur passé (traces historiques) et donc à la capacité de participer au futur. Cʼest dʼailleurs tout lʼenjeu du mouvement archivistique actuel qui touche aux cultures queer, et voit essaimer des initiatives diverses, plus ou moins dissidantes, plus ou moins coordonnées avec des institutions288 en France. Lʼattitude de lʼarchiviste peut rencontrer une posture esquissée par E. Freeman, et avant elle par Jack Halberstam (2005). Celle-ci consiste à ne pas confondre le goà »t que lʼon peut avoir pour les théories avec des formes plus souterraines dʼadhésion émotionnelle. Et comme E. Freeman, je me trouve en prise avec des théories de la désidentification qui me séduisent, mais, comme elle aussi, je suis ému par lʼidée dʼaller chercher en arrière plutôt quʼen avant, de trouver le queer avant le queer, peut-être parce que je me sens à titre personnel un «  mauvais queer  », au sens dʼun queer en dessous de cette mission subversive que le mot nous donne en héritage. E. Freeman nous permet aussi de retourner les approches selon lesquelles le queer serait à venir, en germe, pas encore accompli, déplacé dans une forme dʼutopie plus ou moins distante. Ces pensées nʼexcluent dʼailleurs pas forcément la connexion au passé. José Esteban Muñoz écrit ainsi dans Cruiser lʼUtopie (dont le titre est en soi programmatique) : «  nous nʼavons jamais été queer, mais la queerness existe pour nous comme une idéalité qui peut être distillée du passé et utilisée pour imaginer un futur  »289 (2009, 1). Muñoz ne renonce pas au passé pour penser son utopie queer ; mais elle reste résolument tournée vers le futur, une idéalité, une réalisation transcendante. Læ contributeurice à la revue Trou Noir Polyeucte critique cet aspect de la pensée de Muñoz en identifiant deux pôles attirant chacun la queerité : espérer ou résister. Du côté de lʼespoir, Muñoz et ses utopies queer ; de lʼautre, du côté de la lutte, on trouvera plutôt Lee Edelman et la négativité du queer, la pulsion de mort, le prisme antisocial revendiqué. Ces deux pôles théoriques me semblent doubler une tension qui se rejoue justement dans lʼhistoire du queer, ou plutôt, dans ses lectures : lʼopposition entre fête et colère. À chaque nouvelle Pride, la dialectique structurante290 entre ces deux expressions du queer sont rejouées dans les espaces militants, médiatiques, et peut-être privés. Critique des chars flamboyants, auxquels on oppose la digne mémoire de Stonewall ; critique du «  capitalisme arc-en-ciel  » (à juste titre !) en frottement avec le désir de sʼamuser, dʼêtre visible, de tout simplement exister… Les deux attitudes ne sont pourtant pas nécessairement opposées. Pour prolonger la lecture intuitive que nous avons décelée chez E. Freeman, on pourrait même suggérer quʼelles sont deux états émotionnels faisant partie intégrante de la vie humaine. Mais ces émotions ont une charge, et précisément, une charge historique. On lira ainsi des tweets qui nous rappellent que «  la Pride ce ne sont pas que des paillettes  ». Dans de telles formulations sʼinscrit une binarité qui semble intéressante à travailler. Si deux positions, luttes ou paillettes, négativité du futur ou utopie peuvent devenir lisibles comme polarités, faut-il persister à les inscrire comme telles ? Les lectures qui accordent une valeur supérieure sur le plan politique à la lutte possèdent une antériorité, qui est dʼailleurs inscrite en toutes lettres dans lʼhistoire du mot «  queer  ». Dans le célèbre tract «  Queers Read This  » déjà cité dans ces pages, distribué lors des Pride Marches de Chicago et New York en juin 1990, figure un commentaire éloquent sur la fête : fig. 1.14 : Tract Queers Read This, anonyme, distribué lors de la Pride de 1990 à New York et Chicago.
fig. 1.14 : Tract Queers Read This, anonyme, distribué lors de la Pride de 1990 à New York et Chicago.
Pourquoi laissons-nous les hétéros venir dans les clubs queer ? Qui ça intéresse quʼils nous aiment bien, parce quʼon sait vraiment faire la fête ?291 (1990).
La fête nʼest pas seulement vue, comme lʼutopie, comme une impasse politique en soi, elle est aussi épinglée pour sa vulnérabilité à la récupération. Et il est vrai quʼun des effets du capitalisme arc-en-ciel, en plus du siphonnage des esthétiques queer, est de détourner lʼattention, par ce moyen, de la charge de colère qui nourrit lesdites esthétiques. Il est plus facile «  dʼintégrer  » les personnes LGBT (jʼemploie cette version de lʼacronyme à dessein) quand elles font des enfants, quand elles imitent la famille hétérosexuelle et ses habitus, pas seulement parce que ces actions, parmi dʼautres, sont des marqueurs de normalité, mais aussi parce quʼelles détournent lʼattention dʼune histoire de la colère, voire dʼune histoire colérique qui est celle du queer. Pavés jetés sur la police à Stonewall (1969), faux sang jeté sur lʼÉlysée (2005), cendres dispersées dans le jardin de la Maison Blanche à Washington (1992) : «  queer  » est gros de gestes de rage, mais il semble vain dʼopposer celle-ci à la «  fête  ». Le fait même que la Pride découle des émeutes292 de Stonewall montre quʼil existe un continuum fête-colère -— même sʼil convient bien entendu de rester vigilant quant à lʼappropriation des luttes et à la récupération, en surface, de codes faciles à remettre en circulation en les vidant de leur charge politique (Halberstam 2005, 156). Opposer la fête à la manifestation est sans doute stérile, dʼautant plus que la frontière existant entre les deux est extrêmement poreuse. Ces deux activités humaines possèdent au moins une chose au commun, qui assure leur charge politique : la saisie de lʼespace public, qui était dʼailleurs un enjeu central du tract Queer Read This, dans lequel on peut lire que «  être queer nʼa rien à voir avec un droit à la vie privée ; il a tout à voir avec la liberté de vivre en public, dʼêtre ce que nous sommes  »293. Mobiliser lʼhistoire du queer pour le définir pose donc la question de la mobilisation des temporalités, et avec elle, inévitablement, celle des espaces. La philologie du queer implique de revenir à Teresa de Lauretis, ou encore à Judith Butler ; mais on revient sans doute trop rarement à Gloria Anzaldúa qui pose les fondements dʼune pensée queer dès les années 80 (Bourcier 2015 ; 2017, 198). Le concept de «  frontera  » propre à lʼautrice chicanx met lʼaccent sur la dimension spatiale des marges, et les réinscrit dans des formes de mouvement, proches de la dérive qui font écho à la pensée «  nomade  » de R. Braidotti. G. Anzaldúa écrit, au sujet de la frontière mexico-étasunienne :
Une frontière [borderland] est un espace vague et indéterminé créé par le résidu émotionnel dʼune limite non-naturelle. Elle est en état constant de transition. Ses habitants sont lʼinterdit et le prohibé. Los atravessados vivent là  : celleux aux yeux plissés, les pervers·es, les queers, les fauteurs de trouble, les bâtard·es, les mulâtres, les métis, les demi-mort·es ; en un mot, celleux qui passent, traversent, ou vont aux confins du ‹ normal ›294 (1987, 3).
Les «  corps abjects  » (Butler [2014]1993) existent en continuité avec les espaces liminaires qui leur sont laissés, qui parfois les enferment, mais quʼils apprennent aussi à habiter. Convoquer cette pensée demande une forme de prudence : utiliser la métaphore de la marche ou de la dérive pour nommer les subjectivités des personnes queer nʼest pas sans risque. Récemment, la métaphore de la transition comme migration a pu avoir comme effet de bord lʼinvisibilisation des expériences concrètes de la migration. Nommer la transition de genre (entre autres) comme expérience migrante, cʼest prendre le risque de sʼapproprier depuis une situation de privilège -— celle dʼêtre occidental·e, dʼavoir des papiers -—des récits qui sont souvent silenciés (Robles 2022b). Il faut donc être clair quant à ce qui tient lieu de métaphore (la dérive, la pensée «  nomade  ») et ce qui relève dʼune expérience concrète à lʼintersection de la queerness. Je convoque ici ce concept spatial de frontera car il délimite des espaces habitables malgré tout (ce qui sera précieux pour la suite). Cette théorisation croise chez G. Anzaldúa une lecture de cet «  être queer  » qui nous pose tant problème. Elle affirme ainsi «  [avoir] fait le choix dʼêtre queer  » et nomme ce processus comme un «  chemin  » (1987, 19)295. La frontera associe queer à dʼautres subjectivités, pour mieux les réunir dans un espace de lʼincertitude, dans lequel le déplacement semble inévitable. Ainsi, plutôt que dʼopposer fête et colère (et toute autre binarité), nous ferions bien de les penser elles aussi dans la limite qui les sépare, la dérive qui les relie. Queer : ce «  no manʼs land au-delà de la norme hétérosexuelle  » (Hanson 1993, 138) est tout à la fois contenu par elle -— les parois du placard nʼen limitent pas les contours.
Lorsque je dois expliquer que le genre nʼest pas, mais quʼil fonctionne296 aux étudiant·es suivant le cours Queer[ed] Design, je projette en général un cartoon de Max Fleischer. Celui-ci, intitulé Allʼs Fair at the Fair297 (1938) met en scène deux protagonistes, un homme et une femme en couple vivant aux États-Unis dans une zone rurale, qui se rendent à la ville voir une exposition de nouveautés (entre la foire universelle et le salon des arts ménagers), grâce à leur cheval tirant une charrette (fig. 1.16.a).

Là , iels découvrent les dernières innovations industrielles, sublimées par la grâce de la matière élastique du dessin animé : une machine qui tricote instantanément un pull avec ses mains mécaniques, une emboutisseuse qui extrait dans une énorme grume (sans égard pour la perte de matière) du mobilier, un gigantesque moule permettant de construire un pavillon en quelques secondes, et une machine à presser les oranges qui fait pousser les fruits utilisés de manière accélérée. Le couple sʼextasie devant ces merveilles, avant dʼaller explorer le dancing de lʼexposition. Jusquʼalors, dans le récit, les représentations des machines concernaient des biens de consommation courante, produits grâce à des processus mystérieux, presque magiques. Le maître mot était la rapidité, et ces quelques démonstrations étaient déclenchées sans travailleur·ses, avec un goà »t pour la dépense exagéré de manière ironique. Au dancing, les choses sont différentes puisque les chemins des deux protagonistes se séparent : Elmer se dirige chez le barbier, tandis que Miranda se rend au salon de beauté.

La préparation de lʼhomme du couple est expéditive : les robots du service lui coupent quelques mèches de cheveux et le rasent (fig. 1.16.b). En revanche, le chemin est plus compliqué pour Miranda. Ses cheveux sont coupés, mais aussi teints ; un collier mécanique enserre son cou (fig. 1.16.c) tandis quʼun «  masque de beauté  » lui est violemment projeté sur le visage, sous la forme dʼun geyser de boue ; la boue essuyée par des pales, des tampons compriment ses joues et enduisent sa peau de fond de teint, avant que la poudre ne soit appliquée par un procédé similaire ; elle est enfin maquillée et libérée de son siège, mais doit encore passer par une presse qui écrase son corps afin de la rendre plus mince et élancée. Le couple se retrouve après leurs «  soins  » et rejoignent la piste de danse, où un orchestre composé de robots joue de la musique. Chaque membre du couple danse avec un robot correspondant à son sexe opposé. Les automates qui virevoltent avec Elmer et Miranda dans une danse endiablée reproduisent des marqueurs de genre (pilosité, silhouette, apparence du visage) attendus. Et lorsque la démonstration est terminée et que les danseurs mécaniques retournent à leur placard, Elmer et Miranda peuvent enfin danser ensemble, leur compatibilité de genre ayant été réaffirmée par les robots. Iels finissent par acheter une voiture et retourner à toute vitesse à leur campagne, leur obsolète cheval installé sur le siège passager298.

Ce dessin animé de huit minutes me semble riche à plusieurs égards. Tout dʼabord, il révèle un continuum entre la manière dont lʼindustrie affecte notre relation aux objets et la façon dont les objets de consommation courante contribuent à produire le genre. Avec humour, le récit souligne que les robots sont appelés (dans lʼimaginaire de 1938) à remplacer les humains pour toutes les tâches courantes -— je serai dʼailleurs amené à reparler de ce fait quand jʼévoquerai la relation des femmes à lʼélectroménager (cf. infra., p **.). Il est dʼailleurs intéressant de remarquer que les robots sont ici un peu plus que des esclaves : dans la danse (bien que celle-ci soit payée avec lʼargent du couple), ils deviennent des partenaires sociaux. Seulement, cette interaction ne change rien à lʼordre du genre et lʼagencement hétérosexuel quʼil sous-tend : fréquenter des êtres mécaniques consistue un divertissement, mais rien de nouveau ne se produit dans lʼéchange, qui vise finalement à resserrer les liens entre les époux. Enfin, et cʼest le point le plus important ici, lʼindustrie qui produit chaises, tables et jus dʼorange sur un mode aussi féérique que dispendieux produit aussi le genre, et de façon différenciée. Là où lʼapprêtement masculin ne change pas Elmer, cʼest à une véritable refonte de son corps quʼest exposée Miranda. Si le genre fonctionne sur la base de «  technologies  » comme nous le dit Teresa de Lauretis (1987), il apparaît à la faveur de ce petit film comme une machine. La machine produit le genre, autant que la différence. Les corps entrent par des portes distinctes, vivent des expériences opposées, pour finalement travailler leur compatibilité par la danse. On pourrait, en détournant le titre du livre dʼHenrietta Moore, observer que les sociétés occidentales modernes et contemporaines ne fonctionnent pas tant sur la différence que sur une passion pour la différence. Hommes et femmes ne sont pas seulement opposés : leur opposition est lʼobjet de rituels spécifiques qui travaillent, illustrent, assoient cette économie de la différence. Dans cette machine différentielle, lʼespace domestique, et plus particulièrement la cuisine, est un rouage important.
Tout lʼenjeu de ce chapitre a consisté à cartographier cette différence. Que disons-nous, quand nous affirmons que les hommes sont différents des femmes ? Être féministe ne consiste pas à nier une différence, mais à remettre en cause intégralement ses soubassements épistémiques. Ici, cʼest une approche cartographique qui a été retenue, à la fois pour traiter de manière relationnelle des notions existantes, et pour ouvrir un imaginaire dans lequel les catégories puissent être traversées, plutôt que circonscrire et enfermer. Il faut pourtant prendre acte dʼun fait essentiel : au sujet des vies queer, et pas seulement de la sexualité, le placard, qui organise le secret et métaphorise lʼenfermement, reste un paradigme puissant. Mais le convoquer, ce nʼest pas forcément se soumettre à la biopolitique du coming out, et devoir arbitrer entre «  se dire  » et «  ne pas se dire  ». En réalité, une approche cartographique a fait ici proliférer ce concept en le réancrant dans sa matérialité dʼobjet de design. Inscrit dans un scénario dʼusage, et donc à la fois dans lʼespace et le temps, le placard révèle des doubles fonds, des passages secrets, et peut-être des espaces fictifs utopiques à habiter. Sa porte principale, la plus connue, qui voile la vie homosexuelle, cache bien dʼautres tiroirs que jʼai tâché dʼouvrir. Lʼinvestigation (partie A) a ainsi mis en évidence la manière dont nous faisons le genre, ou dont le genre, par feedback, nous fait. Jʼai ici rencontré une première binarité qui oppose genre à sexe. Il mʼa semblé moins important de tracer des limites entre ce qui tient de lʼun ou de lʼautre, que de poser lʼexistence dʼune intrication sexe-genre, qui ne revient nullement à dire que tout est construit (position constructiviste radicale) ni, à lʼopposé, à réaffirmer le primat dʼune réalité de sexe irréductible (position essentialiste). Utiliser lʼexpression sexe-genre permet de nommer lʼindistinction qui caractérise ces deux réalités qui, toutes aussi difficiles à dissocier soient-elles, ont besoin dʼêtre nommées dans des contextes de recherche. Par conséquent, le terme de «  sexe  » au sens de «  sexuation  » ne doit pas être abandonné, puisquʼil existe des phénomènes liés à ce marquage biologique qui doivent être identifiées. Pour mieux comprendre le tressage des deux catégories, jʼai isolé quatre positions majeures marquant leur relation, pour réaffirmer ce postulat (partie B) : sʼil nʼexiste pas de réalité de sexe qui soit complètement séparable du genre, tant ce dernier sature nos représentations, cela ne signifie nullement quʼil faille arrêter de parler de sexuation. Cʼest plutôt le feedback permanent entre «  donné  » et «  construit  » quʼil convient de saisir, et il faut même percevoir la boucle sans fin qui unit ces réalités. Jʼai terminé cette réflexion en me concentrant sur la dimension produite (plus encore que construite) du genre, pour critiquer la stratégie politique, parfois commerciale, qui sʼoffre de «  dégenrer  » les représentations et les existences. Plutôt que de poser une abolition du genre qui me paraît à la fois illusoire et potentiellement délétère, jʼai voulu donner comme horizon une possible remobilisation des catégories de genre, toujours selon le motif de la dérive, qui autorise les retours, les détours et les remords.
Plus avant, jʼai nommé le concept de Nature (partie C) comme la pierre angulaire du système sexe-genre -— Julia Serano dit que la Nature est une «  carte joker ultime  »299 (Serano 2016[2007], 174). Lʼordre du genre repose sur une épistémè de la différence, elle-même pensée comme naturelle. La différence est souvent le produit de lʼobservation empirique ; or, cʼest ce principe de différence qui produit ses objets, dans la mesure où les groupes «  homme  » et «  femme  » sont considérés comme devant différer. Ce paradigme tend à lisser les différences internes aux groupes. Le système sexe-genre résiste à ses angles morts, puisquʼil intègre à merveille ses contradictions : quʼune anecdote le renforce, il sʼen empare ; quʼun fait le contrarie, il se met à lʼœuvre pour le modifier afin quʼil corresponde à son ordre. Autrement dit, cet ordre épistémologique est plus puissant que les énoncés qui le constituent, et qui peuvent à tout moment changer, sʼadapter, pour préserver leur superstructure. Sur cet atlas sexe-genre, la plaine de la différence se nourrit dʼun fleuve abondant, la Vérité. Les énoncés importent, mais seulement en tant quʼémanation du Vrai. Investir sexe-genre, cʼest sʼattaquer aux régimes de vérité qui gouvernent les corps. Certains groupes humains, parce quʼils menacent potentiellement de perturber lʼordre établi, deviennent paradoxalement des instruments pour consolider le régime du genre vrai. Les personnes trans, par définition, contrarient lʼidée de la continuité entre sexe et genre, et même lʼimmuabilité de la sexuation -— car ce qui est vrai traverse le temps, les âges, et ne saurait tolérer de déplacement, ne serait-ce quʼà lʼéchelle dʼune vie humaine. Le genre investi comme expression du «  vrai  » sexe produit les personnes trans comme intrinsèquement duplices, et plus discrètement, investit les sujets cis dʼun pouvoir dʼénonciation de la vérité sur le genre. Il faut quʼil y ait des corps faux pour que les corps vrais se signalent comme tels, notamment en réagissant directement à leur exposition à lʼartifice (par le vomi, les larmes, etc.). La Nature, comme concept, est ainsi mobilisée de manière changeante : le terme sert à justifier des décisions, asseoir des comportements, tout en instituant les individus dominants (ici, le scientifique) comme étant détachés de la Nature (Haraway 1997), capables dʼen être les porte-paroles, les arbitres et les maîtres.
En effet, les sciences sont des cultures de la Nature qui, en sʼoffrant de la connaître, en constituent la naturalité, ainsi que lʼobligation morale dʼadhérer à son ordre. Les sciences du vivant, notamment, lorsquʼelles ne sont pas éclairées par une posture féministe, fabriquent des lignes -— souvent violentes, à même les corps -—entre ce que lʼon peut toucher (et qui peut le toucher) et ce qui doit rester vierge. Ma posture, dans ce chapitre D, nʼest pas anti-scientifique. Elle ne se donne pas pour objectif de cesser lʼobservation et lʼexpérimentation scientifique, bien au contraire. En suivant D. Haraway, K. Barad, ou encore E. Wilson, il sʼagit de remobiliser le concept dʼobjectivité pour imposer le fait que celle-ci ne va pas de soi. Il est important dʼinvestir lʼhistoire des sciences pour comprendre la manière dont les imaginaires du masculin et du féminin ont infusé la recherche. Cʼest donc une objectivité pensée, située, plutôt que celle, privilégiée, qui établit une forme de lien naturel entre certains sujets et la production de savoir, quʼil importe de construire. Ici, la distinction sexe-genre sʼest avérée utile, puisquʼelle permet de nommer la manière dont les récits de genre saturent les fictions sur le sexe. Ce sont bien les faits quʼil faut replacer au centre de la démarche, puisque critiquer les stéréotypes de genre à lʼœuvre dans les études scientifiques ne revient pas à investir une page blanche. Au contraire, il existe des connaissances scientifiques sous-estimées ou méconnues qui peuvent tout à fait nourrir les études de genre.
Pour esquisser la manière dont de nouveaux savoirs pouvaient sʼinviter dans les étroites catégories de genre, jʼai proposé dʼinterroger le concept de «  femme  », qui est actuellement le site de débats politiques dʼimportance, en réponse aux attaques essentialistes et transphobes des TERF (partie D). Mon objectif nʼétait pas ici de savoir ce quʼest une femme, et encore moins «  la  » femme. Au contraire, jʼai contextualisé ma démarche en lʼinscrivant dans la lignée dʼun féminisme qui pense le sujet femme comme résolument «  excentrique  » (de Lauretis). Quand je parlerai de femmes dans les pages qui suivent, je parlerai dʼune classe à qui on demande dʼêtre des femmes, mais aussi de femmes à qui on refuse leur «  carte de membre  ». Dans les deux cas, «  femme  » est lʼoutil dʼun arbitrage, qui lui-même scelle un destin. Il est donc nécessaire de refuser que femme constitue un concept frontière. Formater le genre est une attitude anti-féministe, et doit être nommée comme telle. Il importe alors de faire proliférer les mots autour de «  femme  » autant que les attitudes correspondantes. Femmeâ„¢ est un de ces termes. Emprunté à Barbara Métais-Chastanier, il nomme ces destins (de femme forte, de girlboss, de boniche, de potiche, de salope) qui sont tour à tour imposés aux femmes et sanctionnés chez elles (et parfois chez dʼautres sujets perçus comme féminins). Face à cette figure injonctive, on peut imaginer dʼautres manières de se dire, surtout quand il faut se dire collectivement. Les mots ne sont jamais aussi intéressants que lorsquʼils fondent des coalitions (Olufemi 2020, 65) : contre Femmeâ„¢, une coalition des meufs peut et doit être possible. Ici, jʼai utilisé les textes dʼAndrea Long Chu pour former une sorte de «  coupe agentielle  »300 (Barad 2007, 148) dans la lecture du genre, qui ne soit pas guidée par une lecture bipartite. En posant que «  tout le monde est femelle  », A. Long Chu mʼautorise à dépasser la fragmentation catégorielle, à changer dʼaxe, de dimension, à explorer enfin un plan souterrain qui donne des clés sur la manière dont le bâtiment sʼagence : cʼest explorer le bâti par ses tuyaux, ses conduits, à défaut de savoir ouvrir toutes les portes. Conscientiser cet être-femelle commun permet dʼapprocher autrement la misogynie, appelée à devenir dans le futur un sujet central de mes recherches.
La tresse sexe-genre, déjà intriquée, sʼest encore compliquée lorsque jʼai abordé la question de la sexualité (ou plus précisément, la question du choix dʼobjet dans son écologie). Ayant posé que lʼhomosexualité nʼest pas seulement affaire de sexualité, jʼai pu la relier à la performance et à la production du genre. Andrea Long Chu lʼaborde dʼailleurs : on fabrique son genre dans le désir de lʼautre. Cette saturation du champ social par le genre ne trouve donc pas dʼexception dans les questions amoureuses et sexuelles : cʼest peut-être une évidence, mais il est pertinent de la nommer. Lʼhomosexualité et la bisexualité, bien quʼelles soient en rupture avec lʼordre straight, héritent cependant dʼun ordre sexué, jusque dans leur propre définition. Cʼest donc un ultime paradoxe quʼil nous faut affronter : les déviant·es de genre que sont les tatas, les butches, les pédales, les futch, peuvent, si iels nʼy prennent garde, renforcer lʼordre straight du sexe. Cʼest ici peut-être que le terme LGBTQIA+ est le plus défaillant : en sus de sa potentielle illisibilité, il tend à séparer les déviant·es de genre (trans) des déviant·es de la sexualité (lesbiennes, gay, bi·es). Or, on peut bien sà »r être lesbienne et trans, gay et trans, bi et trans, et les gays et lesbiennes cis ne sont de toute façon pas aligné·es sur lʼordre straight du genre. Une praxis queer (en cuisine, notamment) commence donc par cet axiome, proposé plus haut : tout est question de genre, sauf le genre lui-même, qui est une question de Vérité.
Le terme queer est souvent proposé comme terme parapluie pouvant adéquatement remplacer le laborieux LGBTQIA+. Pourtant, il est aussi exposé à la récupération, et ne résout pas la question centrale de lʼidentité. Judith Butler lʼobserve : alors que ce terme était justement un terme politique, dʼaction et de coalition, il est aujourdʼhui un mot avec lequel il est possible de se dire queer. Mais se dire queer, est-ce nécessairement dire que lʼon est queer ? (partie E) Comment investir «  queer  » sans le réessentialiser ? Comment sʼen détourner sans assister à sa récupération ? Quels modes de relation (à lʼautre, au savoir, au groupe) sont possibles avec le queer ? Pour mener à bien ce projet, jʼai détaché trois courants dans le fleuve queer. Jʼai dʼabord pensé les modalités de la définition, pour invoquer un effort catégoriel qui investit son objet comme un espace, plutôt que comme une boîte. Cʼest donc vers un queer résolument plastique (au-delà de la définition quʼen donne C. Malabou) que je me suis tourné (partie F). Jʼai ensuite esquissé un mouvement, reliant identification et désidentification avec Muriel Plana. Enfin, jʼai invoqué les histoires communes comme une nécessité éthique. En lʼassociant à lʼavant-garde, il peut être tentant dʼinvestir «  queer  » comme étant porteur dʼune forme de fraîcheur théorique, mais ceci est comporte le risque de le couper de ses racines historiques. Queer a une histoire déjà longue : en tant que mot, il est ancien ; en tant que concept pouvant plus ou moins discrètement déconstruire les normes, il a entre trente et quarante ans ; en tant quʼattitude, il a peut-être existé dès lors quʼil y a eu des humains. Ainsi, penser les histoires hybrides du queer, cʼest aussi sʼautoriser à penser un queer avant le queer. Cʼest aussi mobiliser les affects du queer, ce que queer nous fait, la manière dont il nous émeut et porte nos trajectoires intimes (ce qui est encore différent du rapport identitaire qui peut découler du «  je suis queer  »). Faire le queer revient donc à se frotter à un temps qui n’est pas figé -—je pense par exemple à celle des photographies avant/après dans lesquelles on enferme les personnes trans (Malatino 2022, 26), et jʼai développé ici lʼopposition lassante qui sépare «  fête  » et «  colère  ». Homme/femme, gay/straight ou queer/straight, ou encore fête/colère : autant de partages quʼil est utile de nommer mais quʼil faut travailler à brouiller, complexifier et redistribuer. Il ne sʼagit pas de renoncer à produire des images, mais au contraire, de multiplier les représentations, comme je mʼy emploie, de faire et refaire la carte du genre, non pas pour trouver une vérité, mais pour constater un état. David Halperin nous le dit : «  il nʼy a pas de sécurité dans le terme queer  »301 (115). Queeriser, cʼest renoncer au confort de la vérité. On se nomme, on sʼidentifie, avec la même énergie qui nous fait nommer les tempêtes ; mais nous sommes plutôt des tremblements de terre, dont il faudrait enregistrer les secousses, les tremblements, les vibrations de plaques tectoniques. Dans Alone Together (2012), Sherri Turkle évoque les crocodiles présents à Disneyworld. Elle explique que ces animaux ont rencontré des critiques du public, qui les trouvaient moins «  réalistes  » que des automates (3–4). Lʼanecdote évoque aussi lʼobservation du cinéaste Jean Renoir pour qui «  la vérité est le plus souvent invraisemblable  » (2005[1974], 248). Par ces deux évocations, je trouve un chemin de traverse : abolir non pas le genre, mais lʼesthétique de vérité qui le travaille. Qui sait ce que nous ferons de nos genres lorsque nous renoncerons tout à fait à être authentiques ? Quels glissements de terrain opéreront alors ? Cʼest avec cette dernière secousse que je propose de quitter le seuil du placard pour gagner celui de la cuisine.
___
Courtney Love pour le groupe Hole, chanson «  Doll Parts  », 1994.
Booba, «  Bonne journée  », 2021.
En 2018, la journaliste américaine Emily Chang publie Brotopia, Breaking Up the Boyʼs Club of Silicon Valley, un ouvrage dédié à la situation des femmes dans le milieu des sciences de lʼinformatique, et plus largement dans lʼéconomie du Web, que lʼon nomme communément aujourdʼhui «  la tech  ». Elle dépeint un triste paysage des carrières des femmes dans le milieu de lʼinformatique depuis les années 1960. Peu représentées, les informaticiennes et développeuses font face, y compris de nos jours, à une culture du travail machiste et des environnements professionnels toxiques qui freinent leur carrière, limitent leur agentivité et les expose à diverses formes de maltraitances, allant des plaisanteries graveleuses aux agressions sexuelles. Le travail de E. Chang repose sur des interviews avec des professionnelles, en face-à -face, mais aussi sur une rencontre plus large réalisée en non-mixité302, en 2017 (Chang 2018, 177–78). Après le témoignage très médiatisé de Susan Fowler, qui expose en 2017 les dysfonctionnements graves de la société Uber, E. Chang réunit à son domicile un groupe de femmes, employées chez Uber, Google, Apple, Facebook et des start-ups émergentes en Californie. Ce passage de lʼouvrage est consacré à lʼexposé de leurs témoignages, mais une courte phrase introductive mʼinterpelle. La journaliste mentionne lʼaccueil des professionnelles à son domicile : «  [l]es femmes discutaient dans mon entrée en attendant que Postmates arrive à notre porte avec notre dîner à la demande  »303.
Postmates est une entreprise de livraison de nourriture fondée en 2011, rachetée en 2020 par Uber. Son principe est le même que celui de Deliveroo, implanté en France : des coursier·es payé·es à la mission collectent des repas préparés dans des restaurants, et les livrent à leurs client·es qui ont passé commande par le biais dʼune application smartphone ou dʼun site Web. Si cette description mʼarrête, cʼest quʼelle réussit à ramener une question fort ancienne dans un ouvrage qui fait très peu mention de lʼassignation historique des femmes au foyer. Le point de focalisation de lʼouvrage semble hériter de batailles gagnées par le féminisme de la seconde vague : il nʼest plus question pour les femmes dʼavoir accès au monde du travail, mais dʼy évoluer à égalité avec les hommes, de briser le «  plafond de verre  »304 et de traiter la question du harcèlement sexiste et raciste (entre autres) au travail grâce aux politiques dʼinclusivité et dʼégalité. Mais la condition de cette lutte politique, qui prend ici la forme dʼune réunion dʼéchanges entre professionnelles dʼun même secteur, repose sur la prise en charge dʼune tâche ménagère (le fait de préparer le repas) qui sera finalement traitée par un prestataire externe rémunéré. Ce nʼest donc pas que lʼassignation en cuisine est une question obsolète, mais que cette question est résolue, sans doute régulièrement, peut-être quotidiennement, par une somme de microgestes parfois contradictoires : E. Chang, en recevant dans son salon des femmes pour discuter de lʼéthique de la Silicon Valley, se retrouve à en faire fonctionner lʼéconomie et les logiques inégalitaires.
Jʼentreprends ici une enquête visant à établir comment la cuisine a pu être une prison pour les femmes au cours des siècles, afin de savoir si elle peut devenir un espace politique de lutte et dʼautonomie pour les personnes minorisées, au-delà de la seule oppression de genre. Mais plutôt que dʼexaminer les formes de lʼassignation féminine au logis et leur histoire (ce que je ferai néanmoins, en temps voulu), et particulièrement en cuisine, je propose un chemin à rebours, un fast forward nous permettant de visualiser le paysage très contemporain de la cuisine et de ses usages. Sʼil est aujourdʼhui largement admis quʼune femme puisse faire carrière, cette observation semble entraîner avec elle une somme dʼeffets à priori liés, dont une libération réussie des chaînes de la vie domestique. Je vais donc tâcher de montrer comment des cuisines apparemment «  neutres  » ou «  neutralisées  » sur le plan des habitus de genre contiennent en réalité encore de puissants stigmates qui, sʼils ne condamnent pas les femmes à la confection de tartes et au lavage des sols, les poursuivent et requalifient les rapports de pouvoir entre individus -— y compris lorsquʼelles dégainent leur smartphone pour nourrir leurs convives.
La cuisine que jʼaborde peut sembler bien vide, à trois égards au moins. Premièrement, elle a perdu son appendice humain, la femme au foyer, qui lui était attaché, et selon un récit féministe quelque peu simplifié, se serait émancipée pour vivre une vie de salariée, de working girl. Deuxièmement, lʼévolution des manières dʼhabiter, ainsi que le coà »t croissant du logement, ont rendu lʼexistence dʼune cuisine séparée, dans laquelle il est possible de manger, rare et souvent non souhaitable. Lʼhabitat occidental semble ainsi, depuis les années 1950, avoir favorisé une cuisine ouverte, dite «  à lʼaméricaine  », et dont les fonctions se sont resserrées dans des équipements intégrés dans un mobilier standardisé, unifié, permettant de rationaliser lʼespace. Cette évolution, qui sera explicitée plus loin, amène le désencombrement de lʼespace et incite à «  cacher  » les équipements dans un mobilier-façade à lʼapparence visuelle lisse. Cet aspect peut mener à considérer la cuisine comme «  une pièce de stockage  » (Kaufmann 2015[2005], 119). Enfin, sur le plan des esthétiques et même plus exactement du style, il semblerait que le design dʼintérieur contemporain soit actuellement marqué par une tendance au minimalisme. La médiatisation croissante des gourous du rangement, dont la célèbre Marie Kondo, a renforcé cet effet de vidage visuel de la cuisine. Pour ces trois raisons, il est donc facile dʼavoir lʼimpression quʼil «  nʼy a rien à voir  » en cuisine, peut-être parce quʼil ne sʼy passe plus grand-chose, dès lors que les repas sont pris en charge par un service de livraison externalisé. Ce chapitre se confronte à ce vide apparent et vise à montrer que cette désertion de surface (le mot est important) sʼaccompagne dʼune saturation de significations nouvelles, dʼusages réinventés et dʼimaginaires contradictoires. Jʼen ferai lʼanalyse en cinq étapes.
Tout dʼabord, il nous faudra prendre acte de ce vide, et peut-être le contempler. Des «  poissons carrés  » Findus promettant la fin du travail en cuisine, à des fours qui servent de simples placards, il semble que la cuisine devient, depuis la fin du XXe siècle, une pièce symbolique certes encore associée aux repas, mais dans laquelle il nʼy a pas de cuisine -— au sens de lʼactivité culinaire. Jʼessaierai donc de saisir les raisons et implications de cet abandon, pour me centrer sur la question des applications de livraison du XXIe siècle, et de la manière dont ces services, pourtant soi-disant «  dématérialisés  » contiennent en germe une révolution de lʼhabitat. Deuxièmement, en me concentrant dʼabord sur le contexte contemporain, je mʼintéresserai au rôle du numérique et de ses incarnations technologiques hétérogènes dans la cuisine. Trop souvent compris sur la base de la binarité réel/virtuel, «  le  » numérique apparaît souvent en fin de démonstration dans les ouvrages qui ne sʼy intéressent que de biais. Ce choix dʼorganisation renforce les démonstrations progressistes, qui font du numérique un champ cohérent et unifié, une évolution inévitable et souhaitable, vecteur de nouveauté et de changement. Inclure dès le début de ce chapitre la dimension numérique est une de mes stratégies pour éviter cet écueil. Je montrerai ainsi que la cuisine vidée est aussi une cuisine media, cʼest-à -dire riche de ses représentations médiatiques et traversée dʼimages médiatiques renouvelées (depuis dix ans au moins), mais aussi de plus en plus habillée, améliorée, produite par des dispositifs numériques, et notamment des dispositifs numériques médiatiques.
Ce passage par des cuisines hybrides, telle la cuisine de Top Chef, me donnera lʼoccasion dʼévoquer les cuisines professionnelles. Bien que celles-ci ne soient pas lʼobjet premier de mon étude, il est indispensable de montrer comment la cuisine gastronomique, est elle aussi traversée de rapports de pouvoir, nʼest pas sans relation avec la cuisine privée. Je montrerai que ces cuisines sont encore largement marquées par la domination masculine, et je regarderai alors comment la cuisine se designe quand elle est masculine. Lʼavant-dernière partie sʼintéressera au motif de la réactivation de la cuisine. Ni célébrée, ni rejetée, la cuisine reste pertinente à condition de se relier à une économie qui lui est externe. Il sʼagit en quelque sorte du paradigme de la négociation : la cuisine doit être repensée, sortir des usages traditionnels pour être acceptable. Dans ce contexte, entrepreneuses, mommy bloggers et influenceuses capitalisent sur les ressources en cuisine. Jʼexaminerai également un autre possible réinvestissement de lʼespace de la cuisine, en mʼintéressant aux pratiques culinaires dans le contexte de la pandémie du305 COVID, en tâchant dʼévaluer les implications dʼun tel retour aux fourneaux -— qui semble bel et bien un retour en arrière.
Enfin, je montrerai quʼune négociation possible avec cet espace chargé de significations et dʼinjonctions consiste peut-être à désindividualiser ses usages. Plutôt que de laisser la forme collective de la cuisine aux brigades des restaurants et dʼhôtellerie, jʼanalyserai des exemples de cuisines communes en architecture, avant de mʼintéresser aux cuisines communautaires, parfois éphémères, locales, articulées à des mouvements politiques et en prise avec les questionnements féministes que jʼévoque depuis le début de cet essai.
La vie en cuisine en Occident semble être marquée par un mouvement dʼaller-retour, entre des époques où elle a été occupée pour vivre, et dʼautres où elle a été écartée des pièces principales du logis, rendue à une simple fonction pratique et nécessaire. Siegfried Giedion lʼévoque dans son étude de la mécanisation à travers les siècles (1948), lorsquʼil évoque le moment où, au XVe siècle, la cuisine devient une pièce à part entière alors quʼémerge une conscience bourgeoise (1948, 527). Si les bourgeois dînent ou même dorment encore dans leur cuisine, de fait, jusquʼau XVIIe siècle, cʼest à cette époque que la cuisine est consacrée comme pièce dʼutilité où lʼon ne vit plus, bien que lʼon subsiste grâce à elle. Après un temps fort au XXe siècle où la cuisine sʼéquipe et se mécanise, il semblerait aujourdʼhui que la cuisine ne soit plus un lieu de vie à part entière. En témoigne peut-être la représentation de cette pièce par le système de signes des emojis qui rythme une grande partie des échanges textuels numériques. Si la chambre et la salle de bain sont représentées par des signes renvoyant à leurs équipements (ðŸ›ï¸â€¯/  🛀), il nʼen existe pas dʼéquivalent pour la cuisine. Lorsque la cuisine est représentée, cʼest par lʼintermédiaire des très nombreux emojis évoquant fruits, légumes, plats et desserts. En somme, la cuisine existerait dʼabord dans nos imaginaires par ses productions plutôt que comme un véritable lieu à habiter. Si la cuisine semble ainsi désertée, cʼest peut-être bien quʼelle a symbolisé la vie domestique en son entier, et que la quitter a constitué un enjeu politique réel, parfois recoupé par des intérêts marchands, comme je vais lʼétudier à présent.
La série américaine Sex and the City a marqué lʼhistoire de la télévision en représentant le quotidien de femmes célibataires, employées, urbaines et blanches à Manhattan. La série débute avec la décision concertée des personnages principaux, quatre amies (Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda), dʼarrêter la recherche du prince charmant pour vivre pleinement leur liberté sexuelle. Si le contenu vise très clairement un public féminin, il est intéressant de constater que lʼimplication domestique des personnages est quasi nulle : les fameux brunches du dimanche qui les réunissent et sont prétextes à discuter de leurs vies sentimentales se déroulent au restaurant, comme la plupart des moments de repas capturés à lʼécran. Ce renoncement à lʼespace de la cuisine est même clairement annoncé par Carrie Bradshaw dans la troisième saison. Alors que ses amies lisent la rubrique «  mariages  » du journal et évoquent la domestication des femmes autour dʼelles par cette institution sociale, Miranda lui demande si elle possède un rouleau à pâtisserie. Pour souligner à quel point cet univers lui est étranger, Carrie répond quʼelle «  utilise son four comme un rangement  »306, signe dʼune cuisine éteinte, abandonnée, dans laquelle rien ne se prépare. Dʼautres représentations dessinent cette cuisine oubliée de la fin du XXe siècle. Dans la série House of Cards (2013–2018), la conseillère en relations publiques LeAnn Harvey (Neve Campbell) est dépeinte comme la meilleure professionnelle de son secteur. Une seule scène la montre dans sa cuisine, dans laquelle aucune nourriture ou trace dʼusage nʼest visible. Le plan de travail immaculé servira à une scène de sexe sans aucun enjeu sentimental (fig. 2.1), plutôt destinée à évacuer la violence latente qui existe entre elle et son collègue Doug.

Ailleurs, dans le film Goosebumps (2015), ce commentaire du personnage de la mère de famille accompagne la visite dʼune maison, alors quʼelle découvre une cuisine aux dimensions généreuses, y compris pour les standards américains : «  regarde tout cet espace de plan de travail pour la nourriture à emporter !  »307. La décorrélation entre le design de lʼespace et son usage concret est ici un ressort comique, mais elle peut aussi être interprétée comme un signe de lʼépoque. La cuisine, en Occident, serait devenue un espace de spectacle dont lʼéchelle rivalise avec celle des espaces professionnels, uniquement pour faire imaginer des pratiques qui seront en fait sous-traitées à lʼextérieur du logis.
Ces différents contenus culturels semblent prendre acte dʼune désertion féminine de la cuisine, parfois revendiquée, puisque la nourriture nʼest plus le résultat dʼun acte de préparation mais de commande. Cet abandon de lʼespace cuisine et des tâches qui lui sont associées ne devrait peut-être pas nous surprendre : après tout, lʼémancipation vis-à -vis de la sphère domestique est une des revendications historiques du féminisme, principalement de la seconde vague, mais aussi dans les formulations culturelles populaires des époques ultérieures. Le mouvement féministe américain de la seconde vague sʼest en effet nourri des écrits de la journaliste Betty Friedan. Son bestseller, The Feminine Mystique (plutôt mal traduit en français par La femme mystifiée) paraît en 1963 aux États-Unis—mais Friedan avait déjà diffusé ses idées dans des articles et revues. Dans son ouvrage, lʼautrice part à la recherche des causes du «  problème qui nʼa pas de nom  »308 (1963, 11), soit lʼindéfinissable malaise partagé, à leur insu, par de nombreuses femmes américaines ayant fait des études, puis ayant arrêté de travailler pour se consacrer à leur mari et à leurs enfants. Nous serons bien sà »r amené·es à croiser cette étude plusieurs fois dans ces pages. Je lʼévoque ici pour prendre acte de ses conclusions : enfermées dans un idéal lénifiant, les femmes américaines dʼaprès-guerre ont été découragées de suivre leurs ambitions professionnelles, dit Friedan. Et si elles ont été si nombreuses à se détourner dʼétudes pourtant entamées, cʼest bien quʼil existe une puissante image, cette «  mystique de la féminité  » dont la séduction et lʼapparente inévitabilité freinent la quête identitaire des femmes. Tandis que les hommes sont invités à poursuivre cette quête de soi, les femmes sont censées trouver le sens de leur existence dans la reproduction et le soin apporté aux enfants, ainsi quʼau mari. Il ne fait aucun doute, selon B. Friedan, que les femmes doivent être encouragées à poursuivre des carrières professionnelles en dehors du logis. La journaliste nʼa pas de mots assez durs pour décrire lʼinanité des tâches domestiques, sans doute à la mesure des représentations idéalisées de son époque, qui lui font écrire, se mettant à la place dʼune housewife éplorée (dont elle avait dʼailleurs lʼexpérience) : «  Quel genre de femme était-elle donc, si elle ne ressentait pas la satisfaction mystérieuse apportée par le cirage du sol de la cuisine ?  »309 (Friedan 1963, 14). Plus tôt, elle brosse à larges traits le contenu de cette mystique féminine :
Des millions de femmes vivaient leurs vies à lʼimage de ces jolies illustrations de la housewife suburbaine américaine, embrassant leurs maris devant la baie vitrée, déposant des voitures entières dʼenfants à lʼécole, et souriant en passant leur nouvelle cireuse sur le sol immaculé de la cuisine. Elles faisaient leur propre pain, cousaient leurs vêtements et ceux de leurs enfants, faisaient tourner leurs nouvelles machines à laver et séchoirs toute la journée. Elles changeaient les draps des lits deux fois par semaine plutôt quʼune, et suivaient le cours pour adultes de broderie de tapis, et avaient pitié de leurs pauvres mères frustrées, qui avaient rêvé dʼavoir une carrière. Leur seul rêve était dʼêtre de parfaites épouses et mères ; leur plus grande ambition dʼavoir cinq enfants et une belle maison, leur seule bataille consistant à obtenir et garder leurs maris (14)310.
Pas étonnant, dans ces conditions, que la libération repose avant tout sur une séparation radicale dʼavec lʼimage de la parfaite épouse, et de tout lʼenvironnement de tâches qui lui est associé. Si lʼavortement et lʼautonomie sexuelle ont été des sujets majeurs de ce mouvement de la seconde vague, lʼaccès égalitaire au monde du travail reste un enjeu fort des luttes féministes, dont jʼavancerai plus tard quʼil joue peut-être le rôle dʼun écran de fumée. Les écrits de B. Friedan, nous lʼavons vu en introduction, ont largement été critiqués depuis leur parution dans les années 1960 ; cependant, lʼa priori selon lequel un investissement massif de la sphère du travail salarié par les femmes constitue un vecteur de libération est finalement peu remis en question.
Dans Le Deuxième âge de lʼémancipation (2007), les sociologues Dominique Méda et Hélène Périvier reviennent sur lʼaccès des femmes au salariat en France, et dressent un portrait en demi-teinte de cette intégration. Leur ouvrage ouvre de nombreuses pistes pour résoudre les problèmes rencontrés par les Françaises au XXIe siècle, parmi lesquels le mi-temps subi, les carrières raccourcies et la précarisation de lʼemploi du temps (12–13). Lʼouvrage envisage des solutions habituellement considérées comme progressistes, telle une participation accrue des hommes aux tâches domestiques. Cependant, le regard sur ce travail domestique, lorsquʼil concerne les femmes, semble sans appel. Elles écrivent :
en participant massivement au marché du travail, les femmes ont montré leur refus de cette spécialisation et leur désir de ne pas rester enfermées dans la sphère domestique (2007, 28).
La domesticité serait donc synonyme dʼenfermement : Cindy Lauper ne montre pas autre chose au début des années 1980 dans le clip de son célèbre «  Girls Wanna Have Fun  » (1983[1979]) (fig. 2.2.a). Tandis que sa mère casse tristement, à la chaîne, des Å“ufs dans un bol, Cindy rentre au petit jour et se dispute avec elle en renversant au passage une boîte de corn flakes.

Puis, elle malmène physiquement son père qui lui demande quels sont ses projets pour lʼavenir. Le clip se termine sur un désordre festif, Cindy ayant convié des inconnus à danser dans sa chambre, qui ne parvient même pas à contenir la liesse de la foule. In fine, les fêtards débordent dans la cuisine, tandis que le père de famille admoneste son épouse, sans doute tenue responsable du dévoiement de sa fille fig. 2.2.b). Cette révolte punk semble néanmoins se dérouler dans le cadre dʼune société capitaliste reposant sur le travail salarié ; cʼest du moins ce que suggère la strophe «  [w]hen the working day is done  » («  quand la journée de travail est finie  ») répétée dans la chanson. Le clip semble clairement suggérer que ce travail sʼeffectue à lʼextérieur, et nʼimplique pas de tâches domestiques.

Il est donc intéressant de constater comment, dʼun propos revendiquant lʼintégration des femmes sur le marché du travail, la culture populaire a tiré un lien de causalité entre travail salarié et libération féminine. Lʼidée semble si habituelle, voire inoffensive, que des contenus de culture pop traditionnellement assez misogynes sʼemparent du motif. Dans lʼalbum La rose et le glaive de la série Astérix et Obélix311 (1991), les femmes, habituellement réduites à leur rôle décoratif dʼépouses, vivent une prise de conscience féministe (fig. 2.3). La révolte sera de courte durée, mais les quelques représentations dans lʼalbum témoignent de la manière dont lʼémancipation féminine et le refus de la tâche domestique (prélude à lʼentrée sur le marché du travail) sont irrémédiablement liés. Ces récits déplient, en quelque sorte, lʼimage bien connue de la campagne «  Moulinex libère la femme  » (fig. 2.4), dans laquelle une femme jette son tablier et, semble-t-il, avec lui, les chaînes de la vie au foyer.
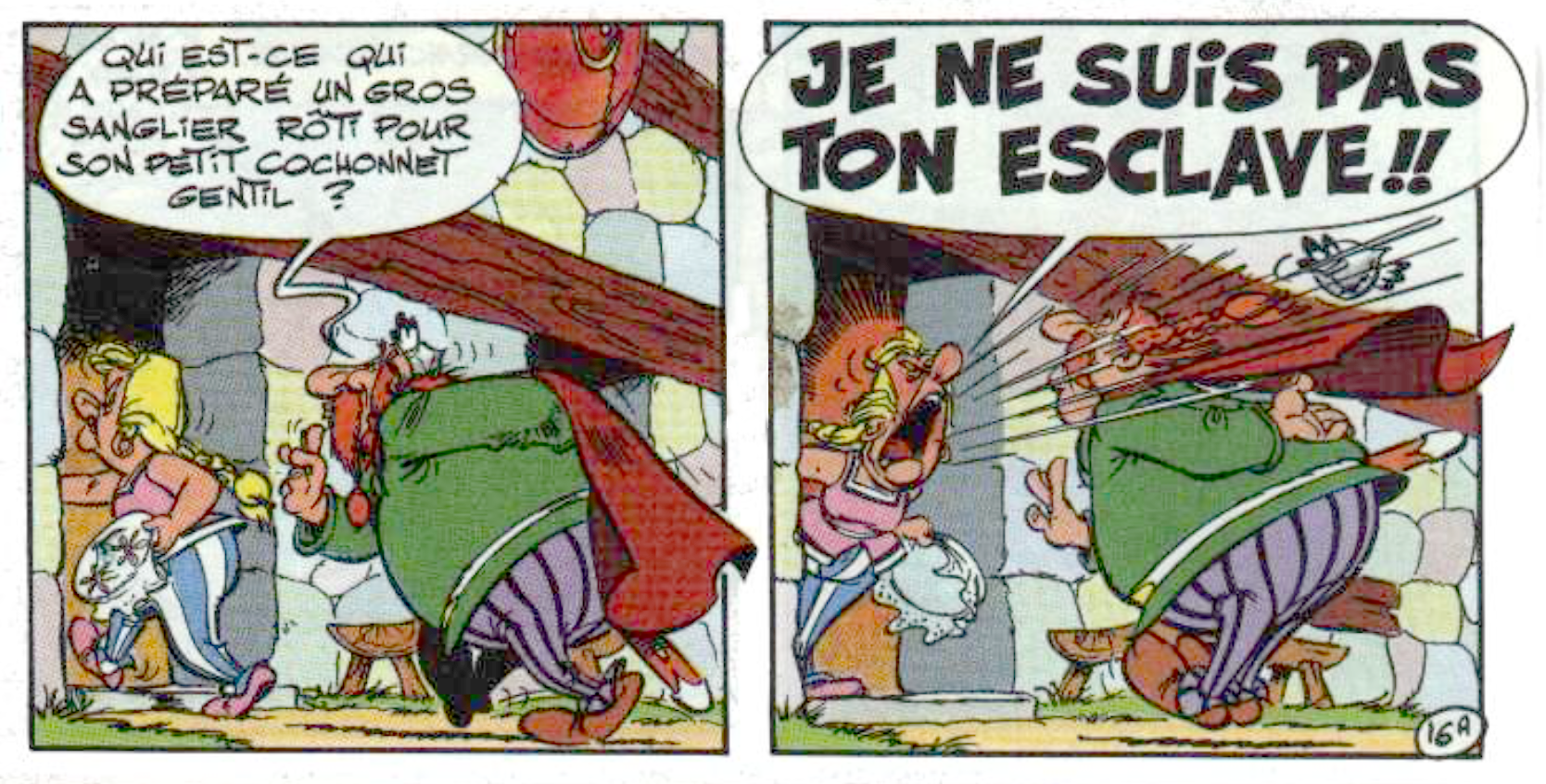
 fig. 2.4 : « Moulinex libère la femme  » associe paradoxalement le fait de quitter la cuisine à une libération, par le geste célèbre de son égérie qui jette son tablier (1962).
À en croire ces représentations, les femmes seraient enchaînées en cuisine, libérées dans lʼespace du travail (souvent indéfini, dʼailleurs). Une telle binarité doit nous inviter à la plus grande prudence, et ici un prisme dʼanalyse queer peut nous aider à dépasser ce jeu dʼoppositions strictes. Suffit-il de sortir de la cuisine pour sʼémanciper ? La cuisine apparemment vidée du XXIe siècle est-elle le signe dʼune libération achevée et réussie ? Si je développerai plus avant la question de la tâche domestique, de ses natures et implications, je peux dʼores et déjà nuancer ce tableau funeste pour la cuisine et lʼespace domestique, qui seraient condamnés à être évacués afin dʼaccomplir le programme de libération féministe. Dominique Méda et Hélène Périvier montrent bien que la place chèrement acquise des femmes dans le monde du travail ne les a pas libérées des tâches domestiques. De nombreuses et récurrentes études montrent dʼailleurs quʼen dépit de leur inscription sur le marché de lʼemploi, ce sont encore les femmes qui assurent la majorité du travail domestique, de la cuisine, et du soin apporté aux enfants en France (Méda & Périvier 2007, 19 ; Singly 2007, 42) comme aux États-Unis (De Vault 1991 ; Szabo 2013). Autrement dit, le prérequis qui consisterait à jeter son tablier pour chausser ses escarpins de working girl tient dʼune image dʼÉpinal quʼil faudrait plutôt redessiner comme suit : le soir venu, la travailleuse rentre chez elle, et retrouve le tablier quʼelle a quitté le matin même.
fig. 2.4 : « Moulinex libère la femme  » associe paradoxalement le fait de quitter la cuisine à une libération, par le geste célèbre de son égérie qui jette son tablier (1962).
À en croire ces représentations, les femmes seraient enchaînées en cuisine, libérées dans lʼespace du travail (souvent indéfini, dʼailleurs). Une telle binarité doit nous inviter à la plus grande prudence, et ici un prisme dʼanalyse queer peut nous aider à dépasser ce jeu dʼoppositions strictes. Suffit-il de sortir de la cuisine pour sʼémanciper ? La cuisine apparemment vidée du XXIe siècle est-elle le signe dʼune libération achevée et réussie ? Si je développerai plus avant la question de la tâche domestique, de ses natures et implications, je peux dʼores et déjà nuancer ce tableau funeste pour la cuisine et lʼespace domestique, qui seraient condamnés à être évacués afin dʼaccomplir le programme de libération féministe. Dominique Méda et Hélène Périvier montrent bien que la place chèrement acquise des femmes dans le monde du travail ne les a pas libérées des tâches domestiques. De nombreuses et récurrentes études montrent dʼailleurs quʼen dépit de leur inscription sur le marché de lʼemploi, ce sont encore les femmes qui assurent la majorité du travail domestique, de la cuisine, et du soin apporté aux enfants en France (Méda & Périvier 2007, 19 ; Singly 2007, 42) comme aux États-Unis (De Vault 1991 ; Szabo 2013). Autrement dit, le prérequis qui consisterait à jeter son tablier pour chausser ses escarpins de working girl tient dʼune image dʼÉpinal quʼil faudrait plutôt redessiner comme suit : le soir venu, la travailleuse rentre chez elle, et retrouve le tablier quʼelle a quitté le matin même.
Les féministes afroféministes, pour qui lʼaccès au salariat comportait des enjeux de genre tout autant que de race, ont été moins promptes à condamner cet espace de la cuisine. bell hooks, dans sa critique du mouvement féministe de la seconde vague, observe que ce positionnement a sans doute ostracisé bon nombre de femmes qui auraient pourtant eu de nombreuses contributions à apporter. Elle rejette ainsi lʼidée quʼun espace soit synonyme dʼaliénation, lorsquʼelle écrit :
lʼaccent qui a été porté sur la création dʼune contre-culture a détourné bon nombre de femmes du mouvement féministe, puisque de tels espaces peuvent aussi se trouver dans les églises, les cuisines, etc. (2017[1984], 101).
Les études transféministes peuvent aussi, par ricochet, nous inciter à la plus grande prudence, lorsquʼil sʼagit de coder des lieux ou actions comme émancipatoires, ou non. Julia Serano montre comment le féminisme, en déconstruisant des représentations stéréotypées de la féminité (maquillage, tenue courte, etc.) se retrouve pris au piège dʼune logique duelle, et à produire un jugement misogyne sur certaines expressions de la féminité, que peuvent notamment adopter les femmes trans (2016[2007], 326–27). Dans le rejet de la cuisine, on retrouve quelque chose de cette dévaluation accidentelle du féminin : en voulant émanciper les femmes, on se retrouve à faire la peau à un lieu qui avait pourtant un potentiel, une valeur, et dans lequel de nombreuses femmes se sont construites et battues. Une telle analyse est aussi facilitée lorsque lʼaccent est mis sur la «  libération  », terme qui suggère que la lutte peut trouver un terme lorsque ses sujets se sont émancipés des logiques de pouvoir qui les opprimaient. La notion de libération implique une dimension temporelle en même temps que quantitative, dans la mesure où elle trace une trajectoire progressiste où les sujets sont de plus en plus libres. B. Friedan évoque dʼailleurs cette idée, lorsquʼelle parle des femmes au foyer qui méprisent leurs mères, trompées par lʼidéal de la carrière. La housewife regardant de haut sa mère travailleuse (chez Friedan) et la jeune féministe émancipée du logis (incarnée par Cindy Lauper dans le clip sus-cité) ont peut-être en commun ce même dédain de leurs aînées, basé sur la certitude quʼelles seraient moins libérées. Transcender ce motif du progrès dans lʼémancipation permettrait sans doute, à lʼincitation de bell hooks, de prendre acte des gestes, habitus et rôles possibles qui y existent, y compris dans des lieux qui semblent pétris de conformité aux vieux rôles et aux «  mystiques  ».
La cuisine vidée est donc potentiellement une cuisine quittée, dans le but, on le voit, partiellement réussi et sans doute illusoire, de «  se libérer  » du patriarcat. Mais lʼaccès au salariat des femmes ne suffit pas à expliquer le vide apparent des cuisines du XXIe siècle ; on a même vu que le travail féminin nʼinfluait quʼassez peu sur la part prépondérante quʼelles prennent dans la gestion des tâches domestiques. En revanche, ces tâches ont été largement redéfinies, selon des modalités qui peuvent justifier que la cuisine soit vidée, à défaut de sa housewife, des outils traditionnels dont celle-ci se servait au quotidien. Siegfried Giedion questionne déjà les conséquences de la mécanisation appliquée à la fabrication des repas en 1948, lorsquʼil se demande si le «  steak à la chaîne  » va «  triomphe[r]  »312 (1948, 606), ou si la fabrication des repas à la maison restera la norme. Si on peut aujourdʼhui affirmer quʼaucun des deux modèles nʼa complètement écrasé lʼautre, il apparaît que lʼindustrie agro-alimentaire distribue aujourdʼhui massivement des plats «  préparés  », probablement choisis pour le gain de temps et dʼénergie assuré par leur consommation, en plus de dispenser de la maîtrise de techniques culinaires. Les sociologues Faustine Régnier, Anne Lhuissier et Séverine Gojard observent que ces aliments préparés constituent, en 2009, 26% des dépenses alimentaires des ménages français, soit plus du double quʼen 1960 (2009, 7)313.
En termes de design, le recours à ces plats a pu orienter les dépenses dʼélectroménager, ou justifie parfois les équipements de certains appartements. On pourra ainsi opter plus volontiers pour un four à micro-ondes que pour un four traditionnel, tandis que les studettes louées aux étudiant·es sont souvent équipées, par défaut, de plaques chauffantes, et rarement de fours ou autres appareils de cuisson. Cette cuisine incarnée de manière emblématique par quelques plats («  poisson carré  », plats «  Findus  », couscous Garbit et autres plats en boîtes et barquettes) est néanmoins plus souvent associée à des habitudes de célibataires quʼà la cuisine familiale prise en charge par les femmes. Le fait que les deux parents dʼune famille soient employés (à plein temps ou non) ne signifie pas pour autant que le statut de la commensalité soit totalement dévalué. Même lʼusage récurrent de plats préparés ne permet pas dʼeffectuer ce diagnostic. En effet, le marketing agroalimentaire, depuis le début du XXIe siècle a réorienté son offre de plats «  tout faits  » en sʼappuyant sur le principe de la finishing touch, en français «  touche finale  ». De nombreux produits ne jouent pas sur une disparition totale de la préparation culinaire, mais sur lʼécrasement du temps de préparation, tout en laissant à lʼusager·e une petite marge de manÅ“uvre ou de créativité qui peut lui donner la sensation dʼavoir apporté sa touche personnelle— cʼest le cas des mélanges pour gâteau à cuire chez soi, par exemple (fig. 2.5) fig. 2.5 : Le packaging de ce gâteau Herta, nommé « à ma façon  », évoque le fait-maison mais participe bien dʼune finishing touch : en fait de cuisine, il faut verser le mélange dans un moule et le passer au four.. Lʼopposition entre la cuisine en boîte et la cuisine maison doit donc être nuancée par la manière dont lʼindustrie prend acte, au travers de son offre, de lʼhybridité qui existe de fait entre ces différentes pratiques. Le trope futuriste (souvent croisé dans la science-fiction, moqué depuis) de la nourriture en pilule ne sʼest pas réalisé314, mais la nourriture préparée doit néanmoins être prise en compte dans les usages des cuisines et dans lʼaménagement de cet espace. Le recours à la nourriture industrielle, plutôt que dʼavoir libéré des travailleuses nouvellement arrivées sur le marché du travail, a peut-être plutôt encouragé les hommes à renoncer à la nourriture faite maison, du moins jusquʼà ce que la conjugalité leur permette de compter sur leur épouse pour se nourrir. Ce serait le sens de la figure de «  lʼhomme-pizza  » identifié par François de Singly (2007, 71) : recourir à des plats préparés pendant la période de célibat permet dʼasseoir son incompétence et de ne pas sʼinvestir en cuisine, conformément au marquage genré qui caractérise cet espace.
fig. 2.5 : Le packaging de ce gâteau Herta, nommé « à ma façon  », évoque le fait-maison mais participe bien dʼune finishing touch : en fait de cuisine, il faut verser le mélange dans un moule et le passer au four.. Lʼopposition entre la cuisine en boîte et la cuisine maison doit donc être nuancée par la manière dont lʼindustrie prend acte, au travers de son offre, de lʼhybridité qui existe de fait entre ces différentes pratiques. Le trope futuriste (souvent croisé dans la science-fiction, moqué depuis) de la nourriture en pilule ne sʼest pas réalisé314, mais la nourriture préparée doit néanmoins être prise en compte dans les usages des cuisines et dans lʼaménagement de cet espace. Le recours à la nourriture industrielle, plutôt que dʼavoir libéré des travailleuses nouvellement arrivées sur le marché du travail, a peut-être plutôt encouragé les hommes à renoncer à la nourriture faite maison, du moins jusquʼà ce que la conjugalité leur permette de compter sur leur épouse pour se nourrir. Ce serait le sens de la figure de «  lʼhomme-pizza  » identifié par François de Singly (2007, 71) : recourir à des plats préparés pendant la période de célibat permet dʼasseoir son incompétence et de ne pas sʼinvestir en cuisine, conformément au marquage genré qui caractérise cet espace.
Parallèlement, lʼinvestissement traditionnel des femmes en cuisine sʼest coloré de nouvelles valeurs et intérêts. Certains sociologues de lʼalimentation constatent ainsi que la prise en charge des tâches culinaires constitue un moyen supplémentaire pour les femmes de contrôler les aliments, leur capital santé (DeVault 1994 ; Singly, 2007, 186) et leur prise alimentaire, en concordance avec lʼidéal de la minceur, central dans les canons de beauté occidentale (cf. infra., chap. IV). Plutôt quʼune désertion calculée et accomplie de la cuisine, cʼest donc une dynamique complexe dʼattraction-répulsion qui structure le rapport des femmes à la cuisine, souvent sur la base des usages des autres personnes du foyer, comme leurs compagnons, dont la démission ou lʼinvestissement nouveau va redéfinir les contours de leur propre travail en cuisine, ou recoder, en termes de genre, lʼespace domestique traditionnellement féminin.
La cuisine nʼest donc pas vide parce quʼelle a été quittée ; les femmes sont plutôt en tiraillement avec cet espace quʼen situation de rupture. Lʼimpression de vide, dès lors, tient peut-être au langage plastique dominant actuellement de ces espaces et au goà »t croissant pour des styles dits «  épurés  » ou «  minimalistes  ». Les gourous du rangement (Marie Kondo) et les défenseurs dʼune vie «  minimaliste  » (comme Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus) ont largement participé à la popularité dʼespaces dépouillés, relevant presque dʼun ascétisme shaker315 (Pandelakis 2018). La cuisine Lepic, designée en 2016 par Jasper Morrison (fig. 2.6.a) est emblématique des goà »ts de son époque et conserve en 2024 une forme dʼactualité. Cet espace se compose de placards intégrés, comme cela est la norme depuis les années 1950, et dʼun îlot central, qui permet de rationaliser lʼespace perdu par une table en proposant des rangements sous le plan de travail qui peut également servir à la prise des repas. Lʼîlot central est un dispositif hybride, démocratisé depuis les années 1970316, qui mixe la maximisation de lʼespace de rangement, la typologie du bar et les nouveaux modes de prises alimentaires, plutôt debout quʼassis.

La cuisine de J. Morrison fait donc usage dʼun élément rationnel sur le plan de lʼespace (lʼîlot) mais se présente comme très vaste, possiblement en connexion à un séjour. Cette impression est renforcée par lʼusage dʼun parquet, plutôt que dʼun linoléum ou dʼun carrelage, surfaces habituellement associées à la cuisine pour leur facilité dʼentretien. Ici, comme mes études de cas ultérieurs, je nʼanalyse pas seulement ici la proposition de design dʼintérieur, mais sa mise en scène au travers des images de communication, qui sont à mon sens partie prenante des scripts dʼusage qui marquent cette cuisine.
Plusieurs aspects frappent immédiatement en regardant ces photographies. Premièrement, elles semblent vides car elles nʼincluent pas dʼusager·e—ce qui permet pourtant, habituellement, dʼavoir une idée des échelles et des espaces de circulation. Aucun appareil électrique nʼest mis en valeur dans cette présentation, dès lors vierge de machine à café, mixeur, ou autre robot ménager. Seul un téléphone sans fil et un aspirateur contredisent éventuellement cette observation : mais le téléphone nʼest pas relié sur secteur, et lʼaspirateur-balai streamline correspond à une typologie dʼobjet ancien, son dessin et sa structure sʼapparentant au langage formel des années 1930 (fig. 2.6.c). Les quelques objets qui constellent la cuisine relèvent de typologies et de langages formels datés : des marmites en fonte, un casse-noix à vis, des brosses et goupillons évoquent le XIXe siècle, ou même des périodes antérieures ; par ailleurs, des bouteilles de mirin, de saké (fig. 2.6.d) et une poêle à takoyaki317 (fig. 2.6.b) renvoient aux traditions culinaires japonaises. fig. 2.6.b Cette cuisine repose donc sur une épuration visuelle : continuité du plan de travail, monochromie des surfaces et contraste maximal entre les matériaux constituent une scène aussi discrète que possible à quelques objets à la curation soignée, qui renvoient à deux «  ailleurs  » : lʼun, géographique, du Japon (dont lʼhéritage formel se lit dans de nombreuses propositions dites «  minimalistes  » du design contemporain), lʼautre temporel, dʼun XIXe siècle attaché aux objets de métier et aux outils manuels. Lʼélectrification est discrétisée en de nombreux points : aucune prise électrique nʼest visible, et les seuls objets électriques sont déconnectés (le téléphone) ou voient leurs fils soigneusement rangés (lʼaspirateur). Les feux de cuisson sont alimentés au gaz, et les suspensions, aussi blanches que les murs, ne sont pas visiblement allumées. Seule la grande hotte qui surplombe la zone de cuisson constitue éventuellement un objet électrique ostentatoire : mais son abstraction, toute géométrique, est telle quʼelle laisse aisément oublier sa fonction première pour rejoindre le jeu de plans, opaques et sans relief, fabriqué par les différentes surfaces. La manière, enfin, dont les objets sont posés dans les quelques placards ouverts, témoigne dʼune curation précise. Cette esthétique muséale consistant à laisser paraître quelques objets choisis, plutôt exposés quʼutilisés, constitue également un choix esthétique récurrent des cuisines du début du XXIe siècle (Contois, 2014).
fig. 2.6.b Cette cuisine repose donc sur une épuration visuelle : continuité du plan de travail, monochromie des surfaces et contraste maximal entre les matériaux constituent une scène aussi discrète que possible à quelques objets à la curation soignée, qui renvoient à deux «  ailleurs  » : lʼun, géographique, du Japon (dont lʼhéritage formel se lit dans de nombreuses propositions dites «  minimalistes  » du design contemporain), lʼautre temporel, dʼun XIXe siècle attaché aux objets de métier et aux outils manuels. Lʼélectrification est discrétisée en de nombreux points : aucune prise électrique nʼest visible, et les seuls objets électriques sont déconnectés (le téléphone) ou voient leurs fils soigneusement rangés (lʼaspirateur). Les feux de cuisson sont alimentés au gaz, et les suspensions, aussi blanches que les murs, ne sont pas visiblement allumées. Seule la grande hotte qui surplombe la zone de cuisson constitue éventuellement un objet électrique ostentatoire : mais son abstraction, toute géométrique, est telle quʼelle laisse aisément oublier sa fonction première pour rejoindre le jeu de plans, opaques et sans relief, fabriqué par les différentes surfaces. La manière, enfin, dont les objets sont posés dans les quelques placards ouverts, témoigne dʼune curation précise. Cette esthétique muséale consistant à laisser paraître quelques objets choisis, plutôt exposés quʼutilisés, constitue également un choix esthétique récurrent des cuisines du début du XXIe siècle (Contois, 2014).


Il est vrai que ces images ne disent rien de la manière dont pourrait être utilisée cette cuisine. Sans aucun doute pourrait-on y faire de grandes fritures et y nourrir de nombreuses personnes : mais le langage visuel qui préside à la présentation de cet aménagement est plutôt évocateur des aspirations de classe liées à la cuisine. Par ailleurs, Lepic ne dénote pas dans le paysage contemporain des cuisines. Mon propos est ici nécessairement généraliste, et ne peut faire la part totale des exceptions qui existent à cet idéal abstrait-évidé de lʼespace cuisine. Il convient toutefois dʼobserver que ce langage formel, ainsi que les choix dʼorganisation de lʼespace, correspondent à un paradigme dominant depuis le début des années 2010. Fin 2020, la revue de design Dezeen propose un panel de trente cuisines designées par des architectes («  Thirty kitchens designed by architects  »), dont le contenu iconographique est tout à fait significatif.
Sur les quelque trente cuisines présentes, seules trois images incluent une présence humaine. La plupart des cuisines, par ailleurs, épousent cette esthétique minimale : la vaisselle et les potentiels robots sont cachés dans des placards unis, lisses ; le plan de travail présente une surface continue, en contraste. Dans la Slab House à Londres (agence Bureau de Change, fig. 2.7.b) ou dans les Olives Houses à Majorque (agence Mar Plus Ask, fig. 2.7.a), ce «  minimalisme  » confine à lʼascétisme radical : seul lʼîlot central, volume coupant, crée une présence dans une pièce presque vide, dʼoù ont même disparu la traditionnelle coupe de fruits ou encore la marmite en fonte nostalgique. Certes, dʼautres cuisines présentent des environnements plus vivants, ne serait-ce que par la présence accrue dʼobjets et dʼaliments : mais les exemples les plus fantaisistes sont proches visuellement de la Lepic, déjà bien «  épurée  ». Les quelques photographies intégrant des personnages méritent également que lʼon sʼy attarde. Sur les trois exemples incluant une présence humaine, deux incluent des femmes, lʼune blanche, lʼautre racisée, qui sʼoccupe dʼun enfant (fig. 2.7.e). La dernière photographie, la seule à inclure un homme, est marquée par un choix intéressant : tandis que la cuisine y apparaît en haute définition, lʼhomme y est complètement flou, capturé au cÅ“ur dʼun mouvement rapide, comme si la présence masculine, déjà bien rare, ne pouvait être que temporaire (fig. 2.7.d).



Seul cet homme «  de passage  » en cuisine amène une notion de temps : les autres clichés sont marqués par leur atemporalité. La photographie de cuisine, parce quʼelle implique des aliments (dont lʼiconique coupe de fruits), croise parfois des registres iconographiques plus anciens, comme celui du genre pictural de la vanité qui offre une contemplation de lʼentropie propre à toute chose. Il est vrai que lʼaction de cuisiner, en tant quʼelle est liée au besoin premier de se nourrir, nous relie à la survie et donc, symboliquement, à cette mortalité fondamentale. Débarrassées dʼune potentielle orange ou pomme mortifère, les cuisines ascètes de 2020 évoquent à lʼopposé des espaces inhabités, inhabitables peut-être, quoique associés majoritairement aux femmes, et hors du temps du changement et de la vie ordinaire -— ce qui, indépendamment de lʼallure contemporaine de lʼacier brossé et du terrazzo, est somme toute assez conservateur.

Un tel paysage du design dʼintérieur de la cuisine contemporaine est peu réjouissant. Il vient créer un contrepoint à la cuisine traditionnelle, bardée dʼéquipements électriques, écrin de la housewife, mais sur un mode déceptif, comme une autre impasse. La récurrence du modèle minimaliste possède peut-être quelque chose, dès lors, dʼune «  panne des imaginaires  » (Nova 2014). Lʼautrice et productrice Rose Eveleth pose cette question de la «  cuisine du futur  » dans un article de la revue Eater (2015). Les évolutions apportées à lʼaménagement de la cuisine sont en effet encore marquées par le vÅ“u moderniste du progrès. Après-guerre, les fabricants de cuisines, de maisons préfabriquées et les producteurs de matériaux ont participé à dʼimportantes campagnes médiatiques, en lien avec le système des grandes expositions. De lʼexposition universelle de Chicago en 1893 à lʼexposition House of Tomorrow montrée cinquante plus tard dans la même ville, en passant par le Salon des arts ménagers en France (1923–1983), lʼélectrification croissante des appareils ménagers, et la rationalisation de lʼespace cuisine ont été soutenus par un discours futuriste, nourri par la croyance dans le progrès, lui-même intrinsèquement lié à la technique.
Pourtant, R. Eveleth intitule son article «  Pourquoi la ‹ cuisine du futur › nous trahit toujours  »318. Elle explique que les vidéos promotionnelles dʼaprès-guerre qui dépeignent la maison du futur (produites par General Motors, Monsanto, Disney) nous semblent aujourdʼhui particulièrement sexistes et présentent par ailleurs des innovations qui peuvent nous sembler amusantes aujourdʼhui—telle cette cuisine intégralement en plastique, rêvée par Monsanto319. Cependant, lʼautrice analyse aussi des vidéos promotionnelles actuelles dʼIkea, Microsoft, Panasonic ou Corning, et observe que les présupposés et les écueils dans la représentation restent les mêmes : les scénarii présentent majoritairement des femmes, reposent sur le solutionnisme technologique320 et ne prennent jamais en compte la question du ménage, préférant illustrer des usages dont lʼintérêt véritable est douteux (visualiser les aliments de son réfrigérateur sur son téléphone, grâce à une caméra). R. Eveleth avance que les hommes sont encore surrepresentés dans le domaine du «  futurisme  » (par exemple, lʼassociation Association of Professional Futurists est composée aux deux tiers dʼhommes) et des technologies, ce qui est dʼailleurs confirmé par dʼautres autrices (Chang 2018, 140–41 ; 177–78). R. Eveleth pointe le fait que ces concepteurs approchent lʼhabitat hors de son contexte, sans prendre en compte les représentations culturelles, les tropes et les habitus qui organisent historiquement cet espace. Enfin, elle propose une troisième hypothèse dʼexplication en pointant le principe fallacieux de conception de la «  solution sans problème  », impasse méthodologique classique dans la discipline du design, à plus forte raison quand les ingénieur·es sont surreprésenté·es par rapport aux designers (Nova 2014 ; Masure 2017).
La domination masculine, la pensée hors-contexte et le solutionnisme technologique expliquent donc «  pourquoi nous ne pouvons toujours pas imaginer quelque chose de plus excitant quʼune femme faisant la cuisine seule  »321 (Eveleth 2015). Il semble que la cuisine est vouée à soit être habitée par la housewife, soit déserte et vide dʼhumains. Cependant, le propos de R. Eveleth nous met justement en garde contre lʼeffet de décontextualisation que produisent les représentations publicitaires de la cuisine. Si les images proposées par lʼarticle de Dezeen sont importantes, elles ne sont pas totalement représentatives de la réalité des usages -— bien quʼelles aient une part non négligeable dans la production de nos imaginaires. Les images de cuisines dépouillées sont paradoxales et polysémiques : elles peuvent évoquer une forme de libération féminine, tout en offrant un style plus «  masculin  » (dépouillé dʼexcès, dʼornements). Tout à la fois, la cuisine contemporaine repose encore sur des présupposés sexistes et des récits nostalgiques : en cessant dʼêtre habitée par la housewife, la cuisine nʼen serait pas plus habitable par les hommes. Avant dʼexaminer la manière dont les hommes ont investi la cuisine privée par goà »t et par nécessité ces trente dernières années, je me dois de faire un détour par une autre cuisine, qui a pu constituer un territoire masculin : la cuisine professionnelle et commerciale.
Aussi dépouillée quʼelle puisse paraître, la cuisine est tout à la fois célébrée, hyperprésente en ce début de millénaire. La chercheuse en études des media Emily Contois, dont jʼai précédemment évoqué les travaux, observe :
 Plus que jamais, la cuisine américaine  »322 est au centre de la scène. Avec un déluge de chaînes de télévision, dʼémissions télévisées, de magazines, de sites Web, les images de cuisines de rêve utilisées par des chefs célèbres, possédées par des célébrités, et achetées par des propriétaires ambitieux bombardent les spectateurices américaines 323 (2014).
La France nʼest pas en reste : depuis 2010, les principales chaînes de télévision ont été envahies par ces contenus culinaires, et plus spécifiquement par le paradigme du concours de talents. Les cuisines sont peut-être dépouillées dans les revues de design ; à la télévision, pour le grand public, ce sont des cuisines très habitées qui se déploient sous nos yeux. Sans espérer réaliser un panorama complet de ces contenus, je souhaite mʼattarder sur les propositions les plus marquantes qui appartiennent au genre de la télé-réalité.
Top Chef (2006 aux États-Unis, 2010 en France) et Master Chef (1995 et 2005 en Angleterre, 2010 et en France) sont deux émissions généralistes de concours de talents, la première dédiée aux professionnel·les et la seconde aux amateurices. Elles mettent en compétition des candidat·es dans des épreuves souvent minutées, caractérisées par un esprit de défi lié au caractère apparemment impossible des objectifs (faire manger des légumes aux enfants, cuisiner un repas gastronomique avec des épluchures, etc.), et un registre spectaculaire (dʼHuy 2011, 6 ; Jehel 2018, 16). Le maître mot est la concurrence, mais aussi, dans les versions françaises, la valorisation dʼun patrimoine national traditionnel et une forme de contemporanéité des pratiques (Béja 2014, 4). Ces séries sont aussi marquées par une forte autoréférentialité : dans la mesure où elles existent depuis une décennie ou plus, les épreuves peuvent mettre en jeu dʼancien·nes candidat·es et créer de nouveaux principes de concours (le système des équipes dans les saisons plus récentes de Top Chef, par exemple). Si Un dîner presque parfait (2008–14) déplace les modalités du concours dans les logis de candidat·es anonymes, la plupart des émissions sʼintéressent davantage à des concours de professionnel·les (Le meilleur pâtissier, La meilleure boulangerie de France), voire à des «  spin-offs  »324 de contenus existants (Objectif Top Chef, En route vers le meilleur pâtissier, Top Chef : Les grands duels, Le moins pire pâtissier). Cauchemar en cuisine, adapté dʼun modèle britannique (Ramsayʼs Kitchen Nightmares, présentée par le chef Gordon Ramsay) montre quant à lui le chef Philippe Etchebest sillonner les routes de France pour «  sauver  » des restaurants dont la survie économique est menacée. Dépassement de ses limites et réalisation de soi sont au cÅ“ur des scripts proposés325.


Ces contenus culinaires représentent un modèle différent de ce que Tasha Oren a nommé dans le contexte américain le modèle de la «  conversation au coin du four  » (2013, 15), suivi par Julia Child ou Martha Stewart. En France, la célèbre émission de Maïté (pseudonyme de Marie-Thérèse Ordonez) en est lʼéquivalent, et elle a constitué la forme durable des émissions culinaires jusquʼà ce que le paradigme du concours-challenge prenne le dessus. Le dispositif de La Cuisine des Mousquetaires (1983–1997) invitait les téléspectateurs -— codés comme téléspectatrices -—  dans la cuisine de Maïté. Le dispositif frontal faisait alors de lʼécran une porte sur une cuisine privée, intime, indépendamment du professionnalisme de Maïté (fig. 2.10). Aujourdʼhui, la caméra est plus mobile et le rôle du montage est accru. En cuisine, par exemple dans Top Chef, chaque candidat·e est positionné dans son espace, dans lequel le chef-coach sʼinvite pour dispenser remarques stressantes ou encouragements (Jehel 2018, 32), afin de faire monter la pression, dans un environnement qui se nourrit «  du suspens, des conflits, des humiliations et des échecs  » (Oren 2013, 18). fig. 2.10 : Maïté, dans La Cuisine des Mousquetaires (1983–1997), propose une cuisine familiale dans un dispositif frontal. Le cours a cédé la place au match, ce que Tasha Oren formule comme «  le passage du ‹ voici comment cuisiner ceci › à ‹ va-t-il parvenir à cuisiner cela ? ›  » (18). Aussi, la cuisine télévisée, en se positionnant du côté de la performance, tend à produire davantage une cuisine à regarder, plutôt quʼà manger (dʼHuy 2011, 6 ; Béja 2014, 14).
fig. 2.10 : Maïté, dans La Cuisine des Mousquetaires (1983–1997), propose une cuisine familiale dans un dispositif frontal. Le cours a cédé la place au match, ce que Tasha Oren formule comme «  le passage du ‹ voici comment cuisiner ceci › à ‹ va-t-il parvenir à cuisiner cela ? ›  » (18). Aussi, la cuisine télévisée, en se positionnant du côté de la performance, tend à produire davantage une cuisine à regarder, plutôt quʼà manger (dʼHuy 2011, 6 ; Béja 2014, 14).
Les cuisines qui servent au concours sont elles-mêmes hybrides : elles sont remplies des outils professionnels dont les chefs se servent pour faire la démonstration de leurs talents, mais procèdent aussi à du placement du produit, stratégie renforcée par les publicités qui introduisent et rythment le programme. Ces espaces associent étroitement la fascination pour un espace professionnel, en même temps quʼils jouent sur la familiarité de certains éléments. Lʼémission devient alors un lieu dʼéchanges et dʼhybridations : la cuisine domestique peut se rêver professionnelle en sʼoutillant comme à lʼécran, et les chefs vainqueurs se retrouvent parfois dans des cuisines de particulier·es pour y délivrer leurs secrets (Norbert et Jean : le défi, 2012). Lʼémission participe à la diffusion dʼun vocabulaire jusquʼici limité aux brigades («  snacker le poisson  », viser un «  équilibre acido-basique  », comme le repère Tasha Oren), mais joue aussi à troubler les habitudes des cuisinier·es en les privant parfois du confort de leur cuisine, (pour cuisiner dans un train, dans une montgolfière ou, défi ultime, dans une cuisine ordinaire326) ou en les plaçant face à des publics non acquis (les enfants). Malgré ces porosités, un fait reste certain : si les équipes de participant·es sont mixtes sur le plan du genre, les chefs starifié·es sont majoritairement des hommes blancs, ainsi que les gagnants du jeu et les «  faux-perdants  » qui, à défaut de remporter le concours, connaissent un succès médiatique au-delà du cadre de lʼémission (Norbert Tarayre). Depuis la deuxième saison, le binôme homme-femme a laissé la place à un présentateur unique, Stéphane Rotenberg ; quand au groupe de chefs «  juges  » , il se compose de personnalités telles que Jean-François Piège, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Thierry Marx ou Michel Sarran. Lʼémission implique aussi de manière plus ponctuelle lʼinvitation de «  grands noms  » comme Paul Bocuse ou Pierre Gagnaire. Les chefs étoilés invités ou jurés sont majoritairement des hommes, tout comme les participant·es et par effet ricochet les gagnant·es (Causse, Dealberto & Guillot 2018, fig. 2.8 & 2.9). Un épisode intitulé «  Revisiter deux plats inventés par des femmes  » réussit même lʼexploit de ne citer aucune de celles-ci (Causse, Dealberto & Guillot 2018), tandis que le chef Thierry Marx qualifiait aux débuts de lʼémission de «  cuisine de ménagère  » les plats les moins réussis (Béja 2014, 15).
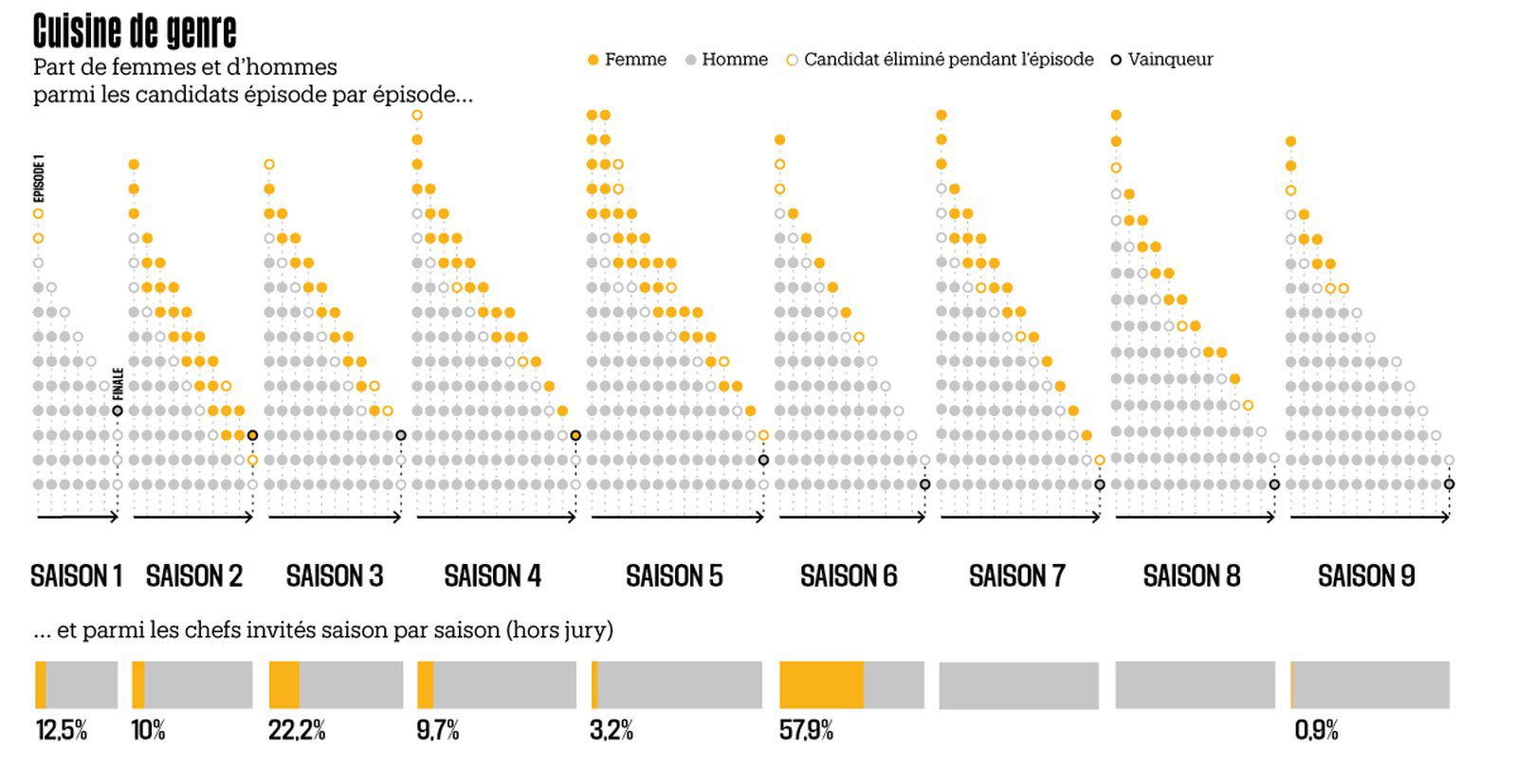
Cette cuisine télévisée produit un autre brouillage dʼimportance entre le jeu et le travail. Si lʼaccent sur le professionnalisme des participant·es et le respect de règles issues du milieu de la gastronomie (le «  Oui, chef !  »â€¯; Béja 2014, §7) participe à situer la production culinaire comme travail, les équipes, comptes à rebours et autres défis inattendus font basculer le contenu du côté du jeu. Ce brouillage est peut-être plus caractéristique du genre de la télé-réalité que de la pratique culinaire. En effet, ce type dʼémissions repose sur le vote du public, et donc une forme de digital labor, et le casting de «  travailleurs-joueurs  » qui interprètent leur propre rôle (Jehel 2018, §4). On découvre donc ici des personnes qui travaillent (pour la chaîne télévisée) à jouer à travailler (performer leur pratique). Sophie Jehel, chercheuse en sciences de lʼinformation et de la communication, argumente ainsi que ces contenus participent à une fabrique de consentement généralisé aux principes du travail néolibéral, ludifié et marqué par le «  postulat individualiste qui fait de lʼindividu le responsable de ses projets et de ses actions  » (§20). Lʼautrice note également que Top Chef, comme dʼautres émissions du même type, consacre une forme de «  surveillance permanente  » dans laquelle «  le travailleur-joueur ne peut maîtriser son image  » (§20).
Du point de vue de la cuisine, cette représentation permet donc de naturaliser lʼintégration de dispositifs audiovisuels à la cuisine, dʼune manière plus globale que la caméra quasi fixe de La cuisine des Mousquetaires. Sophie Jehel argumente aussi que la surveillance totale accroît la pression sur les «  travailleurs-joueurs  », «  pris dans lʼétau dʼinjonctions paradoxales  » (§43)—être dans la maîtrise alors que le dispositif permet aux réalisateurices dʼorienter comme ils le souhaitent la représentation. Ces participant·es sont donc soumis aux principes de «  lʼhyperperformance  » (§43), qui, si elle concerne tous les candidat·es, relève dʼun registre traditionnellement associé à la masculinité. Sophie Jehel évoque ainsi le cas de Thomas, candidat qui se coupe avec un couteau et décide dʼarrêter. Il est admonesté par un des chefs, et dit finalement de lui-même «  je ne vais pas faire le malade, la chialeuse  » (§27). La figure de la «  chialeuse  » associe directement féminité, faiblesse morale et émotivité, qualités qui semblent incompatibles avec lʼesprit de concours de la cuisine media.
Je fais ici lʼhypothèse que ces principes peuvent contaminer, à rebours, la cuisine privée et la pratique culinaire. Ce brouillage des limites ne repose en tout cas pas uniquement sur une modalité «  aspirationnelle  » du show télévisé (qui me fait désirer le même couteau, le même mixeur dans ma propre cuisine) mais aussi sur une transgression affirmée des frontières déjà poreuses entre public et privé, et travail et loisir. Dʼautres émissions participent de ce flou. Master Chef se présente comme un immense jeu-concours permettant la promotion dʼamateurices. Les premières épreuves opposent donc de très nombreux·ses candidat·es. La cuisine est sortie de ses murs et maximalisée selon le principe de la grille : chaque candidat.e possède un petit module sur lequel cuisiner, et le hangar à dirigeables qui accueille lʼépreuve en semble rempli à perte de vue (fig. 2.11). Si lʼon est bien dans le cadre dʼun jeu, lʼordonnancement des petits blocs-cuisines en ce vaste lieu ne manque pas dʼévoquer lʼusine et sa chaîne. La cuisine média de Top Chef constitue donc un autre avatar de la cuisine contemporaine : face au bloc abstrait où plus aucune casserole ne mijote, cʼest une cuisine agitée, scrutée, intensifiée par lʼhybridation du travail et du jeu qui semble en constituer lʼenvers. Si travail et jeu sont en effet mêlés, la typologie du jeu télévisé a peut-être le mérite de remettre du travail en cuisine, là où elle semblait figée comme cuisine-musée à contempler. La manière dont cette cuisine est surveillée, rendue visible, tend peut-être aussi à la masculiniser ; à moins que cette «  masculinité  » de la cuisine professionnelle ne doive être rattachée à des fondements historiques plus anciens.

La cuisine télévisée, bien quʼelle brouille de nombreuses frontières, prolonge et renforce les rapports de pouvoir existants, en mixant les registres de la cuisine professionnelle et de la cuisine domestique, du travail et du jeu, du public et du privé. Si la domination masculine continue de traverser les contenus sus-cités (qui rejettent la «  ménagère  » et la «  chialeuse  »), cʼest peut-être car son modèle, la cuisine de grand restaurant, en porte traditionnellement les stigmates. Dans ses chroniques publiées par Slate et son ouvrage Faiminisme—Quand le sexisme passe à table (2017), Nora Bouazzouni sʼemploie à décrypter la persistance de la domination masculine dans les cuisines professionnelles, y compris en termes strictement numériques. Cette représentation moindre des femmes et des personnes non-blanches dans le domaine de la gastronomie est souvent invoquée pour justifier lʼabsence de mixité dans les émissions télévisées culinaires ; et pour expliquer la moindre représentation des femmes en cuisine, cʼest la faible féminisation des formations dʼhôtellerie-restauration qui est invoquée. Interviewée par Victoire Tuaillon dans le podcast Les couilles sur la table en 2018, N. Bouazzouni donne un panorama de la domination masculine dans les cuisines professionnelles. Elle invoque ainsi un extrait télévisé présent dans le film Miso et Maso vont en bateau (1976), où un critique gastronomique affirme que «  les femmes ne font pas la cuisine, elles font de la cuisine  ». Lʼimpossibilité pour une femme dʼêtre une grande chef se lit dans deux signes, selon lui : aucune femme ne lʼa jamais été, et le mot «  chef  » est masculin. Cet extrait peut faire sourire, tant la misogynie de lʼindividu est caricaturale ; elle repose sur des arguments classiques du masculinisme, que lʼon retrouve aussi dans les explications sur lʼabsence (bien entendu construite) des femmes de lʼhistoire des arts plastiques.
N. Bouazzouni observe que lorsque les pratiques «  féminines  » se professionnalisent, elles se masculinisent automatiquement. Ainsi, le mot «  la cuisinière  » évoque la femme au foyer derrière ses fourneaux, au mieux la «  dame de la cantine  » (salariée mais encore dans le care, à proximité des enfants) ; le terme «  cuisinier  » évoque les grands chefs, la toque, les brigades et la reconnaissance internationale. Une mécanique similaire, observe-t-elle, distingue la couturière (et son dé, son fil, son nécessaire) du couturier (du côté des podiums et de lʼindustrie de la mode). Cette distinction assumée entre privé et public, féminin et masculin a longtemps alimenté les discours sur la cuisine. Le chef Raymond Oliver, un des premiers chefs à être «  télévisé  », publie en 1958 La cuisine pour les hommes. La quatrième de couverture est sans appel : «  les femmes font la cuisine ‹ pour les hommes ›. Les hommes, eux, la font ‹ pour lʼart ›  ». Il refuse également de participer à un concours de cuisine devant lʼopposer à Fanny Cradock327, car les femmes sont selon lui incapables de faire de la grande cuisine (Reader 1995, 377).
Autrement dit, la pratique culinaire des femmes, en cuisine, est vouée à la disparition, à lʼoubli, à une forme dʼanhistoricité totale. Et si R. Oliver cuisine accompagné de Catherine Langeais dans Art et Magie de la Cuisine (la première émission télévisée culinaire française, diffusée de 1954 à 1967), cet ordre genré est respecté dans les performances de chacun·e. Pierre dʼHuy décrit ainsi la participation de la speakerine, dont le rôle premier est dʼassurer de lʼenregistrement de lʼacte culinaire, à -côté qui semble peu intéresser Oliver : «  Catherine fait le lien avec les téléspectatrices, quʼelle interpelle avec un affectueux ‹ Mesdames ›  »328 (2011, §3). Plus loin, il résume ainsi le dispositif : «  Raymond sʼagite, tranche, coupe, broie, blanchit, poche, frit, lisse. Et Catherine, sorte de petite nièce insolente, lʼobserve en action, les bras croisés  » (DʼHuy 2011, §4).
Les femmes sont donc écartées dʼune cuisine qui leur permettrait la reconnaissance sociale : étant privée, elle est du même coup gratuite, ce que jʼinvestirai dans le chapitre III. Les hommes, historiquement, ont eu accès à une cuisine commerciale, donc compensée par un salaire, et permettant une reconnaissance sociale, voire la célébrité. N. Bouazzouni note que si les femmes sont encore trop peu représentées dans les cuisines professionnelles, les chefs hommes ne manquent pas de faire référence, dans leurs histoires personnelles, à telle mère ou grand-mère qui leur a «  tout appris  », ou qui leur a servi de modèle. Là encore, la figure féminine est gelée dans un passé idéalisé : la reconnaissance vient après-coup, et elle reste interpersonnelle, et non sociale. Lʼidée que la «  cuisinière  » reste une figure domestique est soulignée par la dimension familiale : des mères ou grand-mères sans nom, à moins quʼil ne sʼagisse dʼune «  petite nièce  » cantonnée à lʼécran au rôle de faire-valoir.
Malgré cette persistance de la domination masculine, les femmes chefs existent. Si jʼai pointé le manque de mixité de Top Chef, il nʼen reste pas moins que la seconde édition a été gagnée par Stéphanie Le Quellec (2011) ; depuis leur passage à la télévision, les compétitrices Fanny Rey, Tabata Mey, Naoë lle dʼHainaut, Coline Faulquier et Kelly Rangama ont été étoilées329. N. Bouazzouni explique bien que, malgré les difficultés, les femmes chefs existent. En revanche, elles sont peu sollicitées, les experts masculins étant plus facilement contactés—un cercle vicieux se mettant ensuite en place, où les experts établis sont systématiquement rappelés sans que de nouveaux regards soient envisagés. Lʼentrée des chefs femmes dans les cuisines professionnelles pose également son lot de problèmes. Premièrement, la difficulté de la profession et son caractère physiquement éprouvant sont souvent invoqués pour expliquer la sous-représentation des femmes en cuisine, plutôt par des hommes. Deuxièmement, lʼattachement des femmes à construire une «  vie de famille  » serait responsable de leur éloignement des cuisines, car les horaires du métier semblent incompatibles avec le soin apporté aux enfants. La chef Hélène Darroze évoque ce problème, lorsquʼelle est interviewée au sujet du sexisme de Top Chef. Elle dit ainsi avoir «  vu des femmes meilleures que les hommes en cuisine, mais qui ne sont pas allées où elles voulaient parce quʼelles ont eu un bébé ou se sont mariées  ». Des chefs hommes tiennent le même propos, mais il nʼest pas toujours clair si cette explication fait office dʼexcuse, ou permet de conserver les anciennes habitudes à peu de frais. Lilian Min, dans un article pour The Toast (2015) disséquant le sexisme en cuisine, cite le chef français Jean-Georges Vongerichten, pour qui les femmes de 27, 28, 29 ans quittent les brigades en raison du «  tic-tac de lʼhorloge  »330 (biologique sʼentend).
Si dans la bouche dʼun chef homme, la remarque peut donc relever dʼune misogynie qui associe traditionnellement et inévitablement femmes et désir maternel, il nʼen reste pas moins que la nature du travail en cuisine, et particulièrement de ses horaires, sʼaccommode mal du cumul des rôles et de la «  double journée  » (Hochschild 2012) encore assurées par de nombreuses femmes employées. Aux États-Unis, lʼabsence de congé maternel payé et de soutien à la parentalité renforce cette situation. Amanda Kludt parle ainsi dans la revue The Eater du «  piège de la maternité  »331 (2016) propre à lʼindustrie hôtelière. Elle explique que le «  manque total de soutien à la grossesse et à la naissance envoie un message clair […] : ce monde nʼest pas pour toi  »332. Elle démontre que le simple fait de sʼarrêter en raison dʼune grossesse pose le problème du retour, difficile lorsquʼon est chef ou cuisinier·e. Elle évoque également une situation où lʼ«  emploi actif  »333 (cʼest-à -dire sans arrêt pour maternité) est une clause du contrat dans la création dʼun restaurant. Les femmes employées en cuisine parviennent parfois à réaliser leur projet de maternité, lorsquʼelles sont à la tête de leur restaurant, ou en position de créer leurs propres règles ; lorsquʼelles sont employées, elles finissent souvent par se reconvertir professionnellement, pour devenir consultante culinaire ou chef dans une entreprise (Kludt 2016).
En France, le contexte social est plus favorable, mais comme le pointe la chef Darroze, cela ne suffit pas à rendre compatibles brigade et vie de famille. Enfin, la difficulté à exister comme femme chef tient aussi à une domination masculine plus diffuse, une culture du métier, qui résulte dans ce quʼon pourrait appeler une «  ambiance  » qui peut petit à petit pousser les femmes à se désengager de la carrière (Bouazzouni 2017, 25). A. Kludt évoque un environnement de frat house, de lieu historiquement marqué par une culture masculine (pensons par exemple aux vestiaires)334. N. Bouazzouni explique aussi que les gestes de harcèlement (remarques, attouchements) sont encore peu connus, et évoque une culture du silence tenant à la peur dʼêtre «  grillée  » dans un petit milieu (Tuaillon 2018). De manière plus générale, ces dernières années ont vu apparaître des témoignages et un discours plus affirmé sur une forme de «  violence en cuisine  », tenant aux horaires de travail, à la promiscuité des employé·es, au stress. Les suicides médiatisés des chefs Bernard Loiseau (en 2003, après que des journaux ont suggéré quʼil perdrait son étoile) et Anthony Bourdain (en 2018) invitent à sʼinterroger sur la manière dont un métier exigeant a des conséquences délétères pour la santé mentale (Ho 2018b). Je ne dis pas ici que les cuisines professionnelles sont intrinsèquement violentes, par opposition aux cuisines calmes et préservées des logis. Je dis encore moins que cette violence, réelle ou supposée, est telle que les femmes, créatures fragiles, ne pourraient y faire face. Plutôt, je tiens ici à soulever dès à présent la manière dont la cuisine, comme lieu, est traversée de part en part par la question de la violence. Les femmes ne sʼécartent pas des cuisines professionnelles à cause de cette violence, mais parce que pour elles, celle-ci est combinée aux violences sexistes (et racistes, validistes, etc.) et une inhabitabilité chronique qui les pousse à chercher dʼautres espaces, dʼautres carrières. Cʼest donc bien dʼun effet cumulatif des violences de genre, de race, de classe quʼil sʼagit.
Cette difficile participation féminine aux cuisines professionnelles est aussi facilitée par lʼeffacement de lʼhistoire des figures féminines. Si Escoffier ou Bocuse sont des grands noms, ces figures solaires ont pu éclipser des femmes qui ont tout autant participé à lʼélaboration de la gastronomie française. Les mères lyonnaises, dont la Mère Brazier (fig. 2.12), ont construit une longue tradition, dont hérite dʼailleurs Paul Bocuse puisquʼil a rejoint le bouchon de la mère Brazier comme commis (Bouazzouni 2017, 17–18). Il est certain que le commis Bocuse a dépassé en notoriété sa formatrice. Cette transmission ne lʼa nullement empêché, cependant, dʼaffirmer : «  les femmes, je les préfère dans mon lit quʼaux fourneaux  » (Reader 1995, 377). Par ailleurs, si le nom de Brazier connaît une certaine fortune, que ce soit par lʼexistence dʼune bourse destinée aux jeunes femmes souhaitant faire carrière dans la cuisine, ou par le rachat du restaurant par le chef -— depuis étoilé -—Mathieu Viannay (Rivron 2020), dʼautres «  mères  », comme la mère Guy (pourtant pionnière de cette tradition, dès 1759) la mère Brigousse ou la mère Filloux (Reader 1995, 376–377) sont bien moins renommées encore. Si les mères parviennent à se faire une place comme patronnes dʼétablissements, ces espaces nʼen restent pas moins dʼabord masculins, ne serait-ce que par leur fréquentation. La ville de Lyon, selon Keith Reader335, était un haut lieu de clubs gastronomiques au XIXe siècle (1995, 375), sociétés qui nʼintégraient aucune femme ; par ailleurs ces clubs étaient marqués par la figure romantique du flâneur devenue ici celle du «  dîneur  », soit une variante de celle du célibataire (de fait, ou venant au restaurant sans son épouse) (379).

La cuisine sʼest donc masculinisée grâce à un oubli stratégique des figures féminines qui avaient participé, au restaurant ou dans les maisons, à constituer une culture culinaire. Et lorsque des femmes ont pu exister en gastronomie, cʼétait souvent pour le plaisir gustatif dʼhommes, à lʼexclusion de leurs épouses. Autrement dit, la cuisine professionnalise rarement les femmes, ou alors localement, et souvent dans lʼombre.
Certains espaces, éventuellement, peuvent être autorisés à un investissement féminin : la pâtisserie, par exemple, parce quʼelle suggère la délicatesse, et parce quʼelle implique le sucré, donc la frivolité, est plus volontiers associée aux femmes336. 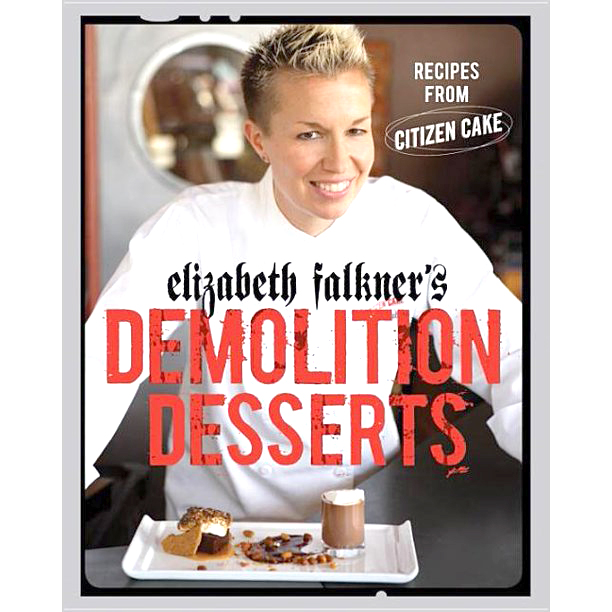 fig. 2.13.a : Elizabeth Falkner est une cheffe californienne qui investit particulièrement la pâtisserie et déconstruit les représentations de fragilité et de délicatesse qui sont traditionnellement associées à la discipline.N. Bouazzouni proteste ainsi contre la manière dont les stéréotypes de genre sʼinvitent parfois en cuisine, laissant imaginer les plats bien charpentés, techniques, des hommes, face aux inventions légères et éthérées des femmes (Tuaillon 2018). Ces représentations sont si bien ancrées, que les femmes qui émergent comme chefs les attaquent parfois frontalement. La chef étasunienne Elizabeth Falkner (fig. 2.13.a), lesbienne «  out  » et activiste pour les causes LGBTQIA+ publie ainsi en 2007 Demolition Desserts (quʼon pourrait traduire par Desserts en démolition). Dans lʼintroduction, elle revendique lʼhéritage de lʼart contemporain, de la cuisine télévisée de Julia Child et de la musique, tout autant que celui de la cuisine maternelle (Falkner 2007, 2). Plus loin, un chapitre intitulé «  Zone de travaux  » est introduit par la remarque suivante : «  ce chapitre—et toute mon approche des desserts (et de la vie)—vise à démolir les stéréotypes et reconstruire quelque chose de différent et dʼexcitant  »337 (Falkner 2007, 113). En 2009, elle sert dans une conférence culinaire un dessert si déconstruit, quʼil est nécessaire de le manger avec des gants (Weston 2009). Si les desserts de E. Falkner ne semblent pas frontalement affronter les normes de genre, ils déconstruisent néanmoins la conception générale de la pâtisserie, associée à la féminité mais aussi au luxe.
fig. 2.13.a : Elizabeth Falkner est une cheffe californienne qui investit particulièrement la pâtisserie et déconstruit les représentations de fragilité et de délicatesse qui sont traditionnellement associées à la discipline.N. Bouazzouni proteste ainsi contre la manière dont les stéréotypes de genre sʼinvitent parfois en cuisine, laissant imaginer les plats bien charpentés, techniques, des hommes, face aux inventions légères et éthérées des femmes (Tuaillon 2018). Ces représentations sont si bien ancrées, que les femmes qui émergent comme chefs les attaquent parfois frontalement. La chef étasunienne Elizabeth Falkner (fig. 2.13.a), lesbienne «  out  » et activiste pour les causes LGBTQIA+ publie ainsi en 2007 Demolition Desserts (quʼon pourrait traduire par Desserts en démolition). Dans lʼintroduction, elle revendique lʼhéritage de lʼart contemporain, de la cuisine télévisée de Julia Child et de la musique, tout autant que celui de la cuisine maternelle (Falkner 2007, 2). Plus loin, un chapitre intitulé «  Zone de travaux  » est introduit par la remarque suivante : «  ce chapitre—et toute mon approche des desserts (et de la vie)—vise à démolir les stéréotypes et reconstruire quelque chose de différent et dʼexcitant  »337 (Falkner 2007, 113). En 2009, elle sert dans une conférence culinaire un dessert si déconstruit, quʼil est nécessaire de le manger avec des gants (Weston 2009). Si les desserts de E. Falkner ne semblent pas frontalement affronter les normes de genre, ils déconstruisent néanmoins la conception générale de la pâtisserie, associée à la féminité mais aussi au luxe.

Le livre est dʼailleurs rythmé par les apparitions de Caremi Keiki, un personnage à lʼallure de tomboy, coiffé dʼune casquette dʼaviateur, qui traverse avec fracas un mur de meringue sur sa moto (fig. 2.13.b). Les typologies familières des desserts sont ici décalées, réinventées, pour former des plats qui ne sont pas reconnaissables au premier coup dʼœil, et dont lʼaspect pointu, parfois acéré, va en lʼencontre des rondeurs adorables des macarons et autres «  douceurs  » associés à une consommation féminine. Lʼapproche évoque celle, en France, dʼOenologouine, des ateliers de dégustation de vin tenus en non-mixité.
Cependant, qualifier lʼassociation de telle ou telle typologie de pratique culinaire comme masculine ou féminine ne résout pas la question de la place des femmes en cuisine. Elle ouvre certes un champ dʼexploration dans des pratiques culinaires qui ne répéteraient pas les normes de genre, ou queeriseraient nos conceptions de certains aliments ou plats. Ces pratiques professionnelles mʼintéressent aussi avant tout dans la mesure où elles informent les pratiques privées, au domicile. Les représentations de la cuisine gastronomique renforcent la ligne de partage entre une cuisine comme art culinaire et la «  popote  » quotidienne des femmes. Mais que se passe-t-il, alors, pour les hommes dans les cuisines privées ?
Lʼespace domestique nʼest pas codé comme masculin, et par extension, la cuisine non plus : voilà une évidence quʼil nous faut analyser de plus près. Affirmer que la domesticité nʼest pas masculine, indépendamment de la justesse de cette observation, peut relever dʼun raccourci. Cʼest une chose dʼobserver que, culturellement, la domesticité possède peu dʼincarnations masculines, cʼen est une autre que de conclure à une exclusion mutuelle du domestique et du masculin. Décrire la manière dont la domesticité produit la féminité ne doit donc pas nous inciter à ignorer des pratiques masculines dans les cuisines privées -— car celles-ci existent, et ses incarnations, pour toutes minoritaires (en nombre) soient-elles, sont importantes. Inspiré par les travaux de lʼhistorienne de lʼarchitecture Beatriz Colomina, Paul B. Preciado analyse ainsi les représentations architecturales du magazine Playboy dans les années 50, et la mise en scène de son patron, Hugh Hefner, dans une vie domestique singulière qui participe à rendre potentiellement habitable la domesticité par les hommes (2010). Il montre ainsi quʼau moment où la séparation public/privé semble la plus claire -— dans les États-Unis dʼaprès-guerre, dans le contexte dʼun «  boom  » économique -—émerge une variante de la figure du célibataire jouisseur (que nous avons déjà croisée, dʼune certaine manière, dans le dîneur du bouchon lyonnais). En se mettant en scène lui-même dans son appartement, le pornographe Hefner construit un «  masculinisme hétérosexuel dʼintérieur  » (Preciado 2010, 32).

Cloîtré volontaire, H. Hefner se présente, travaillant chez lui, sur un lit giratoire couvert de ses papiers (fig. 2.14.a) cerné dʼécrans. La limite public/privé, ou même ville/banlieue, structurant de la société américaine hétérosexuelle dʼaprès-guerre, est ici brouillée, recomposée par le dispositif média. P. B. Preciado rappelle dʼailleurs ce que cette distinction doit à la «  théorie des ‹ deux sphères ›  » caractéristique de la culture occidentale bourgeoise du XIXe siècle (32). Une frontière est symboliquement transgressée, quand le travail sʼinvite dans la domesticité ; mais ce transfert sʼeffectue sur un mode hypervisible, qui ne féminise pas son acteur principal. Au contraire, le penthouse de H. Hefner, et sa pièce maîtresse, le lit giratoire, travaillent à intégrer les fonctions et les usages du corps travailleur-jouisseur. Ce lit, «  [d]ébarrassé de sa condition de meuble  » (149), sorte dʼ«  archive multimédia  » (150) permet de satisfaire lʼhyperactivité de son occupant, qui peut y travailler, y manger (un mini-frigo est installé au pied du lit, 157), y communiquer, y regarder la télévision, y voir sa famille ou sʼy livrer à des ébats sexuels (148)338. Le lit tourne aussi sur lui-même, ce qui permet de changer de «  paysage  » à lʼintérieur du logis. Lʼalanguissement, la domesticité, les vêtements dʼintérieur sont autant dʼéléments plutôt codés comme féminins que H. Hefner réinvente par ses pratiques et leur mise en scène dans la revue Playboy. Et si son manoir existe comme un «  paradis viril  » (182), cʼest aussi une utopie domestique masculine que H. Hefner développe dans les pages de son magazine, lorsquʼil présente un penthouse qui entre en friction avec les idéaux modernistes encore prégnants à son époque. En 1956, Playboy présente dans ses pages un article dédié à cet appartement de célibataire, destiné à maximiser les rencontres sexuelles, mais aussi à expédier les femmes impliquées aussitôt la relation consommée. Le penthouse incarne donc un paradoxe : il est un écrin, une grotte où peut se replier le célibataire—on pourrait dire aujourdʼhui, avec Alain Damasio, un «  technococon  » (2021, 409)—mais qui doit sʼassurer que cette domesticité reste imperméable à une potentielle féminisation, voire, comme le dit P. B. Preciado, se prémunir «  contre la menace matrimoniale  » (88).

La production dʼune domesticité masculine résistante à la féminisation pose donc la question du traitement de la cuisine. Comment cet espace féminin par excellence peut-il être intégré au domicile du «  chaud lapin  » inspiré par H. Hefner ? La stratégie prend la forme de la «  cuisine sans cuisine  » («  kitchenless kitchen  »339, 93) également analysée par Paul B. Preciado. Cette cuisine naît du dessin-dessein proposé par Playboy, et des discours auxquels ce dernier sʼarticule dans lʼarticle en 1959. Lʼespace cuisine est dissimulé par des panneaux, décrits comme des shÅji japonais. Il est à la fois dépouillé, selon un principe esthétique encore palpable dans la Lepic, mais reste chaleureux, habillé dʼormeau et de fibre de verre340. Lʼarticle prend acte du fait que le visiteur peut se demander «  où sont les choses  »â€¯; mais il est aussi rassuré car «  tout est à sa place  » (Preciado 2010, 94). La cuisine (fig. 2.14.b) comporte un îlot central dans lequel le désordre peut disparaître. Aussi, cette cuisine qui nʼen est pas une, ou refuse dʼen porter le nom, marque le rejet du «  proverbial fourneau  », déclaré «  inutile  » (Cardoso 2018, §19). Lʼacte de cuisson est quant à lui télécommandé. Tout juste faut-il préparer toasts, Å“ufs et café la veille, et la pression dʼun bouton active tous ces éléments, alors transformés en petit-déjeuner (Preciado 2010, 96). Mais tout lʼacte culinaire nʼa pas vocation à être expédié ou caché. Playboy évoque ainsi dans ses pages un dispositif de cuisson de la viande sous cloche, ajoutant un autre «  mécanisme […] dʼexhibition  » (Preciado 2010,97) à cette architecture de verre qui ne cache son célibataire que pour mieux, ponctuellement, lʼexhiber et le mettre en scène ; à moins que ce ne soit , comme lʼaffirme P. B. Preciado, la chair fraîche du steak ou de la jeune conquête qui ne soient lʼobjet de la contemplation.
Ce piège à femmes du penthouse ne cherche pas seulement à les attraper, mais à les rejeter une fois lʼacte accompli. La cuisine organise dʼailleurs, plutôt que sa propre disparition, celle de lʼintruse menaçant de féminiser le célibataire par le mariage et la domesticité associée. Selon lʼarticle, seul un homme «  bizarre  » pourrait autant aimer la cuisine que le ménage, travail dʼailleurs littéralement désigné comme celui de la «  hausfrau  » (Preciado 2010, 94 ; Cardoso 2018, §16). La tâche apparemment indigne de la vaisselle est donc confiée au lave-vaisselle, qui permet aussi dʼeffacer les traces de rouge à lèvres laissées par la conquête de la veille (Preciado 2010, 97). La cuisine, et plus largement lʼappartement, ne participent donc pas dʼun seul rejet sémantique du féminin : cʼest une figure très spécifique de la féminité, la housewife, qui est externalisée dans un dispositif technique, tandis quʼune autre, la «  conquête  », disponible sexuellement, est autorisée à rentrer dans le cocon du célibataire pour être consommée. La manière dont cette femme pénètre lʼespace domestique masculin est indissociable de la manière dont elle en sera expulsée le matin venu341. Il nʼest pas seulement nécessairement quʼelle parte, mais aussi que ses traces soient annihilées par un ménage dont le célibataire ne se mêle pas. Par ailleurs, les communications qui relient le penthouse à son extérieur composent un mode silencieux pour celui-ci : le célibataire appliqué à séduire une nouvelle femme est ainsi assuré quʼaucune invitée persistante, qui souhaiterait revenir, ne peut le déranger dʼun coup de sonnette (Preciado 2010, 90). La cuisine-non-cuisine nʼévacue pas la housewife, elle la remplace et lui substitue la conquête selon un mouvement giratoire dʼentrée-sortie conforme à la rotation panoptique du lit du playboy. La masculinité domestique incarnée par H. Hefner repose donc sur une négociation calibrée avec le féminin : le service ménager est externalisé, tandis que le service sexuel est intégré, selon un périmètre rigoureusement aménagé par le design de lʼhabitat.
Le penthouse reste bien sà »r une utopie de célibataire, seulement réalisée, en partie, par le riche Hefner dans son manoir. Il est essentiel, néanmoins, dʼavoir en tête cette mécanique qui alterne entre appropriation, externalisation et rejet pour comprendre à quel point les rôles contemporains des hommes en cuisine sont complexes et paradoxaux. Ce drame de la féminité honnie mais nécessaire est rejoué dans les nouvelles formulations culturelles qui autorisent les hommes à faire de la cuisine leur territoire. Le premier partage structurant réside, comme chez Hefner, dans la régulation quantitative de lʼeffort en relation à la nature des tâches. Il est commun dʼobserver que les inégalités de répartition du travail domestique sont en recul.
En 1998, en France, une femme passe 4 h 33 par jour à exécuter ces tâches domestiques, contre 2 h 41 pour les hommes ; en 2010, les femmes consacrent 2 h 59 à ce travail, contre 1 h 17 pour les hommes, étant étendu que lʼécart se creuse en fonction du nombre dʼenfants. (Singly 2007c, 41 ; Chollet 2015, 184). Une étude publiée par lʼIFOP en 2019 indique quʼil y a eu peu voire pas dʼ«  effet #Metoo  » sur cet aspect des rapports de genre. Le travail culinaire a suivi la même tendance, et il est à présent mieux réparti entre les hommes et les femmes des couples hétérosexuels.
Emily Contois observe que les hommes étasuniens prennent une part croissante dans la préparation des repas, et quʼils admettent plus volontiers y prendre du plaisir (2014). Cette hausse de lʼimplication et de lʼappétence doit toutefois être traitée avec prudence. Le terme dʼ«  égalité  », prisé par les appropriations néo-libérales du féminisme et par les discours réformistes réduit à une question numérique, enregistrable par les chiffres, les rapports de pouvoir et de domination. Une approche égalitaire pourra ainsi parler dʼune parité homme-femme dans des groupes donnés : mais cette parité numérique ne dit rien du pouvoir effectif des femmes incluses dans le groupe, de leur capacité à prendre la parole, être entendues, etc. Il en va de même pour le travail domestique. Un compte de lʼimplication horaire de chaque membre du couple, bien que nécessaire, ne nous informe pas sur la nature du travail effectué, ses effets psychologiques, ou encore sur lʼinvestissement mental de la personne. De plus, si je mentionnerai plus avant des interventions masculines en cuisine qui peuvent être saisies comme des «  progrès  », je serai vigilant à ne pas interpréter lʼapparition dʼun nouveau rôle de genre, ou le renouvellement dʼune figure, comme entraînant la disparition automatique de lʼancien modèle. Ellen Cox, dans son analyse des rôles de genre en cuisine, affirme ainsi que des constructions apparemment nouvelles peuvent tout à fait préserver dʼanciennes attentes normatives. Elle conclut même son étude en affirmant que la «  cuisine domestique devient un site pour dʼanciennes et de nouvelles manières de faire le genre [doing gender], pas de manière mutuellement exclusive, mais dans de complexes itérations des deux  »342 (Cox 2017, 243). Fait plus retors encore, les rôles anciens peuvent être reformulés dans des figures apparemment nouvelles dont le conservatisme est masqué : peu de gens se risqueraient aujourdʼhui à dire frontalement que la place des femmes est en cuisine, mais les attentes quant à leur implication, elles, nʼont pas forcément changé pour autant (Stagi & Benasso 2018, 172).
Reste ce fait : les hommes cuisinent plus quʼauparavant dans les foyers hétérosexuels (Szabo 2013). Une fois le camouflet de lʼégalité réussie écarté, les conditions de cet investissement sont plus lisibles, et présentent un grand intérêt. Les hommes participant plus aux tâches ménagères sʼinvestissent aussi davantage dans la pratique culinaire, qui appartient à ce plus grand ensemble. Il semble même que les hommes aient davantage augmenté leur participation culinaire que leur investissement dans dʼautres tâches. En cela, ils héritent de la masculinité domestique à la Hefner : cuisiner, oui, mais nettoyer, cela semble moins évident. Cette participation choisie ne devrait donc rien au hasard : si les hommes se sont davantage investis en cuisine, cʼest peut-être, stratégiquement, parce quʼil sʼagit dʼune des tâches les plus plaisantes. Dans les études qui sʼintéressent aux catégories de tâches, tel ce rapport de lʼIFOP précédemment cité (2019), il apparaît que la part des hommes ne cuisinant jamais a chuté de 5 points entre 2005 et 2019. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann met dʼailleurs cette évolution sur le compte de la nature de la tâche elle-même, plus agréable et valorisante socialement, que sur une réelle volonté de partage (Kaufmann 2015[2005], 285). La cuisine, dans les discours communs, est souvent nommée comme un plaisir, sinon un loisir. Passer un coup de balai, sortir les poubelles, nettoyer les toilettes sont autant de tâches qui sont considérées comme ennuyeuses, voire pénibles, et dont le résultat ne se voit, paradoxalement, que lorsquʼil nʼest pas fait (Chollet 2015, 181). En contraste, la cuisine est une activité souvent tournée vers les autres, qui manifeste la prise de soin, sinon lʼamour, et qui permet potentiellement dʼexprimer son «  potentiel créatif  »343 (Daniels & Glorieux 2017, 32).
Sʼil faut donc évaluer lʼévolution des rôles de genre produite par la présence dʼhommes en cuisine, il faut aussi considérer la manière dont les pratiques culinaires se masculinisent pour accommoder les hommes hétérosexuels qui sʼen emparent. Cʼest en somme ce que suggère lʼexpression dʼHelen Rosner qui parle dʼune «  dudification  » de la cuisine, que je traduis ici très imparfaitement en «  mec-ification  »344. Les hommes ne se contentent pas de masculiniser la cuisine, ils la «  dudifient  », cʼest-à -dire quʼils la rendent cool, décontractée, adaptée à une masculinité toujours dominante mais selon un modèle de camaraderie et de détente, de fraîcheur presque adolescente. Cette différence entre une cuisine réalisée par les hommes et une cuisine réalisée par les femmes relève dʼune «  inversion symbolique  »345 (Adler 1981, 51) aux nombreux paramètres. Le choix du moment de cuisiner, la fréquence du travail culinaire, le contexte, la présence ou non de témoins sont des aspects clés pour comprendre la manière dont se compose lʼinvestissement masculin des cuisines occidentales. Deux stratégies principales émergent : rejeter les tâches vues comme «  non-masculines  » au profit de pratiques traditionnellement viriles, ou au contraire, masculiniser la tâche féminine pour que celle-ci devienne acceptable.
Jeffery Sobal, dans son examen des représentations sociales du travail masculin en cuisine, affirme que la préparation à proprement parler des repas est encore vue comme majoritairement féminine, tandis que les activités annexes sont plus volontiers gérées par les hommes, telles ces «  activités post-repas  »346 (2017, 131) qui peuvent consister à ranger ou remplir le lave-vaisselle347. La participation masculine, dans ce cas, consiste à éviter les tâches trop «  féminisantes  ». Mais un investissement prononcé sur un terrain féminin peut aussi requalifier la tâche, surtout dans un contexte où la cuisine professionnelle est, comme nous lʼavons vu, masculinisée de manière écrasante. Un homme qui cuisine chez lui bénéficiera donc de lʼassociation entre masculinité et cuisine permise par le registre de la gastronomie. Ceci fait observer à Emily Contois quʼune femme qui cuisine relève du domaine du normal, tandis que lʼhomme qui cuisine apparaîtra comme un héros (Contois 2014) : comme le remarquait de manière plus générale Pierre Bourdieu, les tâches dont les hommes «   sʼemparent […] se trouvent par là -même ennoblies et trasnfigurées  » (1998, 86). En dʼautres termes, un «  devoir féminin  » devient une «  performance masculine  »348 selon le modèle binaire que nous avons déjà croisé qui sépare la cuisine privée de la cuisine professionnelle—sauf quʼici, la ligne de partage sʼinvite dans la sphère domestique.
Pour se masculiniser, la cuisine domestique masculine emprunte à la gastronomie ses codes, ou plus simplement son statut, en appliquant à la pratique culinaire quotidienne une forme dʼexpertise qui peut lui sembler étrangère, ou en investissant des espaces spatialement et temporellement limités qui permettent de distinguer cette «  cuisine de tous les jours  », féminine, dʼune cuisine masculine au statut supérieur. La manière dont les hommes investissent le barbecue témoigne de cette localisation aux effets masculinisants (Adler 1981, 46 ; 53). Par ailleurs, lʼassociation du barbecue à la viande—produit masculin par excellence (Bouazzouni 2017, 71–72 ; Barthes 1970[1957], 73)—au feu, à lʼextérieur, et aux occasions sociales permet de dissocier la pratique culinaire masculine (ponctuelle, festive) des habitus féminins (quotidienne, utilitaire). Mais ce principe sʼétend au-delà de lʼexception que constitue le barbecue : la revendication par le discours ou par le faire dʼune forme dʼexpertise peut amener ce déplacement à des pratiques qui semblent à lʼorigine moins immédiatement masculines.
J. Sobal parle ainsi de la figure de «  lʼhomme sachant  »349 (2017, 135–36) qui va sʼintéresser à des typologies de produit très particulières, comme le vin, ou, justement, la viande. Il fait écho à Jean-Claude Kaufmann qui isole quant à lui «  le héros moderne[/] devenu[/] chef  » (2015[2005], 280). Une enquêtée de Sandra Gaviria et Muriel Letrait, sociologues sʼintéressant au partage des tâches ménagères, affirme que son conjoint «  va être dʼun grand soutien  » «  pour les repas dʼinvitation  », pour lesquels «  il choisit son plat, son vin, son truc, son machin…  » (2007, 207). Dans cette énumération (achevée par les évasifs «  truc  » et «  machin  »), on devine le goà »t de la spécialisation, du désir de produire un repas en vue dʼune dégustation pour des invités -— et donc pas seulement par les membres du foyer. Une autre enquêtée, cette fois dans un travail de Sarra Mougel-Cojocaru et Mireille Paris (dans le même ouvrage dirigé par Jean-François de Singly) raconte la manière dont son conjoint découpe le poulet, avec une application apparemment supérieure à la sienne : «  mon mari adore couper le poulet, le canard enfin tous les trucs très, très compliqués, il adore ça, mais nous on aime pas trop quand il le fait parce quʼil met deux heures à le faire, cʼest-à -dire quʼil le fait vraiment dans les règles de lʼart  » (2007, 147). Elle finit par plaisanter, suggérant que la découpe est si longue que le poulet devient «  froid  » et que «  tout le monde crève de faim  », ce qui fait dire aux enquêtrices, dans une analyse concernant lʼensemble des tâches ménagères et non la seule cuisine, que cette femme trouve son mari «  trop lent  ». Si lʼobservation, de fait, nʼest pas fausse, il me semble quʼun aspect supplémentaire doit être mentionné : lʼattachement au «  bien-fait  » ne porte apparemment pas sur les mêmes éléments chez les hommes et chez les femmes. Ici, la dimension de la manière, voire de lʼart, prend le pas sur la fonction a priori première du repas—la sustentation des convives. Pour les hommes, la pratique culinaire prend aussi souvent un caractère exceptionnel (week-end, repas de fête, vacances) et se trouve dès lors associée à un mode spectaculaire pour les autres, et à une forme de divertissement et dʼenrichissement personnel pour lʼhomme qui cuisine. Lʼ«  homme sachant  » décrit par J. Sobal peut donc recouvrir un ensemble de pratiques qui, par leur contexte temporel (régime dʼexception), les savoir mobilisés (connaître les vins, la viande, pouvoir discourir sur ceux-ci devant les invités) et lʼapplication de savoir-faire (la bonne découpe du poulet, par exemple) consacrent une cuisine spécifique, masculine, distincte de la cuisine ordinaire féminine dont elle mobilise pourtant lʼespace. Ces habitus vont être caractérisés par des gestes potentiellement distincts, qui vont en retour informer les objets et les espaces mobilisés -— la cuisine sera donc potentiellement «  mutée  » par la manière dont elle est investie par des pratiques masculines.

Au cinéma, ce régime de lʼexception, du spectacle, voire de lʼexubérance caractérise un grand nombre de représentations des hommes en cuisine, qui déplient un répertoire de la créativité masculine dans cette pratique, et dans cette pièce, allant de la simple «  débrouille  » créative (registre du bricolage) au génie de lʼinventeur. Dans Kramer vs. Kramer (1979), le personnage de Ted Kramer (Dustin Hoffman) doit sʼoccuper seul de son fils après que sa femme lʼa soudainement quitté. Le premier matin, il semble prendre la mesure de la complexité du travail domestique : il doit faire son propre café (ce quʼil ne semble jamais avoir fait), mais aussi nourrir son enfant, penser à lʼheure de lʼécole, etc. Si la scène démontre son incompétence en matière de cuisine, ainsi que son absence de repères dans cette tâche quotidienne, elle montre aussi une forme de liberté, de fantaisie (fig. 2.15.a ; 2.15.b). Cʼest un endroit de fragilité pour le père Kramer qui semble ne plus rien maîtriser et offrir des justifications absurdes sur sa méthode à son fils, visiblement sceptique. Il finit dʼailleurs par se brà »ler, lâcher la poêle sur le sol, et exploser de rage. Mais cette scène est «  résolue  » par sa relecture, à la fin du film. Alors que la mère Kramer doit récupérer son fils au terme de la bataille légale qui a composé lʼessentiel du récit, père et fils sʼorganisent, silencieusement, pour réaliser avec ordre et structure le même pain perdu quʼau début du film. Cette fois, le récipient est à la bonne taille, aucun ingrédient nʼest oublié, et la poêle est saisie avec la manique appropriée. Lʼincompétence étalée dans la première scène est alors réparée. Plutôt, cʼest une forme de «  cÅ“ur à lʼouvrage  » qui est dépeinte, et si la maladresse existe, elle est finalement compensée par lʼapprentissage pour devenir un moment sensible de complicité père-fils.

Ailleurs, le petit déjeuner est investi sur un mode scientifique, expert, qui confine parfois à la folie. Dans le film dʼanimation The Wrong Trousers (1993) ou encore dans Flubber (1997, fig. 2.16), fig. 2.16.a : Dans Flubber (1997) les personnages de savants fous ont, comme H. Hefner, externalisé la housewife dans une machine infernale. Des mécanismes extrêmement complexes servent à réaliser des tâches ordinaires, comme casser un œuf ou amener une poêle à table.
fig. 2.16.a : Dans Flubber (1997) les personnages de savants fous ont, comme H. Hefner, externalisé la housewife dans une machine infernale. Des mécanismes extrêmement complexes servent à réaliser des tâches ordinaires, comme casser un Å“uf ou amener une poêle à table.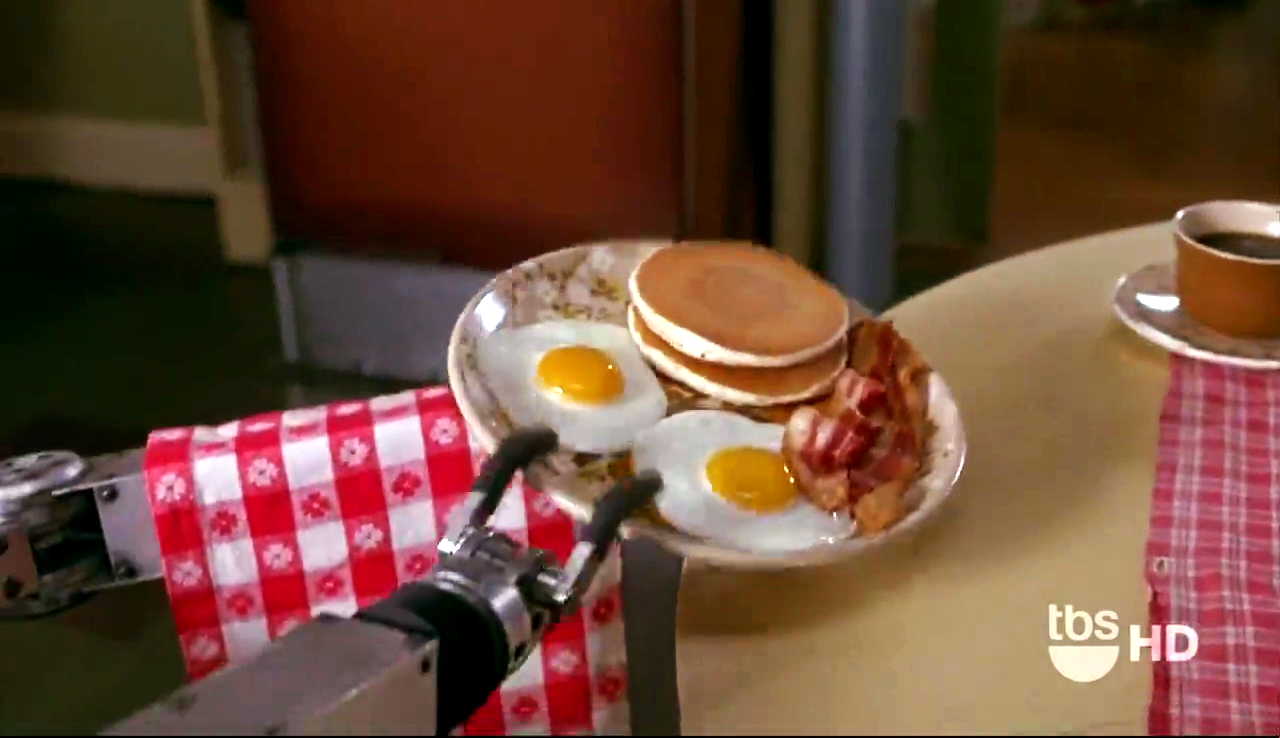 fig. 2.16.b : Flubber (1997) : robot servant le petit-déjeuner. La cuisine devient habitable dans la mesure où elle se fait lʼextension de lʼatelier du savant fou voire machine -— dʼailleurs, dans les deux cas, les personnages sont célibataires. Dans ces deux exemples, le travail nʼest pas pris en charge par le personnage masculin : une grande ingéniosité technique est au contraire mise au service de lʼévitement de la tâche culinaire. Kramer vs. Kramer montre bien une forme dʼinvestissement, résultant dans des progrès, mais la période dʼapprentissage est complètement éludée, comme cʼest dʼailleurs le cas dans dʼautres films où les hommes investissent la cuisine, comme Mrs. Doubtfire (1993, fig 2.17)
fig. 2.16.b : Flubber (1997) : robot servant le petit-déjeuner. La cuisine devient habitable dans la mesure où elle se fait lʼextension de lʼatelier du savant fou voire machine -— dʼailleurs, dans les deux cas, les personnages sont célibataires. Dans ces deux exemples, le travail nʼest pas pris en charge par le personnage masculin : une grande ingéniosité technique est au contraire mise au service de lʼévitement de la tâche culinaire. Kramer vs. Kramer montre bien une forme dʼinvestissement, résultant dans des progrès, mais la période dʼapprentissage est complètement éludée, comme cʼest dʼailleurs le cas dans dʼautres films où les hommes investissent la cuisine, comme Mrs. Doubtfire (1993, fig 2.17) fig. 2.17 : Mrs. Doubtfire présente un homme travesti en femme qui tâche de gérer son incompétence en cuisine. Mais là aussi, le labeur pour arriver à la maîtrise restera invisible. (Parasecoli 2017, 203). On retrouve ici quelque chose de la figure de lʼ «  homme flamboyant  »350, qui se donne en spectacle devant les invités du barbecue, mais qui laisse à sa femme le soin dʼacheter la viande, de la faire mariner «  avant quʼil ne prenne le relais pour assurer sa performance  »351 (Sobal 2017, 135–36). La dimension de labeur, et donc dʼapprentissage, est éludée au profit dʼune représentation dʼincompétence (qui assoit lʼextranéité des hommes par rapport à la cuisine) et dʼune résolution heureuse, déconnectée de la précédente, qui nous rassure in fine sur la compétence de lʼhomme domestiqué. En cuisine, quʼimporte que les hommes soient savants ou ignorants, ils révèlent toujours lʼétendue de leurs compétences avec panache.
fig. 2.17 : Mrs. Doubtfire présente un homme travesti en femme qui tâche de gérer son incompétence en cuisine. Mais là aussi, le labeur pour arriver à la maîtrise restera invisible. (Parasecoli 2017, 203). On retrouve ici quelque chose de la figure de lʼ «  homme flamboyant  »350, qui se donne en spectacle devant les invités du barbecue, mais qui laisse à sa femme le soin dʼacheter la viande, de la faire mariner «  avant quʼil ne prenne le relais pour assurer sa performance  »351 (Sobal 2017, 135–36). La dimension de labeur, et donc dʼapprentissage, est éludée au profit dʼune représentation dʼincompétence (qui assoit lʼextranéité des hommes par rapport à la cuisine) et dʼune résolution heureuse, déconnectée de la précédente, qui nous rassure in fine sur la compétence de lʼhomme domestiqué. En cuisine, quʼimporte que les hommes soient savants ou ignorants, ils révèlent toujours lʼétendue de leurs compétences avec panache.
Ces représentations doivent bien sà »r être historicisées. Aux États-Unis, le paradigme de «  lʼhomme flamboyant  » cité plus haut est connecté au développement, après la Seconde Guerre mondiale, de la pratique sociale du barbecue. Cette pratique dʼexception en rejoint dʼautres selon Thomas A. Adler qui souligne lʼaspect «  événementiel  » de la cuisine des hommes, dans les années 1980 (1981, 51), citant même ses propres pratiques. Parce quʼelle est alors plus rare, la cuisine masculine est associée à un mode festif, qui renforce son caractère spécial, voire supérieur à la cuisine «  ordinaire  » des femmes. La confection des pancakes du dimanche en est un exemple, dans la mesure où pour T. A. Adler, la ponctualité de la performance culinaire masculine permet à la fois la spécialisation (sur des plats identifiables, voire rituels pour la famille) tandis que cette répétition est aussi ce qui va amener les hommes vers lʼexpérimentation, afin de faire varier la routine (du barbecue estival, des pancakes du dimanche). Il écrit ainsi que :
[La] cuisine de Papa existe en contradiction avec celle de Maman : il est dans le festif, elle dans le férial ; il est dans le social, le gastronomiquement expérimental, elle dans lʼordinaire ; il sʼintéresse à des plats en particulier dans des temps marqués, elle dans la diversification et le quotidien; il est dans le jeu, elle est dans le travail352 (51).
Si cette distinction reste présente dans les imaginaires, et informe les figures renouvelées de lʼhomme en cuisine, le caractère dʼexceptionnalité de la pratique culinaire masculine sʼest estompé ces dernières années, ou plutôt, comme nous le verrons ci-après, sʼest redistribué. Michelle Szabo affirme que lʼopposition entre jeu et travail observée par T. A. Adler dans les années 1980 nʼa plus cours aujourdʼhui (2013, 636), retenant que des hommes de plus en plus nombreux assurent la responsabilité de cette tâche. Si elle observe également que les hommes conçoivent plus volontiers la cuisine comme un loisir, elle fait lʼhypothèse que les rôles de genre ne sont peut-être pas directement en cause. Le critère clé qui permet à une personne de considérer la cuisine comme un loisir tiendrait dans la présence dʼenfants en bas âge dont il faut sʼoccuper. Dès que la cuisine se superpose au care des plus jeunes, sa dimension de contrainte (notamment temporelle) surgit et elle peut dès lors être vécue comme une corvée. Parce que les hommes assurent plus rarement le care principal des enfants, ils auraient ainsi lʼopportunité de voir la cuisine comme un mélange agréable de «  travail-loisir  » (Szabo 2013, 626) plutôt que comme une contrainte absolue. Ils sont bien protégés par une forme de privilège de genre, mais indirect : ce nʼest plus lʼassignation des femmes en cuisine qui les limite à cette tâche, mais plutôt lʼinjonction à assurer le travail de care qui les empêche dʼinvestir créativement ce travail comme leurs époux. Si les hommes ne sont pas, en tant que groupe, en France ou aux États-Unis, dépourvus de compétences, la représentation paradoxale de lʼidiot savant en cuisine peut sʼavérer précieuse pour éviter la corvée de la cuisine quotidienne. De manière intéressante, elle peut se retourner, lorsquʼun homme sʼempare dʼune pratique limitée dans le temps, dans le thème, pour en faire un objet dʼinnovation et dʼexpérimentation. Ceci explique aussi que les femmes soient encore à la cuisine, et que les hommes soient en cuisine à la télévision (Cox 2017).
Les stéréotypes de genre impliquent que les savoirs techniques sont souvent associés à la masculinité. Ce lien permet aux hommes de coder leur pratique comme masculine en la technicisant. Le fait dʼapporter une dimension technique, voire de lʼordre de lʼingénierie à la cuisine peut la rapprocher de la pratique gastronomique, mais aussi dʼautres univers comme la mécanique automobile ou le code informatique. Emily Contois évoque ainsi la manière dont cet équipement différencié de la cuisine est devenu un enjeu de marché. Les hommes participent plus en cuisine, cʼest un fait établi, et nʼhésitent pas à sʼéquiper pour mener leur pratique (Contois 2014), dans la mesure où un équipement professionnel va immédiatement permettre de distinguer leur pratique -— notamment sur lʼaxe du genre. Dans son étude, E. Contois observe que ces équipements de la cuisine correspondent à une typologie nouvelle de la pièce dans lʼhabitat, qui relève de la «  cuisine-trophée  »353. La chercheuse explique que ce paradigme sʼest affirmé depuis les années 1990, notamment dans le travail de Terence Conran, dans lequel le rapport entre forme et fonction semble sʼêtre inversé. Si la cuisine-trophée se distingue par lʼintégration dʼéquipements très coà »teux, leur fonction première tient plutôt dans lʼeffet de représentation et la distinction de classe qui en découle.
La cuisine-trophée semble hériter de modèles hybrides antérieurs, comme la cuisine du penthouse de H. Hefner : la table est remplacée par un bar (assise plus haute), les équipements électriques peuvent être dissimulés pour laisser place à des surfaces immaculées, avec un effet de mise en scène lumineux. E. Contois avance que ce sont ici les typologies du bar ou de la boîte de nuit qui sʼinvitent dans le domicile : lʼemprunt de typologies issues des espaces publics participent potentiellement à dé-domestiquer la cuisine, à la rendre habitable pour les hommes. Mais ces trophy kitchen, telles quʼelles sont analysées par E. Contois semblent participer du phénomène de vidage que nous avons évoqué plus tôt. La chercheuse prend ainsi lʼexemple de séries télévisées comme MTV Cribs qui mettent en scène des célébrités dans leur maison, pour expliquer que ce type de représentations a facilité lʼémergence de la cuisine comme signe dʼune aspiration de classe, indépendamment des pratiques concrètes qui y sont réalisées. Un épisode représente le rappeur 50 Cent dans lʼune de ses six cuisines ; il ouvre la porte dʼun four pour découvrir que celui-ci nʼa jamais été complètement déballé : ses grilles sont encore dans leurs cartons (fig. 2.18, Contois 2017). fig. 2.18 : Dans MTV Cribs, des cuisines de luxe, cuisines-trophées sont représentées. On voit ici le rappeur 50 Cent (2007, 2013) découvrir des cartons dans son four. La masculinisation de la cuisine produit donc évidemment un déplacement des représentations de genre, mais aussi de classe. La cuisine luxueuse, pièce de représentation, semble plus facilement appropriable par les hommes—et son usage, du même coup, se fait plus théorique. Si pratique culinaire masculine il y a, elle associera donc souvent expertise, scientificité, art et luxe.
fig. 2.18 : Dans MTV Cribs, des cuisines de luxe, cuisines-trophées sont représentées. On voit ici le rappeur 50 Cent (2007, 2013) découvrir des cartons dans son four. La masculinisation de la cuisine produit donc évidemment un déplacement des représentations de genre, mais aussi de classe. La cuisine luxueuse, pièce de représentation, semble plus facilement appropriable par les hommes—et son usage, du même coup, se fait plus théorique. Si pratique culinaire masculine il y a, elle associera donc souvent expertise, scientificité, art et luxe.
La mode récente du pain fait maison en est un exemple. Dayana Evans évoque en 2018 la vague dʼapprentis boulangers qui apparaît dans la Silicon Valley. Je lʼai évoqué en introduction en parlant du travail dʼEmily Chang : ce contexte professionnel, centré sur lʼinnovation des techniques du numérique est un univers encore particulièrement marqué par la domination masculine. Paradoxalement, cʼest dans ce contexte très masculinisé que D. Evans observe la manière dont des informaticiens ont investi la pratique amateure de la boulangerie. Cette pratique fondamentale, sinon primitive, est revendiquée par les ingénieurs comme une manière de se reconnecter à un ordre manuel, loin des écrans. Toutefois, le vocabulaire et les méthodologies du Web sʼinvitent aussi dans la pratique boulangère, dans laquelle il est soudainement question dʼitération et de «  débogage  »354 (Evans 2018), comme si la fabrication du pain devenait acceptable à condition dʼêtre technicisée355. Les boulangères (professionnelles ou semi-professionnelles) rencontrées par D. Evans lors de son enquête regrettent que ce regain dʼintérêt pour la confection du pain ait surtout permis lʼascension dʼhommes. Les «  prophètes du levain  »356, qui ont le statut dʼexperts dans les medias et bénéficient financièrement de cette mode, sont en effet majoritairement des hommes.

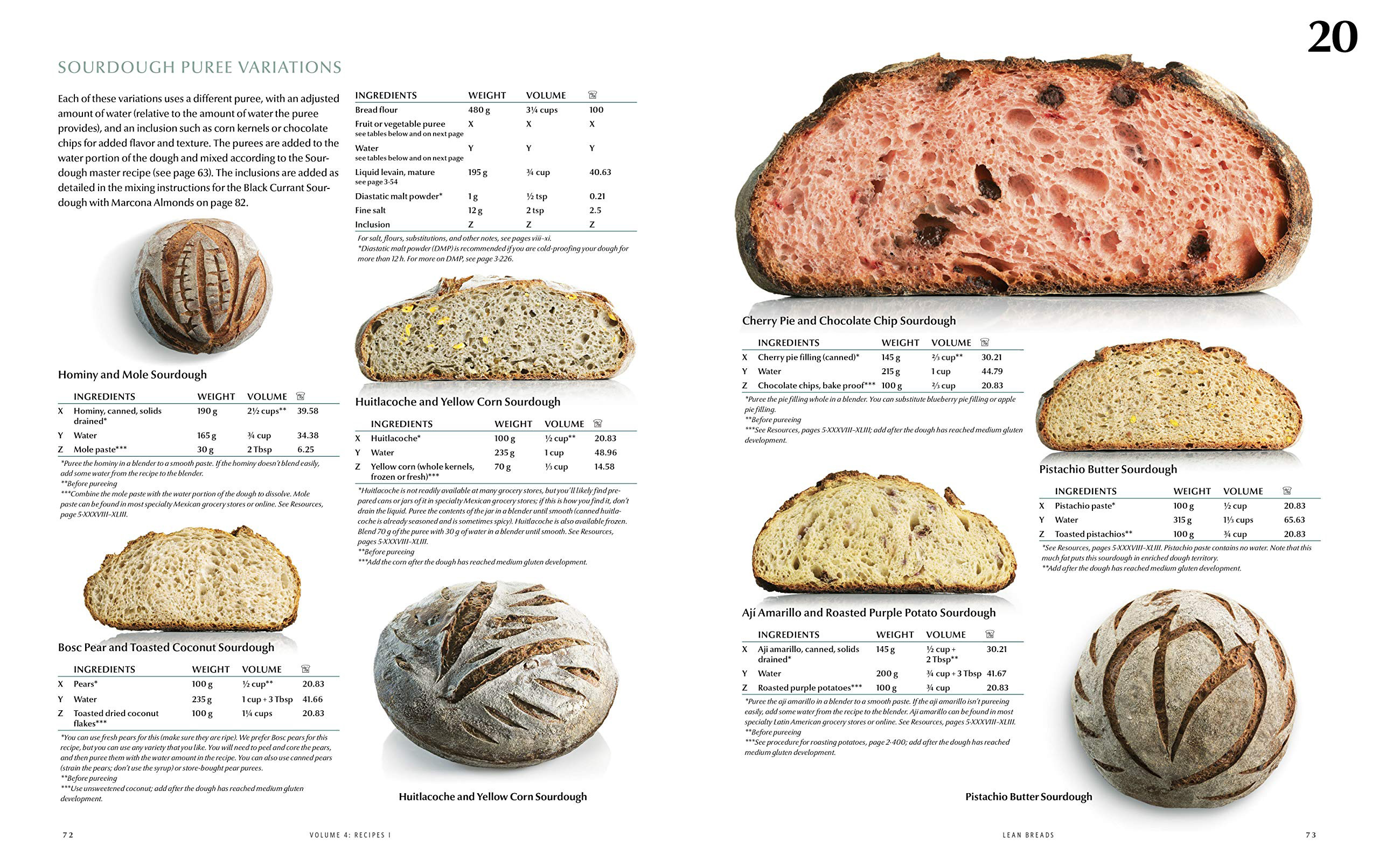
D. Evans mentionne ainsi la parution de Modernist Bread (2017), un livre de cuisine en 5 volumes contenus dans un coffret luxueux, dont la sobriété visuelle et le poids évoquent les plus mythiques codex. Les deux auteurs (Nathan Myhrvold et Francisco Migoya) sont des hommes, et son prix, de 625$, est éloquent. Les choix graphiques à lʼintérieur de lʼouvrage témoignent de cette masculinisation par la scientifisation : le pain, au fil des 2600 pages de lʼouvrage, est historicisé, décortiqué, analysé avec une rigueur encyclopédique dont témoignent les multiples tableaux, schémas à pointillés et autres vues en coupe (fig. 2.19). Lʼimplication masculine en cuisine occasionne donc une requalification de la pratique, mais peut aussi participer dʼune forme dʼappropriation. Dans ce cas, la cuisine masculine intéresse en raison du décalage quʼelle occasionne dʼavec les pratiques féminines, mais aussi en tant que site de production de nouvelles masculinités357. Les cuisines-trophées témoignent donc de lʼinvestissement masculin en cuisine, mais ces nouvelles pratiques ne suffisent pas à décrypter le passage dʼune fonction dʼusage à une fonction principale dʼimage pour cet espace du logis. Qui, dès lors, assume la cuisine du quotidien ? Si on est tenté de répondre les femmes, il faut aujourdʼhui compter avec une nouvelle forme dʼexternalisation dans les applications de livraison sur lesquelles je vais à présent me pencher.
Le vidage apparent de la cuisine peut aussi sʼexpliquer par lʼexternalisation croissante des tâches culinaires. La question ne serait donc plus de savoir si le travail culinaire est un travail «  dʼhomme  » ou de «  femme  », et comment sʼeffectue ce partage genré. Plutôt, il faudrait saisir comment le travail domestique, plus précisément la préparation des repas, sʼexternalise quand elle le peut—quand les participant·es du foyer, financièrement, le peuvent. Cette question est dʼautant plus prégnante dans le contexte de la pandémie du COVID. En France, les deux confinements et autres mesures sanitaires ont conduit les restaurants à fermer leurs salles à plusieurs reprises en 2020–21. En conséquence, le recours à la nourriture à emporter a fait lʼobjet dʼune croissance remarquable358, et des établissements qui ne proposaient jusque-là pas dʼoffre «  à emporter  » ont dà », par nécessité économique, intégrer cette approche. Un pas de côté est donc nécessaire : peut-être que ce nʼest pas la housewife qui a quitté le logis, ou encore son travail qui a été déplacé et requalifié par les hommes, mais plutôt cette catégorie entière de tâches qui a été relocalisée, selon des lignes qui doivent ici être explorées.
Une cuisine sert à cuisiner : à ce stade, ce truisme semble avoir été bien entamé par notre prise en compte du travail salarié féminin (fait social), de lʼindustrie du plat préparé (fait économique et culturel) et de la «  trophisation  » des cuisines selon un imaginaire de classe. Avec la possibilité de recourir très régulièrement à la livraison, les fonctions premières de la cuisine (chauffer, cuire, laver, etc.), de lʼeau à la flamme, semblent devenir obsolètes. À quoi sert un four, quand la nourriture arrive chez soi dans des boîtes fumantes prête à être consommée ? À quoi sert un égouttoir à vaisselle, quand ces mêmes boîtes seront préférées aux assiettes, dans une économie dʼeffort ? Seul le réfrigérateur (pour conserver les restes) et le micro-ondes (pour les réchauffer le moment venu) conservent de leur nécessité dans ce paradigme. Il est évident que je force le trait : recourir à la livraison de plats une ou plusieurs fois par semaine ne signifie pas quʼon abandonne toute pratique culinaire. Toutefois, la croissance des services de livraison, les habitus complexes que ceux-ci créent et les subjectivités spécifiques qui en découlent ne sont pas des faits anodins, ou même externes à la conception des cuisines, et ce, dʼautant plus que les entreprises privées concernées identifient de grands enjeux économiques dans la diffusion de ces habitudes. Nous verrons aussi plus avant que la délégation totale de la préparation des repas à un prestataire externe a été envisagée par des militant·es, réformateurices sociaux et architectes de la fin du XIXe siècle. La manière dont la préparation des repas peut aujourdʼhui être confiée «  en un tap  » à un prestataire privé ne vide pas seulement la cuisine dʼune somme dʼactions mais requalifie—cʼest mon hypothèse—notre relation à la nourriture, notre conception du service et de la tâche domestique, et la manière dont le tissu des villes se tisse et sʼorganise.
Autour de 2010, une nouvelle typologie dʼentreprises émerge dans la Silicon Valley, territoire dʼinnovation numérique propulsée par une économie du venture capital (capital-risque) et de la start-up. Une des valeurs principales de cette économie est la disruption, soit la capacité à renverser un ordre existant par un nouveau, de manière similaire à la promesse dʼinnovation de la technologie : les entreprises, services, techniques ne valent pas en eux-mêmes, mais dans leur capacité à être inédits et à créer des effets de ruptures sur les marchés où ils se positionnent. Dans ce contexte, un ensemble dʼentreprises reposant sur le modèle du pair-à -pair sʼimpose, sur des marchés où existent déjà une offre conséquente, représentée par des acteurs variés, dispersés, mais aussi, parfois, structurés. Airbnb (2008) propose des chambres chez lʼhabitant (en remplacement de la nuit en hôtel) ; Uber (2009) promet la mise en relation de conducteurices directement avec des usager.e.s (en remplacement des taxis) ; enfin, Deliveroo (2013) offre la livraison de plats de restaurants par des livreur·ses à vélo359, et la possibilité de choisir entre toutes les offres existantes, plutôt que de sʼadresser directement au restaurant (qui offre ou non la livraison, selon les cas). Le pair-à -pair est à lʼorigine informé par des principes du partage et dʼéchange, en lien avec la culture du Web Libre. Toutefois, la formulation de ce principe dans le «  capitalisme de plateformes  » (Morozov 2015, 18) instrumentalise cette réciprocité. La mise en relation de deux agents sur la place de marché (læ client·e du restaurant, læ livreur·se), pour toute immédiate et horizontale quʼelle semble, participe en réalité dʼune captation de la force de travail. La concurrence imposée aux travailleur·ses du système permet dʼexploiter un travail à bas coà »t, puisque celui-ci ne relève pas du salariat. Les livreur·ses Deliveroo (fig. 2.20.a), en France, possèdent un statut dʼauto-entrepreneur qui leur permet de contractualiser leur prestation—sans cotiser pour leur retraite, leur sécurité sociale et sans bénéficier de protections en cas dʼaccident ou de maladie.
Ce dispositif est toutefois souvent loué pour ses avantages, notamment pour sa «  fluidification  » du service concerné. Côté usager·e à domicile, le bénéfice est évident : plutôt que de consulter cent menus épars (ce qui paraît de toute façon infaisable), il est possible dʼaller sur lʼapplication et dʼaccéder à une offre de repas élargie.

La couche applicative apportée par Deliveroo coà »te peu cher à lʼentreprise, et lui permet dʼuniformiser une place de marché aux acteurices hétérogènes. Pour le restaurant, le bénéfice est également évident : plutôt que dʼembaucher un livreur·se, de devoir le former, lʼencadrer, et payer les charges liées à son salaire, il est possible dʼaccéder à la livraison sur un mode contractuel, payé à la mission. Cet avantage est légèrement teinté par la concurrence croissante entre les restaurants, dès lors que les dîneur·ses ont accès, par le biais de lʼapplication, à des centaines dʼoffres à portée de tap. Lʼapplication permet également une comparaison plus aisée des prix, et peut stimuler la compétitivité. Enfin, si lʼon suit le discours des plateformes, lʼusager·e pédaleur·se est aussi avantagé : rémunéré à la course, il peut choisir ses horaires, ou encore capitaliser sur des temps courts qui ne seraient pas disponibles pour le salariat. Sur la page de recrutement de Deliveroo, en 2021, le message qui accompagne les portraits de trois fières livreus·es («  Vous décidez où et quand vous livrez  »360) affirme sans ambiguïté des valeurs dʼautonomie, voire de liberté, pour séduire de potentiel·les candidat·es. En lʼabsence de cotisations sociales, le taux horaire est aussi plus avantageux, ce que le site revendique en plus dʼévoquer les pourboires des clients, nous promettant dʼ«  atteindre les objectifs de revenus que vous vous êtes fixés  ». Lʼattractivité de lʼoffre tient aussi dans une récompense à la hauteur de la performance. Les profils des livreur·ses sont notés par les client·es en fonction de leur satisfaction—mais ce système du «  like  », hérité des réseaux sociaux, possède de nombreux effets de bord. Ne pas arriver assez vite pour livrer une commande peut entraîner une mauvaise note, ce qui en retour dégradera la position des livreur·ses dans la file dʼattente gérant les commandes361. Lʼaccent est donc mis sur la vitesse, ce qui incite les cyclistes à prendre des risques : la mort de plusieurs livreur·ses a dʼailleurs été observée (Kristanadjaja 2019), et certain·es de ces non-employé·es des plateformes ont tâché de se structurer pour faire grève (Aizicovici & Songne 2019).
Le modèle de la plateforme permet de promettre un travail libre et flexible, dont lʼenvers est lʼabsence de responsabilité. Deliveroo, ou encore Just Eat ou Doordash sont de «  simples fictions légales  » (Jensen & Meckling 1976 ; Acquier 2017, 92–93), qui fournissent à leurs prestataires un matériel siglé (de lʼimage) mais qui laissent à leur charge tout ce qui relève de lʼoutil concret de travail (force physique du corps, associée aux outils vélo et smartphone) et de son entretien. Aurélien Acquier analyse ainsi le système de ces applications en tant quʼil relève dʼune typologie ancienne de travail, dite du «  domestic system  » (système domestique ; Hounshell 1984 ; Acquier 2017, 94). Dans ce contexte, «  [l]ʼindividu doit constituer et mobiliser un capital préalable […] pour exercer son activité  », à la manière des agriculteurs, au XVIe siècle, qui «  réalisaient une activité ouvrière domestique (souvent textile) durant des périodes de faible activité, pour le compte de négociants avec qui ils entretenaient une relation commerciale  » (Acquier 2017, 94). Deliveroo combine ainsi la capacité de la start-up à générer de vastes profits, tout en faisant descendre le rapport de production au niveau individuel.
Dès 2015, jʼai engagé des recherches pour estimer la part du design, notamment Web et de communication, dans la construction de cette fiction dʼune flexibilité heureuse au travail (Pandelakis 2018), inspiré par le travail de la journaliste étasunienne Lauren Smiley (2015). Je me bornerai à rappeler les conclusions principales de cette étude, puisque je mʼintéresse ici à la manière dont ces nouvelles formes de service domestique impactent la réalisation des tâches domestiques et lʼhabitat.
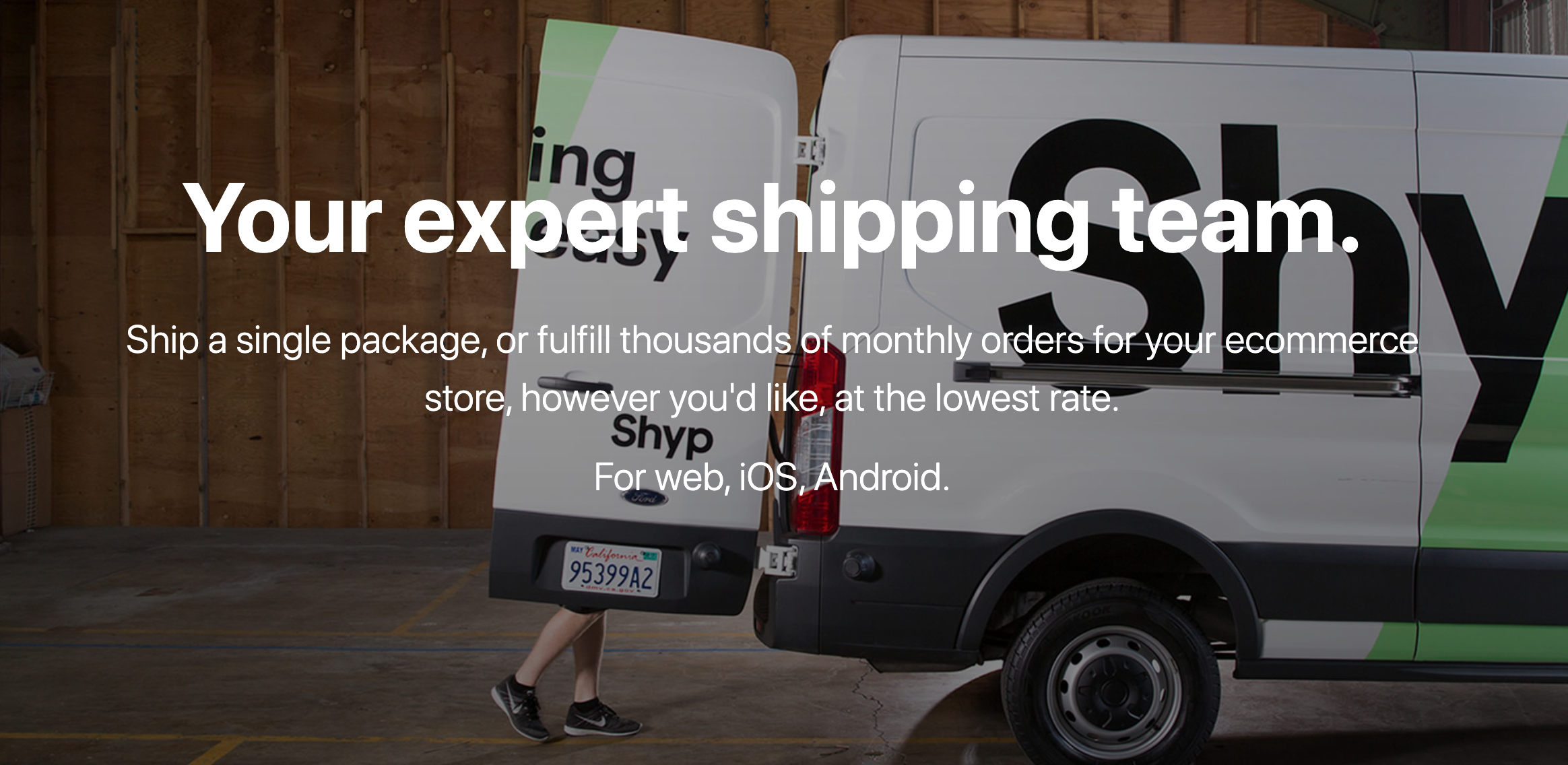
En analysant des plateformes de livraison en 2016, dont Deliveroo, jʼai fait apparaître que le design graphique, en termes sémantiques (visuels et textuels) travaille à gommer la dimension de travail de la livraison. Lʼiconographie de ces sites présente en général des livreur·ses ravi·es, pédalant rapidement mais de manière décontractée vers le couchant californien—une représentation bien éloignée de la réalité du quotidien des livreur·ses payés cinq euros pour trois kilomètres (Kristanadjaja 2019), pédalant aussi vite que possible (parfois dans le froid, sous la pluie) pour ne pas encaisser de pénalité ou être doublé·e par un·e «  collègue  » plus rapide à venir chercher la commande au restaurant362. En élargissant le spectre de lʼanalyse au-delà de la seule livraison alimentaire, le registre visuel employé apparaît de manière plus claire. Sur toutes les applications dont jʼai analysé la communication, un trait est récurrent : le corps des livreur·ses est fréquemment éludé. Cette disparition stratégique peut être un effet du cadrage (fig. 2.20.b) ou de la mise en scène (fig. 2.20.c).

La manière dont lʼapplication maximise la force corporelle de ses travailleur·ses contractuel·les est poétisée par ces images : læ livreur·se, réduit·e à une main magique, apparaît pour apporter de bons petits plats, ou une preste paire de pieds permet dʼobtenir dès quʼon le souhaite des produits de consommation courante. Une stratégie inverse complète cette approche invisibilisante : lorsque læ coursier·e est visible, iel est héroïsé·e. Pour ce faire, iel nʼest quasiment jamais nommé «  livreur  » mais «  magicien  », «  sidekick  », «  rider  » voire même «  ninja  »363 (Pandelakis 2018, 71). Ces anglicismes nappent dʼune enveloppe «  cool  » la réalité du travail produit. Et si cette héroïsation témoigne dʼune visibilité singulière, elle relève en fait dʼune seconde invisibilisation puisque le ninja opère dans lʼombre et le sidekick en marge du super-héros.
Cette manière de situer le travail dans une forme dʼinvisibilité achève de reconstituer le paradigme de la domesticité employée (par lʼaristocratie puis la bourgeoisie) en Occident : læ livreur·ses, comme les majordomes avant eux, sont disponibles à la demande, par tous temps, et opèrent discrètement leur service. Ici, lʼapplication Deliveroo peut-être lue comme un élément de lʼaménagement de la cuisine : son tunnel de consultation complète dʼune certaine manière la surface immaculée de lʼilôt. Comme lʼescalier de service, ou la relégation dans des espaces alternatifs, lʼapplication fabrique un espace dédié à la servitude364. Là où le corps des servi·es côtoyait encore celui des servant·es dans les modèles de service bourgeois, la plateforme assure une plus complète séparation. Le moment de «  contact  » avec læ livreur·se, seule véritable interaction dans cette transaction gérée par smartphones interposés, a même encore diminué à cause des adaptations de service rendues nécessaires par la pandémie du COVID. Enfin, le recours fréquent à des applications de services pour gérer les repas, le ménage, le courrier, les soins corporels ou le soin des animaux a lʼavantage de faciliter le principe du «  à la demande  », mais prend encore un temps conséquent. Il est donc logique, quoique assez ironique, quʼaient émergé des applications visant à fluidifier lʼusage… dʼautres applications. Hello Alfred, telle que L. Smiley la commente en 2015, vise à coordonner grâce à un majordome—dénommé un «  Alfred  »—lʼensemble de services qui coordonnent le fonctionnement de la maison. Le langage employé sur les textes de communication du site sont là aussi éloquents. En 2016, Hello Alfred promettait «  la maison sur pilote automatique  », une «  to-do list  » intégralement résolue (fig. 2.20.d), sʼadressant à des «  individus occupés  »365. Lʼenjeu est de taille : dans un contexte où le coà »t de la vie augmente, il est fréquent que la plupart des membres dʼun foyer soient employés. Management du temps, organisation de la semaine pour préserver le temps personnel et burn out sont des sujets brà »lants sur lesquels il existe une littérature de self-help abondante. Dans ce contexte, la saisie du client comme un individu perpétuellement occupé trouve probablement écho chez de nombreuses personnes, en même temps quʼelle repose sur un ensemble dʼaspirations de classe -— venant ainsi compléter le rêve de la cuisine-trophée.
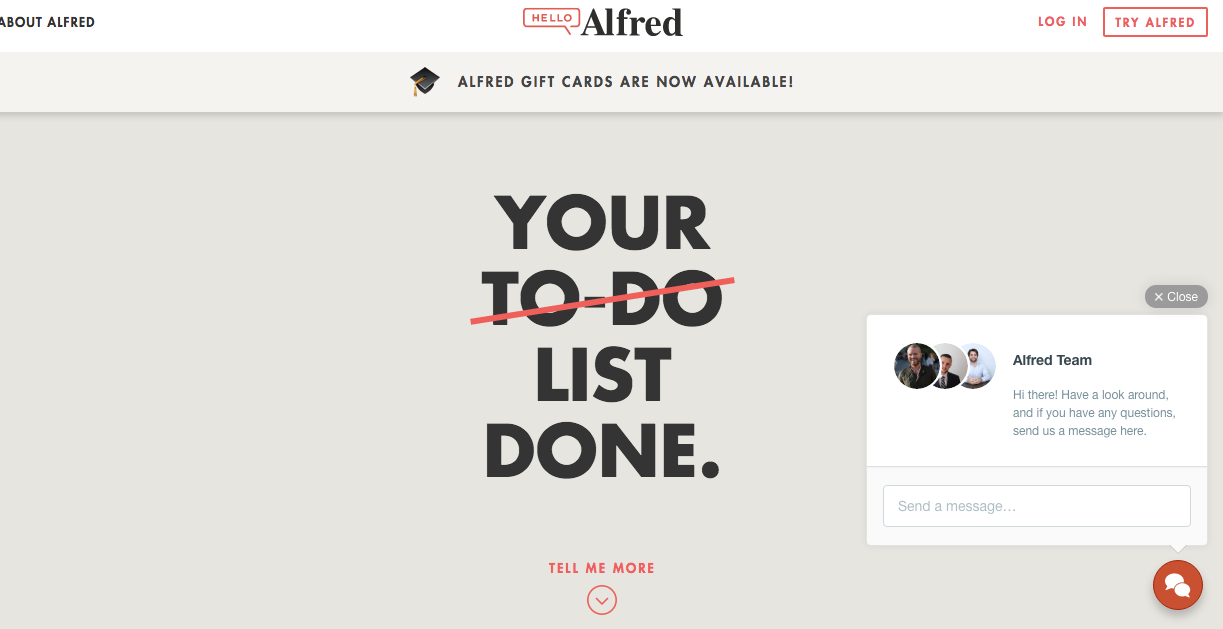
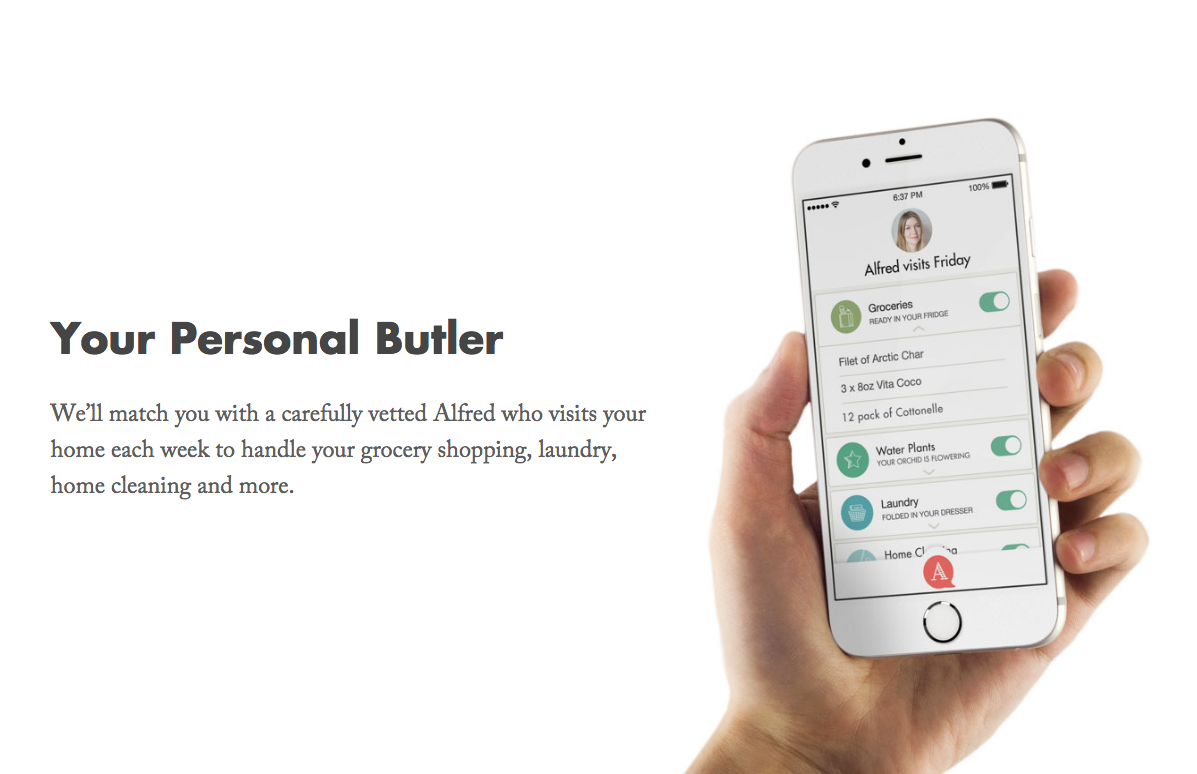
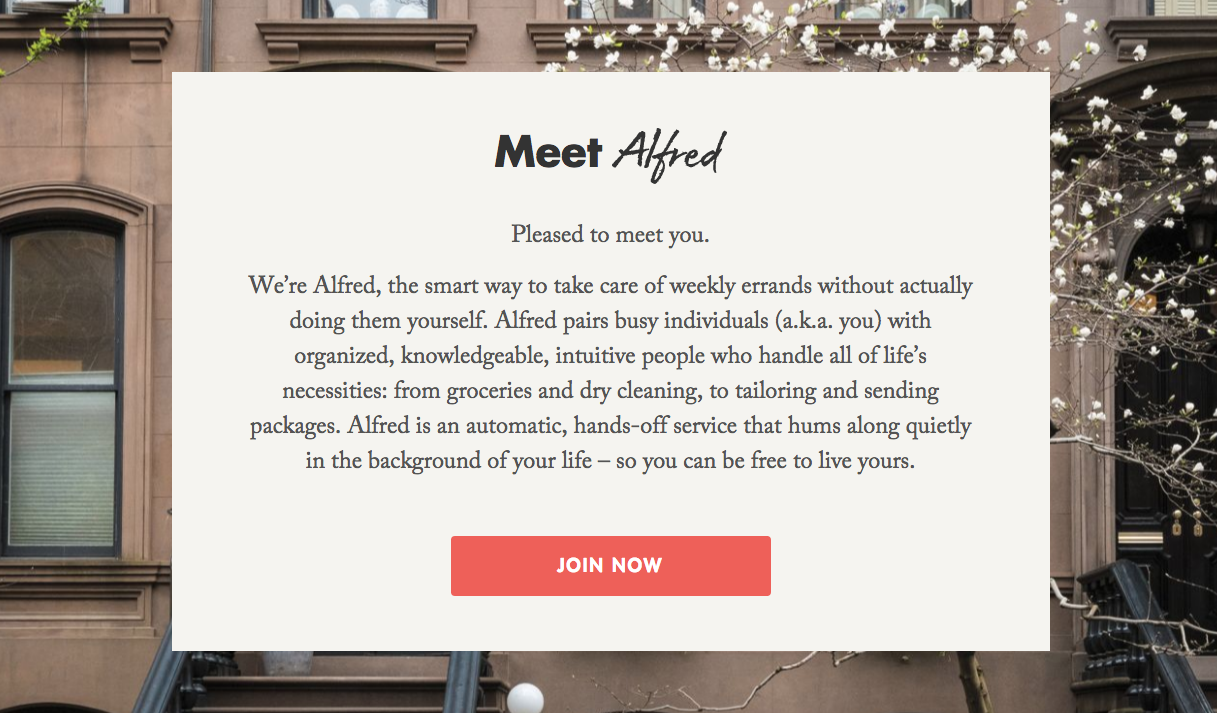
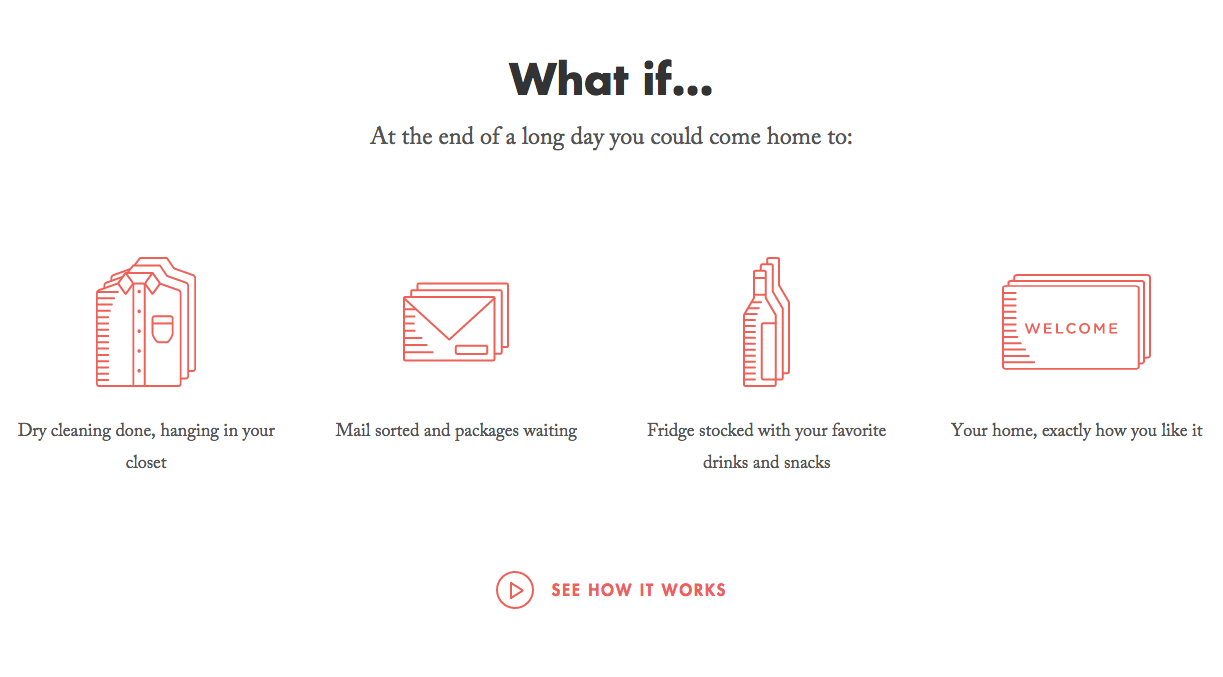
Le travail des livreur·ses Deliveroo consiste en un double retour à des paradigmes anciens du travail : le «  domestic system  » teinte la manière dont iels capitalisent leur temps disponible366, (en marge dʼune activité principale, ou non) tandis que lʼaspiration à une forme de luxe, matérialisée par le majordome, motive le recours au livreur pour les dîneur·ses. Ce double retour en arrière, facilité par le recours à des technologies numériques (sites Web, applications smartphone, 4 ou 5G, GPS) constitue le cadre de lʼémergence dʼun majordomat. Là où la classe domestique a disparu, celle-ci est remplacée par une classe dʼinvisibles, précaires, majoritairement racisé·es, et souvent sans-papiers367. Si ces habitus liés à la livraison participent à brouiller «  les sphères domestique, productive et professionnelle  » (Acquier 2017, 94), ils reconduisent un partage de classe qui semblait révolu, entre servi·es et servant·es, mais sur un mode adouci, «  coolisé  » par le vernis de liberté et de volontariat permis par lʼapplication. Cette culture du service, du «  à la demande  », fait demander à Evgeny Morozov : «  pourquoi les riches ont-ils besoin dʼassistants ?  ». La question est une provocation, car la réponse est évidente : être servi est un signe manifeste du privilège de classe ; il est aussi un avantage stratégique, puisque le professionnel externalisant toute tâche domestique pourra maximiser la participation à son propre emploi. L. Smiley décrit bien comment, dans une délicieuse circularité, la Silicon Valley est peuplée de start-ups qui permettent aux start-upeurs de dédier tout leur temps utile à lʼentreprise. Les livreur·ses sont donc confiné·es (quoique en extérieur) à une forme dʼentreprécariat (Lorusso 2018 ; Ceccato 2023, 149), aliénante selon des modalités que Marx nʼavait pas pu envisager—puisquʼils sont bien propriétaires de leur appareil apparent de production. Mais la situation des confiné·es (ou «  shut-in  » selon lʼexpression de L. Smiley) préférant attendre leur plat chez elleux est tout aussi intéressante, et ses implications pour la cuisine sont réelles. Dans cet univers du service recomposé par Deliveroo, deux occurrences méritent notre attention : Madame de et Clac des doigts.

À Toulouse, le service Madame de (fig. 2.20.e) vend ainsi plus quʼun service ménager. Ici, les employé·es ne sont pas contractualisé·es, mais doivent répondre dʼun code de bonne conduite qui implique de «  se présenter devant [leurs] clients obligatoirement coiffé et maquillé (pour les femmes) et dans une tenue soignée respectant le dress code de la société  », avec «  un tablier toujours propre et repassé  »â€¯; enfin, il est recommandé dʼ«  adresser un signe de reconnaissance à [leurs] clients et faire preuve de distinction dʼéducation à leur égard  ». Les codes graphiques du site (fonte scripte évoquant la distinction et la personnalisation, citations littéraires sur le luxe, images dʼappartements immaculés) construisent ainsi un univers dont le modèle semble remonter à lʼaristocratie, plus encore quʼà la bourgeoisie. Ce «  Madame de  » témoigne ainsi dʼun désir dʼêtre servi, de se distinguer (le nom à particule), tout en gardant la promesse ouverte (sans patronyme précis, cette «  Madame de  » est appropriable par qui veut). Ainsi, tandis que les classes moyennes accèdent au «  à la demande  » contractualisé, les classes supérieures sont invitées à se distinguer en usant dʼun service premium, avec des valets coiffés, tablier repassé, dans une logique de distinction évidente (Bourdieu 1979). Dans les deux cas, cʼest bien à une reconstitution de la classe domestique que nous assistons : le majordomat ne désigne donc pas seulement le travail précarisé des livreur·ses mais une galaxie dʼusages tendant à réinscrire «  lʼêtre-servi  » comme condition désirable des classes dominantes. Le service Clac des doigts possède également une dénomination intéressante. Dans ce cas cependant, ce nʼest pas tant le discours qui réinvente la servitude, quʼun choix technique très significatif. Dans cette logique dʼinvisibilisation propre à lʼéconomie des plateformes de service, la couche applicative elle-même disparaît. Il nʼy a plus dʼapplication, en tout cas, pas visuellement, du côté de lʼutilisateurice. En fait dʼinterface graphique, cʼest lʼapplication de messages du téléphone qui prend le relais. Inutile de passer par une suite de menus, les taps sont réduits à lʼessentiel, à savoir lʼécriture dʼun texto.

Le site Clac des doigts représente ses «  assistants  » comme des petits génies casquettés, flottant dans lʼair, prêts à livrer une chemise repassée, des billets de train ou une valise. La promesse est celle dʼun assistanat complet, mais sa nature nʼest pas claire : qui se trouve de lʼautre côté de lʼapplication de messages ? Un chatbot capable de traiter les demandes ? Des travailleur·ses précaires dans un call center ? Dans un contexte où les services clients sont de plus en plus assurés par des IA (Intelligences Artificielles), la question de la place des humains dans le système se pose. Le «  digital labor  » (Cardon & Casilli 2015) se caractérise aussi par ces tâches simples que lʼon croit réalisables par des robots, à la manière du Mechanical Turk dʼAmazon368. «  Robot  », dont lʼétymologie nous ramène au tchèque robota signifiant «  esclave  » désigne très bien la condition des ces nouveau·elles travailleur·ses exploité·es par les plateformes. Mis·es en scène comme de joyeux génies domestiques dans les communications visuelles de ces entreprises, iels sont en réalité·es dans la couche applicative, robotisé·es dans la mesure où iels délivrent un service proche du chatbot. Ce nʼest dʼailleurs pas un «  bonjour  » qui active le service, mais le texto «  Clac ?  » qui, une fois le désir formulé pourra devenir «  Clac !  » pour valider la requête (fig. 2.20.f.1 & 2). Lʼinterface texto pourra donner lʼimpression quʼun chatbot est un humain ; mais la validation par commandes, et lʼinstantanéité dʼailleurs promise par lʼexpression «  clac des doigts  » donne à lʼhumain derrière lʼinterface la fonction de chatbot. Lʼidéal dʼun numérique qui libérerait les humains des tâches les plus viles, pour peu que lʼon y croit encore, vole ici en éclats : en étant concurrencé·es par les IA, les travailleur·ses les plus précaires nʼont dʼautres choix que dʼadopter leur modèle de travail (fragmentation du temps, rémunération à la microtâche, grand répétitivité et monotonie).
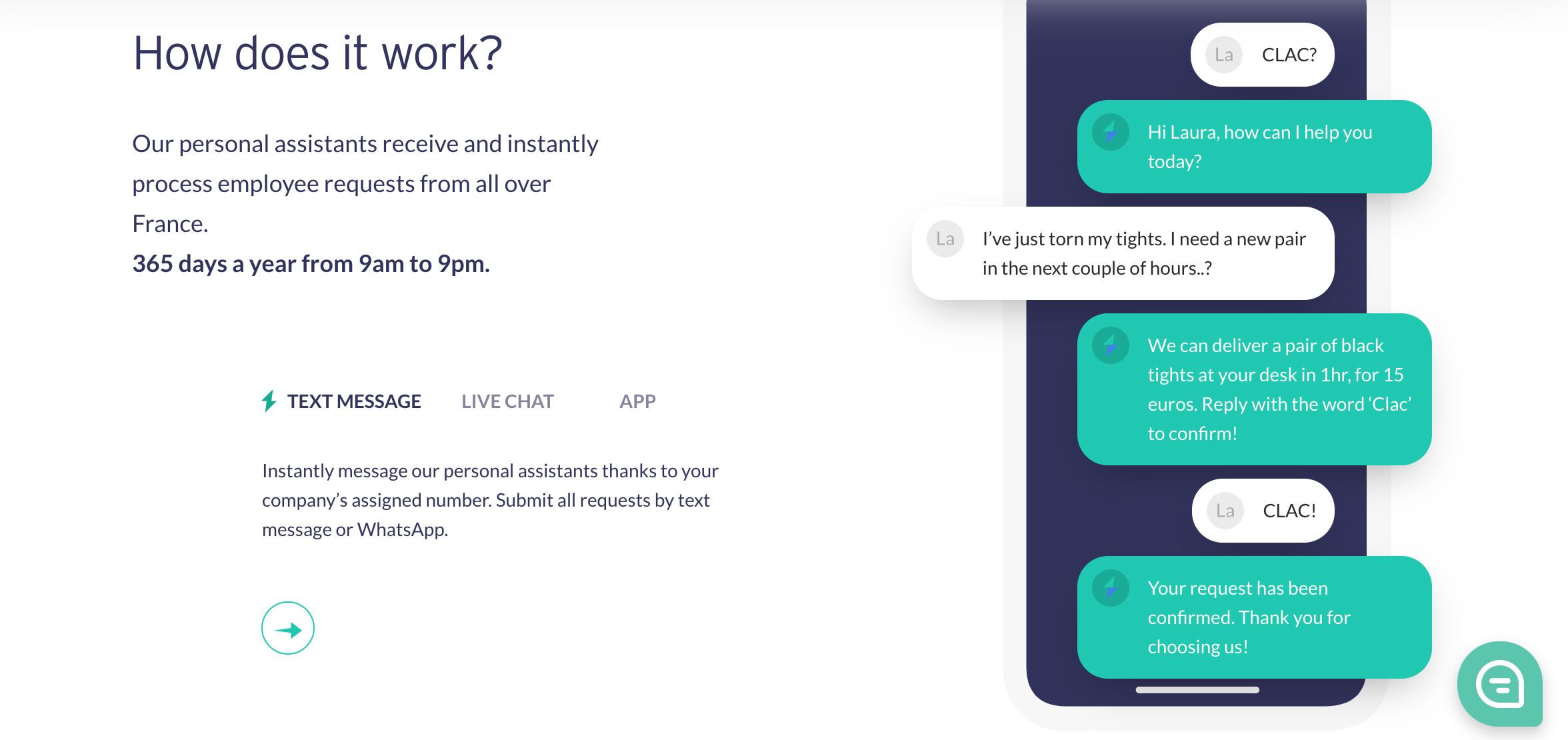
Ma critique ne concerne pas seulement les subjectivités des travailleur·ses qui sʼemploient à livrer petits plats et autres biens de consommation. En effet, les effets de cette économie du «  à la demande  » me semblent délétères de manière transversale ; et même si ce sont bien les livreur·ses qui sont exploité·es dans ce contexte, les conséquences pour les usager·es ne sont pas nulles, dʼautant que leur «  privilège  » de classe est assez relatif, ce type de service étant finalement assez bon marché pour attirer des usager·es de classe moyenne, voire de classes plus modestes. Cʼest dʼailleurs un des attraits de lʼéconomie des plateformes : en abaissant le coà »t du travail, elles rendent «  lʼêtre-servi  » accessible à des populations qui ne pouvaient jusque-là pas y accéder. Cette condition sʼincarne plus précisément, dans le cas de la livraison alimentaire à ce que P. B. Preciado nomme le «   cyber-sédentarisme  » (Preciado 2011, 164), en en relevant les symptômes précurseurs chez H. Hefner.

Les communications des entreprises sont là aussi éloquentes. En 2016, lʼentreprise de livraison Allo Resto369 fait campagne (spots, affiches) en représentant ses usager·es au restaurant, mais en pyjama (lʼune avec un masque de beauté, les autres avec leurs enfants jouant au pied de la table, fig. 2.21.a). Le slogan explique cette collusion des univers, puisque lʼentreprise promet «  [l]a cuisine dʼun restaurant, le confort de la maison  ». Ces publicités inventent pour leurs client·es ce que L. Smiley nomme une vie de «  cloîtrés  » (shut-in) : un quotidien où lʼon se déplace pour aller au travail, dont on rentre tard, pour mener une vie de reclus dans son appartement-boîte où les biens sont livrés par Amazon Prime et la nourriture par Deliveroo. Contemporain de la campagne Allo Resto, un article de Wired (assez daté depuis que la pandémie du COVID est passée par là ) promet que la réalité virtuelle nous permettra bientôt de travailler de chez nous «  en portant notre pyjʼ taché de crème glacée  »370 (Myers 2016). Allo Resto, dans un geste de novlangue qui caractérise bien ces entreprises, ose même parler de soirées «  pyzzama  » : ce nʼest plus lʼhomme-pizza repéré par F. De Singly (2007, 71) mais un autre transfuge qui émerge, puisquʼil nʼest même plus nécessaire dʼouvrir le carton de la pizza surgelée. Le travailleur cloîtré incarné par Hefner était donc visionnaire à plus dʼun titre. Il lʼest devenu par la force des choses, dans la mesure où les confinements liés à la pandémie du COVID ont imposé le télétravail (sans réalité virtuelle, toutefois). Mais cette concrétisation a aussi été préparée par le déploiement dʼun imaginaire dans lequel le pyjama est un signifiant maître : il sʼagit de célébrer le fait de rester chez soi, et dʼembrasser une forme de détente synonyme dʼun relâchement complet des exigences sociales.
À cet égard, le pyjama, vêtement dʼintérieur, incarne la sphère privée mais aussi, plus encore, le fait de se lover dans celle-ci, dʼen profiter au maximum. Allo Resto, rachetée en 2014, et renommée du nom de son entreprise-mère Just Eat en 2018, en offre un exemple avec une nouvelle campagne de publicité (agence Buzzman). Dans celle-ci, un voyageur du futur sʼinvite dans des périodes historiques pour vanter les mérites du système de la livraison371. Le voyageur apporte ainsi son message au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle, expliquant que «  dans le futur, il y a Just Eat  », ce qui permet dʼéviter dʼattendre sa nourriture. Il est intéressant de constater que les deux sociétés esquissées -— les seigneurs du Moyen-Âge, fig. 2.21.c : Le voyageur temporal Just Eat arrive au Moyen-Âge (2016). et la royauté dʼavant la Révolution française (fig. 2.21.b) -—sont extrêmement verticales, et reposent sur des régimes de servitude solidement établis (avec des classes de serfs et de domestiques). Le voyageur du futur apporte donc dans le présent un modèle ancien unissant servant·es et servi·es, plutôt quʼil nʼapporte le futur dans le passé. De servant·es, il nʼy a dʼailleurs nulle trace dans ces spots publicitaires : læ client·e peut alors sʼidentifier au chevalier ou à Marie-Antoinette, læ domestique étant de manière pratique absorbée par lʼécran du téléphone.
fig. 2.21.c : Le voyageur temporal Just Eat arrive au Moyen-Âge (2016). et la royauté dʼavant la Révolution française (fig. 2.21.b) -—sont extrêmement verticales, et reposent sur des régimes de servitude solidement établis (avec des classes de serfs et de domestiques). Le voyageur du futur apporte donc dans le présent un modèle ancien unissant servant·es et servi·es, plutôt quʼil nʼapporte le futur dans le passé. De servant·es, il nʼy a dʼailleurs nulle trace dans ces spots publicitaires : læ client·e peut alors sʼidentifier au chevalier ou à Marie-Antoinette, læ domestique étant de manière pratique absorbée par lʼécran du téléphone.  fig. 2.21.d : Le voyageur temporal Just Eat dans un boudoir digne du Petit Trianon (2016).Le voyageur est vêtu dʼune robe de chambre, variante du pyjama qui signe la décontraction et évoque les soirées aujourdʼhui consacrées par lʼexpression «  Netflix and chill  »372. Cette vie cloîtrée, de façon plus évidente aujourdʼhui dans le contexte du COVID, a quelque chose dʼun piège, ce quʼobservait déjà L. Smiley en 2015. Cette détente complète ne fonctionne réellement quʼen connexion avec un travail éreintant, dont elle constitue lʼexutoire. Quand le restaurant sʼinvite dans la maison, comme dans les publicités Just Eat, cʼest pour mieux, semble-t-il, nous gâter de plats professionnels dans lʼespace privé. Mais on sait que lʼabattement de cette frontière public-privé ne se traduit pas, en réalité, par un accroissement du temps de loisir. Et la promesse dʼune vie en pyjama ne pèse pas lourd, lorsque celle-ci permet en réalité au travail (à ses contraintes, sa temporalité, son stress) de sʼinfiltrer à domicile. Sommet de détente, la soirée Netflix & Chill entérine lʼidée dʼune vie confinée, dont il nʼest plus nécessaire de sʼextraire puisque la rentabilité -— par le télétravail, la consommation audiovisuelle et alimentaire -—est assurée.
fig. 2.21.d : Le voyageur temporal Just Eat dans un boudoir digne du Petit Trianon (2016).Le voyageur est vêtu dʼune robe de chambre, variante du pyjama qui signe la décontraction et évoque les soirées aujourdʼhui consacrées par lʼexpression «  Netflix and chill  »372. Cette vie cloîtrée, de façon plus évidente aujourdʼhui dans le contexte du COVID, a quelque chose dʼun piège, ce quʼobservait déjà L. Smiley en 2015. Cette détente complète ne fonctionne réellement quʼen connexion avec un travail éreintant, dont elle constitue lʼexutoire. Quand le restaurant sʼinvite dans la maison, comme dans les publicités Just Eat, cʼest pour mieux, semble-t-il, nous gâter de plats professionnels dans lʼespace privé. Mais on sait que lʼabattement de cette frontière public-privé ne se traduit pas, en réalité, par un accroissement du temps de loisir. Et la promesse dʼune vie en pyjama ne pèse pas lourd, lorsque celle-ci permet en réalité au travail (à ses contraintes, sa temporalité, son stress) de sʼinfiltrer à domicile. Sommet de détente, la soirée Netflix & Chill entérine lʼidée dʼune vie confinée, dont il nʼest plus nécessaire de sʼextraire puisque la rentabilité -— par le télétravail, la consommation audiovisuelle et alimentaire -—est assurée.

Si ce portrait semble forcé, quʼon pense seulement aux stratégies de ces entreprises : déjà confortées par une croissance remarquable pendant la pandémie en 2020–21, elles adaptent leurs modèles pour une consommation fidélisée, car régularisée. Comme Uber ou Airbnb, les entreprises de livraison de nourriture, dont Deliveroo, ont parié à leurs débuts sur des tarifs très attractifs pour attirer les client·es. Or, comme lʼexplique Heather Haddon dans un article du Wall Street Journal, les promotions par bon cadeau incitent à la volatilité des client·es, ce qui est dommageable pour ces entreprises (2019). Lʼobjectif est donc de suivre le modèle dʼabonnement imposé par Amazon Prime : en échange dʼun paiement mensuel, lʼusager·e aura ainsi accès aux meilleures offres, ou se verra offrir un tarif de livraison préférentiel (Haddon 2019). Ce système permettra donc de naturaliser le principe de la livraison, en poussant à la consommation un·e client·e soucieux·se de «  rentabiliser  » son abonnement. Lʼobjectif est donc de créer des «  super-usagers  », qui, une fois habitué·es à externaliser la fabrication de nourriture, seront peut-être moins enclins à refuser la contractualisation de lʼéducation, de la médecine, ou dʼautres domaines de la vie quotidienne.
Enfin, même si je me focalise sur lʼhabitat, les conséquences pour la ville et lʼurbanisme sont loin dʼêtre neutres. En 2019, mes étudiant·es me signalent déjà comment la livraison réorganise la rue. Un étudiant livreur mentionnait lʼexistence de guichets séparés dans les restaurants McDonalds : la devanture permet le passage des client·es venu·es consommer sur place, tandis que dans une ruelle, un guichet permet la distribution des plats à livrer aux livreur·ses, souvent majoritairement racisé·es. Je nʼai pas trouvé de données chiffrées sur ce dernier point, mais une observation empirique mʼa souvent permis de constater à quel point ce sont de jeunes Noirs ou Maghrébins qui forment le gros des troupes des livreur·ses Deliveroo, ce que confirme le témoignage du livreur militant Jérôme Pimot373 sur son blog (2019).
Le partage de classe est donc aussi potentiellement racial, et ses lignes se retrouvent directement dans lʼaménagement des villes, notamment des pas-de-porte des restaurants. Par ailleurs, la typologie architecturale du restaurant est aussi modifiée par cette évolution des habitudes. Face au recours massif à la livraison forcé par la fermeture légale des restaurants en contexte pandémique, les «  cloud kitchen  » (Singh 2019) ou «  dark kitchen  » (Pointel 2021) sont devenues plus répandues. Ces restaurants se limitent ainsi à une cuisine sans salle, offrant un modèle où la cuisine de restaurant se consomme uniquement chez soi, ce qui induit une rupture forte avec le modèle traditionnel où le service «  à emporter  » est secondaire. Même si les patron·nes de ces établissements peuvent avoir envie dʼouvrir des restaurants avec une salle une fois la pandémie terminée (Pointel 2021), on peut se demander si ce modèle du restaurant-guichet ne va devenir une typologie de lieu, redéfinissant alors les centres-villes. Ceux-ci, déjà désertés par les dîneur·ses qui préféreront peut-être le confort du pyjama, seraient alors composés — dans une perspective dystopique — de devantures-guichets distribuant les mets, à la manière de ces terminaux Amazon qui se substituent aux services postaux, et de cohortes de livreur·ses siglés pédalant dans toute la ville374 pour satisfaire les désirs des confiné·es.
Si le restaurant se passe de la salle dans cet imaginaire, il est possible que lʼappartement se passe de cuisine. Certain·es architectes envisagent sérieusement cette optique, telle Anna Puigjaner qui propose une Kitchenless House (2019). En réalité, ce projet est une dénomination volontairement provocatrice de la part de lʼarchitecte et chercheuse, qui propose un système dʼexternalisation alternatif sur lequel je reviendrai ci-après, dans la partie dédiée aux cuisines communautaires. A. Puigjaner ne propose pas réellement de se débarrasser de la cuisine, plutôt de la condenser et de re-communaliser lʼeffort qui lui est associé. Mais des entreprises privées sʼattaquent plus frontalement à cette question : WeLive propose ainsi des appartements, mais aussi des chambres sans cuisine, avec des équipements partagés (Lyster 2018). La journaliste Arwa Mahdawi explique dans The Guardian que la surface des cuisines sʼeffondre aux États-Unis et en Angleterre, citant un rapport UBS qui postule que dʼici 2030 «  la plupart des repas actuellement préparés à la maison [seront] commandés en ligne et livrés par des restaurants ou des cuisines centrales  »375. La distinction est dʼimportance : le premier choix renvoie clairement à une logique privée où le choix alimentaire est effectué sur une place de marché, sans aucun contrôle des conditions de livraison, tandis que le second implique une révision complète des modes de vie, pensés de manière communautaire, comme le propose dʼailleurs A. Puigjaner. Arwa Mahdawi évoque à son tour la start-up Common qui sʼest emparée de lʼidée, proposant des lieux de vie proche dʼhôtels, néanmoins accessibles grâce à un système de loyer, et nʼincluant pas de cuisine (2018).
On peut ici se demander si lʼaspect attractif dʼune telle offre nʼa pas vocation à changer la norme de ce qui «  fait habitat  ». Il nʼest pas impossible que ces chambres sans cuisine soient adoptées car elles sont moins chères, avant de devenir le seul espace auquel les plus pauvres aient accès -— le modèle des «  chambres de bonnes  » aujourdʼhui occupées par des étudiant·es invite ainsi à être vigilant·e quant à des programmes utilisant lʼaspect politique et progressiste dʼune cuisine partagée, pour ensuite capitaliser sur lʼéconomie dʼespace réalisée. Avant dʼanalyser comment cette externalisation communautaire de la cuisine peut être envisagée de manière positive, il me faut achever lʼanalyse dʼune cuisine qui, à défaut dʼavoir disparu, est redéfinie par les écrans, les applications smartphone et les intelligences artificielles que nous avons déjà croisées en parlant de livraison. Je vais à présent montrer comme la question du majordomat dépasse celle des corps des livreur·ses, et pose des problèmes de subjectivité liés au numérique au cÅ“ur de la cuisine.
Lʼanalyse de la relation des services de livraison à la cuisine nous a permis de montrer comment cet espace privé est en réalité traversé par des usages et donc des rapports de pouvoir qui tiennent de lʼespace public, plutôt que domestique. Aussi, la livraison est plus quʼun service qui vient ponctuellement relayer le travail de la personne investie dans la préparation des repas : elle recouvre un paradigme dʼexternalisation qui peut relever de lʼexploitation (le majordomat) ou à lʼopposé impliquer des répartitions alternatives du travail (dans le cas des cuisines communes que nous étudierons plus avant). Enfin, la livraison peut être lue comme participant du vidage de la cuisine, puisquʼelle évacue, au moins ponctuellement, la nécessité de cuisiner et nettoyer. Plus encore, la nourriture livrée constitue la cuisine comme hub, cʼest-à -dire comme terminal destiné à la réception de mets, mais plus à leur production. Si ce propos semble contradictoire avec lʼaffirmation dʼun investissement croissant de la cuisine perçue comme trophée, il me faut noter que la cuisine apparemment vide est le site dʼun mouvement paradoxal dʼévacuation-investissement. Le dépouillement du décor laisse supposer un délaissement ; la livraison esquisse une obsolescence ; en réalité, cʼest une cuisine ouverte à bien dʼautres activités que la cuisine, à une pluralité de pratiques que nous voyons ici émerger grâce à ces multiples analyses.
Je serai amené à expliciter plus loin la manière dont les progrès techniques ont participé dʼune conception rationnelle, voire tayloriste, de la maison et de la cuisine. Jʼenvisagerai alors les implications historiques dʼune mécanisation du travail féminin de manière plus complète. Ici, jʼaborde la question de la numérisation du logis, et de la manière dont celle-ci, très spécifiquement, prolonge à la fois le «  vidage  » apparent de la cuisine et une forme de majordomat. Je me bornerai donc à observer que la cuisine, comme la sphère domestique tout entière, a bénéficié de progrès techniques dʼabord pensés pour lʼindustrie. Par ailleurs, la manière dont les écrans (télévisés, puis informatiques) ont pénétré la domus dans son ensemble ont participé à faire de la cuisine, entre autres, un hub recevant -— avant des plats livrés -—des messages, des images, dans une logique multimedia, voire hypermedia quʼil est aujourdʼhui banal dʼobserver.
Cette connexion de la cuisine à lʼaudiovisuel ne vient pas seulement dʼune intrusion exogène des écrans, qui viendrait a posteriori. En effet, les dispositifs techniques propres à la cuisine, comme le frigidaire, résultent des progrès techniques de lʼère moderne, et ont émergé de manière contemporaine du cinéma et de son développement. Plus encore, la manipulation des dispositifs techniques peut aussi opérer sur le mode du spectacle, tel le réfrigérateur qui dévoile son contenu dans les spots des années 50—notamment avec le Foodorama de Kelvinator, qui revendique par son nom sa proximité avec le divertissement audiovisuel (Widendaele, à paraître376). Jʼévoquais aussi, plus haut, la manière dont la consommation de nourriture sʼassocie à la consommation de contenus audiovisuels, la pizza sʼassociant à la soirée Netflix, ou Uber Eats à un match de football. Ce continuum Å“il-bouche, assiette-écran, assez évident dans la manière dont le terme alimentaire de «  binge  » (sʼempiffrer, en français), est devenu synonyme de la consommation compulsive de séries377.

Les dispositifs numériques, en somme, ne sont pas des techniques externes qui viendraient contaminer après-coup la cuisine. Leurs éventuelles innovations sʼinscrivent en réalité dans une longue tradition de connexion entre lʼespace cuisine et la production audiovisuelle. Il nʼest dʼailleurs pas rare que la télévision soit placée dans la cuisine, quand ce nʼest pas un deuxième poste qui est dédié à cette pièce. Le designer Ugo La Pietra, en 1983, imagine sur un mode critique et semi-dystopique le «  tout-confort télématique  » dans son installation à la Foire de Milan : dans sa projection isométrique de lʼhabitat, tous les équipements, du lit à la coiffeuse, de la table aux toilettes sont associés à des dispositifs de captation ou de diffusion vidéo (2023[1983] ; fig. 2.22). Lʼexposition ne montre pas une maison qui se numérise (ou se télématise) mais plutôt une condition humaine media qui redéfinit lʼhabitat. La technicisation de la cuisine par le numérique (ou son avatar pré-Internet, la télévision) est donc une question ancienne, qui demande une analyse des dispositifs précis qui promettent dʼêtre inclus dans les années à venir.
Pour éclairer cette numérisation de la cuisine, je propose dʼétudier un dispositif de réfrigérateur connecté produit par Samsung en 2015, en utilisant -— de manière un peu contre-intuitive -—un article de recherche du début des années 2000 écrit par Genevieve Bell and Joseph « Jofish » Kaye dans la revue Gastronomica. Les deux chercheureuses observent en effet que la technologie sʼest invitée dans lʼespace domestique selon des modalités évolutives. Leviers majeurs dans la concrétisation de la «  maison de demain  »378, les technologies restent centrales dans le paradigme -—émergent dans les années 2000 -—  de la maison connectée ou de la «  smart house  »379 (Bell & Kaye 2002, 49). Si la smart house comme la «  maison de demain  » relèvent dʼimaginaires solutionnistes sinon messianiques de la technologie, le travail de G. Bell et J. Kaye a le mérite de montrer que, y compris dans les grandes entreprises actrices des secteurs de lʼélectroménager et de lʼélectronique, la possibilité dʼune opacité des systèmes a été prise en compte. Il existe aujourdʼhui toute une critique de la «  boîte noire  » (Masure 2019) : les objets qui relèvent de ce principe masquent un dispositif technique aux effets délétères pour les relations humaines, la subjectivité ou encore la vie privée derrière une surface qui ne rend pas ses effets intelligibles. Cette critique actuelle peut faire oublier quʼil a existé une conscience de ce problème, notamment chez Philips qui dans son exposition La casa prossima futura (1999) affirme que «  les produits ressembleront aux objets et meubles familiers, avec une pertinence et une signification accrues par rapport aux ‹ boîtes noires › dʼaujourdʼhui  »380 (Bell & Kaye, 2002, 38). Il est aussi question que les technologies les plus pointues soient «  incorporées dans des objets anthropologiquement signifiants, comme un tablier, une balance, un grille-pain en verre  » (Bell & Kaye, 2002, 59 ; cf. infra. chap IV)381. Un rapide coup dʼœil aux surfaces noires, opaques et lisses des box internet, tablettes et autres assistants vocaux dʼaujourdʼhui peut donc nous plonger dans la perplexité, puisquʼils semblent aller à lʼencontre des vÅ“ux formulés par le design prospectif -— pourtant issu dʼune grande entreprise ! -—dʼil y a vingt ans.
G. Bell et J. Kaye utilisent plusieurs terrains réalisés dans des cuisines européennes pour appuyer leur thèse, selon laquelle considérer la série dʼactions en cuisine «  acheter -— cuisiner -— manger -— nettoyer  »382 est insuffisante et ne rend pas compte de la part «  [dʼ]expérience  » qui se produit en cuisine (Bell & Kaye 2002, 30 ; 29). Assez typique de la pensée du design de son époque, lʼessai appuie sur une dimension contextuelle pensée comme expérientielle, lʼexpérience elle-même se trouvant définie par le lien à lʼautre, dans un esprit très caractéristique du «  global village  » amené par les débuts dʼInternet. Les dispositifs vus comme respectant ce programme de connection émotionnelle peuvent aujourdʼhui faire sourire, soit par leur aspect gadget (un terminal diffusant une odeur provenant dʼune autre cuisine, ou une machine à café donnant les nouvelles) ou leur accomplissement troublant (les auteurices promettant la possibilité dʼun dîner à distance, par écrans interposés) (Bell & Kaye 2002, 29–30). Si les auteurices rappellent fort justement, dans leur manifeste («  Kitchen manifesto  ») la nécessité de prendre en compte le contexte et la réalité des pratiques (Bell & Kaye 2002, 32), leur propos oppose lʼefficacité à lʼexpérience, réduite à un contenu émotionnel flou, qui prend le risque de surinvestir la psychologie des usager·es, ou de permettre des formes de justification, par le discours, de dispositifs inadaptés383. Par ailleurs, la cuisine peut être vue comme médiatique dans cet essai, dans la mesure où elle permet la mise en relation de contenus, notamment à partir de la nourriture, qui devient le cÅ“ur dʼun réseau dʼhyperliens—mais sans que lʼon sache bien ce quʼapporte cette mise en connexion dʼinformations par le numérique.
Ainsi, iels évoquent le projet counterActive de Wendy Ju (2001), dans lequel «  [l]es recettes contiennent des liens et des faits en exergue ; une recette de tarte aux cerises vous dira quel est le nombre de cerises moyen sur un arbre, et une recette de poulet à la Provençale inclura les images et les sons dʼun marché français typique  »384. La nécessité de ces informations est douteuse, et peut même faire sourire, de nos jours : elle témoigne de lʼémerveillement face à un Web encore jeune et bourgeonnant, ne comportant alors «  que  » 38 millions de sites Web, contre presque deux milliards aujourdʼhui385. Cependant, il me semble que le texte capture de manière intéressante et contradictoire la nécessité dʼune analyse contextuelle, en même temps que du pouvoir de fascination que possède lʼintégration de technologies numériques dans lʼespace domestique. Ainsi, plutôt que de mʼamuser dʼexemples de projets «  datés  », je propose de montrer en quoi les dispositifs dits innovants des années 2020 investissent des imaginaires très proches, voire, contreviennent aux intuitions de certain·e.s observateurices ayant très vite vu les limites des «  boîtes noires  ». Par ailleurs, nous verrons plus loin que le concept dʼun plan de travail-écran, formulé en 1999 par W. Ju fait encore partie de projections pensées par les marques, dans des démonstrations relevant, dans lʼesprit, de la moderne «  maison de demain  »386.

Le Family Hubâ„¢ de Samsung ressemble encore à un réfrigérateur (fig. 2.23.a) : pour autant, est-il «  anthropologiquement signifiant […]  » ? Sa forme générale est celle dʼun réfrigérateur standard, double porte, de teinte sombre. Ce type de modèle est souvent identifié par les marques comme «  américain  » en raison de son grand format. Il est aussi communément muni dʼun distributeur à glaçons, ce qui est le cas du Family Hubâ„¢, qui en est équipé sur sa porte gauche. Lʼinnovation réelle se situe cependant sur la porte droite, pourvue dʼun écran tactile permettant dʼaccéder à une interface. Pour mieux comprendre lʼintention de cet ajout, il faut recontextualiser le réfrigérateur dans lʼhistoire des technologies. Siegfried Giedion fait apparaître toute la complexité du processus de réfrigération lorsquʼil écrit à ce sujet en 1948. Le processus technique qui consiste à produire du froid est complexe, et nécessite un dispositif massif dont il a été difficile de réduire lʼencombrement. Une des premières machines, conçues par Ferdinand Carré, est la sensation de lʼexposition universelle de Londres en 1862 : elle parvient à générer dʼénormes blocs de glace, mais occupe un espace considérable (Giedion 1948, 601). Comme souvent dans lʼhistoire de lʼélectroménager, il sʼest donc agi dʼamener un dispositif technique «  à lʼéchelle de la cuisine  »387 (Giedion 1948, 602). Pendant longtemps, le réfrigérateur hérite des défauts liés à sa taille, et reste un des seuls éléments à ne pas être englobé par les surfaces unifiées de la cuisine équipée (Giedion 1948, 603). Par ailleurs, sʼil est aujourdʼhui un des équipements les plus traditionnels de lʼhabitat (à la différence du lave-vaisselle ou du lave-linge), son fonctionnement nʼavait rien dʼévident : il fallait à lʼorigine (au XIXe siècle) faire chauffer le dispositif pendant plusieurs heures avant dʼespérer obtenir le froid attendu. Ce problème technique a été résolu, et il est aujourdʼhui banal de produire du froid pour étendre la durée de conservation des aliments. Les modes de consommation alimentaire sont même structurés autour de cette possibilité (Lyster 2018, 55), et cʼest grâce à ce principe, hors de la sphère domestique, que sʼest banalisée la consommation de produits «  exotiques  », non locaux et hors-saison (Giedion 1948, 604).
La capacité du Family Hub™ à produire du froid est si intégrée que les vidéos et autres supports promotionnels vantent assez peu cette fonction aujourdʼhui considérée comme acquise. La vidéo promotionnelle qui figure en en-tête du site dédié au Family Hub™ mérite que lʼon sʼy attarde388. Ce type de contenus est pertinent, car il établit lʼusage idéal du produit et tisse autour de lui des imaginaires. De manière significative, la vidéo qui décrit la vie quotidienne dʼune famille de quatre personnes approche dʼabord le réfrigérateur de Samsung comme un dispositif de planification des repas. La femme du couple hétérosexuel tapote sur lʼécran pour accéder à des recettes. Les ingrédients manquants sont identifiés, et il lui est proposé de commander ceux-ci en un tap sur Amazon Fresh389. Le tunnel dʼachat a été compressé : seul le code pin de la carte bancaire est nécessaire, mais il est inutile de remplir un long formulaire. Lʼinterface reste majoritairement accessible par taps, et le clavier est rarement nécessaire. La vidéo est donc tout aussi signifiante pour ce quʼelle ne montre pas, à savoir lʼexistence dʼun compte dans lequel des données personnelles détaillées ont été entrées, et qui est accessible par défaut depuis le réfrigérateur. Cette première action sʼeffectue indépendamment de lʼouverture du frigidaire, qui est un écran avant dʼêtre une boîte froide. Toutes les interactions sont familières, et reprennent grâce aux propositions de lʼécran notamment, celles que lʼon pourrait imaginer sur une tablette en orientation portrait.
Une seconde scène montre le père de famille ranger les courses avec sa fille. Cette fois, nous pénétrons avec la caméra dans lʼintérieur du Family Hubâ„¢. Si une mention rapide nous informe que le réfrigérateur propose le «  all around cooling  »390 la séquence est surtout consacrée aux aliments, enveloppés dʼun filet quadrillé blanc qui semble signifier le fonctionnement dʼun scanner (fig. 2.23.b). fig. 2.23.b : Les aliments sont scannés dans le frigo, un dispositif technique dramatisé par l’usage d’un filet technique sur l’objet. Le langage visuel est proche du cinéma de science-fiction, et suggère un dispositif de reconnaissance. En effet, il est promis que le réfrigérateur identifie les aliments de façon à tenir un inventaire en temps réel. Nous sortons ensuite rapidement de cette exploration interne : le père de famille sélectionne les items du frigo depuis lʼécran et interroge lʼinterface qui propose des recettes en fonction des ingrédients sélectionnés. Plus tard, la cadette de la famille a perdu ses chaussons de danse : la mère les localise grâce aux caméras du frigo, qui surveillent en temps réel la maison. Enfin, le soir venu, le père de famille surprend son épouse grâce à un collage interactif sur lʼécran, qui lui propose de swiper pour découvrir leur prochaine destination de vacances. Puis, cʼest le père qui active le mode nuit du réfrigérateur, en réalité, celui de la maison complète dont les lumières sʼéteignent de concert.
fig. 2.23.b : Les aliments sont scannés dans le frigo, un dispositif technique dramatisé par l’usage d’un filet technique sur l’objet. Le langage visuel est proche du cinéma de science-fiction, et suggère un dispositif de reconnaissance. En effet, il est promis que le réfrigérateur identifie les aliments de façon à tenir un inventaire en temps réel. Nous sortons ensuite rapidement de cette exploration interne : le père de famille sélectionne les items du frigo depuis lʼécran et interroge lʼinterface qui propose des recettes en fonction des ingrédients sélectionnés. Plus tard, la cadette de la famille a perdu ses chaussons de danse : la mère les localise grâce aux caméras du frigo, qui surveillent en temps réel la maison. Enfin, le soir venu, le père de famille surprend son épouse grâce à un collage interactif sur lʼécran, qui lui propose de swiper pour découvrir leur prochaine destination de vacances. Puis, cʼest le père qui active le mode nuit du réfrigérateur, en réalité, celui de la maison complète dont les lumières sʼéteignent de concert.

Le Family Hubâ„¢ accomplit donc la promesse contenue dans son nom : il est un terminal, mais pas seulement pour la cuisine. Si lʼon voit que le réfrigérateur peut activer le four (et dans dʼautres vidéos, lʼaspirateur automatique), il contrôle en réalité lʼensemble de la maison et par extension, lʼintégralité de la vie domestique et même familiale. Il correspond donc à lʼidéal de la smart house dans laquelle un terminal unique gère le chauffage, lʼaération, la sécurité, la climatisation, les objets électriques, voire les réseaux dʼeau et dʼélectricité. La smart house elle-même sʼinscrit dans le contexte de «  LʼInternet des Objets  » (IoT) qui vise à placer les objets du quotidien en réseau, ainsi quʼà les interfacer à des applications. Le propos publicitaire qui entoure lʼobjet participe ainsi à définir une forme de connexion totale, à la fois comprise comme connexion technique et émotionnelle. Là où G. Bell et J. Kaye nous mettaient en garde contre des objets seulement investis sur le plan de la technologie pour offrir de penser la charge émotive des usages, le marketing produit dans ce cas un discours permettant dʼécraser lʼun sur lʼautre. Cʼest parce que le Family Hubâ„¢ permet de choisir des recettes que père et fille entrent en relation pour préparer le dîner ; cʼest parce que la surveillance est relayée par le réfrigérateur, que la mère réconforte sa fille qui encore perdu ses chaussons ; enfin, cʼest parce que lʼécran fabrique la surprise que le couple hétérosexuel est cimenté par la surprise romantique du mari. Une ligne de causalité directe est donc tracée entre la connexion au réseau et la connexion à ses proches («  Connectés comme jamais auparavant  »391, nous dit un des slogans sur le site). Toutes ces composantes relationnelles, familiales, sont associées à des aspirations de classe : dans la cuisine immaculée, cʼest lʼidéal des repas fait maison, la pratique de la danse classique ou les vacances dʼété qui sont associées au réfrigérateur. La stratégie tient au public cible : avec un coà »t de 4499€ en 2021392, le réfrigérateur sʼimpose clairement comme un équipement destiné aux CSP+.
La vidéo combine habilement la promesse de connexion à lʼextérieur au voilement des implications des principes techniques retenus. Le scanner des aliments qui vise à lister lʼinventaire du réfrigérateur suppose la génération et le stockage de données établissant en temps réel les habitudes de consommation des usager·es. Aussi, la connexion à Amazon ou X (anciennement Twitter), représentée dans le clip, est vue comme vecteur de praticité et de loisir, mais nʼindique pas selon quelles modalités ces informations sont partagées. De manière assez curieuse, une scène représente lʼaîné de la famille en train de traiter une image sur son téléphone, et celle-ci est immédiatement envoyée sur les réseaux sociaux par son père, sur le mode de la plaisanterie. La violation potentielle de la vie privée, voire du consentement, est donc bien envisagée par les concepteurices de la publicité, voire du réfrigérateur, mais sur un mode léger et sans conséquences. Ces dimensions sont pourtant cruciales pour le design des objets domestiques, et interrogent sur les conséquences de lʼintégration dʼun tel dispositif dans son domicile.
Dans cette vidéo récente, comme dans dʼautres spots antérieurs pour le Family Hubâ„¢, cʼest aussi lʼabsence de travail domestique qui frappe. Des tâches sont évoquées : lorsque la mère de famille interagit avec Amazon Fresh, ce sont les courses alimentaires qui sont traitées ; lorsque le père interroge lʼécran pour trouver une recette, cʼest la préparation des repas qui entre en jeu. Mais ces tâches sont éludées, réduites au prélude interactif sur lʼapplication. Lʼécran nʼest toutefois pas le seul agent de lʼinteraction produite ici. Le réfrigérateur inclut une intelligence artificielle, Bixby 2.0, quʼil est possible de solliciter par commande vocale comme les assistantes Alexa ou Siri. Cet·te assistant·e vocal·e est présent dans les téléphones de la marque Samsung, et se trouve ici intégrée à un réfrigérateur. Dans un court clip de présentation («  Découvrez le Family Hub 4.0  »), on voit une femme demander la météo à Bixby, qui affiche sur son écran les prévisions, et répond avec une voix plutôt codée comme féminine, ce qui nʼest pas sans renforcer lʼidée classique dʼun assistanat genré. Lʼusagère peut ensuite demander quʼun mémo soit envoyé. Toutes ces actions sont faites alors que lʼusagère regarde nonchalamment son fils jouer dehors, un torchon à la main—mais le travail est seulement suggéré, jamais montré. Ailleurs, cʼest un père de famille qui, détail sans doute volontairement progressiste, active en un tap le nettoyage du frigo, alors quʼil traverse la maison, seau et vaporisateur à la main. Si la publicité évite ici le stéréotype de genre qui associe femmes et ménage, elle en produit dʼautres, lorsque la mère de famille sélectionne lʼoption «  basses calories  » pour choisir un menu, et que sa fille, en écho, fait son shopping en ligne et affiche ses envies sur lʼécran du réfrigérateur.
En somme, ces contenus associent de manière très volontaire progrès technique et progressisme social, grâce à des couples interraciaux où les rôles traditionnels semblent au moins avoir été gommés, sinon reformulés. En revanche, dʼautres injonctions se dessinent : un partage constant dʼinformations, la connexion de toute chose dans la vie domestique, et le spectre des caméras dans les chambres des enfants sont autant dʼéléments que la musique pop-rock primesautière des clips ne parvient pas à faire oublier. Le Family Hubâ„¢ nʼest pas imperméable aux usages concrets qui se produisent en cuisine : la manière dont lʼinterface permet de reconstituer un mur de photos familiales semble directement en lien avec la manière dont la cuisine fonctionne comme «  lieu de mémoire  »393 (Meah 2016, 50), notamment grâce aux «  éphémères  » qui sʼy cristallisent, que A. Meah décrit comme «  des collages de moments ou des instantanés piqués sur un tableau, ou accrochés à la patafix sur un mur ou un frigo, un congélateur, un chauffe-eau : des photos dʼidentité amusantes, des images numériques imprimés sur du papier machine, des invitations à des fêtes, des talons de tickets, des citations préférées, des autoportraits dʼenfants, les empreintes de leurs mains, des cartes postales, des aimants souvenirs  »394. Le produit de Samsung sʼinscrit dans cet investissement émotionnel en promettant que lʼécran du Family Hubâ„¢ jouera le rôle de ce tableau dʼaffichage dont les choix graphiques imitent parfois la forme et le rendu.
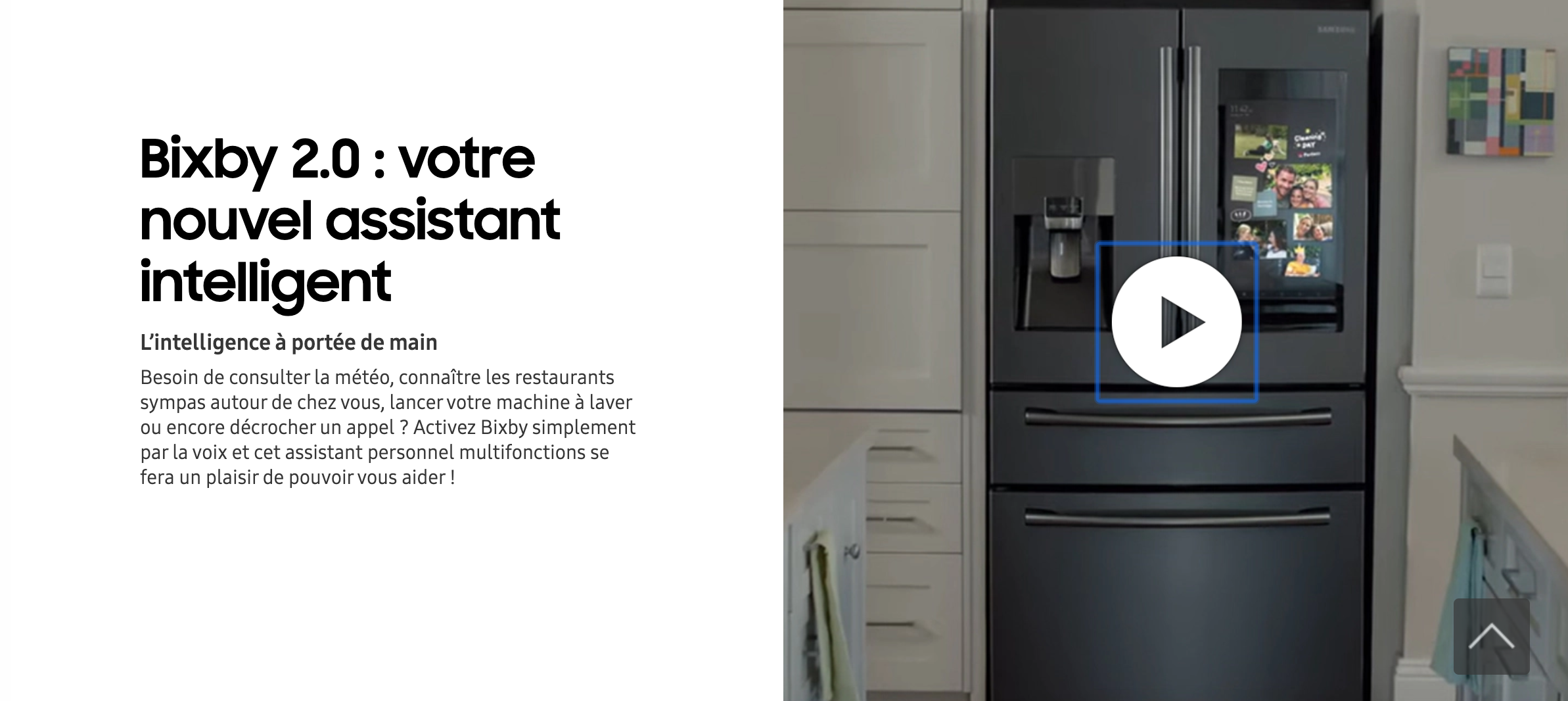
Cependant, le fait que ces éphémérides se constituent avec les moyens du bord interroge sur la nécessité du dispositif technique en surcouche. Si G. Bell et J. Kaye voient une plus-value dans la conception dʼune cafetière qui donne les nouvelles, il me faut mʼinterroger sur la nature de ces objets, leurs fonctions et leurs limites. Si la cafetière, pour exister, doit donner les nouvelles, la radio ne va-t-elle pas se mettre à faire du café ? La multiplication de ces objets interconnectés ne va-t-elle pas créer un brouillage, voire une compétition entre les fonctions ? Nʼest-il pas non plus possible que les usages se télescopent, créant de la confusion ou du désordre ? Et si ce désordre est évité grâce à un terminal central permettant de tout contrôler, ce dispositif, réfrigérateur ou autre, devient alors porteur dʼune responsabilité colossale. Plus loin, je reviendrai sur la manière dont la smart house peut être instrumentalisée par des conjoint·es violent·es (cf. infra., chap. IV). Je me bornerai ici à constater que cette intégration dʼun dispositif technique au réfrigérateur pose un problème de confidentialité des données, et compose lʼappareil électroménager comme potentiel cheval de Troie395. De plus, la connexion émotionnelle familiale implique aussi un nouvel agent : lʼintelligence artificielle. Bixby, à qui il est possible de tout demander, prolonge alors lʼéthos du «  à la demande  » que jʼai déconstruit plus tôt.
Lʼintégration dʼun assistant vocal à un objet dʼélectroménager permet aussi de naturaliser le recours à ce type dʼoutil. Qui ne voudrait pas acheter Amazon Echo ou Ok Google verra finalement cette technologie -— et ses micros en permanence ouverts -—intégrer le domicile, et rejoindre la caméra embarquée du frigo. Enfin, elle constitue lʼusager·e dans un rapport où la parole devient ordre, la requête trouvant une réponse par le biais de lʼassistant, que celui-ci soit artificiel ou à vélo. Le fait que le réfrigérateur voit ses fonctions fusionner avec celles dʼun smartphone constitue également un changement de paradigme important. Historiquement associé à lʼabondance (Widendaele, à paraître), surtout après-guerre en Europe et aux États-Unis, le réfrigérateur migre ici vers des imaginaires du contrôle familial -— certes heureux, mais relevant dʼune surveillance ubiquitaire (Weiser 1991 ; Citton 2023, 370) prolongée par les entreprises auxquelles sont connectées le dispositif. La communication publicitaire de Samsung revendique cet aspect, en quelque sorte, lorsquʼelle défend un dispositif qui est «  plus quʼun réfrigérateur  »396. Mais ce «  plus  » est sans doute aussi anecdotique que le fait pour un·e quidam de connaître le nombre de cerises sur un arbre.
La technologie ne résout rien quʼil ne soit possible de faire soi-même : je peux regarder le contenu de mon réfrigérateur sur lʼapplication, mais je peux tout aussi bien ouvrir sa porte397. En cela le Family Hubâ„¢ appartient sans doute à cette typologie dʼobjets qui existent parce quʼil est possible de les créer (Masure 2017), mais qui ne résolvent rien, ou tiennent de la solution sans problème. En revanche, ces dispositifs doivent recevoir toute lʼattention des designers dans la mesure où tout objet est porteur dʼune «  romance  » (Contois 2014). Le simple fait dʼacheter un objet, nous dit Emily Contois, permet dʼimaginer lʼusage qui peut en être fait. Nous avons vu que la dimension aspirationnelle des objets de la cuisine et de la cuisine elle-même est forte. Tandis que des objets comme le Family Hubâ„¢ rendent donc encore un peu plus poreuse la frontière public/privé, ils participent aussi dʼune écologie où lʼobjet sʼachète plus quʼil ne sʼutilise. Et si le grief, de Georges Pérec (1965) à Jean Baudrillard (1968), est ancien, il nʼen reste pas moins que cette dimension aspirationnelle participe à cacher le véritable fonctionnement de lʼobjet, muté en véritable fenêtre sur la vie intime et ses usages, enregistrée à défaut dʼêtre investie. Lorsque les riches, pour parler comme E. Morozov, sʼinventent ici un nouvel assistant, la question de la nature du travail en cuisine sʼopacifie encore un peu plus un possible réinvestissement de ce lieu devient moins accessible.
La cuisine que nous avons définie comme «  évidée  » au début de ce chapitre nous apparaît à présent comme étant tour-à -tour délaissée ou surinvestie : si un habitat sans cuisine a déjà été pensé, ce sont plutôt des cuisines (pièces de la maison) sans cuisine (pratique culinaire) qui émergent et sʼimposent à travers les modèles de la cuisine-trophée ou de la cuisine hub recevant la nourriture tout prête. Cependant, tout espace évacué ou abandonné offre en retour la possibilité dʼun réinvestissement : si jʼai évoqué pour commencer la manière dont les femmes avaient été encouragées à quitter la cuisine pour investir le salariat, il me faut à présent examiner comment des retours ponctuels, permanents, politisés, monétisés et idéalisés organisent des relations spécifiques avec lʼespace cuisine. Jʼaurai plus loin lʼoccasion de montrer que la cuisine nʼest pas un espace aussi distinct du salariat quʼil y a paraît. Nous verrons alors que le salariat masculin a été rendu possible par le labeur féminin gratuit en cuisine (plus largement, à la maison), et que lʼinvisibilisation de ce travail en tant que travail a permis sa gratuité. Cependant, le trajet féministe pensé depuis le féminisme de seconde vague, qui va de la cuisine à lʼentreprise, est déjà fragilisé, ou en tout cas contrarié par des visions alternatives de lʼarticulation entre femmes, travail et logis.

Malgré lʼinvisibilisation du travail féminin, sa valeur a parfois été reconnue par celles qui le pratiquaient, et qui ont trouvé des moyens de capitaliser sur celui-ci — et pas seulement en lʼassociant au travail du mari, par le mariage. Le film Mildred Pierce (1945) est une des représentations les plus marquantes dʼun tel parcours. Mildred (Joan Crawford) est une femme piégée dans un mariage malheureux qui vend les pâtisseries quʼelle confectionne dans sa cuisine pour contribuer au budget du ménage (fig. 2.24). Après que son mari la quitte, Mildred doit sʼoccuper seules de ses deux filles, et combine alors travail domestique et travail de serveuse. Elle projette ensuite dʼinvestir dans un restaurant qui va lui permettre lʼascension sociale dont sa fille aînée, Veda, a toujours rêvé. Ce restaurant ne sera pas son seul aboutissement, puisque Mildred montera toute une chaîne dʼétablissements sur la côte ouest. Le film est traversé par de nombreuses péripéties, notamment liées au remariage de Mildred et aux actions de Veda ; je laisse celles-ci de côté, car le récit mʼintéresse dans la mesure où il thématise la reconversion du labeur gratuit et invisible de son personnage en source de richesse et de capital social. Plutôt que de laisser la cuisine pour investir un travail salarié, Mildred utilise une pratique genrée pour sʼélever et sʼautonomiser. Un tel récit semblera peut-être daté ; mais il trouve des échos dans des récits et images des XXe et XXIe siècles, preuve que lʼidée dʼun savoir-faire spécifique en cuisine, féminin, ne contient pas automatiquement un programme conservateur. Depuis 2016, la série Queen Sugar produite par Ava Duvernay et Oprah Winfrey narre la vie dʼune famille afroaméricaine de Louisiane propriétaire de champs de canne à sucre et dʼune raffinerie. Les femmes y sont présentées comme des personnages forts, indépendants, ayant une carrière avant de sʼinvestir à des degrés divers dans lʼentreprise familiale. Mais la plus âgée, tante Violet (aunt Vi), travaille dans un café comme serveuse, ce qui est lʼoccasion de nombreuses péripéties—au premier chef, celle qui voit Vi décider de vendre ses tartes (sous lʼappellation «  Viʼs Prized Pies  ») avant de racheter lʼétablissement qui lʼemployait (fig. 2.25). Il existe donc des signes, dans la fiction, dʼune autre vie en cuisine : ni dans la cuisine domestique, ni dans la cuisine professionnelle, mais dans une sorte de continuum établi par le corps de la housewife, et qui plus est, à travers les époques. À défaut de pouvoir investir des cuisines professionnelles dominées par des hommes, ce serait donc à la cuisine domestique de muter en unité de production -— ce quʼelle était déjà , dès lors quʼelle participait au maintien économique et social de lʼunité familiale.

Cette mutation de la cuisine nʼest pas seulement le fait de quelques fictions, qui courent bien sà »r le risque dʼidéaliser les possibles. La cuisine peut fournir les outils de lʼémancipation, mais au-delà encore, quand cette émancipation est en marche, elle trouve souvent le chemin de la cuisine, même si la capitalisation ne repose pas sur la fabrication de pains et de tartes. Cʼest ici que lʼautonomie corporelle et gynécologique croise la cuisine. Les femmes étant historiquement liées à cette pièce, les stratégies de libération peuvent sʼy positionner parce que lʼoppression sʼy déploie, et pas seulement dans la mesure où les femmes sont invitées à limiter leur spectre dʼaction à la cuisine et aux tâches ménagères. Dans la série Mrs. America (2020), qui raconte lʼhistoire du féminisme américain de seconde vague, on voit la journaliste et activiste Gloria Steinem militer pour la légalisation de lʼavortement. Ce faisant, elle évoque auprès de son interlocuteur, un homme politique, «  les femmes […] charcutées sur la table de la cuisine  »398—cʼest-à -dire les conséquences dramatiques dʼavortements pratiqués dans la clandestinité, avec les moyens du bord. Cette mise en récit du mouvement féministe utilise un vocabulaire emprunté aux brochures et ouvrages de son époque. Si lʼunivers des femmes est donc souvent rétréci pour épouser les contours de lʼunivers domestique, la cuisine est lʼemblème de cet asservissement -— tout autant quʼun espace concret où se manifeste lʼoppression.
Cette expérience peut elle aussi être le site dʼun retournement. Dans Vibrator Nation (2017), Lynn Comella retrace lʼhistoire des boutiques de sextoys féministes, et la manière souvent contradictoire dont ces espaces militants ont dà » composer avec leur nature de commerce et les lois du marché. Elle évoque ainsi la manière dont la cuisine est utilisée pour fabriquer des produits qui seront ensuite vendus à lʼextérieur, à la manière de Mildred Pierce : sauf que ce sont des sextoys que Marilyn Bishara fabrique dans sa cuisine et lave dans son évier pour sa marque Vixen Creations (Comella 2017, 124). Et ce récit nʼest pas isolé : ailleurs, Comella affirme que «  [l]e centre des opérations de commande par courrier de Eve Garden pendant la première année dʼexistence de lʼentreprise était la table de cuisine de Dell Williams dans son appartement de Midtown Manhattan  »399 (2017, 38). La cuisine ne permet pas seulement de capitaliser sur des savoir-faire liés aux pratiques culinaires : elle ouvre en fait un territoire dʼexpérimentations pour des femmes qui nʼont pas accès à des lieux de fabrication ou tout simplement de travail alternatifs. En dʼautres termes, la cuisine se fait ici atelier, ce qui est particulièrement intéressant du point de vue du design : cette pièce de la maison nʼest pas seulement le point final dʼun processus de conception, elle peut aussi accueillir le déploiement de projets.
Le travail rémunéré nʼest plus opposé à la vie domestique, ce dont témoignent parfois les images des communications des marques. Ainsi Jennifer Pritchett, propriétaire de la boutique Smitten Kitten, pose avec les dildos rangés dans un plat à gratin (fig. 2.26), ses vêtements protégés par un tablier à carreaux qui évoque immédiatement le stéréotype de la housewife dévouée. fig. 2.26 : Jennifer Pritchett pose avec les produits de son entreprise Smitten Kitten (crédit : Jenn Bauer), dédiée à la vente dʼobjets pour le sexe. Ainsi remis en circulation, les signes de la féminité «  à sa place  » sʼempouvoirent et affirment lʼautonomie, à la fois financière (par le biais de lʼentreprise) et sexuelle (puisquʼil est question de jouets pour le sexe et de plaisir). Cette puissance de la cuisine dont les compétences peuvent à tout moment pénétrer le marché nʼest pas récente, comme le montre lʼexemple de Mildred Pierce. Il en existe aussi une conscience chez les plus conservateurs. Betty Friedan analyse dans The Feminine Mystique (1963) la presse féminine dʼaprès-guerre pour montrer comment ces contenus incitent les femmes à rester à la maison et à investir des valeurs domestiques.
fig. 2.26 : Jennifer Pritchett pose avec les produits de son entreprise Smitten Kitten (crédit : Jenn Bauer), dédiée à la vente dʼobjets pour le sexe. Ainsi remis en circulation, les signes de la féminité «  à sa place  » sʼempouvoirent et affirment lʼautonomie, à la fois financière (par le biais de lʼentreprise) et sexuelle (puisquʼil est question de jouets pour le sexe et de plaisir). Cette puissance de la cuisine dont les compétences peuvent à tout moment pénétrer le marché nʼest pas récente, comme le montre lʼexemple de Mildred Pierce. Il en existe aussi une conscience chez les plus conservateurs. Betty Friedan analyse dans The Feminine Mystique (1963) la presse féminine dʼaprès-guerre pour montrer comment ces contenus incitent les femmes à rester à la maison et à investir des valeurs domestiques.
Elle cite notamment la nouvelle «  The Sandwich Maker  » («  La Fabricante de Sandwiches  », dans une imparfaite traduction) parue dans le Ladiesʼ Home Journal en avril 1959 (Friedan 1979[1963], 39–40). Au cours du récit, une jeune épouse décide de fabriquer et vendre des sandwiches pour gagner un peu dʼargent, car son mari lui refuse dʼaccéder à un compte en banque. Mais cette histoire qui semble au premier abord faire état dʼune prise dʼautonomie ne dépeint celle-ci que pour lʼassocier à de tristes conséquences, et à un doux renoncement à la carrière de «  sandwich maker  ». La jeune femme se trompe dans sa commande dʼemballages, puis se trouve dépassée par sa petite entreprise. Lʼhistoire se conclut par la concession du mari, qui accorde à sa femme le droit dʼaccéder à un carnet de chèques, tandis que celle-ci entame une nouvelle grossesse. Pour Friedan, cette histoire est lʼoccasion de montrer le rétrécissement des imaginaires liés aux vies de femme au début du XXe siècle. Elle met en friction la nouvelle avec une autre, «  Sarah and the Seaplane  », dans laquelle la jeune Sarah devient aviatrice (Friedan 1979[1963], 34–35). Pour Friedan, le passage de lʼavion aux sandwiches démontre ce resserrement dʼaprès-guerre sur les affaires domestiques. Mais on peut aussi interpréter «  The Sandwich Maker  » comme une nouvelle doublement conservatrice : une première fois, au sens de Friedan, puisque les femmes sont vues comme des créatures domestiques ; une seconde fois, comme récit de mise en garde, montrant de manière préemptive aux femmes au foyer quʼun simple désir dʼinvestir créativement ce déjà -là de la cuisine est voué à lʼéchec, et constitue même une transgression.
Les exemples que jʼai évoqués précédemment réinvestissent des savoirs ou pratiques liés à la cuisine dans le but de les monétiser, cʼest-à -dire dʼéchanger leurs productions contre de lʼargent, dans une logique de marché. Mais retourner à la cuisine peut constituer une décision consciente, défendue de manière contemporaine. Les discours plaidant pour un retour à la cuisine ne se limitent peut-être pas à des postures conservatrices. Le retour aux fourneaux par esprit de tradition nʼanime en tout cas pas Shannon Hayes lorsquʼelle écrit Radical Homemakers: Reclaiming Domesticity from a Consumer Culture en 2010. Elle revient sur les progrès du féminisme de la seconde vague, et en revisitant Betty Friedan, analyse lʼinjonction pour les femmes à quitter la vie domestique pour investir le salariat. S. Hayes considère que ce trajet a été largement idéalisé, et quʼil implique de nombreux effets de bord, dont lʼaliénation par le travail (du coup partagée par les hommes et les femmes), la perte des savoir-faire liés à la sphère domestique et lʼimpact écologique dʼune vie «  dédoublée  » (les foyers devant avoir deux voitures, deux systèmes dʼassurance maladie, etc.). Si elle reconnaît, avec Friedan, que la place forcée en cuisine peut être aliénante, elle désigne lʼemploi privé comme des «  menottes dorées  »400 en citant lʼune de ses enquêtées (35). Certes, les femmes deviennent indépendantes de leur mari lorsquʼelles sont salariées, mais deviennent alors tout aussi dépendantes de leur patron (42). Lʼargument de lʼouvrage est résolument antiréformiste. Là où Dominique Méda et Hélène Périvier défendent coà »te que coà »te la parité de lʼemploi (2007), S. Hayes plaide en faveur dʼun changement radical de système en retournant au logis. Pour elle, ce retour nʼest pas genré : elle incite hommes et femmes à recentrer le domicile comme cÅ“ur de la vie humaine. Cependant, nous verrons plus avant que ce retour est souvent féminin, et bute sur les écueils habituels, comme lʼinégale répartition des tâches.
Pour S. Hayes, lʼassociation du travail à lʼemploi salarié relève dʼun problème pour les Étasunien·nes qui auraient perdu leur traditionnel esprit dʼentreprise (39). En ancrant son argument dans une forte conscience des enjeux écologiques contemporains, elle développe ainsi le paradigme de la «  communauté Terre  »401 où «  les personnes au foyer [homemakers] ont choisi dʼarrêter dʼinvestir leur énergie vitale pour tout emploi qui nʼhonore pas les quatre piliers de la famille, de la communauté, de la justice sociale et de lʼéquilibre écologique  »402 (2010, 38–39). En respectant ces valeurs, dit-elle, «  nous commençons à démanteler lʼéconomie extractive et à créer à sa place une économie servant la vie, qui nous permet de satisfaire nos besoins tout en vivant avec la terre et ses esprits  »403 (2010, 51). La langue emprunte à une culture hippie, voire new age, quʼil est facile de trouver surannée, et pour cette raison, le discours de S. Hayes peut être facile à disqualifier. Pour autant, je vais ici mʼemployer à en comprendre les principes et les perspectives, car il me semble que son étude pointe de véritables angles morts dans les discours féministes réformistes, qui font de lʼemploi la clé de lʼémancipation féminine. S. Hayes sʼappuie sur les discours des féministes matérialistes, dont Dolores Hayden, qui reconnaissent une valeur au travail de reproduction effectué par les femmes, à lʼopposé du marxisme historique qui aligne lʼégalité entre hommes et femmes sur une participation des femmes à la production industrielle. Par ailleurs, elle affirme les conséquences délétères de lʼemploi salarié sur les personnes et lʼenvironnement, pour inciter ses lecteurices à repenser leur vie autour de leur habitat et de ses ressources.
Il sʼagit dès lors de reprendre la main sur la production de nourriture (par des potagers, cultures, élevage dʼanimaux, fabrication de conserves), le soin des personnes et particulièrement des enfants (par des gardes partagées, à lʼécole à la maison), la fabrication/réparation dʼobjets du quotidien (couture, fabrication de savon, de bougies), etc. Elle indique que toutes ces activités participent de compétences qui ont été perdues, voire plus clairement effacées par une économie fondée sur la rationalisation, la vitesse et lʼefficacité. Effectivement, il est difficile de ne pas sourire en lisant ses descriptions de la vie de couples salariés recourant à des plats préparés, à des médicaments issus de lʼindustrie pharmaceutique et lʼemploi dʼaides (femme de ménage, gouvernante), autant de solutions coà »teuses rendues obligatoires par la manière dont le salariat les accapare. La temporalité amenée par le salariat rend ces solutions incontournables en même temps que le recours à ces techniques de rationalisation a un prix qui rend le salariat nécessaire. Cʼest ce cercle vicieux, pointé comme absurde, que S. Hayes cherche à enrayer en signalant quʼil sʼest produit un «  abandon de la cuisine  »404 (39), synonyme de perte de savoir-faire, dʼautonomie, de vie communautaire et de plaisir.
Si S. Hayes ne plaide pas pour un seul retour des femmes en cuisine, elle dit bien que ce sont les femmes qui ont été coupées de leurs savoirs par la culture capitaliste du salariat puisque «  la maison américaine a été laissée vide, prise en charge par une femme dé-spécialisée au point que son obligation envers la société est devenue de fonctionner en tant que consommatrice, dʼacheter ces services et ces biens pour sa famille que son mari et elle, quelques générations plus tôt, auraient produit de concert grâce à leur travail  »405 (2010, 71). Un de ses arguments les plus saillants consiste à pousser la démonstration de B. Friedan dans ses retranchements. Cette dernière avance en effet que la domesticité idéalisée des années 1950 sʼest traduite par une conversion de lʼépouse en parfaite consommatrice ; cependant, nous dit S. Hayes, le passage à une vie salariée nʼa en rien entamé cette condition, et lʼa même renforcée dans la mesure où la femme employée recourt à davantage de produits et services (une voiture pour aller au travail, des vêtements adaptés au milieu professionnel, des plats préparés pour suppléer au manque de temps, etc.) quʼune personne au foyer ayant repensé ses moyens de subsistance.
La force de lʼargumentaire de S. Hayes réside dans cette revendication dʼun épanouissement possible dans une vie domestique. Ce faisant, lʼhabitat en faveur duquel elle plaide tient quelque peu dʼun anti-hub. Si sa proposition repose sur quelques idéalisations, elle participe aussi dʼun fort réalisme. Démissionner de son emploi salarié nʼest quʼun premier pas (faisant partie dʼune étape décrite comme «  renoncement  ») qui doit préparer de longues phases de labeur (la «  reprise en main  » suivie de la «  reconstruction  »)406 (2010, 250). Elle souligne les nécessités de lʼautoformation et de la recherche pour sʼautonomiser et compenser la perte de savoir-faire. Elle plaide enfin en faveur dʼune maison vivante, désordonnée, loin des représentations immaculées des magazines dʼarchitecture dʼintérieur. Le logis et la cuisine sont donc véritablement habitées, quand elles sont traversées par le partage familial et communautaire, comme le mettent en évidence les relevés dʼenquêtes quʼelle produit en rencontrant des «  personnes au foyer radicales  » («  Radical Homemakers  »). Ce réinvestissement nʼest toutefois jamais au seul service de la réalisation individuelle, bien que celle-ci soit prise en compte dans la démonstration. Lʼenjeu majeur reste de rompre avec les dommages sociaux et écologiques de lʼéconomie capitaliste extractive, pour retrouver un lien plus juste aux ressources et à lʼenvironnement.
S.Hayes est consciente des obstacles et limites de son projet. Elle explique bien que le choix de rompre avec le salariat, dans le contexte des États-Unis en 2010, est nʼoffre guère la possibilité de remords. La pression des pair·es peut aussi décourager un tel choix, dans la mesure où il est sans retour et considéré comme risqué (240 ; 244). Elle admet aussi que la société étasunienne, en dévalorisant le travail domestique, rend celui-ci invisible et vierge de validations extérieures, y compris dans ces foyers «  radicaux  » que S. Hayes décrit. Certaines personnes rencontrées, dʼailleurs des femmes, admettent que le travail domestique existe indépendamment des promotions, des prix, de toutes les formes de reconnaissance que le travail salarié a instituées. Il faut ainsi accepter de retourner à un travail dont les accomplissements se font le plus souvent dans lʼombre, ou à lʼinsu de celleux qui en sont pourtant les récipiendaires (conjoint·e, enfants).
Dʼautres limites au modèle du foyer radical émergent à la lecture de lʼouvrage de S. Hayes. Zulfiya Tursunova et Chantal Shivanna Ramraj produisent ainsi une critique positive du livre en 2015, mais observent que les enquêté·es bénéficient souvent dʼun privilège économique (héritage, patrimoine familial, conjoint·e salarié·e) qui permet le transfert à une vie domestique407. Elles pointent lʼabsence de diversité dans le panel des enquêté·es (Tursunova & Ramraj 2015, 157) ainsi que la focalisation sur les États-Unis qui empêche une perspective transnationale, pourtant essentielle sur les questions dʼécologie, dʼêtre envisagée. La question raciale est également omise de lʼargumentaire, alors que lʼautrice produit de nombreuses observations mélioratives sur la vie des colons (au XVIIIe siècle) sur le continent américain, perçu comme un modèle de soutenabilité -— sans jamais évoquer lʼécocide lié au colonialisme, lʼexploitation et lʼextermination des populations natives ou la place de lʼesclavage dans les logis ainsi posés comme modèles de fonctionnement. Cette vision des modèles antérieurs est souvent idéalisée, et prend le risque de dévaloriser la situation actuelle dans le seul but dʼaffuter lʼargumentaire. Ainsi, lorsque S. Hayes fait référence à «  une époque où la maison nʼétait pas juste un lieu pour dormir la nuit  »408 (61), on comprend bien quʼelle attaque le système de la maison dortoir suburbaine : mais nʼest-ce pas aller un peu vite en besogne, que dʼimaginer que la maison a été de manière effective ainsi réduite à cette fonction ? Un raccourci similaire frappe lʼarc principal du projet de réinvestissement de la domesticité. Elle affirme ainsi que «  pour chaque besoin que nous réapprenons à satisfaire par nous-mêmes, au sein de nos maisons et de nos communautés, nous renforçons notre indépendance vis-à -vis dʼune économie extractive et parasitaire  »409 (2010, 83). La causalité exprimée entre savoir-faire domestique et conséquences vertueuses nʼest pas aussi automatique quʼil y paraît.
Certain·es critiques, comme lʼanthropologue Aude Vidal, ont déconstruit cet imaginaire. Si les incitations de S. Hayes restent intéressantes, son positionnement de la révolution au niveau de lʼindividu peut culminer dans un éthos des «  petits gestes  » (Vidal 2017, 34) aux conséquences moindres, et au fort potentiel de récupération par les entreprises (lorsque les entreprises reprennent ce principe, plutôt que de questionner les modèles extractifs globaux). Par ailleurs, valoriser lʼautonomie peut favoriser des échanges intercommunautaires à la campagne, lʼadoption de ce principe en ville se solde souvent par une consommation renforcée dʼoutils (machine à pain, appareil à faire les yaourts, etc.) dont lʼusage «  autonome  » vient créer un manque à gagner pour les professionnel·les fabricant ces produits (Vidal, 2017, 77). Aude Vidal met ainsi en garde contre ce DIY (Do It Yourself) adopté par les bourgeois·es séduit·es par lʼécologie, et pointe la possibilité dʼune «  violence de classe  » (2017, 79) exercée lorsque les plus fortuné·es redécouvrent des savoir-faire, sur le mode du loisir, tandis que dʼautres doivent préserver leur production comme première source de revenus. Le classisme potentiel de ces pratiques domestiques surgit également quand une enquêtée évoque la satisfaction de fournir à son fils une nourriture de meilleure qualité, qui amène immédiatement une comparaison avec la nourriture de la cantine, dont son enfant ne veut plus, pas plus que des gâteaux achetés par les autres familles lors des occasions festives (236). On peut se demander quelle interdépendance et quelles communautés se construisent, quand la nourriture «  saine  » et faite à la maison devient un nouveau levier de distinction avec les autres, perçus comme aliénés au capitalisme et décrits par un autre enquêté comme des «  robots  » (242).
Ces points seraient moins problématiques sʼils étaient relevés par S. Hayes, mais cette dernière semble souvent en grande osmose idéologique avec ses enquêté·es, ce qui lui fait manquer les effets de bord du système. Un problème comparable émerge avec la dévaluation constante de la télévision, diabolisée, par opposition à des loisirs perçus comme plus vertueux (potager, travaux manuels, lecture). Cette moralisation de certaines activités a pour conséquence de rejeter en bloc une partie conséquente de la culture populaire, et attribue des valeurs négatives à certains habitus de classe sans comprendre les ramifications dʼun tel geste. Lʼopposition entre consommation et production amène S. Hayes à des approximations qui sont particulièrement sensibles pour les designers : à la télévision, elle oppose des loisirs qui «  ne font pas partie de la culture de la consommation  »410 (2010, 234), comme le canoë , les concerts, les pratiques artistiques. Or, toutes ces activités sont liées dʼune façon ou dʼune autre au capitalisme et à la consommation : il faut bien produire les canoë s, les guitares, les pinceaux ; la circulation des représentations de ces pratiques dans le champ médiatique, à elle seule, attache ces loisirs à la culture de la consommation. En posant lʼidée quʼil existe de telles pratiques libres du joug consumériste, S. Hayes projette un «  dehors  » du capitalisme qui est non seulement illusoire, mais qui prend le risque de binariser la pensée sur le mode dʼune libération réussie ou échouée. La critique opéraïste, de Maurizio Lazaratto à Toni Negri & Michael Hardt, refuse lʼidée dʼun tel en-dehors, comme Michel Foucault avait démontré lʼimpossibilité dʼun en-dehors du disciplinaire, plaidant alors pour des «  hétérotopies  » (1994[1984], 1575).
La dernière limite du projet de foyer radical de S. Hayes tient dans lʼapproche de lʼunité familiale, principalement vue comme cellule hétérosexuelle, monogame, et reproductive. Si lʼautrice fait lʼeffort dʼintégrer des personnes célibataires et de comprendre les obstacles particuliers que ces personnes rencontrent dans leur quête dʼautonomie domestique, le panel de familles rencontrées est très uniforme, notamment en termes dʼarrangements familiaux. Le mariage lui-même est vu comme uniquement hétérosexuel, décrit comme unissant «  maris et femmes  »411 (59). À plusieurs reprises, lʼautrice évoque lʼégalité quʼelle associe à des «  mariages sains  », sans que les critères de cette santé soient vraiment détaillés. Bien sà »r, il est question de partage des tâches, de communication, de partenariat entre les époux·ses : mais lʼuniformité des incarnations de ces couples fonctionnels questionne sur les valeurs qui composent véritablement ce critère de la santé. Dans un contexte où le mariage est clé, son envers, le divorce, est systématiquement associé à lʼéchec, et, avec le soutien dʼétudes, aux problèmes de santé mentale (138). Logiquement, le nombre de divorces à lʼéchelle nationale est ainsi interprété comme un signe de déroute sociale, symptôme dʼune société individualiste (104). Lʼautrice elle-même reconnaît que dans le dispositif quʼelle soutient, la «  soutenabilité économique reposera grandement sur le succès [du] mariage  »412 (191).
Lorsque la réussite du mariage devient la condition de la réussite dʼun projet, son fonctionnement en tant que tel nʼest plus questionné. Si le mariage est la pierre angulaire du dispositif, les personnes impliquées ne risquent-elles pas dʼaccepter la disparition de lʼaffection, le changement des projets de vie voire des formes de violence en vue de préserver leurs conditions de vie ? Les personnes enquêtées, surtout des femmes, évoquent dʼailleurs des arrangements très inégaux. Lʼautrice elle-même révèle le maintien dʼune structure classique lorsquʼelle écrit que «  tous les maris ne sont pas aussi adeptes du travail domestique que leurs femmes, mais ils donnent tout de même un coup de main  »413 (193). Cette idée que le travail domestique, quoique partagé, soit toujours le travail des femmes, et quʼun homme sʼappliquant à ses tâches «  aide  » plus quʼil ne travaille est un des points clés qui maintient les inégalités dans la répartition des tâches. Aussi, le projet de S. Hayes parie sur une harmonie qui semble bien fragile, dès lors que les points de pression traditionnels exercés sur les femmes ne sont pas posés sur la table.
Enfin, la conception de la famille de lʼautrice repose principalement sur le couple hétérosexuel, et dʼautres arrangements domestiques (ne serait-ce quʼun couple monogame gay ou lesbien) nʼont aucune place dans lʼouvrage. Fait significatif, le terme «  queer  » est employé dans sa signification la plus ancienne, celle de «  bizarre  » ou «  étrange  » (97). Cette absence nʼest pas seulement problématique au regard dʼun manque de diversité—qui est aujourdʼhui la principale manière dont est approché le manque de représentation des personnes minorisées dans les médias et contenus culturels. En omettant de parler de couples (ou autres cellules) minorisées sur le plan de la race, du genre ou de lʼorientation sexuelle, S. Hayes forme un diagnostic établissant la «  communauté  » comme état souhaitable, critiquant en miroir un individualisme quʼelle estime être au service du capitalisme le plus débridé. Elle oublie ainsi que les communautés dʼindividus peuvent être des organes normatifs voire oppressifs, et que tout écart à cette norme peut être sanctionné, notamment en rendant impossible la vie des personnes minorisées. Les femmes décrites dans lʼouvrage donnent bien volontiers leurs enfants à garder à leurs voisin·es ; en feraient-elles autant si les voisines étaient un couple de femmes trans ? Quel impact la célébration des médecines naturelles dans ces groupes pourrait-elle avoir sur la perception dʼenfants nés dʼune GPA ou dʼune PMA ? Lʼintégration dans la communauté serait-elle aussi évidente avec une famille composée dʼune trouple gay en union libre ?
En faisant de la communauté le moyen et lʼobjectif de sa démarche de soutenabilité domestique, S. Hayes oublie que rien ne lie, de facto, communauté et sécurité, et que pour les personnes queer en particulier, la communauté peut être un organe répressif les empêchant dʼaccéder à lʼagentivité. Enfin, si lʼautrice a raison de pointer que les jeunes qui vivent chez leurs parents sont considéré·es comme des «  raté·es  » tandis que les plus agé·es sont vus de manière symétrique comme des «  fardeaux  » (139), il me semble quʼelle force le trait en affirmant que «  lʼidéal de lʼinterdépendance générationnelle est un mythe culturel renforcé par la télévision  »414 (138). Si lʼindividualisme est effectivement une valeur forte du capitalisme contemporain, la famille nʼen reste pas moins célébrée, à travers les mythes de compatibilité hétérosexuelle, de lʼâme sÅ“ur et de la réalisation de soi par lʼacte reproductif. Si la famille a été délaissée, cʼest bien comme unité de production, comme site de collaboration pour assurer la survie de ses membres et S. Hayes soulève sans doute quelque chose de pertinent à lʼendroit des compétences familiales. Mais ce diagnostic demande encore à être questionné afin de ne pas fétichiser encore une structure familiale dont la réalisation constituerait de fait un geste révolutionnaire contre lʼéconomie extractive et les ravages du capitalisme.
Ce retour à la maison ne vaut pas seulement en tant quʼexpérience vécue par les participant·es. Dans une logique de partage des savoirs, et dans le contexte dʼun usage accru des médias sociaux, ces tentatives de retour à une vie domestique sont automédiatisés, mis en scène, et cette production dʼimages, paradoxalement peut-être, intègre le travail domestique. Ce dernier nʼinclut plus seulement la tâche, ou son résultat, mais aussi sa transformation en récit par le biais dʼoutils numériques médiatiques. Les radical homemakers croisent ici la figure de la mommy blogger, déjà évoquée dans lʼintroduction. Jʼai cité les propos de Mona Chollet au sujet de Mimi Thorisson, blogueuse, influenceuse et autrice du blog Manger. À lire les descriptions faites par M. Chollet des images produites par le blog, on voit combien ces représentations participent dʼun retour à la maison, pas seulement concret, mais dʼun retour à des imaginaires nostalgiques, enchantés, dʼun «  avant  » domestique :
Les photos montrent la famille cueillant des brassées de fleurs dʼacacia pour en faire des beignets au printemps, dînant aux bougies dans le jardin les soirs dʼété, vagabondant dans les vignes au moment des vendanges, cueillant des champignons dans une forêt brumeuse en automne. Vêtue avec élégance et simplicité, tenant souvent en laisse lʼun des fox-terriers dont son mari fait lʼélevage, prenant la pose avec les commerçants, restaurateurs et petits producteurs de la région, Mimi balade dʼune image à lʼautre sa silhouette de mannequin, sa chevelure brillante et son sourire de Joconde. On la retrouve découpant gracieusement des légumes dans le clair-obscur de sa cuisine rustique, ou portant des pommes dans le creux de son tablier blanc, pieds nus sur le carrelage (2011, 203–204).
Mimi Thorisson est donc une homemaker à plus dʼun titre : elle fournit le travail nécessaire au maintien de son logis, mais elle produit aussi le logis comme idéal, produit même lʼaspiration à une vie domestique au féminin -— qui nʼest pas antiféministe dès lors quʼelle relève du «  choix  » (Chollet 2011, 209–210). bell hooks identifie déjà , environ trente plus tôt, que «  lʼidéalisation de la maternité par les bourgeoises blanches constitue une tentative de réparer les dommages causés par les critiques féministes antérieures  » (2017[1984], 248). Mona Chollet déconstruit cependant cette question du choix, qui nʼest bien sà »r pas équivalent pour toutes. Les mommy bloggers incarnent en effet un paradoxe : elles investissent un programme domestique, rompent en apparence avec le paradigme de lʼémancipation féminine, mais professionnalisent leurs pratiques domestiques en les médiatisant. Dès lors, le retour à la maison nʼen est pas un, dans la mesure même où il est rendu visible. Son processus de médiatisation annule sa domesticité, en la rendant publique, en visibilisant un travail habituellement invisible et en lui donnant une valeur (dʼimage, certes) sur une place de marché. Felicia Wu Song analyse ces contradictions des mommy bloggers qui souhaitent à la fois partager des expériences «  authentiques  », souvent difficiles de la maternité (dépression post-partum, éducation dʼun enfant en situation de handicap, etc.), et la possibilité de convertir cette pratique en une activité rémunératrice par le biais de partenariats commerciaux. La sociologue F. W. Song évoque notamment Heather Armstrong, la figure la plus connue de maman blogueuse aux États-Unis. En 2021, son blog dooce
Ces blogs nʼexistent pas de manière isolée, comme en témoigne lʼexistence dʼévénements comme Blog Her, qui consacrent ce segment dʼexpression individuelle en catégorie culturelle et place de marché. F. W. Song montre comment les mères sont donc tiraillées entre lʼintention initiale consistant à offrir «  des comptes-rendus authentiques et crus sur la maternité  »415 et la nécessité, pour convertir leur activité en source de revenus, de revenir «  aux scripts sentimentaux et aseptisés qui dominent dans la culture mainstream  »416 (Song 2016, 45–46). Ces mères qui bloguent doivent faire face aux accusations de superficialité, puisque la maternité est considérée comme un sujet moindre, non politique, par opposition à des problèmes sociaux plus larges ; lorsquʼelles sʼattaquent à dʼautres sujets que ceux de la maternité et la domesticité, elles ont du mal à être vues comme étant pertinentes, sont parfois rabaissées par le public, voire par leurs proches, comme cette femme dont lʼactivité est perçue par son mari comme «  du temps passé avec ses ‹ petites copines dʼInternet ›  »417 (Song 2016, 48). F. W. Song en conclut que ces femmes ont réussi avec succès à transformer leur statut de mommy blogger en des rôles plus reconnus comme «  lifestyle influencer  » (dans la version originale) ou «  experte en médias sociaux  »418 (2016, 49). Lʼusage même du blog est devenu plus marginal dans les années 2010, rendu partiellement obsolète par lʼusage dominant dʼInstagram puis TikTok et de leurs logiques de publication (textes plus courts, contenu centré sur les images animées ou non). Cependant, les entreprises qui approchent ces femmes pour des partenariats les conçoivent toujours dʼabord comme des consommatrices, et sollicitent leurs plateformes pour du placement de produit, quand ce nʼest pas pour du travail gratuit (Song 2016, 46–47). Ici, les blogueuses sont rattrapées par leur place dans lʼespace domestique : si la nature du labeur change par sa médiatisation, il est toujours marqué au fer rouge de la gratuité. La visibilisation de la maternité et le développement dʼune «  voix  » rendent visibles des expériences qui vont contre le grain des imaginaires traditionnels de la félicité parentale. Elles permettent à ces blogueuses dʼaccéder à des statuts professionnels améliorés, mais, observe F. W. Song, ces femmes manquent encore de «  pouvoir symbolique  » «  en tant que mères  »419 (2016, 49). La disruption de la vie privée amenée par les pratiques de blogueuses ou dʼinfluenceuses permet donc plutôt de sʼextraire de la vie domestique que de véritablement réinvestir celle-ci.
Cette partie aurait pu sʼarrêter ici, nʼeut été la pandémie du COVID. Ce phénomène de lʼhistoire contemporaine a des conséquences majeures sur le logis, le travail domestique féminin et lʼinvestissement de la cuisine. Nous avons vu que, malgré des tentatives variées (radical homemaking, mommy blogging), le retour à la vie domestique reste souvent attaché à un programme politique conservateur. Les intentions initiales des personnes intéressées par le retour au foyer peuvent être bien différentes, mais lʼenvironnement socioculturel qui garantit le déséquilibre du partage des tâches et la dévalorisation du travail domestique féminin rendent difficile un retour qui nʼest pas synonyme de renoncement. Lʼépidémie du COVID, dans les pays occidentaux, a été associée à des mesures nationales de confinement total ou partiel au printemps 2020 qui ont forcé ce retour à la vie domestique—a priori pour lʼensemble de la population. Toutefois, dès cette période, de nombreuses voix se sont élevées pour affirmer que si le dispositif concernait «  tout le monde  », les inégalités de classe, race et genre étaient renforcées par le dispositif. Il a ainsi pu être observé que les personnes vivant dans de plus petits espaces étaient désavantagées par les mesures de confinement, tandis que les personnes racisé·es ou vivant dans des quartiers sensibles, en France, étaient davantage sujettes aux contrôles de police et à la vérification de lʼattestation. Enfin, la fermeture des écoles a impliqué que les familles assurent lʼintégralité du care des enfants, et cette situation inédite a pu renforcer des inégalités de genre.

Début 2020, avant lʼarrivée de lʼépidémie sur les continents européen et américain, les journalistes sʼintéressent déjà à la manière dont le confinement de la ville de Wuhan (et sa région, le Hubei) changent les pratiques de consommation alimentaire et par ricochet, le travail de préparation alimentaire. La fermeture des marchés limite alors lʼaccès aux produits frais (fig. 2.27), forçant les Chinois·es à remplacer ceux-ci par des produits préparés, sous vide, ou à repenser leurs habitudes de préparation (Hamby 2020). Certaines personnes, contraintes à rester dans leur quartier, nʼont pas accès aux magasins et doivent se tourner vers des achats groupés sur WeChat pour subvenir à leurs besoins alimentaires (Cachero 2020). Mais comme cela a été le cas en France (et dʼautres pays occidentaux) un mois plus tard, les Chinois·es (et habitant·es de Wuhan en général) ont réinventé leurs pratiques, pas seulement par nécessité matérielle, mais pour faire face à lʼennui. Interviewé·es par la journaliste Helen Rosner, les blogueur·ses culinaires Chris Thomas and Stephanie Li résument la situation. C. Thomas observe ainsi : «  les pâtes fraîches sont devenues un nouvel essentiel pour nous, parce que nous avons beaucoup de temps et beaucoup de farine  »420 (Rosner 2020). La nourriture a ainsi été investie de manières plurielles : la réorganisation des familles autour dʼune vie à la maison a nécessité de cuisiner trois repas par jour, là où les cantines scolaires et dʼentreprise assuraient cette tâche externalisée, et la nourriture est apparue comme une ressource pour des personnes au chômage technique, ou simplement moins occupées en vertu dʼune journée libérée des temps de transports. Cette soudaine passion boulangère et pâtissière a conduit à une modification des comportements de consommation, au moins en France, comme en témoigne un rapport publié par France AgriMer en septembre 2020 qui parle de la farine comme du produit «  rupturiste  » par excellence pendant la période du premier confinement (2020, 7).
Le journal français Libération, en phase avec cet esprit du temps, a renommé sa série «  Bouffons la vie  », dédiée à la gastronomie en «  Bouffons la vie contre le Covid  ». Dans les lignes de cette colonne, la nécessité de cuisiner pour se nourrir, ou la capacité de la pratique à faire passer le temps apparaissent aux côtés de vertus rassérénantes, antidépressives. Le langage est souvent celui de la redécouverte : grâce à une recette de galettes, la râpe va «  connaître le plein emploi  ». Ailleurs, cʼest la guimauve qui devient prétexte à tester les limites de lʼattestation de sortie, un cake huile dʼolive-citron qui permet dʼimaginer un voyage à Marseille, tandis que des endives au jambon, associées au printemps, permettent de retrouver une prise avec le temps qui passe et le cycle des saisons. Sʼil est sans doute trop tôt pour parler dʼune «  cuisine COVID  », il est clair que la pratique culinaire a été centrale pour beaucoup pendant le premier confinement, que ce soit pour des questions dʼapprovisionnement ou de nécessité pratique. La dimension obligatoire de cette cuisine redécouverte est indissociable de sa dimension de plaisir, associée à une forme de résilience dans un contexte de pandémie : la cuisine connecte, étend le domaine domestique, fait passer le temps et aide à vivre au-delà de ses fonctions nourricières.
Ce retour à la cuisine ne sʼest néanmoins pas effectué en dehors des rapports de pouvoir qui structurent traditionnellement lʼespace domestique occidental. Lʼanalyse des conséquences de ce retour en cuisine demande de regarder au-delà de celle-ci, pour saisir des symptômes peut-être discrets dʼun retour aux rôles normatifs de genre. En mai 2020, la journaliste Anna Fazackerley écrit dans le Guardian que les taux de publication des chercheuses se sont effondrés depuis le début de lʼannée, tandis que ceux des chercheurs sont restés stables. Ces observations sont dʼabord empiriques, et reposent sur des témoignages comme ceux de la chercheuse Elizabeth Hannon, qui tweete au sujet du faible nombre de contributions faites par des femmes reçues par la revue dont elle a la direction (Fazackerley 2020). Ce tweet, observe A. Fazackerley, suscite de nombreux émois de chercheuses qui disent «  à peine gérer le soin aux enfants et le travail pendant le confinement lié au coronavirus  »421 (Fazackerley 2020). Lʼarticle montre ensuite comment une situation déjà inégale, mais perçue comme égale, a vu les écarts dʼimplication temporelle entre hommes et femmes se creuser sous lʼeffet du dispositif inédit du confinement. Les chercheurs, statistiquement, avaient quatre fois plus de chances que les chercheuses dʼavoir un·e partenaire impliqué·e dans les tâches domestiques (Flaherty 2020). Dans un contexte où les femmes gagnent toujours moins que les hommes, la profession la plus rémunératrice est souvent privilégiée dans des temps critiques vécus par un couple, comme le choix du temps partiel (Méda & Périvier 2007, 15) ou la décision pour un conjoint (le plus souvent, une conjointe) dʼarrêter de travailler temporairement. Une même logique semble avoir eu cours ici, la profession la plus rémunératrice devenant celle qui doit être maintenue, tandis que la profession moins intéressante financièrement -— celle de la femme -—verra son temps grignoté, ou pire, augmenté par le travail domestique et le care des enfants (Fazackerley 2020 ; Ferguson 2020).
Dans un autre article du Guardian, une consultante exprime ainsi son découragement : «  à cause de la pandémie, jʼai été privée de choix. Je me sens comme une femme au foyer des années 50  »422 (Ferguson 2020). Tout comme le temps non travaillé lié au soin des enfants en bas âge pénalise les femmes pour leur avancement professionnel ou leur retraite (Méda & Périvier 2007, 15) le temps consacré à la cuisine ou au soin des enfants par les femmes constitue un handicap qui peut les suivre tout au long de leur carrière : pour reprendre les deux exemples précédents, une chercheuse peut rater des dépôts de financement (pour lʼheure plus importants dans le monde anglo-saxon, mais le contexte français y vient également), une consultante peut perdre des client·es. Ce temps perdu se traduit, au bout de nombreuses années comme un handicap cumulatif423 qui pénalise les femmes : dʼailleurs, le rythme de publication par les chercheuses nʼétait pas revenu à la normale en aoà »t 2020 (Flaherty 2020), et continue même de se creuser aujourdʼhui (Draux 2024).
Parler du «  care  » donné aux enfants tient aussi de lʼeuphémisme dans cette situation précise qui, avec la fermeture des écoles, a souvent impliqué la classe à la maison, ou une supervision accrue des devoirs. Dans un contexte où les enfants ont lʼhabitude de solliciter leur mère pour ce type de tâches, il devient impossible pour les femmes de maintenir leur activité, à moins de faire une double journée (voire triple, si on considère que la situation «  normale  » tient déjà de la double journée, cf. infra., p.**). En France, la philosophe Tania de Montaigne a ainsi appelé en juillet 2020 à une reconnaissance nationale des «  mères télétravailleuses » ʼ soit «  ces femmes pieuvres qui ont fait des PowerPoint, des réunions Skype, des conf calls, tout en devenant spécialistes du collage de gommettes ou de la cuisson dʼobjets moches en pâte à sel  » (Hage 2021). Mary-Ann Stephenson, directrice de lʼorganisme anglais Womenʼs Budget Group résume ainsi la situation inégalitaire quʼelle a vue sʼinstaller :
[l]es hommes semblent davantage capables de sʼenfermer dans un bureau, tandis que les femmes travaillent à la table de la cuisine -— et essaient aussi de faire lʼécole à la maison424 (Ferguson 2020).
La féminisation des professions éducatives consacrées aux petites classes aide aussi sans doute à ce report automatique de lʼenseignement aux enfants sur les femmes dans les couples hétérosexuels. Les femmes interrogées par Donna Ferguson pour le Guardian parlent aussi de ce phénomène qui voient leurs enfants plus facilement graviter vers elles en cas de besoin que vers leurs conjoint·es. Les femmes restent attachées à lʼespace domestique, et une situation de crise peut donc facilement faciliter un renforcement de cette assignation.

Lʼassociation des femmes à lʼespace domestique informe aussi les discours sur le logis en contexte pandémique. Les injonctions gouvernementales à limiter les contaminations sont longtemps restées au centre du dispositif de gestion de la crise dans de nombreux pays européens. En Angleterre, cʼest une campagne apparemment inoffensive qui enjoint en 2021 les Britanniques à «  rester à la maison, sauver des vies  » («  stay home, stay lives  », fig. 2.28)425. Cette campagne a été diffusée en janvier 2021, dans le contexte de lʼapparition du variant du Kent, diffusé au reste de lʼEurope et connu en France comme «  variant anglais  ». Lʼaffiche est toutefois composée dʼune illustration principale comportant quatre petites maisons, vues en coupe, dans lesquelles sʼactivent des personnages. Un seul homme apparaît, sur son canapé, détendu avec sa compagne. Dans les trois autres demeures, une femme se tient à côté dʼune table à repasser avec un bébé, une deuxième femme lit une histoire à ses deux enfants, et la troisième se tient à côté dʼune femme plus petite (sa fille ?) quʼelle a lʼair de guider pour passer la serpillière.
Autrement dit, investir la sphère domestique est associé majoritairement aux femmes, qui sʼoccupent des «  corvées  »â€¯; lorsquʼun homme est représenté dans un intérieur, son occupation est associée à la détente, aux loisirs, pourquoi pas à la vie de couple. Lʼimage peut en effet se lire spatialement, comme un voisinage dont lʼintimité nous est révélée, comme des maisons de poupées dont on retire la façade ; toutefois, la similarité des maisons et leur alignement invitent aussi à lire de gauche à droite une forme de succession temporelle des étapes. Même si les personnages sont différents, on imagine alors une temporalité domestique où les femmes sont constamment occupées (même la femme sur le canapé peut être lue comme sʼoccupant de son conjoint) et les hommes, détendus ou retirés dans une autre pièce, occupés par quelque activité importante. Lʼaffiche a causé un tollé général qui a mené à son retrait rapide de la circulation. La question est dʼautant plus brà »lante, en Angleterre, que les écoles et les crèches y sont restées fermées (contrairement à la France), imposant aux familles de prendre des congés non payés pour assurer le soin aux enfants. Et ce congé non compensé, cela ne surprendra pas à lʼissue de cette analyse, a été pris deux fois plus souvent par des femmes que par des hommes (Topping 2021).
Ce parcours réalisé dans le monde du retour à la cuisine peut laisser un goà »t amer en bouche. En effet, les femmes semblent prises au cÅ“ur dʼune contradiction inextricable : avoir un emploi consiste à renoncer à des savoir-faire, mais avoir lʼemploi ne les empêche pas dʼêtre très investies dans le travail domestique. À la moindre crise, ce travail savamment externalisé peut effectuer un retour fracassant, comme lʼa montré la crise du COVID. Par ailleurs, si jʼai évoqué des situations de triple journée, il me faut nuancer et rappeler que cette situation a souvent été celle de femmes employées par le secteur tertiaire, et à fortiori CSP+. De nombreuses femmes, surreprésentées dans les emplois du soin, le secteur hospitalier, les emplois de caisse, se sont retrouvées «  en première ligne  », certes loin de leurs cuisines, mais particulièrement exposées au virus et à la situation de tension générale, souvent en contrepartie de salaires précaires (Hage 2021). Par ailleurs, le manque dʼaccès aux soins a empêché de nombreuses femmes dʼavoir recours à la contraception ou à lʼIVG. En somme, les inégalités de genre et plus précisément lʼinvisibilisation du travail domestique, la précarisation par le travail salarié peu qualifié et les difficultés dʼaccès à la santé reproductive ont été aggravées par la crise du COVID. Il faut donc être particulièrement vigilant quant à ce retour à la domesticité et ses implications réelles pour les femmes, qui affrontent une multiplicité de problèmes matériels liés au sexisme. Face à eux, le vÅ“u de partage équitable des tâches semble bien timide. Pour de nombreuses femmes, dont fait partie la journaliste Helen Rosner, cʼest bien la dimension obligatoire de cette domesticité «  confinée  » qui pose problème. Les femmes sont peut-être plus vulnérables à cette injonction à «  rester à la maison  », puisque celle-ci a été historiquement liée à leur genre. H. Rosner écrit ainsi :
Lʼobligation, comme il se trouve, signe véritablement la fin de la joie ; il nʼy aurait sans doute pas autant de publicités à la télévision montrant des femmes qui semblent curieusement heureuses de faire la lessive si la domesticité obligatoire ne réduisait pas tranquillement lʼâme en poussière (Rosner 2020)426.
Après une période où Rosner confesse trouver du réconfort à cuisiner en contexte pandémique, la tâche semble perdre tout son sens pour elle, notamment en raison de cette obligation. Elle admet que le fait dʼavoir pu, un jour, éprouver du plaisir à faire cette tâche relève aussi dʼun privilège de classe. Et si la crise du COVID creuse encore les inégalités, entre celleux qui regrettent mélancoliquement un temps où cuisiner était plus plaisant, et dʼautres qui essaient de subsister (parfois en ayant recours aux banques alimentaires ou restaurants solidaires pour la première fois), la manière dont la pandémie agite la cuisine et la domesticité doit nous interpeller. On peut facilement écarter dʼun revers de bras qui fait son pain pour la première fois, ou sʼessaie au levain ou aux confitures : en réalité, ces pratiques ont un potentiel quʼil est important de saisir. Ici le travail de S. Hayes amène un indice précieux : il existe une expertise, des savoir-faire en cuisine qui, en contexte de crise deviennent des savoir-survivre.
Pour les plus fortuné·es, cette survie est davantage une résistance psychologique, puisque leur subsistance physique est assurée. Mais le soutien physique comme moral apporté par la cuisine compte. En 2021, jʼai diffusé un tract de recherche sur lʼempouvoirement en cuisine, suite à la disparition de la publication dans laquelle lʼarticle devrait trouver sa place427. Ces pages constituent lʼorigine du présent texte à plus dʼun titre, et doit être signalé ici car jʼy développais lʼidée dʼune subsistance possible et nécessaire depuis la cuisine. On trouvera peut-être que je me suis éloigné du design : or, ce sont bien la manière dont les cuisines sʼarticulent aux maisons, qui permettent aux femmes dʼy accompagner les devoirs des enfants, pendant que les hommes sʼisolent dans leur bureau. Et si la cuisine est conçue avec une conscience de cet empouvoirement possible, alors dʼautres récits peuvent être mis en place. Dans le tract, jʼévoquais la manière dont le self-care (dont peut faire partie la pratique culinaire) était souvent perçu comme un repli sur soi et une rupture dʼavec un contexte politique. Mais une telle lecture a été en retour très critiquée. Dans Care Work (2018), la poète et activiste Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha critique un article de B. Loewe, «  An End to Self Care  », dans lequel lʼauteurice affirme quʼon «  ne peut pas tricoter son chemin vers la révolution  »428. L.L Piepzna-Samarasinha pointe lʼaspect «  classiste  » et «  fem-phobique  »429 de cette affirmation, qui nie la manière dont, historiquement, les femmes se sont organisées autour dʼactivités comme le tricot ou la couture pour mener des luttes politiques (2018, 209). Elle utilise le travail de Kim Katrin Milan qui parle dʼune «  science fem  »430 (Milan 2013), pour évoquer des «  connaissances, technologies et intelligences  »431 (Piepzna-Samarasinha 2018, 69) propres à un groupe minorisé -— les personnes fem, mais aussi les personnes en situation de handicap, chez qui elle défend lʼexistence dʼune «  crip science  ». Il y a chez Piepzna-Samarasinha la volonté de connecter entre elles les survies physique et psychologique, et de rattacher celles-ci aux moyens du bord, et donc à la vie domestique -— à plus forte raison que les personnes en situation de handicap ou de maladie chronique sont souvent amenées à passer un temps conséquent dans ce contexte, chez elles, voire au lit.
Les écrits de K. K. Milan et L. L. Piepzna-Samarasinha invitent à considérer les menus travaux, les tâches apparemment simples, ou décrites comme du travail «  peu qualifié  » comme possédant une valeur, en tant que «  travail culturel  ». L. L. Piepzna-Samarasinha souligne la manière dont le tricot ou la cuisine peuvent en fait faire pleinement partie des luttes politiques, les accompagner et les soutenir (2018, 209). Elle parle ainsi de «  toutes les manières faites maison avec lesquelles nous survivons  »432 (2018, 167). Tricoter, dit L. L. Piepzna-Samarasinha, comme moyen de relâcher lʼanxiété, ou de vêtir son enfant, est une pratique légitime qui a sa place dans un tribunal où une communauté est venue protester contre une condamnation (2018, 209–10). Il ne sʼagit pas dʼadopter un paradigme «  petites causes -— grands effets  », mais plutôt de considérer (Macé 2017) des luttes existantes et leurs moyens concrets, souvent enracinés dans des gestes ordinaires, qui malgré toute leur banalité, relèvent de techniques fem, de méthodes de survie nées de lʼoppression de genre. Parce que ces gestes existent dans des communautés qui les partagent et les maintiennent vivants, cʼest vers une cuisine ramifiée que je vais à présent me tourner. Si S. Hayes associe retour à la maison et vie communautaire, il nous faut sans doute retourner cette narration pour saisir comment, dans des communautés diverses et à travers de lʼhistoire, sʼest imposée une cuisine non pas réinvestie, mais jamais abandonnée, partagée, communalisée.
Solidifiée dans les imaginaires par la culture bourgeoise, la cuisine nʼen est pour autant pas la propriété. Le terme «  cuisine », nous aurons lʼoccasion de le vérifier plus avant, recouvre de multiples réalités en termes dʼaménagement. Le stéréotype soutenu par la publicité de la ménagère posant souriante, en tablier, devant sa cuisine équipée est encore très prégnant dans la culture populaire, comme le montre la consultante anglaise précédemment citée, qui compare sa vie de femme confinée en 2021, à celle dʼune housewife des années 1950. Cependant, cette image ne doit pas jouer le rôle de camouflet. Elle reste un idéal, certes matérialisé par des expériences et remis en circulation par les diverses productions médiatiques (des publicités aux fictions, en passant par les autorécits des media sociaux), mais qui ne décrit pas la totalité des expériences existantes. La domination des représentations dʼune cuisine équipée et individuelle ne doit donc pas faire oublier comment la cuisine, en de nombreux endroits, est déjà collective, et nʼexiste que dans la mesure où elle est reliée à une communauté donnée.

Si le terme de «  collectif  » peut rapidement évoquer des groupes politiques formés et identifiés (que jʼexposerai plus loin), les formes de groupes peuvent être variées ainsi que discrètes. Les fameuses réunions Tupperware, arrivées en France dans les années 60 (Achin & Naudier 2009), peuvent ainsi faire sourire (fig. 2.28). Il serait facile de les railler, de les réduire à des rassemblements de «  bonnes femmes  ». La connexion de la réunion à un acte dʼachat, qui plus est dʼun objet en plastique (matériau aujourdʼhui honni, emblématique -— sans doute à tort -—des modes de consommation anti-écologiques) achève de disqualifier a priori ces groupes comme de potentielles cellules dignes dʼintérêt pour une approche politisée de la cuisine. Pourtant, les travaux effectués en France (Achin & Naudier 2009) et aux États-Unis (Clarke 2001) sur le système Tupperware offrent un tout autre regard sur ce dispositif économique et social.
Catherine Achin et Delphine Naudier montrent comment les réunions sont dʼabord émancipatrices pour les «  démonstratrices  ». Ces femmes sont embauchées par la marque Tupperware, qui, fait notoire, a localisé sa production française en Indre-et-Loire. Si les équipements en électroménager coà »teux sont plutôt le fait des classes aisées, les produits Tupperware, pourtant identifiés comme chers, sont prisés des classes populaires et moyennes (Achin & Naudier 2009, §8). Les démonstratrices nʼont souvent pas fait dʼétudes dans le domaine commercial, et sont formées par la marque depuis que Brownie Wise, femme américaine divorcée et précaire a devisé le système des réunions au début des années 1950 (Achin & Naudier 2009 ; Clarke 2001). La marque permet donc à des femmes sans qualifications de gagner un revenu et, surtout, de quitter la maison (Clarke 2001, 202). Dans lʼenquête sociologique de Catherine Achin et Delphine Naudier, il apparaît que lʼattrait économique du complément de revenu est perçu comme moindre par rapport à la perspective dʼautonomie que promettent les réunions pour les démonstratrices, qui peuvent alors prendre leur voiture, sortir de chez elles et rencontrer dʼautres femmes. Dans les témoignages des enquêtées, la nature politique souterraine de ces réunions apparaît. Pour certaines client·es Tupperware, pour qui les luttes féministes des années 1960 semblent bien lointaines, la réunion de démonstration est la «  première expérience de ‹ groupe de femmes ›  » (Achin & Naudier 2009, §8). Les démonstratrices ne sont pas des militantes, selon les deux sociologues, mais prennent en charge un rôle de «  passeuse  » en distillant conseils et avis, par exemple sur le couple ou la contraception. Certains sujets comme lʼavortement ou les violences conjugales restent tabou (Achin & Naudier 2009, §10), toutefois le groupe réuni pour consommer finit par élaborer une socialité qui déborde la seule expérience dʼachat. Si lʼon dit souvent que le féminisme (ou les politiques queer) sont vulnérables à la récupération par le marché, il faut aussi envisager que des expériences a priori au service du profit et de grands groupes financiers puissent être «  hackés  » et servir de lieux politiques.
Ici, le prétexte de lʼachat de matériel culinaire fait mieux que de permettre la rencontre féministe, il sert de leurre permettant à la conversation entre femmes de se tenir sans éveiller les suspicions dʼépoux dans un contexte de «  domination rapprochée  » (Achin & Naudier 2009, §10 ; Memmi 2008). Ceci est dʼautant plus intéressant du point de vue du design. La boîte Tupperware, en tant quʼobjet modulaire, en plastique, est entrée dans lʼhistoire du design en étant idéalisée comme produit réalisant lʼidéal moderniste de rationalisation technique et dʼéconomie de forme. Mais comme le mentionne Alison Clarke, cette entrée du produit Tupperware dans lʼhistoire du design a été permise par un arrachement de lʼobjet à son contexte, notamment de vente, puisque les réunions étaient systématiquement omises des publications et expositions de design (Clarke 2001, 93). La dévalorisation de la réunion entre femmes permet donc à celle-ci de se produire loin des regards, mais tend aussi à la faire disparaître de lʼHistoire. Il y a dès lors un enjeu spécifique à lʼhistoire du design, qui en replaçant lʼobjet dans ses usages concrets, le réinscrit dans ses dimensions politiques, et sa relation à des communautés (ici féminines, peut-être féministes). La cuisine semble créer le groupe de femmes, lui donner lʼintérêt commun qui va permettre de créer des solidarités au-delà de la collaboration domestique ou culinaire. Le mouvement inverse, ou des groupes constitués inventent leur cuisine, existe également.
Jʼai cité plus tôt le travail de lʼarchitecte et chercheuse Anna Puigjaner, dont les recherches portent sur des «  villes sans cuisine  » (Kitchenless Cities). Lʼappellation du programme, explique-t-elle, tient de la provocation : il ne sʼagit pas de supprimer la cuisine, mais de la repenser comme une unité indépendante du logis tel quʼil est traditionnellement conçu (Puigjaner 2018). Dans une interview pour ArchDaily, A. Puigjaner explique quʼelle vit personnellement dans une maison sans cuisine en tant que pièce séparée. En réalité, elle possède une kitchenette, et signale que ce dispositif est viable sʼil est associé à une cuisine commune dont il assure le relais (Bestard 2016). En posant lʼidée dʼun espace privé sans cuisine, la cuisine ne disparaît donc pas, mais se déplace. A. Puigjaner étudie ainsi le cas spécifique des «  cuisines urbaines  »433 (Puigjaner 2018) au Pérou, phénomène quʼelle fait remonter aux années 1970, dans le contexte dʼune réforme économique aux conséquences difficiles. À cette époque, lʼinflation complique lʼaccès à la nourriture, et des cuisines communautaires sʼorganisent parallèlement aux mouvements de grève. Ces pratiques alimentaires populaires, désignées comme «  ollas populares  » vont former le socle de la constitution des cuisines urbaines, dans lesquelles des groupes de femmes (une quinzaine de personnes) se réunissent dans une cuisine privée et cuisinent à tour de rôle dans celle-ci (Puigjaner 2018). Le principe est de proposer une cuisine à bas coà »t, voire à prix coà »tant. Les femmes impliquées dans ces dispositifs, dit A. Puigjaner, refusent dʼêtre rémunérées, ce qui produit des avantages paradoxaux. En effet, «  [c]omprendre leur travail comme étant volontaire a permis de développer des liens sociaux plus forts, mais a en même temps perpétué un manque dʼaccès à lʼéconomie pour ces femmes  »434 (Puigjaner 2018).

Par ailleurs, les cuisines urbaines ont été identifiées comme essentielles à la vie du pays, ce qui a incité les gouvernements successifs à aider financièrement ces structures. Toutefois, une division existe entre les cuisines qui accèdent aux aides de lʼÉtat péruvien et celles qui le refusent pour des raisons politiques. A. Puigjaner évoque les Comedores Populares (fig. 2.30.a), où les femmes maintiennent les bas prix des repas, tout en refusant rémunération et aides. Ces cuisines servent donc des formes de survie (pour les client·es des repas) et dʼempouvoirement pour les femmes qui collaborent de cette manière, parfois depuis des cuisines privées (fig. 2.29.b). fig. 2.29.b : Comedor Popular La Balanza, à Lima. Mais la survie de ces principes est fragile. Historiquement frappées par des groupes terroristes (le groupe Shining Path), ces groupes de femmes se distinguent par leur capacité dʼadaptation à leurs conditions, mais cette souplesse ne doit pas faire oublier la fragilité des structures et des bénéfices qui en sont tirés. A. Puigjaner explique ainsi comment, au début des années 90, le World Food Program permet au Pérou de recevoir lʼexcédent de la production étasunienne de blé, dans le but, pour les États-Unis, de maintenir le prix du produit sur leur marché national. Cette arrivée de blé au Pérou donne un accès inespéré à de grandes quantités de farine, qui permettent à leur tour la création de boulangeries associées aux cuisines urbaines. Mais la fin du dispositif dʼenvoi de blé entraînera aussitôt la faillite de ces nouvelles entreprises (à quelques rares exceptions). Lʼexemple des Comedores Populares permet donc dʼimaginer un investissement communautaire des cuisines. Les femmes ne nourrissent pas seulement leur famille, mais aussi elles-mêmes (puisquʼelles profitent dʼun tarif préférentiel des repas) et leur communauté. La cuisine communautaire et autonome est marquée par des contradictions internes liées au contexte de lʼéconomie mondialisée et du capitalisme néo-libéral. Ces cuisines sʼépanouissent avec les aides de lʼÉtat (dans le cas des Club de Madres), mais lʼacceptation dʼun tel dispositif contredit les principes dʼautonomie et la force politique initiale contenue dans un projet dʼabord structuré autour de groupes de femmes.
fig. 2.29.b : Comedor Popular La Balanza, à Lima. Mais la survie de ces principes est fragile. Historiquement frappées par des groupes terroristes (le groupe Shining Path), ces groupes de femmes se distinguent par leur capacité dʼadaptation à leurs conditions, mais cette souplesse ne doit pas faire oublier la fragilité des structures et des bénéfices qui en sont tirés. A. Puigjaner explique ainsi comment, au début des années 90, le World Food Program permet au Pérou de recevoir lʼexcédent de la production étasunienne de blé, dans le but, pour les États-Unis, de maintenir le prix du produit sur leur marché national. Cette arrivée de blé au Pérou donne un accès inespéré à de grandes quantités de farine, qui permettent à leur tour la création de boulangeries associées aux cuisines urbaines. Mais la fin du dispositif dʼenvoi de blé entraînera aussitôt la faillite de ces nouvelles entreprises (à quelques rares exceptions). Lʼexemple des Comedores Populares permet donc dʼimaginer un investissement communautaire des cuisines. Les femmes ne nourrissent pas seulement leur famille, mais aussi elles-mêmes (puisquʼelles profitent dʼun tarif préférentiel des repas) et leur communauté. La cuisine communautaire et autonome est marquée par des contradictions internes liées au contexte de lʼéconomie mondialisée et du capitalisme néo-libéral. Ces cuisines sʼépanouissent avec les aides de lʼÉtat (dans le cas des Club de Madres), mais lʼacceptation dʼun tel dispositif contredit les principes dʼautonomie et la force politique initiale contenue dans un projet dʼabord structuré autour de groupes de femmes.
Cet exemple permet de mieux saisir comment une approche collectiviste de la cuisine, si elle permet de rompre avec les pratiques individualisées dans cet espace, ne permet pas pour autant de sʼextraire de logiques capitalistes. Jʼai déjà pointé, au sujet des radical homemakers, comment cet objectif semble voué à lʼéchec. Par ailleurs, lʼexemple des Comedores Populares permet de visibiliser une autre dimension de la cuisine : sa connexion permanente avec lʼÉtat, ainsi que ses structures financières et politiques. Opérer indépendamment de lʼÉtat peut être fragilisant, mais dépendre des aides gouvernementales court également le risque de subordonner la réussite dʼune structure à la continuité de lʼaide (comme le montre lʼexemple du blé étasunien). Plutôt que de penser un en-dehors du capitalisme, il faudrait donc imaginer des moyens de faire avec, voire de hacker le système existant, comme le font dʼune certaine manière les démonstratrices Tupperware qui, venues parler de leurs boîtes en plastique, se retrouvent à évoquer la contraception, voire à créer des liens pour lutter contre un abus conjugal (Achin & Naudier 2009, §10). Les différents exemples que jʼai évoqués ici, de la réunion Tupperware étasunienne (à lʼorigine) à la création de cuisines partagées autour des ollas populares peuvent sembler très éloignés : mais leurs écarts sont justement instructifs. Ils me permettent de mettre lʼaccent sur le fait que «  les communs  », ou «  la communauté  » sont dʼabord des effets de processus et dépendent de temporalités et rythmicités différentes. Dans les deux cas, cʼest bien la répétition dʼun temps privilégié autour de la pratique alimentaire qui active des formes de politicité, et cʼest donc vers la création de tels temps que lʼaménagement visé par le design doit se tourner.
La discipline du design, justement, semble sʼêtre emparée de cette question de la communauté. Aux côtés des sous-disciplines bien connues du produit, de lʼespace, de la communication et de la mode, le design dʼinnovation sociale sʼest taillé une place dans le paysage de la création en design, de manière très lisible depuis le début du millénaire. Sʼil ne sʼagit pas dʼun champ homogène, son vocabulaire, ses formes et ses moyens constituent un ensemble identifiable, et même la base de programmes pédagogiques435. Sur la plateforme en ligne française Social Design436, six objectifs de la sous-discipline sont détaillés : «  faire lien  », «  fabriquer la ville  », «  transmettre  », «  donner goà »t  », «  rendre durable  » et «  prendre soin  ». Le design social réinvestit donc des missions anciennes (penser le tissu urbain) mais leur associe des visées plus spécifiques (le soin, le domaine médical) et des enjeux qui recouvrent le travail des travailleur·ses sociaux ou plus largement des collectivités territoriales. En 2015, le chercheur en design Ezio Manzini publie Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, faisant suite à dʼautres ouvrages sur la localité (Spark! Design and Locality, 2004) ou à son ouvrage plus ancien, La matière de lʼinvention (1986), qui reste un texte fondamental de la discipline du design.
Dans Design, When Everybody Designs, E. Manzini décrit une époque où tout le monde est incité à designer, voire où tout le monde est considéré comme designer. Prenant acte de ce fait, il maintient que le design doit faire lʼobjet dʼun apprentissage, surtout dans un contexte où les ressources planétaires sʼavèrent limitées et nous invitent à repenser les écosystèmes de conception et de production de biens et dʼespaces (Manzini 2015, 2). Manzini cite un rapport de lʼéconomiste et entrepreneur britannique Robin Murray, «  Dangers and Opportunity  » dans lequel ce dernier affirme quʼune révolution économique est en marche, caractérisée par le brouillage des limites entre production et consommation, une attention accrue à la collaboration et lʼusage intensif des réseaux pour structurer les rapports entre acteurs (Murray 2009, 4). Cette économie manque cependant de capitaux pour véritablement se développer ; or, dans un contexte de crise financière et écologique, argumente Murray, cette économie sociale constitue une troisième voie vis-à -vis des directions plus connues de la redistribution (modèle peer-to-peer, des communs sur le Web) et de la «  révolution industrielle verte  »437 (Murray 2009, 9). Dans ce modèle, le logis («  household  ») est présenté comme faisant partie de lʼéconomie, à lʼopposé de la tradition dʼinvisibilisation du foyer, perçu comme privé et non productif. Murray affirme même que :
les membres du foyer [householders] deviennent leurs propres designers, processeurs et assembleurs, et leurs maisons des mini-bureaux. Nous avons un aperçu de ce que pourraient signifier des services environnementaux qui, grâce aux technologies, offrent une perspective où chaque maison devient sa propre station de production dʼénergie (à travers des mini-chaudières produisant chaleur et énergie et des micro-recyclables), et chaque voiture sa propre unité de conservation de lʼénergie (avec les voitures électriques)438 (Murray 2009, 11).
Le design social se nourrit donc dʼune pensée des écosystèmes, reformulés comme des boucles vertueuses dans lesquelles tous les acteurs du dispositif voient leurs besoins satisfaits par la collaboration entre les pairs et lʼorganisation pragmatique des infrastructures, quant à elle orientée vers la valorisation des ressources énergétiques et dédiées à limiter lʼimpact environnemental des activités humaines. Il est intéressant de constater que ces projets de grande envergure reposent sur une pensée revendiquée des microéchelles, et notamment de lʼunité «  maison  », qui devient, chez Murray, le lieu de production de lʼénergie quʼelle consomme, ou chez Manzini, une manière de relier les générations et solutionner la crise du logement (Manzini 2015, 13).
Un point de vue féministe sur ces questions peut amener deux questions au moins. Premièrement, lʼidée de repositionner la maison comme unité de production interroge sur les responsabilités accrues qui pourraient encore incomber aux femmes, puisquʼelles sont encore attachées à cet espace, nous lʼavons vu, et sont trop souvent immédiatement considérées comme responsables du travail qui sʼy produit. À lʼinverse, les propos de Manzini comme ceux de Murray adoptent une perspective universaliste, qui ne mentionne jamais les questions de genre. Les termes «  homme  » ou «  femme  » ne sont jamais cités, et le terme «  humain  » leur est généralement préféré. Si on peut se féliciter que le terme «  Homme  » comme signifiant général de lʼhumanité soit abandonné, on peut aussi sʼinterroger sur la manière dont le logis est ainsi produit comme un espace neutre sur le plan des questions de genre, éludant une riche histoire où le logis comme unité de production a été pensé et organisé, mais dans un contexte féministe, dʼabord par des femmes. Je prends donc ici acte dʼun contexte où le design est de plus en plus considéré comme relevant de lʼinnovation sociale, investissant lʼaide mutuelle, la collaboration ou le partage comme des leviers de conception. Cependant, il est nécessaire de réinscrire ces stratégies dans le contexte militant qui les a formulées. Deux enjeux au moins apparaissent ici : premièrement, il faut rappeler que la mutualisation du travail domestique est au cÅ“ur du féminisme, autant que le suffragisme ou la question salariale qui lʼont pourtant supplantée dans les imaginaires collectifs. Deuxièmement, la discipline du design social ne peut exister quʼen prenant acte de ces innovations antérieures, et actant que le design social, historiquement, est un design féministe et afroféministe—pourtant, lʼhistoricisation du design et de ses productions ont gommé cette dimension qui demande donc à être réaffirmée et re-traversée.
En 1982, lʼhistorienne de lʼurbanisme étasunienne Dolores Hayden publie The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities, un ouvrage dédié aux productions, expérimentations et fictions qui ont projeté, entre la fin de la guerre de Sécession et le début de la Grande Dépression aux États-Unis (soit entre 1865 et 1927) une mutualisation du travail domestique dans le but de révolutionner la condition féminine. Son intérêt se porte plus particulièrement sur les trois générations de féministes matérialistes qui ont critiqué le modèle des «  deux sphères  » (sans toutefois le remettre systématiquement en cause) et ont associé à cette production théorique des actions et expérimentations très diverses, en développant des organisations, formant des coopératives, créant des crèches et des pressings autogérés, des cuisines publiques, des logis sans cuisine, des clubs ou des associations produisant de la nourriture (cuisines publiques) relevant dʼune pensée des «  villes féministes  »439 (Hayden 1982, 3). Ce travail historique possède une forte dimension politique.
Selon D. Hayden, le féminisme de la seconde vague, incarné par B. Friedan, est en effet caduc. Ces discours ont bien intégré la question du travail domestique féminin non rémunéré, mais ont oublié lʼisolement des femmes dans lʼespace du foyer -— croyant peut-être lʼavoir résolu en embrassant le travail salarié. D. Hayden montre que ces deux questions sont indissociables, et quʼà lʼorigine (autour de 1860), aux côtés des discours suffragistes, une riche réflexion théorique et expérimentale émerge pour repenser la sphère domestique plutôt que de la fuir. Ce projet se concrétise dans lʼinvention de formes mutualisées qui prennent en charge le travail domestique dans le logis, dans des espaces externes, ou dans des habitats reformulés associant différemment les fonctions des espaces. Ces actes et pensées révolutionnaires ont bien sà »r trouvé leurs limites, parfois pratiques, économiques, ou politiques en raison dʼune forte opposition conservatrice ; par ailleurs, les idées des féministes matérialistes, explique D. Hayden, ont souvent été affaiblies par leurs propres contradictions ou par ignorance des questions de classes et de race. Ce manque a alors permis un retour de bâton («  backlash  ») conservateur et capitaliste. Cette révolution domestique constitue néanmoins la pièce manquante du féminisme, dont Hayden, dans les années 1980, affirme lʼactualité, montrant dans sa conclusion lʼurgence qui existe à réintégrer la question domestique aux politiques féministes. Son étude possède parmi ses nombreux intérêts celui de positionner la période 1920–1970 comme étant plutôt une période de perte dʼavantages plutôt que de progrès, ce qui va à lʼencontre des lectures dominantes pour qui les causes féministes, du suffragisme au mouvement des années 1960–70, ont gagné du terrain et «  progressé  » selon une courbe régulière.
Le matérialisme des féministes citées par D. Hayden doit moins à Marx et Engels quʼau socialisme communautaire de Robert Owen en Angleterre (1813) et Charles Fourier en France (puis aux États-Unis, où il sera traduit en 1840). La période saisie par D. Hayden correspond à un moment moderne où de nombreuses innovations techniques bousculent la pensée des villes et lʼorganisation des maisons. Lʼarrivée de lʼéclairage au gaz (1816–20), des égouts (dès 1848 en Angleterre), de lʼeau courante (avec la robinetterie dès 1845 pour les plus riches), de la réfrigération (dès 1862, dans ses principes) et de lʼélectricité (première centrale électrique en 1896, après un accès possible sur le plan individuel) laissent imaginer, au XIXe siècle, une vie nouvelle, facilitée par les techniques, mais aussi des villes repensées autour de ces ressources, rendues accessibles par un système dʼinfrastructures collectivisées. Parmi les commentateurices fasciné·es par les promesses du progrès technique, D. Hayden cite lʼarchitecte, paysagiste et disciple de Fourier Frederick Law Olmsted qui imagine en 1870 une gestion municipale du chauffage et un système de commande (par pneumatique) des produits du quotidien (Hayden 1982, 11). D. Hayden explique que ces inventions ont été perçues à lʼépoque de leur conception comme des avancées intrinsèquement sociales, qui devaient inévitablement amener à une mutualisation des ressources et à une réforme globale des villes et de lʼhabitat. Les féministes matérialistes reçoivent quant à elles ces évolutions depuis la «  sphère  » du logis, et elles seront nombreuses à annoncer la fin de lʼespace domestique privé. La pensée de la domesticité va avoir un impact fort sur lʼaménagement des espaces, et jʼévoquerai dans le chapitre suivant les rôles de Catharine Beecher, Lillian Moller Gilbreth et Christine Frederick, autrices de guides ménagers, sur lʼespace de la cuisine et la mécanisation de celui-ci. Ces autrices ont eu un rôle important, qui a amené Alexandra Midal (2009, 23–33) à rappeler leur influence centrale dans lʼhistoire du design—mais aucune des trois nʼa investi la dimension sociale de la cuisine et sa capacité à être traversée par des formes de coopération. Au contraire, dans le cas de Frederick, le discours en faveur dʼune modernisation des outils de la femme au foyer a consolidé le modèle de la femme isolée au logis (Hayden 1982, 285). Catharine Beecher également, malgré une approche qui lui a valu dʼêtre intégrée, quoique tardivement, aux histoires du design, plaidait en faveur dʼune femme au foyer dédiée, sinon sacrifiée à la cause domestique.
D. Hayden invite dès lors dʼautres figures dans cette pensée de la domesticité, comme Melusina Fay Peirce qui propose des formes de travail domestique coopératif tout en critiquant le «  POUVOIR-DU-MARI  »440 (Hayden 1982, 84), ou Marie Stevens Howland qui vit dans les communautés expérimentales de Topolobampo au Mexique, ou encore le Unitary Household monté par Stephen Pearl Andrews à New York (1858), deux projets soutenus par une externalisation du travail domestique et une éthique -— alors naissante -—de lʼamour libre (Hayden 1982, 102). Certaines des féministes matérialistes étudiées par D. Hayden sʼassocient à des architectes pour monter leurs projets (comme Jane Addams avec la Hull-House en 1889–1916) mais dʼautres produisent elles-mêmes le travail de conception (Alice Constance Austin à Llano Del Rio). Dans certains cas, le travail ne porte pas sur la restructuration de lʼespace, mais consiste à organiser des groupes assurant la prise en charge des repas dans des coopératives, avec des objectifs différents : Ellen Swallow Richards et Mary Hinman Abel forment ainsi des coopératives dans lʼoptique dʼéloigner les hommes des cafés en leur proposant des repas livrés, tandis que pour Mary Kenney, la coopérative alimentaire est dʼabord un moyen de soutenir la grève. D. Hayden sʼattache à évoquer de manière exhaustive des personnalités féminines dans lʼhistoire du féminisme et de la conception urbaine ; je mʼattacherai ici plutôt, en lien avec mon propos précédent, à restituer un paysage des possibles de la mutualisation domestique et des grandes options permises par une telle approche.
La mutualisation de lʼespace domestique, de ses ressources et du travail quʼil rend nécessaire nʼest pas un fait en soi, mais le résultat dʼune somme dʼarbitrages complexes, menant parfois à des impasses. Les féministes qui annoncent la fin de lʼespace domestique privé nʼannoncent pas pour autant la fin du travail domestique : elles ont au contraire une conscience forte de sa nécessaire relocalisation ou redistribution. Leurs efforts portent sur la reconnaissance du travail domestique comme travail, et sur la nécessité de le rémunérer, soit en accordant un salaire à la femme au foyer, soit en payant des professionel·les de lʼentretien et de la cuisine. D. Hayden synthétise ainsi leur questionnement :
[Lʼespace de travail domestique] devrait-il être situé dans le complexe résidentiel (soit une maison avec une unité dʼhabitation, ou le bloc suburbain), dans le voisinage, dans lʼusine, dans la cité ou la nation ?441 (Hayden 1982, 21).
La question de la localisation de lʼunité de production du travail domestique implique donc immédiatement une question dʼéchelle. Cette dimension rend nécessaire une série de choix cruciaux qui mettent en friction «  les standards nationaux face au contrôle local, […] la participation adulte générale face à une efficace spécialisation, […] le choix individuel face à la responsabilité sociale  »442 (Hayden 1982, 28). Les réponses à ces questions ont souvent été multiples, et des tendances apparaissent selon les époques ; D. Hayden observe quʼentre 1870 et 1900 le modèle de lʼappartement-hôtel est dominant et fait consensus. Dans cette formule, des habitant·es se rassemblent dans un immeuble ou voisinage de maisons individuelles sans cuisine, mutualisent le travail domestique (notamment culinaire) et prennent leurs repas en commun dans une salle à manger. Ces dispositifs qui mutualisent la préparation de repas peuvent aussi inclure une crèche, une école, des lieux de fête. La mutualisation, quant à elle, peut répondre de modèles différents, parmi lesquels deux grandes tendances sʼaffirment, entre le choix dʼune coopération entre les habitant·es, qui sʼoccupent des tâches elleux-mêmes, ou le recours à des professionnel·les rémunéré·es embauché·es par la communauté. Ce dernier choix a été beaucoup discuté, entre celles qui refusent de recourir à lʼaide employée (pour des raisons sociales, ou par mépris du travail des domestiques, comme Melusina Fay Peirce) et préfèrent la coopération, et les autres qui y voient une garantie de qualité du travail effectué (Charlotte Perkins Gilman), ainsi quʼun choix rendu nécessaire par la scientifisation des activités domestiques.
En termes structurels, la mise en commun des ressources amène souvent des plans en étoile, où lʼéquipement commun est situé au centre, dʼoù irradient des circulations pour desservir des unités individuelles ou alors, un plan-grille est rythmé de modules dans lesquels les équipements partagés apparaissent à intervalles réguliers 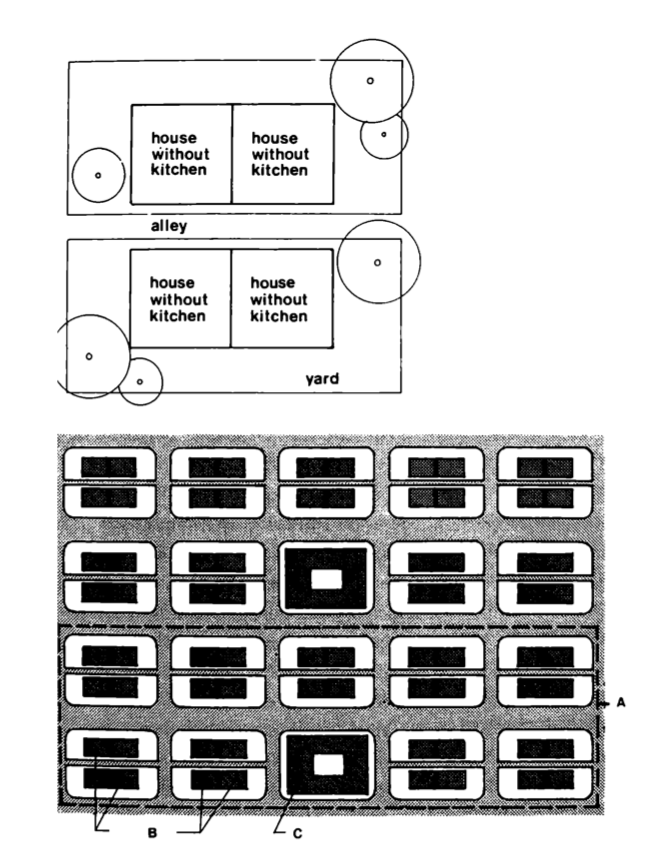 fig. 2.31.a : Melusina Fay Piere décrit des habitats rassemblés, régulièrement complétés par des équipements communs dans «  Cooperative Housekeeping  », un article pour le Atlantic Monthly (1868).(dans les projections de Melusina Fay Peirce, fig. 2.31.a, Hayden 1982, 71 ; ou dans la proposition de Albert Kimsey Owen, John Deery et Mary Howland, fig. 2.31.b, Hayden 1982, 111).
fig. 2.31.a : Melusina Fay Piere décrit des habitats rassemblés, régulièrement complétés par des équipements communs dans «  Cooperative Housekeeping  », un article pour le Atlantic Monthly (1868).(dans les projections de Melusina Fay Peirce, fig. 2.31.a, Hayden 1982, 71 ; ou dans la proposition de Albert Kimsey Owen, John Deery et Mary Howland, fig. 2.31.b, Hayden 1982, 111).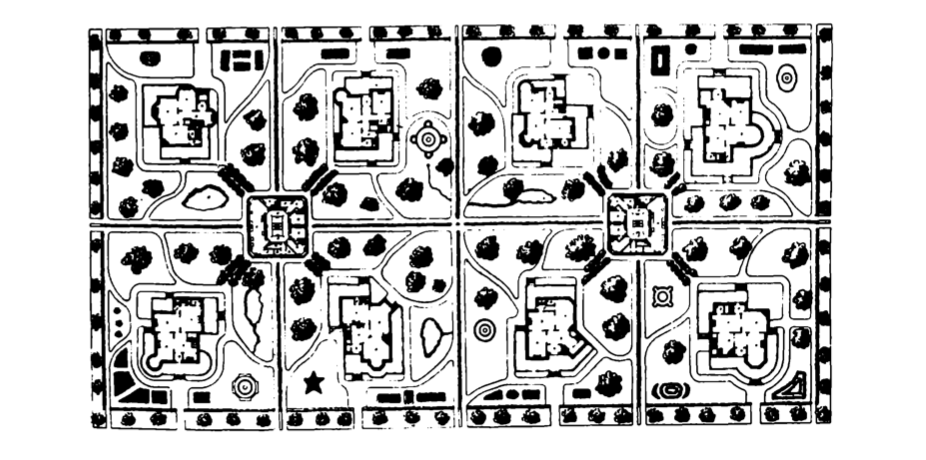 fig. 2.31.b : Albert Kimsey Owen, John Deery et Mary Howland travaillent au plan de la ville de Topolopambo au Mexique (1885) ; le projet n’a pas été réalisé. À lʼéchelle de lʼimmeuble, on retrouve le même exemple de lʼespace central structurant (très souvent, une salle à manger) autour de laquelle sont distribuées chambres et salles dʼeau (chez Leonard E. Ladd en 1890, ou John Pickering Putnam la même année ; Hayden 1982, 147). La mutualisation des ressources (labeur compris) implique une échelle collective qui fait passer le dessin, lui aussi, à une échelle macro : ce sont moins des ensembles individuels qui sont structurés que leur assemblage et leur connexion. Avant 1900, cʼest donc le modèle dʼun immeuble proposant une cuisine et salle à manger commune (et des appartements sans cuisine) qui sʼimpose.
fig. 2.31.b : Albert Kimsey Owen, John Deery et Mary Howland travaillent au plan de la ville de Topolopambo au Mexique (1885) ; le projet n’a pas été réalisé. À lʼéchelle de lʼimmeuble, on retrouve le même exemple de lʼespace central structurant (très souvent, une salle à manger) autour de laquelle sont distribuées chambres et salles dʼeau (chez Leonard E. Ladd en 1890, ou John Pickering Putnam la même année ; Hayden 1982, 147). La mutualisation des ressources (labeur compris) implique une échelle collective qui fait passer le dessin, lui aussi, à une échelle macro : ce sont moins des ensembles individuels qui sont structurés que leur assemblage et leur connexion. Avant 1900, cʼest donc le modèle dʼun immeuble proposant une cuisine et salle à manger commune (et des appartements sans cuisine) qui sʼimpose.
Entre 1900 et 1930, ce modèle de lʼappartement-hôtel fait place à une multiplicité de solutions. Lʼélectricité et lʼeau étant désormais accessibles à des unités dʼhabitation isolées, et plus seulement aux grands immeubles, la formule des appartements sans cuisine rassemblés dans un seul bâtiment perd de sa superbe ; de plus, cette solution est restée accessible aux plus fortuné·es (Hayden 1982, 229). La suppression de la cuisine privée reste un sujet de premier ordre, comme en témoigne A Modern Utopia de H. G Wells (1905). Lʼauteur y affirme en effet que «  lʼutopiste ordinaire ne penserait pas plus à une cuisine privée spéciale pour son dîner quʼil penserait à une minoterie ou une laiterie privée  »443 (Hayden 1982, 229), montrant à quel point la privatisation des fonctions du logis nʼavait rien dʼune évidence, et constituait même, au début du XXe siècle, un choix perçu comme absurde. Cela avait déjà été observé par des féministes quelques décennies plus tôt, à la manière dʼune Jane Sophia Appleton qui écrit en 1848 dans sa fiction dʼanticipation :
Pensez juste à lʼabsurdité dʼune centaine de gouvernant·es, luttant chaque samedi matin pour éduquer une centaine de petites filles tout en fabriquant des tartes dans une centaine de petits fours !444 (Hayden 1982, 52).
Lʼécriture de fictions dʼanticipation est un fait remarquable de cette révolution féministe parallèle au suffragisme et parfois mêlée à lui. Des auteurices projettent une pensée de la vie du futur, en proposant des plans ou en décrivant des sociétés alternatives—Anna Bowman Dodd décrit un monde où le mot foyer («  home  ») est obsolète (1887) ; Henry Olerich imagine une société martienne non-sexiste, où le travail nʼest plus structuré par le genre, et où les familles comptent 1000 membres (1894) ; Charlotte Perkins Gilman décrit dans Herland une société sans hommes (Hayden 1982, 183). Toutes ces fictions nourriront lʼinspiration des architectes impliqué·es dans des projets mutualistes, et certains architectes, elleux-mêmes, écriront même de la fiction (comme Alice Constance Austin qui conçoit les plans de Llana del Rio, et décrit une ville socialiste dans The Next Step en 1935). Les écrits des autrices de science-fiction Ursula Le Guin (The Dispossessed en 1974) et Marge Piercy (Woman on the Edge of Time en 1976) viennent plus facilement à lʼesprit quand il est question dʼutopies collectives, aussi est-il intéressant de les relier à ces projets plus anciens qui envisageaient dʼailleurs une forme de concrétisation.
Entre 1900 et 1930, des réponses diverses reposent sur la suppression de la cuisine privée, du Cooperative Quadrangle de Raymond Unwin and Barry Parker (1901) aux quadrangles dʼEbenezer Howard (1909), inspirés par les premiers. Le modèle de lʼappartement hôtel est délaissé en faveur dʼensembles dʼhabitation à lʼéchelle du voisinage. Le Cooperative Quadrangle, dessiné avec des cuisines communes, réintègre malheureusement des cuisines privées sous la pression des partenaires financiers (Hayden 1982, 231). La forme du bungalow, expérimentée à Los Angeles en 1910, aurait pu être un espace idéal pour développer des formes de coopération, mais celles-ci resteront lettre morte, victimes du turnover imposé par le modèle locatif de ces structures (Hayden 1982, 239). Alice Constance Austin reprend le principe du quadrangle amené par Howard, et le développe à lʼéchelle urbaine à Llano Del Rio en 1910, avec lʼobjectif de formuler une alternative à la cité capitaliste de Los Angeles (Hayden 1982, 242). Pendant cette période, les discours sur la mutualisation et la mise en commun des ressources subissent des pressions externes dues aux logiques de marché et au développement du capitalisme, qui culminera dans la société de consommation dʼaprès-guerre. Pour cette raison, les discours mutualistes, à lʼorigine imprégnés par les idéologies socialistes, sont aussi récupérés par les entrepreneurs qui militent en réalité pour un modèle individualiste, privé et plus lucratif. Le projet dʼune société suburbaine, où la famille hétérosexuelle est le module social par excellence, auquel correspond le module dʼhabitation du pavillon de banlieue où tout (travail domestique, équipements domestiques, véhicule) est individualisé nʼest pas le modèle dominant après la Seconde Guerre mondiale par accident : il a été activement formé par la frange la plus conservatrice des théoriciennes de la vie domestique, et soutenu par les acteurs financiers du marché (investisseurs et promoteurs immobiliers). Malgré lʼexistence de projets concrètement réalisés, un grand nombre des kitchenless houses sont ainsi restées à lʼétat de plans, ou ont été seulement concrétisées pour rapidement péricliter. Le modèle architectural nʼest pas seulement en cause : une fois la communauté formée, il faut organiser le travail (coopératif ou externalisé) selon des modalités qui permettent, à défaut de profits, une continuité du modèle. Si les apartment houses permettent des économies dʼéchelle et un coà »t réduit du loyer, beaucoup de projets mentionnés par D. Hayden se heurtent à la faisabilité économique
Des obstacles similaires concernent les projets de cuisines publiques qui reposent sur la collaboration dʼacteurs plutôt que sur la construction dʼun nouvel environnement (même si celle-ci peut aussi avoir lieu, in fine). Les coopératives évoquées par Dolores Hayden, au nombre de 33 aux États-Unis, ont des durées de vies sʼétendant de 6 mois à 33 ans (Hayden 1982, 242) et connaissent des formes variées, entre familles bourgeoises qui mutualisent leurs espaces et lʼemploi de leurs domestiques, et des formes de philanthropie, où des femmes des classes supérieures se réunissent pour proposer des «  soupes  », particulièrement populaires en temps de crise ou de guerre (Hayden 1982, 157–159 ; 224). En tant que projets sociaux, ces entreprises achoppent souvent sur des aspects économiques, quand ce nʼest pas sur les goà »ts des consommateurices des repas -— D. Hayden mentionne que les plus pauvres, concernés par ces entreprises philanthropiques sont souvent des immigrant·es qui préfèrent leur cuisine traditionnelle au goà »t «  Yankee  » imposé par des bienfaitrices, fussent-elles des expertes en nutrition (Hayden 1982, 167). Néanmoins, ces cuisines publiques prennent la forme dʼassociations, de cuisines aménagées pour ces besoins, voire de services de livraison pour lesquels des moyens de conserver la chaleur sont inventés. Ces dernières incarnations peuvent sembler plus loin de notre sujet, puisquʼelles nous font retourner à la cuisine professionnelle -— mais il faut se souvenir que cette cuisine collective ou «  soupe  » est une typologie ancienne, qui si elle regagne ici un intérêt à la faveur des idéaux socialistes de la fin du XIXe siècle aux États-Unis, a connu des incarnations bien antérieures qui ont nourri la cuisine privée des XIX-XXe siècles.
Siegfried Giedion lʼaffirme dans Mechanization Takes Command lorsquʼil évoque la cuisine du comte Rumford (Sir Benjamin Thompson). Le comte étasunien devient aide de camp en Bavière en 1784 et y installe sa «  soupe  » dédiée aux pauvres (Richards 1899, 20), soit une cuisine capable de nourrir plus de cent personnes. Ses expériences sur la chaleur et la lumière sont développées dans ce contexte, mais aussi dans des cuisines militaires et dʼhôpital (Giedion 1945, 531) où le comte devise un dispositif permettant de réduire les déplacements du cuisinier autour des casseroles, en lui assignant une position fixe permettant malgré tout la supervision. Ce dispositif en rond présenté par Giedion a dʼailleurs quelque chose de panoptique (fig. 2.32)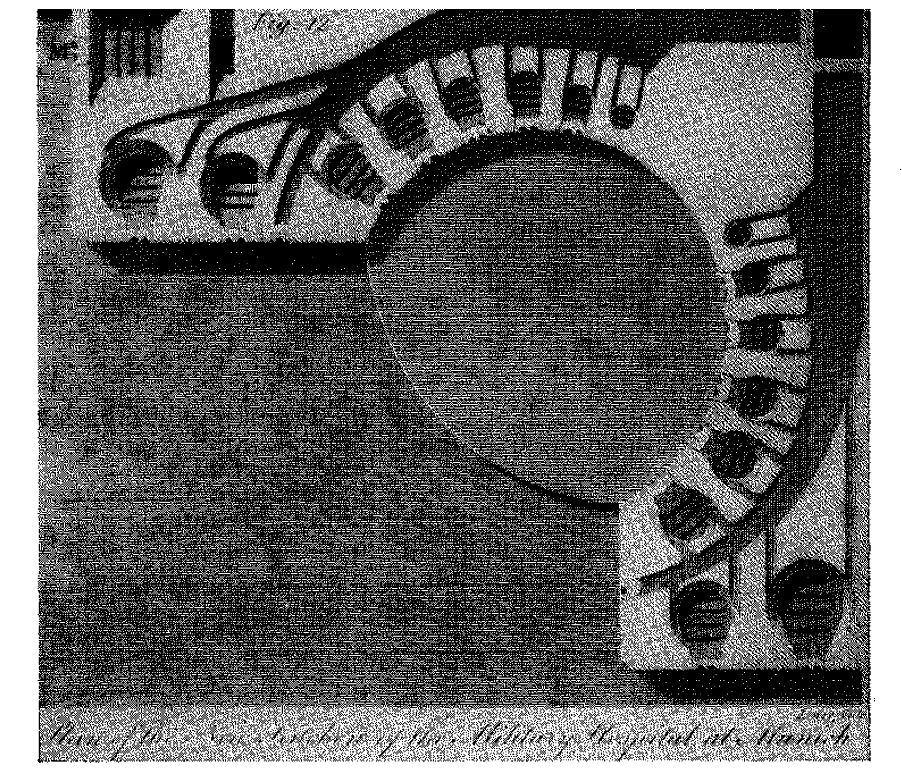 fig. 2.32 : Le Comte Rumford fait figure de précurseur, en inventant la gazinière et en pensant une organisation continue du plan de cuisson, sur un modèle presque panoptique (1870–75). Cette image de très mauvaise qualité est extraite du Mechanization Takes Command de Siegfried Giedion (1948). et montre quʼil nʼa pas fallu attendre le Family Hub pour que la notion de surveillance sʼinvite en cuisine. Giedion attribue à Mumford lʼinvention de la gazinière moderne (1945, 173), et relie du même coup la mise au point dʼun dispositif clé de la cuisine contemporaine à son développement dans une «  installation[…] de nourriture de masse  »445 (Giedion 1945, 530).
fig. 2.32 : Le Comte Rumford fait figure de précurseur, en inventant la gazinière et en pensant une organisation continue du plan de cuisson, sur un modèle presque panoptique (1870–75). Cette image de très mauvaise qualité est extraite du Mechanization Takes Command de Siegfried Giedion (1948). et montre quʼil nʼa pas fallu attendre le Family Hub pour que la notion de surveillance sʼinvite en cuisine. Giedion attribue à Mumford lʼinvention de la gazinière moderne (1945, 173), et relie du même coup la mise au point dʼun dispositif clé de la cuisine contemporaine à son développement dans une «  installation[…] de nourriture de masse  »445 (Giedion 1945, 530).
Cette cuisine du comte Mumford connaît une fortune critique dans le contexte des féminismes matérialistes interrogeant la sphère domestique. Lors de lʼexposition universelle de Chicago en 1893, la Rumford Kitchen proposée par Ellen Swallow Richards capture lʼimagination des visiteur·ses. Richards est lʼune des premières femmes à enseigner au MIT où elle dirige le Womenʼs Laboratory (Hayden 1982, 242 ; 157). Associée à Mary Hinman Abel, elle propose cette Rumford Kitchen, dont le nom est un hommage au comte Mumford. Cette proposition philanthrope, toutefois, est moins autoritaire que celle de son modèle, puisque Richards et Abel ne souhaitent pas imposer leur nourriture aux plus pauvres, mais plutôt les y initier en laissant la possibilité dʼun choix (Hayden 1982, 242 ; 159). Cette cuisine expérimentale est positionnée par ses créatrices comme un dispositif de commémoration, mais aussi comme une création prospective permettant dʼenvisager le futur des cuisines collectives. Lʼexemple du travail de Richards et Abel démontre aussi lʼimmense dimension expérimentale des projets entrepris à la fin du XXe siècle. Féminisme émancipateur, science ménagère, recherches en nutrition, utopie socialiste et pratiques coopératives sʼagencent et parfois sʼentrechoquent dans ces formulations hétérogènes, des apartment houses trop souvent réservées aux riches aux soupes populaires prisonnières de leurs idéaux philanthropes, et de la condescendance qui peut accompagner ce positionnement.
Les limites théoriques ou pratiques du projet socialiste mutualiste sont riches dʼenseignements pour cette étude. Jʼen retiendrai trois, situées sur les axes du genre, de la race et de la classe. Ces trois aspects ne sont pas distincts, et sont souvent tissés ensemble ; je les sépare comme clés dʼentrée. Les féministes elles-mêmes font face à des contradictions sur le plan du genre et de lʼassignation de genre (alors pensée comme assignation de sexe) des femmes à lʼespace domestique. Beaucoup ne remettent pas en cause cette féminisation du travail domestique, cherchant plutôt à le redistribuer ou à lui attribuer une valeur par le biais dʼun salaire. Catharine Beecher et Caroline Hunt décrivent ainsi la naturalité de la place féminine au logis, dans une éthique marquée par le sacrifice (Hayden 1982, 80). Dʼautres militent en faveur du travail féminin, et certaines des fictions utopistes évoquées plus haut racontent un monde où les femmes sont massivement salariées et débarrassées des tâches ménagères. Si certaines insistent sur lʼaspect aliénant et répétitif des tâches, dʼautres sont plus enclines à le valoriser et vont participer à lʼélaboration dʼune science domestique. Cette scientifisation peut-être source dʼémancipation, pour celles qui fondent une carrière (paradoxalement !) hors du logis en militant pour celui-ci ; mais elle peut aussi se solidifier en une technique féminine, pendant de la technique masculine (automobile, mécanique) qui participe alors à cristalliser la division sexuée (Hayden 1982, 126). En dʼautres termes, la pensée dʼune mutualisation des tâches est irriguée par la pensée féministe qui questionne lʼassignation des femmes au logis ; cependant, mutualiser nʼest pas directement synonyme dʼémancipation féministe.
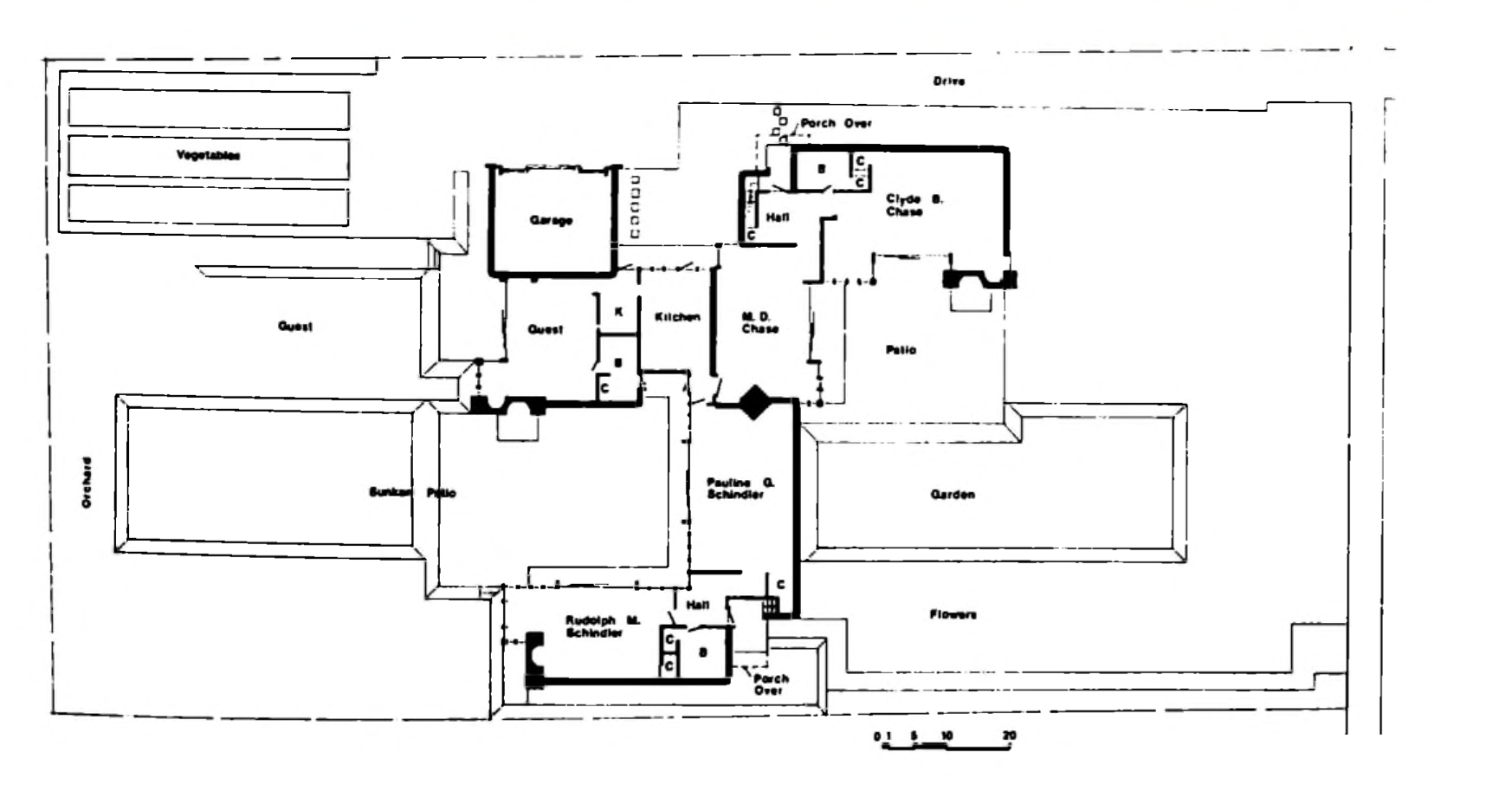
Le projet de lʼarchitecte Rudolph Schindler en est un exemple criant, tel quʼil est analysé par D. Hayden. Schindler, élève dʼAdolphe Loos (Clarisse 2004, 112) conçoit en 1922 une maison commune pour un couple dʼamis, son épouse (Pauline Schindler) et lui-même (fig. 2.33). Lʼexemple est intéressant, car cet architecte immigré dʼEurope ambitionne dʼappliquer le Style International, alors dominant sur le continent, à un dispositif communautaire qui connaît aux États-Unis des incarnations stylistiques éclectiques (Hayden 1982, 248, 250). Il prévoit des espaces communs (garage, cuisine), remplace la salle à manger par des patios extérieurs, et offre à chaque membre de la maisonnée sa chambre personnelle. Ce programme paraît progressiste au premier regard ; mais D. Hayden en pointe les limites, voire les échecs, lorsquʼelle observe que les deux chambres des épouses sont connectées à la cuisine (facilitant leur implication dans cet espace), et que lesdites chambres sont des espaces traversants quʼaucun couloir ne permet de contourner. Bien que cet habitat ait été conçu dans un esprit progressiste (la cohabitation de deux couples) et ait pu fonctionner sur ce principe (le couple Schindler finira par y vivre ensemble après le divorce), il trahit selon D. Hayden le maintien dʼun partage genré. Elle égratigne au passage le féminisme des hommes architectes empressés de solutionner les inégalités pour les autres, en pensant la répartition de lʼespace, sans projeter leur propre participation accrue aux tâches ménagères. Sʼil est difficile de juger de la participation de R. Schindler aux tâches de son logis, on peut tout de même être dubitatif face à une «  chambre à soi  » ouverte aux déambulations du mari. Ces rapides exemples montrent que la mutualisation ne peut pas fonctionner comme levier si elle ne sʼaccompagne pas dʼun programme féministe clair visant lʼautonomie des femmes, et repensant donc frontalement leur association aux tâches ménagères. Mais les femmes des mouvements mutualistes, elles-mêmes, ont entretenu de nombreux angles morts quant à la répartition du travail domestique.

Nous avons vu précédemment quʼun des arbitrages majeurs concernant une conception mutualisée du travail domestique concerne lʼemploi des domestiques, sujet sur lequel il nʼexiste pas de consensus chez les féministes socialistes. Dans certains cas, le projet mutualiste implique une coopération des participant·es qui sʼoccupent elleux-mêmes des tâches à tour de rôle. Le Mahoning Club, formé en 1903 est un dining club rassemblant des personnes plutôt fortunées : un couple fait ainsi lʼachat dʼune maison trop grande et décide dʼen mutualiser les équipements (Hayden 1982, 211). Dans ce projet mené à Warren, dans lʼOhio, des couples vivent avec des personnes célibataires, mais chacun·e doit faire sa part des tâches et les hommes nʼen sont pas exempts. Les rotations ne sont pas complètement débarrassées des habitus de genre : à table, les femmes servent et les hommes coupent la viande ; souvent, lorsque vient le «  tour  » de travail du couple, cʼest lʼépouse qui prend en charge cette responsabilité. Mais les hommes célibataires, en revanche, sont bien mis à contribution. Le modèle est plus égalitariste quʼil nʼest égal, mais prouve que dans certains cas, il a bien existé une intention de repenser le partage genré du travail. Lʼintention était même antérieure à 1903 : Melusina Peirce, dès 1869, se met en Å“uvre pour constituer une communauté soudée autour dʼune mutualisation des tâches (Hayden 1982, 80–81) dans la Bow Street House. Mais ce projet, quoique fonctionnel, rencontre lʼire des maris, excédés que le travail de leurs femmes bénéficie à dʼautres hommes, ou agacés que les réunions de coordination mobilisent leurs épouses (Hayden 1982, 81).
Imaginer des projets sur la base dʼune embauche de domestiques permet dʼéviter ces écueils, mais crée bien sà »r de nouveaux obstacles. Le problème majeur est dʼordre logique : si les femmes sʼémancipent en mutualisant leur travail domestique, quʼelles font faire par dʼautres femmes, comment vont sʼémanciper ces femmes employées pour assurer le travail domestique des autres ? D. Hayden note que cette contradiction nʼa pas échappé aux critiques conservatrices. La journaliste anti-féministe Laura Fay-Smith (nulle autre que la sÅ“ur de la progressiste Melusina Fay Peirce) (Hayden 1982, 200–01) ironise sur la féministe «  qui veut se hisser au-dessus des durs travaux de la maison, sur les épaules des femmes que la nécessité pousse à devenir des servantes rémunérées  »446 (Hayden 1982, 201). Melusina Fay Peirce, bien que progressiste, avait dʼailleurs une position bien ambivalente sur la question. Elle mène des projets qui impliquent que les femmes se rassemblent et fassent payer leurs maris pour le service rendu, ce qui peut mener à abolir des frontières de classes entre femmes ainsi solidarisées ; mais elle affirme à la fois dans ses essais la nécessité dʼune discipline de fer avec les lavandières, décrites comme paresseuses (Hayden 1982, 69).
D. Hayden affirme que cette ignorance des questions de classe liées aux questions de genre a été la faiblesse majeure du mouvement mutualiste et coopératif mené par les féministes matérialistes. En centrant leur propos sur lʼémancipation féministe, ces théoriciennes ont pu générer des effets de bords en termes de classe : scientifiser la cuisine et la nutrition va ainsi consacrer des femmes (souvent bourgeoises) dans des postures dʼexpertes, qui vont adopter une attitude paternaliste envers les housewives ordinaires ; la survie économique dʼun apartment hotel peut amener ses habitant·es à ne pas prendre en compte le paiement des domestiques ; enfin, la mutualisation peut être une stratégie pour maximiser son revenu et accéder à des services domestiques peu chers, sans aucun égard pour les personnes effectuant ces tâches. Lorsque la pauvreté est prise en compte, cʼest souvent sur le modèle philanthropique et la qualité du service sʼadapte à la population cible. D. Hayden résume ainsi la manière dont le projet mutualiste se corrompt en devenant philanthrope :
oubliées les visions généreuses des cuisines coopératives livrant des dîners élégants à sept plats, et les pressings coopératifs présentant des rangées de dentelles blanches comme neige, parfaitement repassées. Une ration suffisante de soupe et assez de charbon pour tenir la semaine semblaient bien assez comme ça447 (1982, 155).
La mutualisation ne garantit donc pas plus la justice économique quʼelle nʼassure une approche féministe. Par ailleurs, le terme même de «  féministe  » utilisé pour désigner les actrices du mouvement de la «  révolution domestique  » découpée par D. Hayden peut recouvrir des réalités très hétérogènes, et de multiples contradictions internes -— sans même parler des évolutions dʼopinion au fil de la vie des participantes. Catharine Beecher reste ainsi très traditionnelle sur les questions de genre, en projetant une femme seule liée par le sens du devoir à sa cuisine privée ; mais elle a mené des actions abolitionnistes qui montre une conscience claire des enjeux de race aux État-Unis. En revanche, Charlotte Perkins Gilman, présentée dans lʼouvrage de D. Hayden comme lʼune des féministes les plus avant-gardistes de son temps, écrit par ailleurs sur le «  problème n*gre  »448 aux États-Unis et sʼinquiète des vagues dʼimmigration qui diluent selon elle la pureté raciale de son pays. Ces contradictions intellectuelles internes expliquent que le mouvement de mutualisation du travail domestique se soit heurté à la constitution dʼune classe oppressée de travailleur·es (femmes pauvres, personnes racisées) en cherchant à émanciper le sujet «  femme  » de ce travail. D. Hayden observe dʼailleurs que cette impasse sʼexplique par la discussion limitée, voire inexistante de lʼimplication des hommes dans cette tâche. Si des hommes de la fin du XIXe siècle pouvaient volontiers accepter une implication accrue des femmes dans la vie publique, au prétexte de leur expertise domestique, vue comme un atout dans la gestion des villes, ils étaient moins pressés dʼinvestir eux-mêmes cette sphère domestique (Hayden 1982, 288–289). Lénine lui-même imaginait tout à fait les femmes à lʼusine, insistait même sur le fait que cette inclusion favorise leur émancipation ; mais jamais il nʼa projeté une participation masculine au foyer (Hayden 1982, 282).
Cʼest ce sujet manquant de lʼhomme (ou de la femme riche) participant aux corvées qui explique «  la corruption finale de lʼéconomie domestique  »449. Si de nombreuses théoriciennes imaginent professionnaliser les tâches, au point dʼen faire une science ménagère et dʼembaucher pour leurs projets des travailleur·ses spécialisé·es, elles nʼimaginent pas cette spécialisation pour elles-mêmes (Hayden 1982, 202), prolongeant par ce simple choix la dévalorisation dʼun espace dont elles essaient, paradoxalement, de défendre lʼimportance. Si la conscience féministe place les tâches domestiques au premier plan, lʼ «  arbitrage entre ‹ faire › et ‹ faire faire ›  » (Devetter & Rousseau 2011, 79) qui les accompagne inévitablement penche ici, pour ces femmes bourgeoises et blanches du côté dʼun «  faire-faire  » qui rend leur féminisme caduc, dès lors quʼelles ne se projettent jamais dans la position de travailleuse.
Le tressage entre socialisme domestique et science ménagère, explique D. Hayden, va progressivement voir sa première ambition se tarir, au bénéfice dʼune domesticité certes professionnalisée par le paradigme de la science, mais du coup vulnérable à la récupération : la «  technique  » ne sert plus à mutualiser les efforts, mais à perfectionner de petits appareils individuels ; la femme au foyer, isolée, devient la consommatrice de ces appareils multipliés, plutôt que condensés dans leur forme initiale, collective, que Siegfried Giedion a bien documentée. Par ailleurs, lʼétude de D. Hayden permet de saisir que la rencontre entre lʼusine et le foyer (objet dʼun chapitre ci-après, cf. infra., p. **) nʼa pas été le fait premier dʼune Christine Frederick cherchant à «  tayloriser  » le travail de la housewife, mais de féministes matérialistes comme Melusina Fay Peirce. Dans une des feuilles produites par la Cambridge Cooperative Housekeeping Society dont Peirce accueille les réunions, il est clairement question dʼappliquer le modèle de la manufacture à lʼespace domestique, cʼest-à -dire de penser «  la combinaison entre le Capital, et la division et lʼorganisation du travail  »450 (Hayden 1982, 80). Amener lʼusine au foyer ne consiste alors pas à rendre le travail de la housewife plus efficace, mais permet dʼorganiser et politiser le foyer selon les mêmes lignes qui traversent lʼactivité ouvrière. Lʼadoption du taylorisme, dʼune part, et la mécanisation du foyer, de lʼautre, vont ainsi utiliser lʼarc narratif de la femme au foyer libérée par les techniques pour dépouiller le projet initial dʼune refonte totale de lʼarticulation entre foyer et ville, ainsi que des relations sociales quʼelles sous-tendent. La conclusion de lʼouvrage de Hayden, écrit dans les années 80, a des implications sinistres pour les mouvements féministes de son époque, mais aussi pour la nôtre. D. Hayden écrit :
Quand une nouvelle génération de féministes apparut […] elles avaient une demande puissante à formuler, la fin de la division sexuelle du travail domestique. Mais les nouvelles féministes, qui ont essayé de partager le soin aux enfants et le travail du foyer avec les hommes, nʼont pas compris lʼhistoire qui traversait les environnements domestiques quʼelles habitaient451 (1982, 289).
En se focalisant sur un partage des tâches, les féministes des années 60, si lʼon suit D. Hayden, ont dʼune certaine manière raté le coche. Penser ce travail comme masse à partager venait bien sà »r dʼune intention légitime focalisée sur la place des femmes ; mais en se focalisant sur le travail domestique et ses implications, les féministes de cette période auraient peut-être paradoxalement accompli davantage de choses pour les femmes à cet endroit. Ceci ne remet nullement en cause les avancées du féminisme de la seconde vague, mais peut nous aider à comprendre pourquoi dans les années 2010–20 les discours féministes dominants, notamment ceux dʼun féminisme dʼÉtat, se sont bien volontiers focalisés sur «  lʼégalité  », un objectif numérique, vague tout à la fois, qui évite de parler de labeur, dʼémancipation, de la nature des tâches, etc. Ce sera justement une des ambitions du chapitre suivant que de comprendre ce travail pour en saisir la complexité, sinon lʼimpossible répartition. Partager (avec un partenaire masculin) ou déléguer ne sont pas les deux seules issues pour le travail domestique : cʼest que les afroféministes ont pu mettre en évidence et quʼil nous faut à présent aborder.
En 1984, deux ans après la publication de The Grand Domestic Revolution, la poétesse noire et lesbienne Audre Lorde apprend quʼelle est atteinte dʼun cancer du foie. Le journal quʼelle tient pendant ces journées marquées par la maladie, mais aussi par la poursuite de ses activités littéraires et militantes, A Burst of Light, commence par son récit dʼune lecture avec les Sapphire Sapphos (un groupe de militantes lesbiennes et racisées) à Washington :
Rentrer à lʼintérieur, après la tempête hivernale de D.C., faisait lʼeffet dʼune embrassade. La cheminée rugissante, la pièce aux poutres étroites remplie de femmes Noires et Marrones, une table couverte de mets délicieux visiblement cuisinés avec amour. Il y avait de la tarte de patate douce, du riz et des haricots rouges, des haricots noirs et du riz, des lentilles corail et du riz, des fèves au piment, des spaghettis aux boulettes de viande suédoises, du cabillaud à lʼaki, des nouilles aux épinards avec de la sauce aux palourdes, de la salade aux cinq fèves, de la salade de poisson, et dʼautres salades suivant dʼautres combinaisons […] Tout ce festin reflétait une plénitude rêvée de femmes partageant leur couleur et leur nourriture et leur chaleur et leur lumière—Zami devenue réalité. Jʼétais pleine de joie à lʼidée quʼun tel espace se soit enfin concrétisé un mardi soir glacé à Washington D.C., et je le dis tout haut452. (Lorde, 2017[1988], 41–42).
Dans Zami: A New Spelling of My Name (1982), Lorde développe selon le sous-titre de lʼouvrage une «  biomythographie  » dans laquelle ce nom de Zami (originaire de la Caraïbe) désigne la constitution de communautés amicales et amoureuses de femmes. Dans lʼextrait qui précède, la référence à Zami affirme la manière dont les Sapphire Sapphos réalisent une communauté soudée par de forts liens, un groupe spécifique qui puise sa force dans le partage dʼune ou plusieurs identités et des pratiques qui accompagnent celles-ci. Cʼest moins la cuisine que la table qui sert de lien à la fois concret et métaphorique à cette communauté de femmes noires et marrones. Lʼévocation des mets renvoie à des pratiques indigènes et à des héritages matrilinéaires de pratiques culinaires spécifiques (lʼaki, par exemple, est lié à la Jamaïque et à son histoire coloniale ; les fèves et le riz évoquent la cuisine cubaine). Il est impossible de parler de la manière dont les Noir·es, et particulièrement les femmes noires, investissent la cuisine, sans parler de la table. Si la description de Lorde laisse imaginer une salle à manger, la table, dans ces imaginaires, est la surface unique présente dans la cuisine, sur laquelle tout se fait : la préparation, la dégustation, mais aussi la conversation.
Ellen Kohl & Priscilla McCutcheon, deux chercheuses étasuniennes respectivement Blanche et Noire, ont ainsi avancé le terme de «  réflexivité de table de cuisine  »453 (2015). Elles défendent lʼidée selon laquelle la recherche devrait sʼenrichir de conversations informelles, quʼelles relient à lʼespace de la cuisine. Selon elles, la détente et lʼintimité qui sʼarticulent dans cet espace favorisent le surgissement de regards nouveaux sur la recherche, notamment sur la positionnalité des chercheur·ses par rapport à leur sujet car «  [l]a cuisine nʼest pas seulement un espace de travail où la nourriture est préparée et consommée, mais plutôt un espace qui crée et reproduit un ensemble complexe de relations entre les individus  »454 (2015, 749). En discutant au quotidien autour de la table de la cuisine, les deux chercheuses disent trouver un espace alternatif aux espaces universitaires, où la parole peut être plus spontanée. Pour défendre cette idée, elles retracent lʼimportance de la table de la cuisine dans les imaginaires noirs-étasuniens, sans pour autant la fétichiser. Elles évoquent aussi le concept de «  safe space  », qui a dʼailleurs depuis été importé tel quel en France. Dans les milieux militants queer et anti-racistes, un «  safe space  » désigne un lieu dans lequel des personnes minorisées peuvent trouver du répit par rapport aux microagressions du quotidien (et dʼautres formes plus graves de violence). Le concept est particulièrement critiqué aujourdʼhui, car il est souvent employé de manière performative, pour dire que tel ou tel espace est «  safe  », cʼest-à -dire vierge des formes dʼoppression rencontrées de manière ordinaire dans la société. Cependant, lʼintersection des oppressions et les différences entre les identités et les expériences rendent impossible, ou en tout cas difficile, la création ex nihilo dʼun espace qui serait universellement sà »r, safe.
Ellen Kohl et Priscilla McCutcheon se font lʼécho de ces problématiques en nommant la table de cuisine comme un potentiel «  safe space  » pour les femmes racisées, mais refusent dʼassocier automatiquement cet espace à lʼabsence de violences car la cuisine nʼest pas «  un espace où les structures de pouvoir sont magiquement effacées  »455 (2015, 758). Elles insistent ainsi sur une définition processuelle du safe space, qui devient safe par un travail plutôt que par un acte de dénomination. Souvenons-nous ici que bell hooks a critiqué Betty Friedan, en pointant que pour les femmes noires, la domesticité nʼest pas seulement un espace dʼoppression de genre (hooks 2017[1984], 78) mais peut-être un espace dʼautonomie et de résilience. Ellen Kohl & Priscilla McCutcheon en prennent acte, mais rappellent aussi que lʼoppression spécifique vécue par les femmes noires en cuisine est tout autant affaire de race et de classe que de genre. Elles pointent que le stéréotype raciste de la «  mammy  » (la bonne noire, maternelle et dévouée à ses maîtres blanc·hes) hante la cuisine des femmes noires, et a pu servir à dévaluer leur travail (Kohl & McCutcheon 2015, 750). Nous serons dʼailleurs amené·es à croiser cette figure plus avant, lorsquʼil sera question de lʼexternalisation racisée du travail domestique. Pour lʼheure, nous pouvons donc remarquer que les écrits de théoriciennes afroféministes introduisent une vision plus complexe de la cuisine, émancipatrice et oppressive à la fois. Dans un tel contexte, quitter la cuisine ne résout rien, et coupe même des liens précieux, ceux-là même que Audre Lorde défend face au repas militant auquel elle participe à Washington.
Dans son travail sur les cuisines mutualistes, Dolores Hayden met en évidence les obstacles rencontrés par des femmes blanches lorsque celles-ci se mettent en Å“uvre pour redistribuer le travail domestique, sur la base de formation de communautés. Ce faisant, elles font face à la difficulté de constituer la communauté, le projet étant parfois activement sabordé par des maris qui préfèrent lʼorganisation traditionnelle du travail. Dans le prisme afroféministe, la communauté ne vient pas après-coup : elle existe déjà , de panière pragmatique, pour survivre à lʼesclavage, ou dans le cas spécifique des États-Unis, au contexte des lois Jim Crow456 (Kohl & McCutcheon 2015, 750). Tout comme Audre Lorde associe la solidarité politique à lʼabondance des plats disposés sur une table, bell hooks convoque les richesses produites dans la cuisine de sa grand-mère. Les cuisines blanches tendent à invisibiliser le travail en cuisine, soit parce quʼelles sentimentalisent et idéalisent le travail maternel, soit, et ce fait est lié au premier, parce que dévaluer ce travail permet de le faire effectuer par dʼautres, le plus souvent des femmes pauvres ou racisées (Nakano-Glenn 1992, 7–8). En revanche, les écrits des autrices afroféministes tissent très finement nourriture, résistance et résilience, comme le montre bell hooks lorsquʼelle écrit :
Dans la cuisine de ma grand-mère, le savon était fabriqué, le beurre était battu, les animaux étaient dépouillés, les récoltes étaient mises en conserve. La viande pendait des crochets dans le sombre cellier et les pommes de terre étaient conservées dans des paniers. Pendant mon enfance, ce lieu sombre recueillait les fruits du travail difficile et du labeur positif. Il était le symbole de lʼautodétermination et de la survie (hooks 2009, 43)457.
Dans de nombreux écrits afro-féministes, la cuisine incarne métonymiquement le foyer (home) et le sens dʼappartenance. bell hooks écrit ainsi les lignes qui précèdent dans un ouvrage dédié au sentiment dʼêtre-chez-soi, ou «  belonging  », que traduit incomplètement ce terme dʼappartenance (Belonging: A Culture of Place). Dans son propos introductif, hooks affirme que de nombreuses personnes «  ne ressentent aucun sentiment du lieu  »458 et font au contraire lʼexpérience dʼun «  sentiment de crise, dʼun désastre imminent  »459 (2009, 1). Elle lie son étude du sentiment dʼappartenance à sa propre expérience, en analysant son retour à sa région dʼorigine, le Kentucky, alors que son parcours universitaire lʼavait propulsée dans un autre environnement, plus urbain, comme cela est typique des parcours dʼascension de classe. bell hooks nomme ce besoin humain du lien à la terre, à lʼautre, et le lie à son combat antiraciste et à sa défense de lʼenvironnement. Lʼautrice afro-féministe resitue ainsi une histoire oubliée des fermier·es noirs aux États-Unis, et se met en Å“uvre pour raviver cette connexion spirituelle entre personnes afro-descendantes et terre quʼelle connecte étroitement à la question politique de la propriété terrienne. Toutes ces réflexions traversent lʼévocation de la cuisine, qui nʼest pas seulement un lieu individuel de mémoire, mais une des pièces majeures dans la recherche dʼun lieu, dans ce «  homecoming  » (retour à la maison, dans une imparfaite traduction), ou «  sentiment dʼêtre lié au lieu  »460. bell hooks nomme ce désir comme universel, tout en en saisissant la dimension spécifique pour les personnes noires étasuniennes, pour qui elle nomme la nécessité dʼune «  auto-guérison noire  »461 (hooks 2009, 3).
Lʼurgence à trouver «  son  » lieu est dʼautant plus brà »lante pour les personnes racisées que lʼexpérience du racisme semble souvent prendre la forme dʼun déplacement (littéral, dans les formes dʼenlèvement et dʼacculturation amenées par lʼesclavage) et dʼun jugement de non-appartenance au lieu. Il est fréquent de croiser dans les écrits de féministes racisées des récits dʼenfance dans lesquels on les renvoie à leur non-appartenance à lʼespace. La philosophe Sara Ahmed, australienne dʼorigine pakistanaise, raconte ainsi comment, à lʼâge de quatorze ans, elle est interpellée en revenant de lʼécole par des policiers qui la questionnent sur ses origines (Ahmed 2007, 33). Elle écrit :
[c]ʼétait une expérience de transformation en une étrangère, celle qui est reconnue comme nʼétant pas à sa place, celle qui nʼappartient pas, dont la proximité est interprétée comme un un crime ou une menace462 (33).
La chercheuse afro-étasunienne Carolyn Finney raconte une histoire très similaire. Elle a neuf ans quand des policiers lui demandent ce quʼelle fait là alors quʼelle rentre chez elle. Elle dit aller au coin de la rue ; on lui demande : «  tu travailles là -bas ?  »463 (Bergman 2007). Ces deux expériences sont analysées par Sara Ahmed et Carolyn Finney et forment la base dʼune conscience antiraciste et féministe. Lʼexpérience de Finney apporte même un éclairage supplémentaire, puisque la question du policier trace des lignes dʼappartenance, ou non, du corps féminin noir : située comme «  pas à sa place  », C. Finney peut éventuellement avoir une place dans la géographie découpée par les mots du policier : si elle travaille dans la maison des Blanc·hes, si elle est employée dans un service domestique, alors elle peut être à sa place. Ici la cuisine possède de nouveau une importance capitale et ces exemples éclairent un peu plus le texte de bell hooks cité précédemment. La cuisine noire ne vaut pas seulement comme lieu dʼappartenance, mais en ce quʼelle est le miroir de la cuisine des maîtres blanc·hes, marquée pour les personnes noires par lʼexpérience de la servitude (Nakano-Glenn 1992, 15), que ce soit dans le contexte de lʼesclavage ou dans des périodes plus récentes, où les personnes racisées sont toujours surreprésentées dans les emplois de service. Mobiliser la cuisine, lʼinvestir, cʼest déclarer comme espace à soi, espace dʼappartenance, un lieu qui est associé à lʼexpérience de la servitude et donc de lʼoppression — cʼest en quelque sorte un reclaim spatial.
La cuisine comme espace de réappropriation des lieux, et donc de soi, est indissociable des pratiques culinaires. Les textes dʼAudre Lorde et bell hooks insistent chacun à leur manière sur la nourriture, sur ce besoin fondamental de se nourrir quʼelles connectent au besoin dʼétablir une communauté (politique chez Lorde, familiale chez hooks, mais alors aussi politique par son lien à un groupe plus large). Chez bell hooks, la relation à lʼespace et à lʼarchitecture fait même lʼobjet dʼune étude détaillée avant Belonging, en 2009. Dans Art on My Mind (1995), lʼautrice avance le concept dʼun «  black vernacular  », soit dʼune architecture vernaculaire noire qui tend à disparaître lorsque les afroétasunien·nes quittent les campagnes, dans un objectif de promotion sociale, et lorsque lʼhistoire ou les représentations culturelles ne font pas la part de formes de subsistance noire manifestées dans lʼhabitat. Pour elle, les «  cabanons  » («  shacks  ») sont des lieux investis par les personnes pauvres ou afro-descendantes, par nécessité, qui témoignent dʼune inventivité et dʼun investissement spécifique de lʼespace. hooks remarque que ces lieux tendent à être augmentés avec le temps, quʼils sont entretenus avec beaucoup de soin, et quʼils intègrent le porche qui est «  une continuation de lʼespace de vie  »464, un «  espace liminaire  » où les groupes oppressés «  peuvent étendre les limites du désir et de lʼimagination  »465 (1995, 149). Cette prise de pouvoir est rendue possible par une pratique vernaculaire de lʼarchitecture -— dont les trouvailles croisent dʼailleurs celles de lʼarchitecture «  officielle  », majoritairement blanche. Les porches décrits par hooks peuvent ainsi évoquer le choix des patios chez Rudolph Schindler dans sa maison de Californie (1922). La résilience des populations afro-descendantes face à lʼoppression permet aussi à la cuisine dʼexister hors dʼelle-même. Si elle est à la fois très matérielle, ancrée entre quatres murs, dans lʼespace sombre et protecteur décrit par bell hooks, la cuisine peut radicalement se déplacer.
Les personnes racisées qui nʼappartiennent pas symboliquement au lieu lʼarrachent à ses processus normalisants, pour le recomposer ailleurs, autrement. Tao Leigh Goffe défend ainsi lʼidée dʼun «  marronnage en cuisine  » (Goffe 2020, 18). Goffe utilise la définition du terme selon Kamau Brathwaite, selon qui le marronnage est «  lʼacte physique et psychologique de la survie africaine  »466 (Goffe 2020, 18). Le marronnage renvoie ainsi à toutes les pratiques historiques de désobéissance de la part des personnes racisées esclavagées, étendant la définition plus connue du marronnage qui désigne comme «  marron  » (ou negmarron, ou cimarron) lʼesclave en fuite. T. L. Goffe amène ce concept en parlant plus précisément du jerk, un mélange dʼépices issu de la Jamaïque comme une forme de marronnage culinaire (2020, 18). Le jerk est en effet associé à une cuisson dans le sol. Si les occidentaux associent aujourdʼhui ce mélange au barbecue, T. L. Goffe a à cÅ“ur de rappeler que la cuisson traditionnelle, indigène, de la viande mêlée au jerk est justement lʼantithèse dʼune flamme à ciel ouvert (2020, 20). La technique permet de ne pas être repéré par lʼennemi, et manifeste ici encore une connexion à la terre, au land qui compose «  la forêt tropicale comme cuisine  »467 (2020, 20). Lʼautrice noue ensuite la richesse de cet héritage à la situation contextuelle de la pandémie du COVID, et affirme que lʼhéritage du jerk, plus quʼune recette, se situe dans la capacité de «  faire avec  » («  make do  ») ce qui se trouve dans les placards. Le «  caractère évasif  » de la recette du jerk, note T. L. Goffe, vient aussi dʼune culture de lʼopacité développée par les «  marron·es  » pour survivre. Lʼautrice en conclut quʼ«  [i]l y a du pouvoir dans la cuisine quʼelle soit à lʼintérieur ou à lʼextérieur  ». Son propos relie les deux espaces, et dessine, comme le porche de bell hooks, un espace liminal où la cuisine vivante palpite, sʼétend, se distend et gagne dʼautres espaces.
Il suffit de penser au propos de Katherine Hayes, ou aux exemples historiques de Dolores Hayden, pour voir à quel point cette définition noire vernaculaire (selon la typologie de bell hooks du «  black vernacular  ») de la cuisine et par extension de la domesticité est beaucoup plus plastique (par stratégie autant que par nécessité) que ses contreparties blanches. Elle se tient toujours sur un point dʼéquilibre : jamais résumée à ses murs, toujours en extension, mais vers un symbolisme qui ne lʼarrache pas au monde matériel. Ce raisonnement qui questionne la dimension raciale de la domesticité comme «  faire le logis  » peut sʼétendre à une échelle plus vaste ou «  domestique  » désigne un «  faire la nation  », ce que recouvre dʼailleurs lʼadjectif «  domestic  » en anglais (on désignera ainsi lʼIntérieur comme «  domestic affairs  »). Richard Iton permet dʼapprocher cette possibilité lorsquʼil théorise un «  black fantastic  » en lien avec une «  hétérodoxie  »468, soit «  la capacité à imaginer et à opérer simultanément à lʼintérieur, contre, et en dehors de lʼétat-nation  »469 (Iton 2010, 202). Marronnage culinaire, black vernacular et black fantastic composent ainsi ensemble une géographie de possibles qui associent de manière conflictuelle lʼexpérience de la domination et la création de formes de résilience.

Le film Fast Color (2018) en produit quant à lui une représentation dans le domaine du cinéma. Dans ce film de super-héros hors des canons habituels de Marvel et DC Comics, Ruth est une vagabonde, anciennement dépendante à la drogue, qui retourne dans la maison de son enfance pour y retrouver sa fille Lila, et sa mère, Bo, à qui elle lʼa confiée. Ruth possède des pouvoirs, notamment celui de dissocier la matière : tous les objets quʼelle rencontre peuvent ainsi être réduits à lʼétat de poussière. Contrairement à Bo et Lila qui maîtrisent cette capacité, Ruth a perdu son pouvoir. Cʼest autour de la table (fig. 2.34) du petit déjeuner que Lila montre ses talents, ce qui va placer Ruth sur un chemin de reconnexion à sa famille en même temps quʼà sa propre force. In fine, le pouvoir de Ruth dépasse la disruption de la matière, et lui permet, une fois reconquis, de dénouer les nuages qui refusent depuis plusieurs années de produire de la pluie et plongent le pays dans une terrible sécheresse. Un lien extrêmement fort est ainsi tissé entre la généalogie familiale, entre femmes noires afro-étasuniennes, lʼémancipation par la prise de conscience de sa capacité dʼagir, la réparation du trauma individuel et collectif, la solidarité transnationale (évoquée à la fin du film) et la résilience face à lʼécocide contemporain. La scène, fantastique, où les bols sur la table vibrent pour devenir poussière, font écho aux autres, plus ordinaires, ancrées dans le monde matériel, où Bo compte chaque goutte dʼeau dans sa cuisine. Le fantastique ou la magie ici transcrites ne relèvent pas dʼune forme dʼescapisme mais soulignent au contraire la connexion entre choses vivantes, un continuum entre corps exploités et biotopes pillés (Yussof 2018, 91). La cuisine, ou sa table, expriment ainsi cette «  connexion entre autoréparation noire et écologie  »470 (hooks 2009, 3).
En creux, de telles représentations doivent nous inciter à examiner la blanchité de la cuisine. Mon approche, par le prisme du genre, mʼa amené à désigner des lignes de partage entre hommes et femmes. Mais ces lignes ne préexistent pas, ou ne sont pas dominantes par rapport à la structuration des espaces par les rapports raciaux. Ainsi, si cuisines et femmes sont historiquement associées, féminités noires et féminités blanches nʼy sont pas enchaînées à la même échelle, avec la même force ou au même titre. Evelyn Nakano-Glenn a notamment contesté lʼexistence dʼune expérience féminine universelle à cet endroit, en introduisant la question de la race et de la classe dans lʼanalyse du travail domestique (1992). Ainsi, lʼimage de la housewife désespérée dʼêtre confinée au foyer doit tout autant être analysée comme une incarnation (sinon une performance) de la féminité que comme une expression de la Blancheur. Ces observations me serviront de socle plus avant, lorsque jʼanalyserai plus en détail les relations entre servantes racisées et maîtresses blanches. Elles me permettent aussi de rappeler ma propre position par rapport à ces questions. Étant moi-même blanc, jʼanalyse ici des expériences que je ne partage pas, quand bien même elles peuvent susciter chez moi émotion, intérêt et empathie. Lʼapproche du «  black fantastic  » par un auteur blanc peut susciter une fascination, voire amener une forme de fétichisation contre laquelle je ne suis sans doute pas immunisé -— je lʼavais déjà évoqué dans mon propos introductif, en invitant à une forme de prudence en évoquant la résilience des personnes pauvres (cf. infra., p. **). Dʼun point de vue blanc, lʼévocation des cuisines noires ne doit pas me servir dʼinspiration, ou pire, mʼamener à lʼappropriation ou à lʼinstrumentalisation. En revanche, elle peut de manière plus constructive amener à penser des formes de réparation, qui ne sont pas étrangères au design, puisque lʼhistoire de la discipline comporte encore beaucoup de pages manquantes à cet endroit. Le chef, artiste et auteur nigérian Tunde Wey a mis en Å“uvre des projets culinaires qui repensent le restaurant, sa cuisine, et qui fournissent peut-être des pistes pour penser une cuisine privée où la question de la race est conscientisée.

Les projets de Tunde Wey sʼappuient sur sa pratique de chef, et placent au centre la dimension économique de la nourriture : ce ne sont pas à première vue des projets «  de design  », mais il me semble quʼil est possible de les considérer comme tels (fig. 2.35.a). Dans une interview accordée à la revue The Funambulist en 2020, T. Wey reconnaît lʼhistoire coloniale de nombreux ingrédients communs (sucre, thé, café, etc.) mais affirme ne pas utiliser dʼapproche «  légiste  »471 face à ces ressources (2020, 36). En effet, les multiples projets quʼils mènent projettent les questions coloniales et raciales dans le présent, celui du service au restaurant. Un des leviers utilisés (et non expérimentés, comme lʼaffirme T. Wey) est la «  tarification asymétrique  »472 (2020, 36).
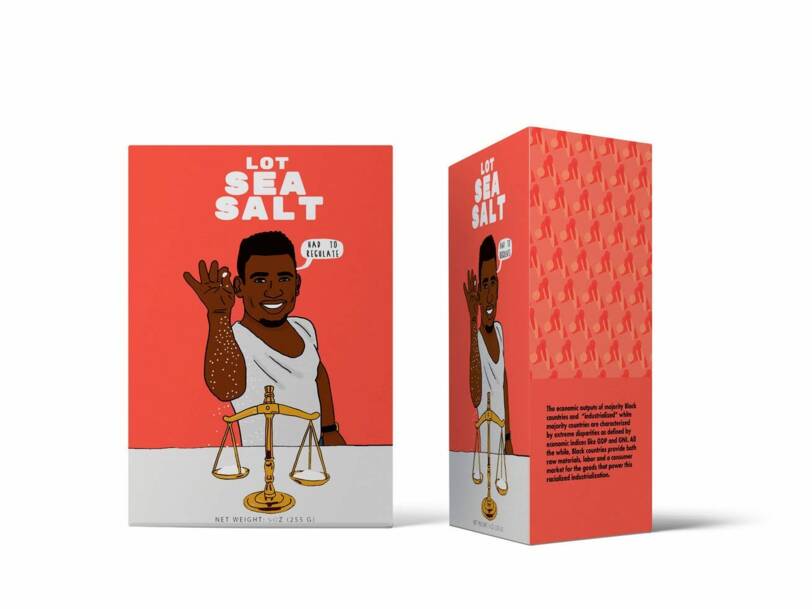
Lot est une marque de sel dont chaque paquet est vendu au prix de 100$ aux Blanc·hes (fig. 2.33.b ; sur le site alotofsalt
Dans dʼautres cas, la tarification résulte directement des inégalités identifiées sur le lieu où se déroule le dîner : lors du Hot Chicken Shit, à Nashville en 2018, T. Wey propose à ses client·es dʼacheter du poulet pour corriger les injustices liées au logement (Anderson 2018). Un morceau de poulet coà »te 100€, un demi-poulet 50 000$— avec la possibilité dʼéchanger la nourriture contre un titre de propriété. Dans une autre proposition, les personnes blanches paient 30$ leur plat tandis que les client·es racisé·es versent 12$. À la fin du repas, la différence de prix est redistribuée aux client·es noir·es, dispositif qui donne partiellement satisfaction à T. Wey : les personnes blanches sont en effet en accord avec le fait de payer plus, mais la transaction peut aussi apparaître comme une forme de charité, qui selon T. Wey est un modèle différent de la réparation. La différence de prix nʼest donc pas symbolique, ou arbitraire : elle traduit des inégalités concrètes dans lʼaccès au logement, les salaires, la répartition des richesses. Dʼautres leviers existent : T. Wey a tâché dʼutiliser le placement des client·es dans le restaurant pour travailler sur les effets de la gentrification. Ces projets visibilisent les liens qui existent entre les individus : celleux qui produisent le sel et celleux qui lʼachètent à bas prix ; celleux qui cuisinent dans les restaurants et celleux qui ont accès à cette cuisine en vertu de leur privilège économique.
Je discute ici de ces projets pour deux raisons. La première tient à la nécessité de traiter la cuisine comme un lieu historique dʼoppression de genre tout autant, et peut-être plus encore aujourdʼhui, de race. Dans un second temps, les cuisines commerciales, nous lʼavons vu, ne sont pas strictement séparées des cuisines privées. De nombreux fils relient ces deux typologies de cuisines, qui ne sont dʼailleurs pas complètement distinctes, lorsque des personnes utilisent leur cuisine comme lieu de production pour leur entreprise (de tartes, dʼinfluences sur les réseaux sociaux, ou les deux). Dans le contexte du COVID, la survie des cuisines commerciales dépend aussi de la manière dont les cuisines privées font place à ces services. Et inversement, la cuisine privée, pour rester un lieu à part entière, ne peut pas être seulement un hub où sont livrés des plats. Pour comprendre la cuisine, je vais dans le prochain chapitre moins aborder celle-ci comme lieu de production. Cette dimension va nécessairement nous amener à considérer le labeur en cuisine et à questionner sa nature -— afin de comprendre quʼelle serait une juste rétribution, compensation, visibilisation, inspiré·es par le travail décolonial de Tunde Wey. Jʼai commencé ce chapitre en voulant contempler une forme de vide en cuisine : le parcours que je mʼapprête à synthétiser ci-dessous amène à des conclusions nuancées sur cet évidement apparent—car il semblerait bien que la cuisine soit plus saturée que vidée.
Il peut être tentant de dire que la pièce-cuisine est obsolète, mais beaucoup plus difficile de dresser le même constat sur lʼaction de faire la cuisine. Priver le logis de sa pièce à cuisiner implique tout de suite de résoudre la question de la préparation des repas et de la prise en charge de ce besoin fondamental, se nourrir. Il y a bien sà »r un intérêt économique à ce constat : si la cuisine est sans intérêt, alors les entreprises de livraison de plats de restaurants ont le champ libre pour capitaliser sur ce marché. Toutefois, même si cette économie des plateformes de livraison de nourriture connaît un grand succès et vise même à fabriquer des «  super-usagers  », la conception dʼun appartement standard inclut encore cette pièce : il est dʼailleurs illégal, en France, de louer un appartement qui ne comporte pas dʼévier. Un évier, cʼest sans doute trop juste pour dire quʼil y a cuisine : pourtant, «  faire cuisine  » à partir de cet équipement minimal est la réalité de nombreuses personnes, à commencer par les étudiant·es ou les personnes précaires. Pour celleux qui ont lʼopportunité de déléguer lʼacte de préparation, la cuisine peut être délaissée, et à défaut de disparaître, devenir une zone de transit où lʼon réchauffe les repas au micro-ondes et où lʼon jette les boîtes et emballages de livraison. Cette cuisine fanée semble être en contradiction totale avec la mode des cuisines-trophée, des pièces aux dimensions colossales, réservées aux plus riches, mais dont les équipements (surfaces continues, îlot central, matériaux luxueux) quoique dignes des cuisines professionnelles, sont dʼabord destinés à être vus avant dʼêtre mis en action par une quelconque recette.
On peut ainsi trouver que cette vision de la cuisine hub et celle de la cuisine trophée sont aux antipodes : en réalité, les deux visions sont complémentaires. Dans les deux cas, cʼest la pratique culinaire, ses gestes et ses habitus qui passent au second plan. Le brouillage de la frontière privé-public est un autre point commun entre ces deux typologies : le hub isole ses habitant·es mais les connecte et les rend dépendant·es de toute une somme dʼinteractions numériques et urbaines ; la cuisine trophée, esthétiquement, reproduit les formes publiques du bar ou du restaurant à la maison.
Apparemment consumée par une logique de surface, la cuisine-trophée rend aussi la pièce-cuisine autrement nécessaire : elle devient un lieu dʼexpression de classe, un théâtre pour une performance de genre souvent masculine, lorsque des hommes utilisent lʼhéritage gastronomique, fortement masculinisé, pour re-produire leur genre, à la fois de manière plus ouverte (puisque leur définition de la masculinité, moins rigide, ne les prive plus de la cuisine) et plus sélective. Et la cuisine hubisée, elle aussi, peut servir à faire la démonstration dʼun privilège économique, matérialisé dans le majordome -— humain ou numérique.
En se «  dudifiant  », la pratique culinaire habite un temps plus exceptionnel, lié au spectacle, aux loisirs et à la réalisation de soi. En somme, elle cesse dʼêtre un travail—ou plutôt, elle existe dans les représentations médiatiques et scénarios de design sous la forme du hobby, sa dimension de labeur disparaissant dès lors aux oubliettes. La cuisine est abandonnée en tant que lieu où lʼon effectue le travail culinaire, ce qui ouvre dʼautres possibles pour lʼhabiter, tout en utilisant ces nouvelles inventions comme un voile sur le travail effectif qui doit bien continuer dʼêtre réalisé pour que les bouches -— celle de la housewife comprise -—soient nourries.
Une piste possible consiste à prendre acte de cette mutation (fin de la cuisine comme lieu de travail) pour inventer dʼautres espaces où peut se faire ce labeur. Une telle stratégie nʼest possible quʼà la condition dʼeffectuer une double historicisation, qui fasse la part des expériences socialistes mutualistes aux États-Unis (mais aussi en Europe) et des expériences et écritures non-blanches. La discipline du design, aujourdʼhui pensée comme collaborative, sociale, communautaire, tend parfois à fétichiser des formes du travail de groupe ou des pensées radicales en projetant dans certains espaces (tiers-lieux, fablabs) la concrétisation dʼune utopie communautaire. Dans le contexte de la conception de la cuisine, mais aussi au-delà , il est nécessaire de réhistoriciser ces pratiques, pour montrer que celles-ci prédatent le XXIe siècle, et pour analyser les freins, souvent venus des marchés, qui ont empêché la réalisation de leurs programmes ou pire, préparé leur réappropriation. Ici, on peut considérer que la cuisine nʼest pas vidée, mais a plutôt été purgée : on a construit lʼinvisibilité des femmes noires (Hayden 1982, 288), tout comme on a focalisé lʼhistoire des féminismes sur le suffrage, plutôt que sur les révolutions domestiques qui lʼont accompagné.
Ce chapitre nous a également permis de rappeler que la pièce-cuisine est indissociable de la nourriture. Une approche de design pourrait nous amener à nous focaliser sur lʼordonnancement spatial du lieu et les équipements qui y prennent place. Or, les écritures Noires sont également précieuses ici, et décrivent plus souvent les aliments, leur force nourricière, plutôt que tel robot ou dispositif ingénieux. Je ne laisserai pas de côté lʼélectroménager, qui doit bien sà »r être envisagé dans cette étude. Mais ce second chapitre ou «  pilier  », représenté par des sacs de nourriture à emporter, doit nous permettre de replacer la production culinaire et «  cuisinaire  » au centre. Dans la cuisine, les corps qui se meuvent entre en friction, rejouent des rapports de pouvoir (genre, race, classe) souvent anciens ; or, la nourriture elle-même peut-être le support de ces dramaturgies du pouvoir. Comme le rappelle la cheffe Soleil Ho dans son podcast Racist Sandwich (dont le titre à lui seul est éloquent) : «  une tortilla nʼest pas une page blanche  »473 (2019).
La cuisine, pour toute domestique quʼelle soit, est en lien direct avec son extérieur. Garnie des biens de consommation démultipliés par le capitalisme industriel, connectée aux plateformes de livraison et aux corps des livreur·ses qui pédalent pour la remplir, aux data center qui espionnent avec caméras et micros la vie domestique depuis lʼœil du frigo… La cuisine est saturée de ces liens. Shannon Hayes souhaite que le retour au foyer des radical homemakers leur fasse redécouvrir des formes quasi primitives dʼinterdépendance : mais entre quelles personnes ou quels groupes ces liens se forment-ils ? Plutôt que dʼespérer une forme pastorale dʼinterdépendance, remède à la dépendance du système capitaliste, il faudrait plutôt prendre acte de cet écheveau de dépendances en cuisine qui traverse celle-ci avant même que lʼon ait érigé son premier mur. Le vÅ“u dʼinterdépendance interroge aussi sur la notion de communauté.
La cuisine des maîtres a souvent été (est encore) pour les personnes pauvres ou racisées un point de contact avec les lieux de pouvoir auxquels elles nʼont pas accès. Le spectre de lʼétranger traverse la cuisine comme le logis, dans la mesure où la domesticité, tandis quʼelle oppresse les femmes blanches de la modernité, trace les contours dʼune géographie exclusive, où les foyers les plus chaleureux ne sont habitables par «  lʼAutre  » quʼà la condition où cellui-ci soit cantonné à une position de servitude. La cuisine, lieu du repas familial, ne se limite donc pas à définir cette unité, ou plutôt, en définit les contours tout en les démultipliant, en reproduisant à plusieurs échelles le modèle distinguant celleux qui appartiennent (belong) et celleux qui sont voués à rester sur le perron -— du logis, du voisinage, de la nation.
La cuisine nʼest pas vide, mais elle a été abandonnée : cela a même fait partie dʼun programme. Si je nuancerai cette affirmation en évoquant dans le chapitre suivant le mouvement Wages for Housework, force est de constater que le féminisme de la seconde vague, sans vendre son âme au diable, a peut-être troqué sa liberté contre la cuisine. En apparence, la transaction est avantageuse : en quittant la cuisine, les femmes rentrent dans lʼemploi salarié, et rompent définitivement avec cette «  mystique féminine  » qui les empoisonne. Mais la cuisine ainsi délaissée, ouverte aux quatre vents est alors récupérée : par des hommes célibataires qui y composent de nouveaux modèles de la sexualité, où les femmes tiennent un rôle aussi accessoire que lʼétait celui de boniche (dans le penthouse de H. Hefner) ; aussi, par les acteurs du marché, qui peuvent capitaliser sur ce travail à redistribuer, en le faisant effectuer à bas coà »t, ou en vendant mille accessoires incarnant autant de promesses de temps libéré. Lʼanalyse que nous avons menée dans ce chapitre montre bien que les femmes ne sont pas libérées de la cuisine : elles ne lʼont quittée en journée que pour mieux y retourner le soir venu, selon des modalités que nous détaillerons plus loin. On peut préférer la visiteuse nocturne du penthouse à la boniche affairée : toutefois, cette figure si honnie de la boniche a peut-être encore quelques ressources dans son tablier, si on lui laisse lʼoccasion de montrer ce travail que la culture occidentale semble si occupée à refouler.
Abandonnée dans les discours, la cuisine est alors désinvestie : on y revient par nécessité, pour cuisiner, mais les pouvoirs du lieu semblent avoir disparu. Certaines femmes lʼont bien compris, à la manière dʼune Mimi Thorisson qui décide, paradoxe suprême, de fonder une carrière publique lucrative sur lʼapparente félicité des femmes dédiées à leur espace domestique. Ce choix, qui peut paraître marginal, traduit une des faiblesses majeures du féminisme de seconde vague et sa vulnérabilité aux arguments conservateurs, souvent prompts à observer que les femmes salariées «  libérées  » font faire leurs corvées par dʼautres, ou les réalisent à la va-vite une fois la journée terminée. Le hashtag #tradwife sur Instagram réunit ces femmes qui revendiquent leur choix de rester à la maison, dʼêtre dévouées à leurs maris et de faire de nombreux enfants comme un choix révolutionnaire. Si leur racisme et leur homophobie revendiqués font également partie du programme, il semble quʼelles ont correctement identifié le talon dʼAchille du féminisme héritier de Betty Friedan.
En France, la réforme des retraites de 2020 a provoqué une large mobilisation. À Toulouse, dans les cortèges, jʼai pu voir des femmes habillées comme la célèbre Susie the Riveter, cette ouvrière dont lʼimage est devenue une icône féministe et de la lutte des classes. Issue dʼune campagne étasunienne pendant la Seconde Guerre mondiale destinée à recruter des travailleuses dans les usines, cette femme au faciès concentré, biceps bandé, offre une image empouvoirante de la féminité associée au travail ouvrier. Alors que ces femmes effectuaient leur chorégraphie en protestation dʼune réforme qui promettait de précariser davantage les femmes pour les raisons habituelles (salaire inférieur, recours supérieur au temps partiel, rupture de la continuité de lʼemploi lors des naissances dʼenfants), je me suis surpris à imaginer quʼune autre figure soit présente : la boniche. Difficile de se déguiser en boniche sans convoquer les connotations conservatrices que jʼévoquais plus haut : peut-être là aussi y a-t-il eu un rapt, une figure de travailleuse devenant honnie, rejetée, du coup récupérée dans sa forme la plus docile et la plus soumise. Le quatrième chapitre, à cet égard, tentera de recomposer un autre portrait, complexe et combattant, de la boniche.
Le mouvement féministe de seconde vague ne doit pas pour autant être accablé : ses angles morts sont dʼabord problématiques dans la mesure où ils sont persistants de nos jours. Le féminisme se donne fréquemment comme programme de penser la place des femmes. Situé du côté des femmes, il est logique que le féminisme pense leur émancipation des lieux dʼoppression : mais cette mécanique lui fait rater, dʼune certaine manière, le sujet des hommes et de leur implication dans le travail domestique. La notion dʼégalité est séduisante précisément parce quʼelle semble aborder la question des hommes : mais, ainsi réduits à constituer lʼautre terme dʼun calcul numérique strict, les hommes sont évoqués en passant, comme groupe repère, et la masculinité et la domination masculine sont évacuées de lʼordre du jour.
Plus tôt, jʼai suivi le diagnostic dʼune dudification (mec-ification) de la cuisine en cherchant à évaluer ce que cette pièce signifie pour les hommes, comment ils lʼinvestissent et la travaillent. Mais cette analyse doit encore être poussée, au regard du chemin traversé : les hommes ne masculinisent pas seulement la cuisine lorsquʼils sʼattaquent (enfin) au travail que recouvre cette pièce de la maison ; plus généralement, ce lieu et ses pratiques se sont masculinisés. Spectacle, représentation, hobby sont des dimensions valorisées de la pratique culinaire, y compris lorsquʼelle est effectuée par des femmes. Mais quʼen est-il, dès lors, du labeur en cuisine quotidien et répétitif qui ne peut sʼincarner dans ces modalités ?
Si le féminisme a failli en délaissant la cuisine, cʼest peut-être que les options ont été très réduites et ce, dʼautant plus que ce mouvement de la seconde vague a été suivi dʼun backlash intense, qui a permis, de Reagan à Thatcher, lʼéclosion dʼun capitalisme financier laissant peu de marge de manœuvre. Nan Bauer Maglin décrit ainsi ce terrible choix auquel sont confrontées les femmes dans la revue heresies (1981) :
La vision des femmes proposée par la culture mainstream pose un choix entre une immersion totale dans la cuisine -— que soit la cuisine grouillante, apparemment plus chaleureuse des classes travailleuses et des cultures immigrantes, ou la cuisine blanche, brillante, vide, divisée sur la base du sexe de la classe moyenne -— ou le rejet total de la cuisine474 (1981, 46).
Son analyse repose sur des représentations littéraires, certes : mais il semble bien que le paysage intellectuel de cette époque ait formulé les conditions de la négociation en ces termes. Les femmes ont ainsi massivement «  choisi  » le salariat. Il ne sʼagit pas pour nous de nous lamenter sur la perte de savoir-faire ancestraux, ou dʼidéaliser la vie au logis. Plutôt, il nous faut nous plonger dans ce travail, le comprendre pour évaluer comme il a muté, comment il sʼest partagé, selon quelles lignes, et si le partage peut être considéré comme juste. Plutôt que de prendre un siège en cuisine, nous allons à présent nous demander ce que la cuisine peut ; ce quʼelle réalise ; ce quʼelle accomplit. Il sʼagira de savoir, enfin, qui va faire la vaisselle—et plus encore, ce que cela implique de faire la vaisselle.
Marouane Bakhti, Comment sortir du monde, 2023, p. 111.
«  10 septembre 1975
Il était une fois une gouine-photographe qui était amoureuse dʼune gouine-potière. Elles vivaient avec une gouine-guérisseuse, une gouine-en-manque-dʼamour et une gouine qui-voyait-loin-et-nettoyait-la-cuisine. Elles se sont enseigné tout ce quʼelles savaient et ont beaucoup travaillé sur ce quʼil fallait faire et pourquoi le faire. Je suis tombée amoureuse de la gouine-photographe, de la gouine-qui-allait-lentement, de la gouine-au-baiser-fleuri.
– la gouine-musicienne  »475
Journal de Susan, dans Country Lesbians The Story of the WomanShare Collective, 1976, p. 90.
«  Housework, housework, housework
Housework, housework, housework
[…]
Housework, housework
Iʼm so tired of this vacuum, need a man to help soon
Donʼt need a man to make a move on me
I need a man to move in with me
Donʼt need a man to treat me mean
I need a man to help me clean
Someone whoʼs heaven sent
Someone to help pay rent
Someone to share dreams and wishes
Someone to help me do the dishes  »476
chanson du groupe B52ʼs, «  Housework  », album Bouncing Off the Satellites, 1986.
En 2020, les Nations Unies publient sur la plateforme en ligne Medium un post dédié à une annonce fictive, celle de la découverte dʼun pays où lʼégalité homme-femme est accomplie. Nommée Equiterra, la contrée est représentée par un visuel réalisé par lʼillustratrice Ruby Taylor et sert de synthèse visuelle et spatiale au programme égalitaire conçu par les Nations Unies (fig. 3.1). Lʼarticle propose dʼexplorer la capitale à Equiterra, où chaque lieu est connecté par des signes textuels et visuels à des enjeux de lʼégalité. Les lecteurices découvrent ainsi successivement «  lʼavenue des contre-stéréotypes  », «  lʼallée sans-violence  », «  la rue des salaires égaux  », «  la station de recyclage de la masculinité toxique  », «  le square de lʼinclusion  », la «  rue de lʼaction pour le climat  », «  lʼavenue de la représentation équitable  », le «  boulevard de lʼéducation  » et enfin «  lʼavenue de la liberté  »477. Au-delà de cette métaphore par la carte, lʼimage fourmille de détails et on peut reconnaître chez son autrice lʼintention de balayer plusieurs enjeux du féminisme, sans les réduire à un symbole unique. Mais à la découverte de cette image dans un article de la revue Journal of Future Studies écrit par Ivana Milojević, je ne peux mʼempêcher de constater lʼabsence de nourriture et celle, conjointe, dʼun lieu pour sa culture, sa production ou sa préparation. En somme, ce visuel exhaustif qui réussit à montrer une variété dʼêtres humains en train de faire du sport, dʼaller à la plage, de travailler dans une usine ou encore de faire les boutiques, occulte complètement lʼexistence de la cuisine. Faut-il encore sʼen étonner, alors que le chapitre précédent était entièrement consacré à lʼeffacement, sinon à la disparition de ce lieu ? Une chose est sà »re : dans cette utopie féministe, la cuisine sʼest évanouie, et nʼa pas été remplacée.

Pourtant, le portrait dʼun devenir entièrement négatif de la cuisine est bien entendu biaisé. On pense immédiatement aux succès de nombreuses blogueuses «  food  », ou encore aux émissions comme Top Chef, déjà évoquées dans ces pages, qui, parce quʼelles cultivent et prolongent une culture du temps passé en cuisine, mettent à mal lʼidée selon laquelle cette pièce serait vouée à disparaître complètement. En réalité, les motifs de la disparition de la cuisine et de son soudain réinvestissement, plutôt que de constituer deux réalités contraires, sont deux aspects complémentaires de la relation que nous entretenons avec elle. Cette ambiguïté peut dʼautant plus compliquer lʼanalyse quʼen français le mot «  cuisine  » désigne deux référents distincts. La cuisine est la pièce de la maison à laquelle est dédié cet essai, mais le mot renvoie aussi à la pratique culinaire qui peut y prendre place (fig. 3.2). Il est vrai que les deux peuvent se superposer : on cuisine en cuisine, après tout. Mais on peut aussi faire tout autre chose dans cette pièce de la maison, comme on peut cuisiner dans une variété dʼautres lieux que la seule cuisine domestique (en cuisine collective, dans une chambre étudiante, dans un camping-car, en extérieur, etc.).
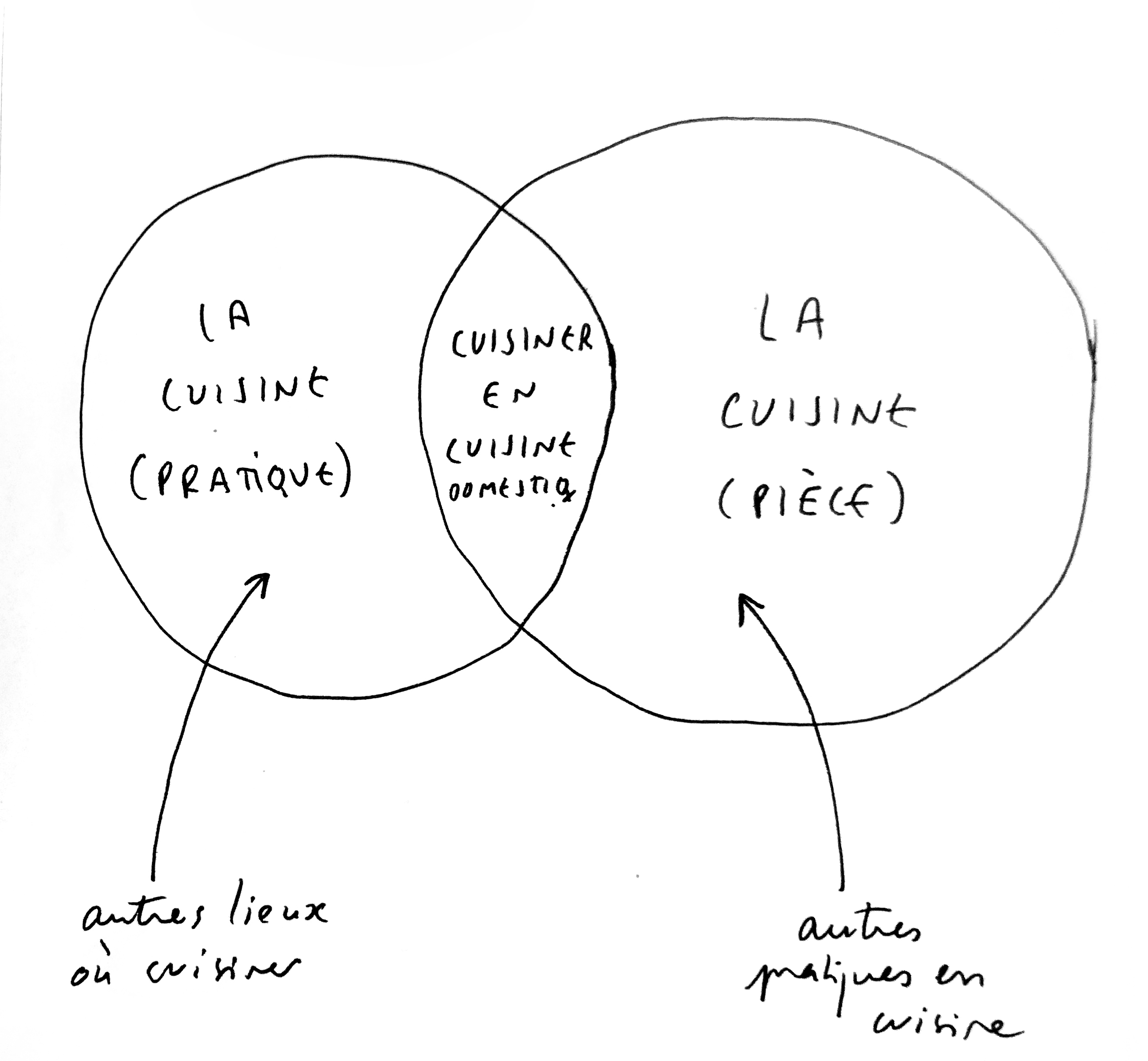
Je mentionne cette double référentialité parce quʼelle peut produire un glissement dans ma démarche : en parlant dʼun espace architectural, je peux facilement mʼégarer et oublier sa conception pour ne plus observer que ses appropriations. Or, je souhaite analyser la conception de la cuisine à travers sa destination première, qui est, a priori, de préparer les repas et ses composantes, voire de les y consommer dans certains cas. La cuisine sera donc envisagée dans les pages qui suivent comme un lieu de production, au sens strict de la pratique culinaire : il va presque de soi quʼune cuisine doit être conçue pour quʼon puisse y cuisiner. Jʼenvisagerai à la fois la relation de la cuisine à sa production plus souterraine, symbolique et culturelle. En effet, jʼentends montrer que la cuisine ne fabrique pas seulement de bons petits plats, quʼelle produit aussi la femme au foyer, la famille hétérosexuelle et un ensemble de possibles pour celles et ceux qui lʼhabitent.
Si mon objectif apparaît ici de manière redondante, cʼest quʼil demande encore à être incarné, comme je lʼai suggéré à la fin du chapitre précédent. Que fait-on en cuisine ? Quʼy fabrique-t-on, au sens littéral comme au sens figuré ? Si le travail domestique ne se résume pas au travail en cuisine, je voudrais exposer comment cette pièce sert de centre des opérations dans le foyer, au point dʼincarner de manière métonymique tout le travail domestique, quʼil soit culinaire ou non. Lorsquʼon rapproche lʼespace de la cuisine de la question de la production, on pense peut-être en premier lieu à la production de cet espace lui-même. Or, il apparaît à cet endroit que les femmes ne sont guère productrices, puisquʼelles habitent le plus souvent (dans les imaginaires comme dans les faits) des espaces quʼelles nʼont pas conçus. Au-delà du fait social qui veut que, dans le monde contemporain occidental, nous sommes rares à concevoir les espaces dans lesquels nous habitons478, la profession dʼarchitecte qui ordonne nos espaces, les pense pour nous et en projette les usages est, nous lʼavons vu, très peu féminisée. Parce que la femme architecte a été sur le plan historique une figure repoussoir ou, tout simplement, un personnage impossible, la cuisine apparaît comme un paradoxe : pensée pour les femmes, elle nʼa pas été (à quelques exceptions notoires) pensée par elles. Je rappellerai donc la manière dont lʼarchitecture est une pratique genrée, même si certaines femmes ont tout de même travaillé à élaborer des modèles plus ou moins durables.
Du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle, la production de la cuisine a pu être pensée en des termes analogues à ceux de la production industrielle. Cette dernière a pour lieu de référence lʼusine intégrée au circuit capitaliste, puisque le travail quʼelle accueille, soit-il mal rémunéré et effectué dans des conditions délétères, est compensé sur le plan économique. Cette séparation genrée des espaces a particulièrement été mise en lumière par les théories marxistes féministes, qui ont observé la manière dont le capitalisme fonctionne sur la base dʼun travail rémunéré (celui des hommes), rendu possible par un travail gratuit (celui des femmes, au logis). À son origine, on rencontre la célèbre «  théorie des deux sphères  » pensée par le théologien Thomas Gisborne. Dans son ouvrage An Enquiry into the Duties of the Female Sex (1813), il affirme que les natures différentes des hommes et des femmes les prédisposent à des tâches différentes, et les associe dès lors à des espaces distincts (Gisborne 1813, B, 11 ; Fine 2010, XVIII). Ce motif a eu une grande fortune critique, peut-être excessive : Gisborne lui-même, dans son ouvrage, parle de cette distinction pour les classes les plus hautes et intègre tout à fait lʼidée que des femmes (pauvres) puissent travailler pour dʼautres femmes (celles quʼil évoque et à qui il sʼadresse dans son ouvrage ; 1813, 193). Il convient donc de séparer ce que la théorie des deux sphères a pu avoir de prescriptif pour Gisborne, et la manière dont ce concept a permis ensuite dʼévoquer lʼidéal de la société victorienne. Enfin, il faut être vigilant à ce que lʼidée des deux sphères ne devienne pas une lentille déformante à travers laquelle on regarde le passé (Attfield 2000, 122–23).
Mon examen de lʼhistoire de lʼarchitecture mettra ainsi en lumière la manière dont ces deux aires existent dans une forme de tension, voire de friction, notamment lorsque les méthodes tayloristes sʼinvitent en cuisine pour rationaliser le travail de la ménagère. Les théories marxistes ont en effet montré lʼexistence, à lʼorigine du capitalisme industriel, dʼune relation de dépendance mutuelle entre lʼusine (ou plus tard, lʼentreprise) et lʼespace domestique. Je mʼintéresserai ainsi à la manière dont le paradigme de lʼusine a contribué à redéfinir la conception de lʼespace de la cuisine dans la maison individuelle. Pour ce faire, je me concentrerai sur lʼingénierie domestique, et notamment sur les autrices des guides de la vie domestique du XIXe siècle au début du XXe siècle. Souvent perçu comme une compétence naturelle des femmes, le travail culinaire et ménager a été élevé au rang de science ménagère par ces théoriciennes : si on peut interpréter ces guides comme des discours féministes, force est de constater que certains propos renforcent parfois lʼassignation des femmes au foyer, alors même que ces influenceuses (je mʼautorise ici lʼanachronisme, à dessein) mènent leurs carrières en défendant un mode de vie tout autre pour leurs lectrices.
Je reviendrai ensuite à la relation entre femmes et architecture, et à la manière dont les femmes architectes se sont emparées de lʼespace domestique. Il nʼest en effet pas aussi simple que de faire penser les maisons par les femmes (comme le souhaitait la théoricienne française Paulette Bernège) pour les libérer des murs trop étroits qui les enserrent. Toutefois, je mʼattacherai à montrer, en rapprochant des exemples apparemment distants, que lʼagentivité féminine peut prendre des formes architecturales. Enfin, je reviendrai aux fondements de la relation problématique des femmes à la cuisine, en évoquant le travail domestique et sa possible réinvention, par la rémunération ou lʼexternalisation. Cet examen nous permettra de cartographier bien des impasses, et de comprendre comment lʼespace domestique nʼenferme pas seulement matériellement et symboliquement les femmes : son processus de conception même est miné dʼattentes sexistes et de pièges faussement libérateurs.
Tout espace dans lequel on cuisine mérite peut-être le statut de cuisine. Ce potentiel est dʼailleurs contenu en germe dans certains ouvrages, tel le Cuisiner en tous temps, en tous lieux (1996) du médecin Jean-Philippe Derenne, qui explique avoir développé une technique culinaire ne nécessitant quʼun couteau, une bouilloire et des sacs congélation pour continuer de partager sa passion de la gastronomie avec sa femme hospitalisée479 (Rousseau 2010). Mais on pourrait aussi arguer que ce «  faire-cuisine  » nʼéquivaut pas à la conception dʼune pièce qui ait le statut de cuisine. À défaut dʼune différence de nature, il y a bien une différence de degré entre un «  faire-cuisine  » mobile qui se contente de quelques outils, et la conception complète dʼun espace méritant ce nom. Or, quʼappelle-t-on cuisine ? Lʼimage dʼun espace aux placards harmonisés, dissimulant derrière leur façade des équipements électriques est peut-être une évidence pour nous, mais cet agencement est bien le résultat de processus historiques complexes, parfois contradictoires. En dʼautres termes, comment le «  lieu où lʼon cuisine  » est-il devenu le type contemporain de la cuisine équipée, et quel est le statut de sa production ?
Siegfried Giedion, dans sa somme dédiée à lʼavènement de la mécanisation (1948) situe lʼorigine dʼune pensée systémique de la pratique culinaire dans les travaux de Catharine Beecher. Ses deux écrits, Treatise on Domestic Economy480 (1845[1842]) et The American Womanʼs Home481 co-écrit avec sa sÅ“ur Harriet Beecher Stowe482 (1869), interrogent la condition de la femme américaine, au foyer, et entendent repenser lʼorganisation du travail domestique et la place des servant·es, amené·es selon elles à disparaître au profit dʼune division du travail dans la famille, notamment auprès des enfants (Giedion 1948, 516). Giedion est cependant très clair lorsquʼil affirme quʼil «  ne faut pas confondre lʼorganisation du processus de travail avec lʼutilisation dʼoutils mécanisés  »483 (516). Autrement dit, le mouvement qui va solidifier le paradigme de la cuisine équipée est réalisé par deux tendances quʼil est aisé de confondre : rationalisation et mécanisation. Or, si la mécanisation de la cuisine est facilitée par la rationalisation préalable de cet espace, il sʼagit bien de deux dynamiques distinctes.
En France, ce «  tournant rationnel  » est palpable dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le chef et auteur Urbain Dubois484 coécrit en 1856, avec Émile Bernard, La cuisine classique, étude pratiques, raisonnées et démonstratives de lʼécole française appliquée au service à la Russe.  fig. 3.3 : Planches extraites de l’ouvrage d’Urbain Dubois, La cuisine classique, étude pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française appliquée au service à la Russe (1856), co-écrit avec Émile Bernard. Il s’agit ici de desserts, p. 25 et 26 sur le document disponible sur Gallica, [en ligne], https:
fig. 3.3 : Planches extraites de l’ouvrage d’Urbain Dubois, La cuisine classique, étude pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française appliquée au service à la Russe (1856), co-écrit avec Émile Bernard. Il s’agit ici de desserts, p. 25 et 26 sur le document disponible sur Gallica, [en ligne], https:
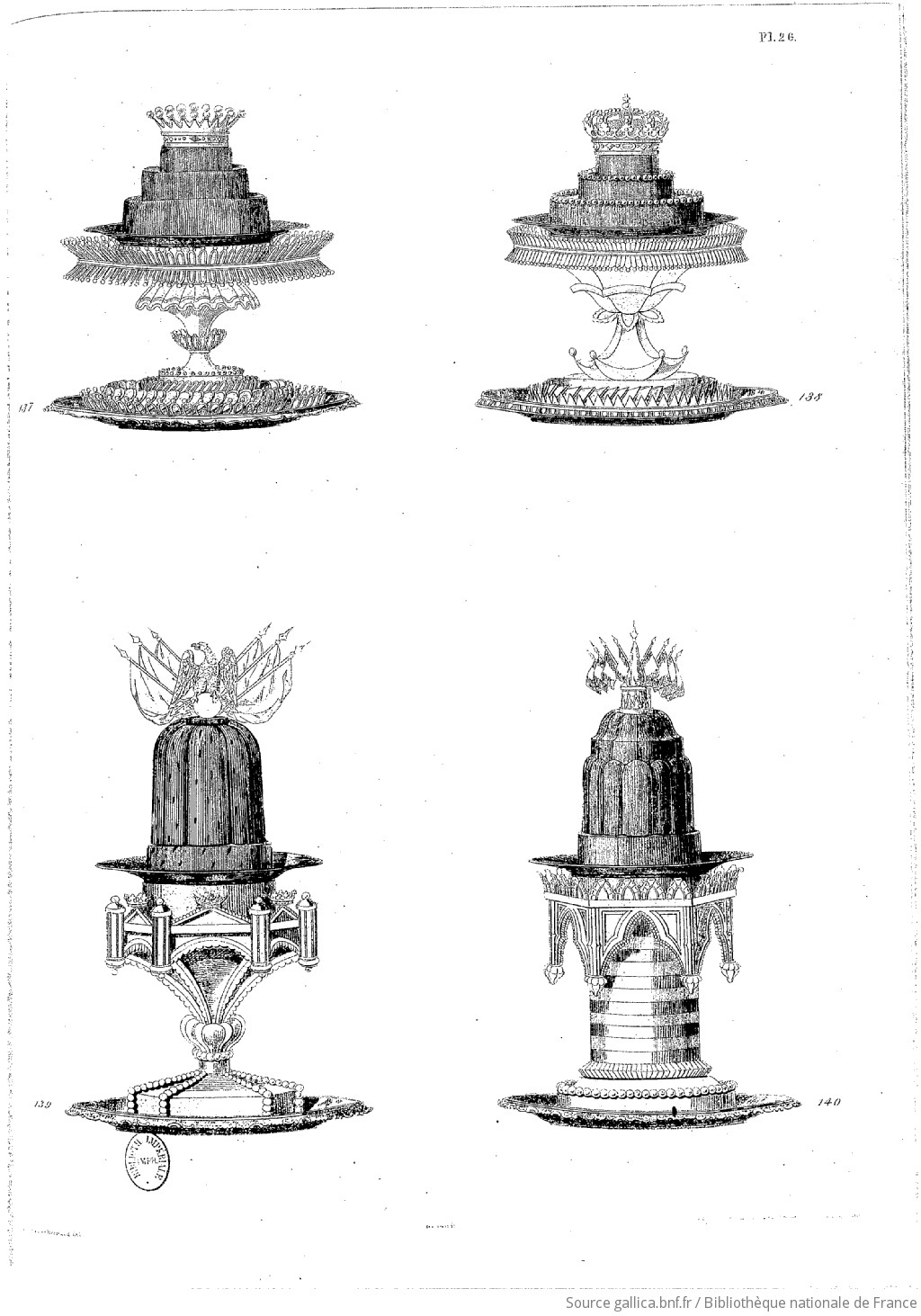 fig. 3.3.b : Une seconde planche de desserts décrits par Urbain Dubois.À la fin du XIXe siècle, des cuisiniers professionnels (plutôt des hommes) et des théoriciennes de lʼéconomie domestique (des femmes) sʼemploient à penser la rationalisation de la cuisine. Mais quʼen était-il aux époques précédentes ? Dans sa brève histoire du design des cuisines («  A Brief History of Kitchen Design  ») écrite pour la revue Core77, le journaliste et design Rain Noe évoque lʼère de la préstandardisation, quʼil associe à «  un bric-à -brac de pièces de mobilier dépareillées  »485. Cette situation, quʼon serait tenté de situer avant les écrits des Beecher, va en réalité se prolonger jusquʼà nos jours : il nʼest en effet pas rare aujourdʼhui de voir des cuisines aménagées par les achats successifs de meubles, plutôt quʼen un seul bloc. Le fait que les Beecher écrivent au sujet de la cuisine, et que Catharine Beecher propose dès 1842 un aménagement idéal de cette pièce de la maison (publié à nouveau dans lʼouvrage coécrit avec Harriet en 1869), nʼest nullement synonyme dʼune diffusion rapide et uniforme dʼun standard. Comme souvent, en design, il importe de distinguer le type proposé par les designers de sa pénétration réelle sur le marché, puis de son intégration aux usages, souvent inégale en fonction de la classe sociale.
fig. 3.3.b : Une seconde planche de desserts décrits par Urbain Dubois.À la fin du XIXe siècle, des cuisiniers professionnels (plutôt des hommes) et des théoriciennes de lʼéconomie domestique (des femmes) sʼemploient à penser la rationalisation de la cuisine. Mais quʼen était-il aux époques précédentes ? Dans sa brève histoire du design des cuisines («  A Brief History of Kitchen Design  ») écrite pour la revue Core77, le journaliste et design Rain Noe évoque lʼère de la préstandardisation, quʼil associe à «  un bric-à -brac de pièces de mobilier dépareillées  »485. Cette situation, quʼon serait tenté de situer avant les écrits des Beecher, va en réalité se prolonger jusquʼà nos jours : il nʼest en effet pas rare aujourdʼhui de voir des cuisines aménagées par les achats successifs de meubles, plutôt quʼen un seul bloc. Le fait que les Beecher écrivent au sujet de la cuisine, et que Catharine Beecher propose dès 1842 un aménagement idéal de cette pièce de la maison (publié à nouveau dans lʼouvrage coécrit avec Harriet en 1869), nʼest nullement synonyme dʼune diffusion rapide et uniforme dʼun standard. Comme souvent, en design, il importe de distinguer le type proposé par les designers de sa pénétration réelle sur le marché, puis de son intégration aux usages, souvent inégale en fonction de la classe sociale.
La cuisine aurait donc été en désordre, dépareillée et peu fonctionnelle avant dʼêtre pleinement investie et repensée au XIXe siècle. Mais le fait que la cuisine puisse exister dans des arrangements hybrides montre peut-être que lʼordre nʼen est pas le principe fondateur. Si les placards uniformes ne constituent pas lʼessence de la cuisine, quelle est-elle ? Siegfried Giedion la situe dans la source de chaleur.

Il affirme en effet que «  lʼhistoire de la cuisine telle que nous la connaissons aujourdʼhui est en grande partie liée à la concentration croissante de ses sources de chaleur  »486 (527). Il relie cette évolution à la chaîne dʼévolutions techniques qui ont fait passer les usages de la flamme du foyer au poêle à charbon, puis aux feux au gaz, et enfin aux feux électriques. La mention de la cheminée permet à Giedion de rappeler ces faits plus anciens : ce nʼest quʼau XVe siècle, avec lʼémergence des prémices dʼune conscience bourgeoise, que la cuisine se sépare du reste de la maisonnée. Pourtant, ici encore, cette séparation nʼest pas uniforme et dépend des contextes. Giedion affirme que jusquʼau XVIIe siècle, cette pièce sert de salle à manger, parfois de chambre ou de pièce de réception (ibid.). Cʼest aussi à cette époque que la séparation entre cuisine et pièces de vie sʼaffirme, faisant de la cuisine une simple pièce «  de service  » (528). Une hypothèse principale est souvent mobilisée pour expliquer ce fait : à mesure quʼémerge un style de vie et des habitus bourgeois, il convient de séparer la souillure de la cuisine, en particulier ses odeurs des pièces à vivre qui sont aussi des pièces de représentation. fig. 3.6.a : Exemple de chariot de service pour restaurant (époque contemporaine), marque Horeca. La cuisine nʼest pas la seule pièce à être concernée par ce modèle.
fig. 3.6.a : Exemple de chariot de service pour restaurant (époque contemporaine), marque Horeca. La cuisine nʼest pas la seule pièce à être concernée par ce modèle. fig. 3.5 : Image d’une publicité pour un passe-plat ou serving hatch par la marque Ostens Servway, catalogue par Ostens (Byfleet) Ltd, années 1930–1940, archives du MODA (Museum of Domestic Design and Architecture). Lʼarchitecte Marianna Janowicz rappelle ainsi lʼopposition historique entre les espaces des plus riches, qui tendent à multiplier les pièces et les fonctions qui leur sont associées, et des espaces plus modestes, où la pièce unique de vie est la norme et rassemble un ensemble dʼusages divers (2021–22, 7). Pour résumer à gros traits, plus on est riche, plus on partitionne son espace, et la cuisine est repoussée loin des salles de réception, voire en sous-sol (Collet 2006, 2). La division entre vie sociale et service tient aussi à la division de classe entre servant·es et servi·es : lʼarchitecture ordonne donc les rapports sociaux en définissant des lieux pour chacun·e. La cuisine tire sa spécificité de ses fonctions, mais aussi de la nécessité pour celles-ci dʼêtre effectuées sans contaminer le reste de la maison, notamment par lʼodeur. Cette séparation constitue lʼinversion dʼune stratégie plus ancienne qui consistait à ne pas séparer les espaces pour profiter de la chaleur dégagée par le foyer de cuisson. Les séparations pratiquées à partir du XVIIe siècle posent la question de la connexion de ces espaces, puisquʼil faut bien que la nourriture arrive jusquʼà la salle à manger pour le service. Des dispositifs comme la desserte, le monte-plat (fig. 3.5) ou encore le passe-plat, jouent le rôle dʼordonnateurs et relient ce que le bâti travaille à séparer.(fig. 3.5.a & b)487.
fig. 3.5 : Image d’une publicité pour un passe-plat ou serving hatch par la marque Ostens Servway, catalogue par Ostens (Byfleet) Ltd, années 1930–1940, archives du MODA (Museum of Domestic Design and Architecture). Lʼarchitecte Marianna Janowicz rappelle ainsi lʼopposition historique entre les espaces des plus riches, qui tendent à multiplier les pièces et les fonctions qui leur sont associées, et des espaces plus modestes, où la pièce unique de vie est la norme et rassemble un ensemble dʼusages divers (2021–22, 7). Pour résumer à gros traits, plus on est riche, plus on partitionne son espace, et la cuisine est repoussée loin des salles de réception, voire en sous-sol (Collet 2006, 2). La division entre vie sociale et service tient aussi à la division de classe entre servant·es et servi·es : lʼarchitecture ordonne donc les rapports sociaux en définissant des lieux pour chacun·e. La cuisine tire sa spécificité de ses fonctions, mais aussi de la nécessité pour celles-ci dʼêtre effectuées sans contaminer le reste de la maison, notamment par lʼodeur. Cette séparation constitue lʼinversion dʼune stratégie plus ancienne qui consistait à ne pas séparer les espaces pour profiter de la chaleur dégagée par le foyer de cuisson. Les séparations pratiquées à partir du XVIIe siècle posent la question de la connexion de ces espaces, puisquʼil faut bien que la nourriture arrive jusquʼà la salle à manger pour le service. Des dispositifs comme la desserte, le monte-plat (fig. 3.5) ou encore le passe-plat, jouent le rôle dʼordonnateurs et relient ce que le bâti travaille à séparer.(fig. 3.5.a & b)487.

La cuisine est dʼabord centrale, tant quʼil est question de profiter de sa chaleur. Au XIXe siècle, la cuisine ne subit pas uniquement lʼinfluence du taylorisme, sur laquelle je reviendrai, mais aussi celle de lʼhygiénisme alors naissant. On veut tenir la cuisine et ses pratiques contaminantes à distance, tout en assurant la ventilation dʼun lieu où peuvent se multiplier les germes honnis, à leur tour contaminants pour la nourriture. Lʼarchitecte et essayiste Catherine Clarisse nous rappelle ainsi que la cuisine est souvent «  sale (on y cuisine au charbon, cʼest le lieu des ordures), poisseuse (on y cuisine avec toutes sortes de graisses) et embuée (la lessive y sèche)  » (2004, 45). Dans les écrits des commentateurices concerné·es (hommes chefs ou femmes autrices de guides), cʼest une véritable cuisine de lʼenfer qui est mobilisée pour mieux asseoir lʼargument de nécessaires rationalisations et hygiénisations. Urbain Dubois pose ainsi la question au début de sa Cuisine artistique : «  Dʼoù vient que les cuisines, même dans les grandes et belles maisons, soient le plus ordinairement, mal disposées, défectueuses, incommodes, mal-saines ?  » (1872,2). Lʼadhésion de lʼauteur aux thèses hygiénistes de son temps ne fait aucun doute lorsquʼon lit plus loin :
Les cuisines les plus défectueuses sont celles construites dans les souterrains, car elles sont alors peu aérées, peu éclairées, humides, malsaines ; dans ces conditions, si elles nʼoffrent pas de dangers immédiats et apparents, elles ont toujours pour résultat, dʼinoculer aux cuisiniers le germe dʼinfirmités qui se développent plus tard (ibid.).
Et lʼauteur de plaider en faveur de grandes cuisines bien ventilées et baignées de lumière. Lʼarchitecte écossais Robert Kerr ne dit rien dʼautre en 1865 dans son traité The Gentlemanʼs House488 :
Dans son sens le plus courant, le confort dʼune maison indique lʼabsence de tous les maux tels que les courants dʼair, les cheminées enfumées, les odeurs de cuisine, lʼhumidité, les nuisibles, le bruit et la poussière ; la saleté de lʼété et le froid de lʼhiver ; les entrées sombres, les passages aveugles et les pièces renfermées (1865, 70)489.
La partie quʼil consacre à la cuisine dans son traité comporte ainsi de longs passages au sujet de la qualité de lʼair, de la ventilation et de la «  fraîcheur  » qui doit être entretenue dans ces lieux (206–207). Toutefois, on remarquera que lʼaménagement global de cet espace est encore approché du point de vue du mobilier existant et de ses dimensions standard : pour Kerr, la cuisine est une boîte à remplir avec des équipements, et la manière dont ils peuvent être reliés nʼest pas un sujet majeur pour lʼauteur (fig. 3.7).
De ce parcours rapide de quelques traités du milieu du XIXe siècle, on retiendra donc deux idées. Premièrement, la cuisine, avant dʼêtre un espace féminin, est un espace qui ordonne des rapports de classe. Le souci de lʼhygiène, prégnant au XIXe siècle, met en scène cette préoccupation dans la mesure où les classes les plus pauvres sont associées à la saleté et vues comme les sources de maladies et de germes490.
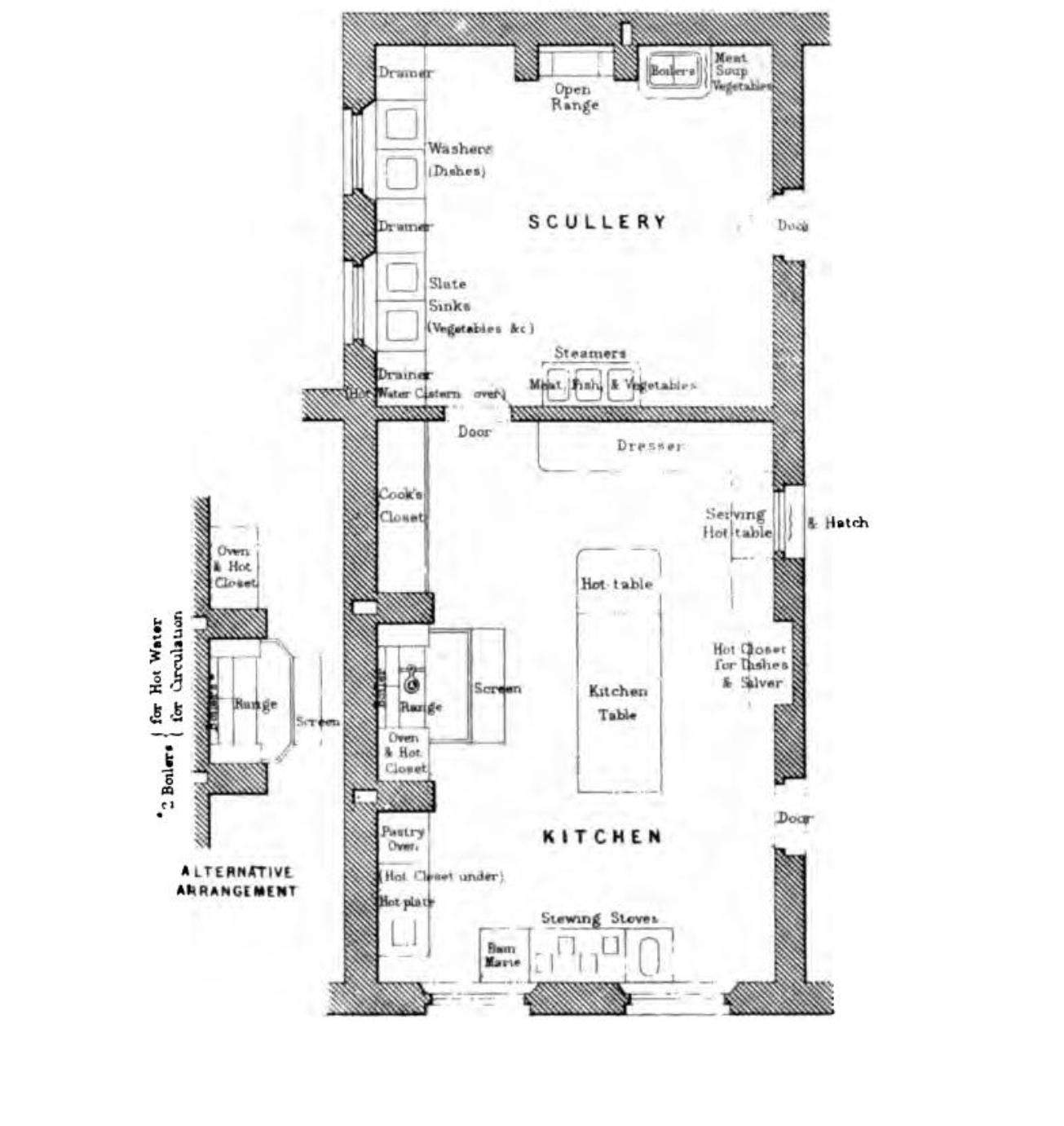
Mais la conscience accrue de la nourriture comme possible contaminant fait surgir une contradiction : cette crasse que lʼon voulait tenir à distance, en coulisse491, ne peut pas non plus être chassée trop loin ou trop profondément. La cuisine doit rester ouverte pour que circule cet air pur tant prisé par les hygiénistes, mais aussi pour limiter la complexité du «  trafic  » entre les lieux où se fabriquent les repas, et ceux où ils sont servis (Kerr 1865, 96). Les femmes ne sont pas encore des fées du logis que déjà la cuisine est le lieu dʼune tension, entre visibilité et invisibilité, ouverture et fermeture. Deuxièmement, hygiénisme et rationalisation sont deux préoccupations contemporaines lʼune de lʼautre qui ne sont pas toujours strictement associées : si Urbain Dubois parle de «  laboratoire  » autant que de qualité de lʼair, Robert Kerr sʼy intéresse aussi, tout en pensant encore à la cuisine en tant que pièce à remplir dʼéquipements dépareillés et peu scientifiques, du moins en apparence.
Lʼespace réclamé par Urbain Dubois se heurte à une autre contrainte : le coà »t. En effet, si les considérations hygiénistes réclament dʼouvrir et de faire place, la spéculation immobilière qui sʼamorce au XIXe siècle conduit à une augmentation du prix des logements qui incite à «  condenser  » la part consacrée aux espaces de service (Clarisse 2004, 44). Le modèle bourgeois est ainsi décrit par la chercheuse et architecte Catherine Clarisse :
La cuisine dʼun appartement bourgeois prend généralement jour sur une cour ou une courette, et fait partie dʼun dispositif complet. Elle est distribuée par un couloir de service la reliant à la salle à manger, et par un escalier de service donnant sur la cour de service (local à ordures), qui dessert la cave (charbon, provisions, vin) et les chambres de service sous les combles. Lui est généralement associé lʼoffice (qui parfois accueille une table pour les domestiques et les repas des enfants). La buanderie ou la lingerie complète dans le meilleur des cas cet ensemble (Clarisse 2004, 43).
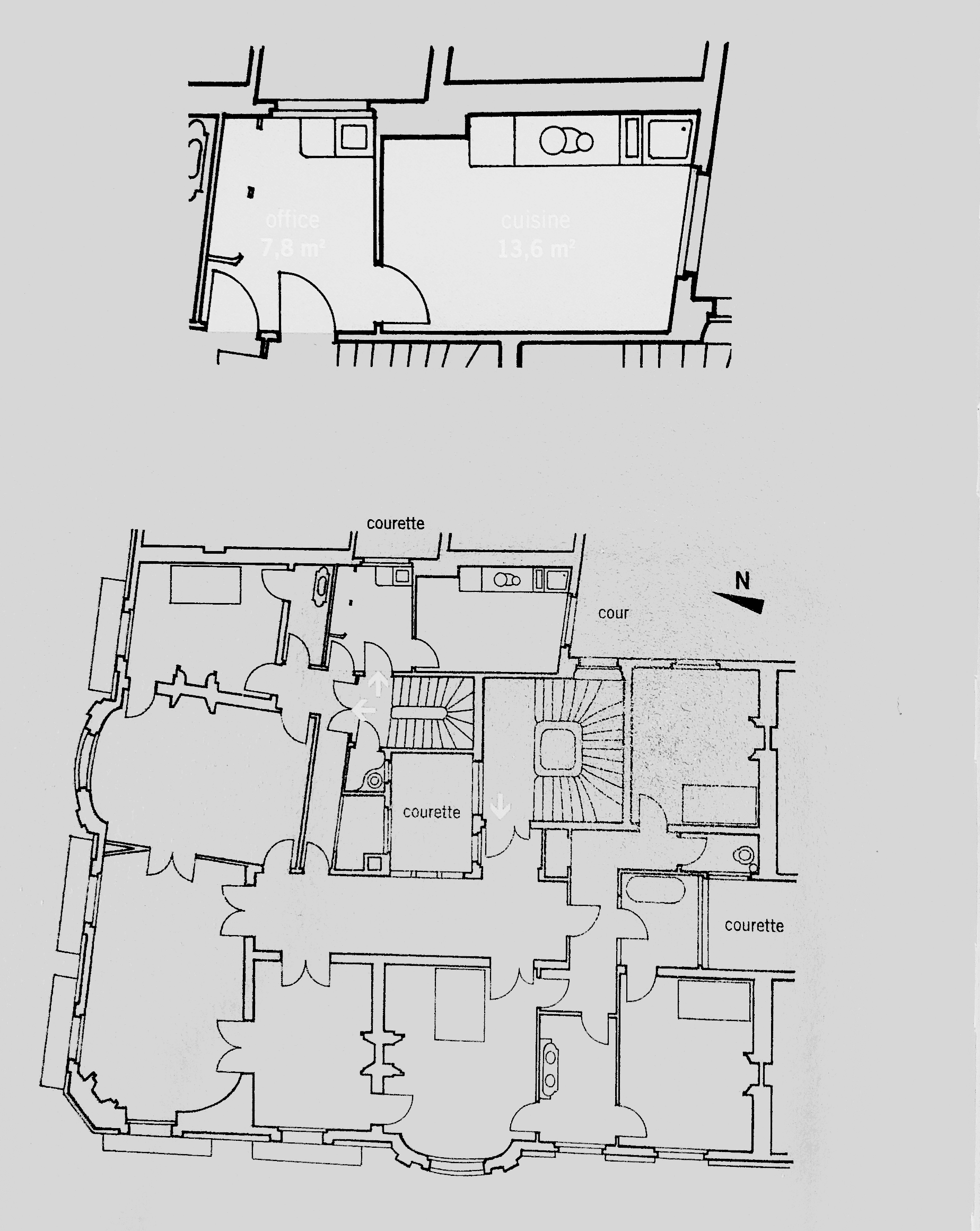
Cette cuisine (fig. 3.8) est dʼabord envisagée comme le domaine des domestiques, parce que les bourgeois, au XIXe siècle, sont désormais en mesure dʼembaucher un petit personnel réservé auparavant à lʼaristocratie. Même chez les petits bourgeois, ce personnel de service est présent (Clarisse 2004, 44) quoique peut-être moins nombreux. Si les femmes bourgeoises sont consacrées comme maîtresses du foyer à cette époque, elles ne sont pas exactement assignées à la cuisine. Tout au plus, elles dirigent le personnel qui sʼy déploie et sʼy active, tandis que leur oisiveté personnelle est signe de lʼopulence de leur foyer (Singly 2007a, 73). Cette ascension de la classe bourgeoise va dʼailleurs avoir comme corollaire une forte demande de domestiques. Dans un premier temps, au début du XXe siècle, la classe domestique croît avec lʼembourgeoisement de la société (Moujoud & Falquet 2010, 173). Comme la révolution industrielle offre des emplois mieux rémunérés aux hommes, la classe domestique devient plus nombreuse en même temps que plus féminine (Moujoud & Falquet 2010, 172). Lʼindustrie concurrence toutefois les employeurs bourgeois à la recherche de personnel. Parce que les salaires ouvriers sont plus intéressants, il arrive que les femmes, par exemple, en France ou en Grande-Bretagne (Janowicz 2021, 7), se désintéressent de ces métiers domestiques mal rémunérés. Le début du XXe siècle est donc marqué par une pénurie de bonnes, compensée par le recours à une main-dʼœuvre étrangère. Cette mutation est capitale, et continue de conditionner le marché du travail domestique jusquʼà nos jours : dʼabord local, le marché du travail domestique sʼinternationalise et mobilise une main dʼœuvre immigrée. Ce sont en premier lieu les Allemandes, les Italiennes et les Polonaises qui viennent travailler en France (Moujoud & Falquet 2010, 73–74) ; plus tard, les femmes issues des territoires outre-mer sont mobilisées, notamment par lʼintermédiaire du Bumidom. Dans de nombreux cas, aux États-Unis, comme en France, la ligne qui sépare les maîtresses de maison de leur personnel est à la fois de classe et de race, et jʼaurai lʼoccasion dʼy revenir ci-après, car ce partage affecte la pensée de la cuisine.
Les années 1880 voient sʼamorcer une mutation : la classe domestique recule en nombre, tandis que le travail à la maison, en particulier en cuisine, est de plus en plus lʼapanage dʼune femme célébrée comme fée du logis, même si les formulations peuvent varier pour désigner cette figure émergente. Les guides de la vie domestique participent à la fabriquer autant quʼà sʼopposer au recours à du personnel salarié. En Angleterre et aux USA, le modèle victorien (celui-là même qui amènera Virginia Woolf à ferrailler contre «  lʼAnge de maison  ») se caractérise par la piété et le dévouement à sa famille de lʼépouse blanche et bourgeoise. bell hooks résume ce contexte dans De la marge au centre :
Au XIXe siècle, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la ‹ culture de la domesticité › était un système de valeurs des classes moyenne et supérieure majoritairement blanches et protestantes, qui plaçait la femme au centre du foyer, la célébrait pour cela et la limitait à ce rôle. La valeur des femmes était déterminée par leur dévotion à leur famille et leur foyer, et par leur rejet de toute implication dans la sphère publique. La ‹ culture de la domesticité › proposait une vision de la féminité et du rôle des femmes qui insistait sur quatre grands principes : la ‹ vraie femme › devait être pieuse, pure, soumise et dévouée à sa famille. Cette pensée a eu une influence réelle et directe sur les lois qui limitaient les activités des femmes, ainsi que sur les critères (sociaux mais aussi physiques) qui étaient censés délimiter les contours du genre féminin et permettre dʼidentifier quelles femmes étaient des ‹ vraies femmes ›. (2017[1984], note 19, p. 245)
Autrement dit, un ensemble de valeurs est associé à lʼidentité «  femme  », et par un effet retour (évoqué dans mon premier chapitre), celles qui ne participent pas à reproduire ces valeurs peuvent se voir exclues de la catégorie «  femme  », indissociable de la catégorie parente «  vraie femme  ». Ces injonctions imposent aussi aux femmes de régner sur lʼespace domestique, et sur lʼaide rémunérée à laquelle elles recourent. Cependant, de plus en plus de discours incitent, au fil du XXe siècle aux États-Unis, à se passer de cette aide, dʼailleurs devenue plus coà »teuse, en raison de mouvements sociaux (Bloom 2015). Catharine Beecher, précurseuse des manuels dʼéconomie domestique, est ainsi fermement opposée au recours aux employé·es. Siegfried Giedion évoque même chez elle un «  problème de serviteurs  »492 (1948, 515). Lʼauteur nous rappelle les arguments invoqués par Beecher pour refuser la présence de domestiques : elle sʼoppose, éthiquement, à lʼexistence dʼune classe servante (opposée au vote des femmes, elle est toutefois abolitionniste), mais pointe aussi, pratiquement, les problèmes de compatibilité psychologique entre læ domestique et la famille qui reçoit ses services. Politiquement, Beecher rejette donc ce modèle quʼelle qualifie de «  féodal  »493 (Beecher & Beecher Stowe 1869, 302 ; Giedion 1948, 515) qui met une classe au service dʼune autre, ce qui ne lʼempêche pas dʼapprocher la question du travail domestique de manière résolument sexiste. Beecher nʼest bien sà »r pas seule à porter ce discours : de lʼautre côté de lʼAtlantique, la figure de «  lʼange de maison  » est en train dʼémerger dans un contexte victorien qui associe féminité, bourgeoisie, piété et pureté. Sʼil faut attendre 1931 pour en lire une critique acide dans lʼessai, précédemment évoqué, «  Professions for Women  » de Virginia Woolf494, lʼexpression est bien antérieure. Elle est, à lʼorigine, le titre dʼun poème narratif de Coventry Patmore publié entre 1854 et 1862 -—précisément dans la période charnière à laquelle jʼai prêté attention plus haut. Patmore chante dans ce poème les louanges de son épouse, quʼil décrit comme dévouée, humble, docile -—un «  fantôme  »495 dira Woolf quelques décennies plus tard, incitant les femmes à tuer cet «  Ange  » qui leur rend visite dès quʼelles veulent sʼautonomiser, par exemple en écrivant. Woolf la décrit en ces termes :
Je vais tenter de vous en faire un bref portrait. Elle était pleine dʼune intense compassion. Elle était extrêmement charmante. Elle était dénuée de tout égoïsme. Elle excellait dans tous les arts domestiques. Sa vie était faite de sacrifices quotidiens. Si lʼon servait du poulet, elle prenait lʼaile ; sʼil y avait un courant dʼair, elle sʼy asseyait -—en résumé, elle était ainsi faite quʼelle nʼavait nulle pensée, nul désir qui lui fà »t propre, préférant toujours partager les pensées et les désirs des autres.
Avant toute chose -—faut-il le rappeler -—elle était pure. Sa pureté -—ce rose qui lui venait aux joues, sa grâce exquise -—était censée être sa principale beauté. À cette époque -—la fin du règne de la reine Victoria -—chaque foyer avait son ange496 (Woolf, 2015[1931], 393–394).
Ce modèle victorien possède sans aucun doute des spécificités britanniques, qui ne sont pas mon sujet premier ici ; il importe plutôt de voir comment «  lʼAnge  » a pu connaître différentes incarnations, aux États-Unis et même en France. Si, au sujet de la rationalisation de lʼespace de la cuisine, Catharine Beecher est une «  personnalité prophétique  » selon les mots de Siegfried Giedion (513–514), il importe de voir comment ses projets de conception sont aussi traversés par une éthique qui, pour toute féministe quʼelle peut paraître, est aussi éminemment sexiste et réductrice pour les femmes. Je vais ainsi montrer comment la cuisine, tandis quʼelle se purifie sur le plan de lʼair ambiant, produit la figure dʼune épouse au travail pure sur le plan moral. Le projet dʼéconomie domestique porté par Catharine Beecher, tandis quʼil pose les fondements de la science ménagère, implique également une éthique (sinon une morale) au foyer. Il est même possible que ce substrat religieux et moral de la cuisine prémoderne prépare, quoique de manière peut-être paradoxale, sa rationalisation scientifique.
Catharine Beecher (fig. 3.9) est citée dans la plupart des travaux sur lesquels nous nous appuyons comme la pionnière de lʼéconomie domestique.  fig. 3.9 : Portrait de Catharine Beecher (1848). Source : Wikimédia CommonsDeux écrits sont significatifs au sujet de la cuisine : elle écrit dʼabord seule A Treatise on Domestic Economy en 1842 puis The American Womanʼs Home en 1869 avec sa sÅ“ur Harriet (fig. 3.10). Toutefois, il est important de noter que Catharine Beecher a commencé sa carrière dʼautrice dès 1829, en écrivant entre autres sur lʼéducation des enfants (Suggestions Respecting Improvements in Education) ou encore sur lʼesclavage (An Essay on Slavery and Abolitionism with reference to the Duty of American Females, 1839). Elle prend également position sur la question du déplacement des populations indigènes du continent américain dans une circulaire anonyme497. Vue sous cet angle, Catharine Beecher peut être considérée comme progressiste. De plus, le fait que sa sÅ“ur ait écrit La case de lʼOncle Tom (1852), ouvrage aujourdʼhui certes critiqué, mais qui sʼancre tout de même sur une posture abolitionniste qui nʼest alors pas dominante chez les Blanc·hes, peut alimenter cette hypothèse. En réalité, Catharine Beecher est une personnalité paradoxale, qui prête aux femmes une force bien réelle, mais sur la base dʼune compréhension sexiste différentialiste du genre humain, soutenue par ses croyances religieuses et plus particulièrement lʼadhésion ferme à un dessein divin qui a donné à chacun·e un rôle sur Terre. Dans cet imaginaire de la destinée manifeste, Dieu est ainsi «  lʼAuteur de toute grâce et de toute beauté  »498 (1842, 117).
fig. 3.9 : Portrait de Catharine Beecher (1848). Source : Wikimédia CommonsDeux écrits sont significatifs au sujet de la cuisine : elle écrit dʼabord seule A Treatise on Domestic Economy en 1842 puis The American Womanʼs Home en 1869 avec sa sÅ“ur Harriet (fig. 3.10). Toutefois, il est important de noter que Catharine Beecher a commencé sa carrière dʼautrice dès 1829, en écrivant entre autres sur lʼéducation des enfants (Suggestions Respecting Improvements in Education) ou encore sur lʼesclavage (An Essay on Slavery and Abolitionism with reference to the Duty of American Females, 1839). Elle prend également position sur la question du déplacement des populations indigènes du continent américain dans une circulaire anonyme497. Vue sous cet angle, Catharine Beecher peut être considérée comme progressiste. De plus, le fait que sa sÅ“ur ait écrit La case de lʼOncle Tom (1852), ouvrage aujourdʼhui certes critiqué, mais qui sʼancre tout de même sur une posture abolitionniste qui nʼest alors pas dominante chez les Blanc·hes, peut alimenter cette hypothèse. En réalité, Catharine Beecher est une personnalité paradoxale, qui prête aux femmes une force bien réelle, mais sur la base dʼune compréhension sexiste différentialiste du genre humain, soutenue par ses croyances religieuses et plus particulièrement lʼadhésion ferme à un dessein divin qui a donné à chacun·e un rôle sur Terre. Dans cet imaginaire de la destinée manifeste, Dieu est ainsi «  lʼAuteur de toute grâce et de toute beauté  »498 (1842, 117).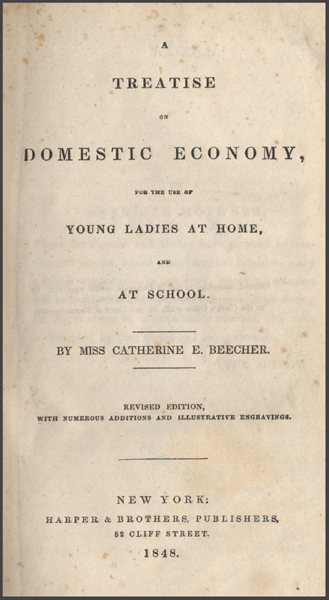 fig. 3.10 : Un livre de Catharine Beecher : Treatise on Domestic Economy (1842).
fig. 3.10 : Un livre de Catharine Beecher : Treatise on Domestic Economy (1842).
A Treatise on Domestic Economy se présente dʼabord comme un ensemble de principes généraux liés au foyer, mais aussi à la conduite dʼune vie saine. Indignée par la mortalité infantile (1842, 114), Beecher dédie de nombreux passages à la santé de la famille et commence son ouvrage par un exposé dʼanatomie assorti de nombreuses gravures explicatives. Elle sʼoppose notamment aux excitants, «  boissons alcoolisées, thé, café, mixtures dʼopium  »499 (107) et préconise de boire de lʼeau, plutôt en dehors des repas. Dans cet ensemble vaste de préconisations dont je ne saurais faire ici la liste complète, la maîtresse de maison nʼest pas en reste, et Beecher consacre un développement assez long aux vêtements de travail qui ne doivent pas comprimer le corps de celle qui les porte (116) : corsets et robes trop serrées sont rejetés en bloc. Et si Dieu est le grand Architecte dont il ne faudrait trop contrarier les plans, Beecher cite tout de même (quoique de manière parfois évasive) les découvertes scientifiques récentes de son époque (125) pour justifier son propos.
Dans cet ensemble de recommandations autour de la santé, un conseil en particulier mʼarrête : il sʼagit de balayer les espaces de vie, ici encore en concordance avec cette préoccupation bien de son temps pour lʼair pur, débarrassé de ses miasmes. Dans le chapitre XI consacré à «  lʼexercice domestique  »500, Beecher prend en compte les critiques adressées au balayage, qui ferait respirer à celleux qui sʼy adonnent une quantité néfaste de poussière. Pour elle, le balayage fréquent permet de conserver une bonne qualité de lʼair ; aussi :
[…] la mère qui engagera des domestiques pour enlever cette tâche et dʼautres travaux domestiques qui assureraient à ses filles la santé, la grâce, la beauté et les vertus domestiques, et les jeunes filles qui acceptent dʼêtre privées de ces avantages, vivront probablement en pleurant la langueur, le découragement, la douleur et le chagrin qui accompagneront la mauvaise santé, comme un résultat presque inévitable501 (134).
Si Beecher refuse les corsets au profit dʼune forme naturellement féminine (quʼelle situe comme faisant partie du dessein divin), elle défend avec ferveur lʼexercice physique et plaide à cet égard en faveur dʼune absence de domestiques sur qui faire reposer lʼexécution des tâches. Jʼévoquais plus haut cette particularité du travail de lʼautrice : externaliser le travail domestique, en employant des personnes vouées à ce travail, et donc salariées, est vu principalement comme un mal. Beecher recommande de ne pas recourir à cette aide, même si elle semble aussi se résigner au fait que ces domestiques seront présent·es ; lorsquʼelle admet leur présence comme un état de fait, elle en parle comme de «  domestiques ignorant·es  »502 que la maîtresse de maison doit piloter (261). Beecher refuse cette aide professionnalisée, mais elle ne rejette nullement la professionnalisation et lʼexige plutôt de la maîtresse de maison. Son ouvrage vise ainsi à corriger le fait que les femmes ne soient pas assez formées à ce quʼelle décrit comme une lourde charge. Cʼest dʼailleurs un des mérites du travail de Beecher. En dépit de son conservatisme et de son sexisme, on peut lui reconnaître au moins cet apport : le travail domestique est reconnu comme ardu, et nécessitant des compétences spécifiques. Que les femmes soient destinées à cet emploi ne rend nullement lʼexécution «  naturelle  », laquelle doit faire lʼobjet dʼune formation.
Les femmes sont valorisées dans lʼœuvre de Catharine Beecher, puis des deux sÅ“urs du même nom. Marianna Janowicz pose que le travail de lʼautrice offre «  une image de la cuisine telle le cockpit dʼun vaisseau domestique  »503 (2021, 7). Cʼest en effet une image de contrôle total des opérations qui vient à lʼesprit en lisant les ouvrages de Beecher : santé, éducation des enfants, boissons, aliments, habitudes de vie (comme le fait de se lever tôt), bonnes manières, humeur de la femme au foyer, santé mentale, dons à la charité, soins faits aux malades, etc. Rien nʼest laissé au hasard. Le premier ouvrage ne consacre ainsi que quelques pages à lʼaménagement des lieux en tant que tel, et encore, sur la base du plan général de maisons. Beecher décline plusieurs propositions dʼaménagement intérieur (fig. 3.11.a & b) en prenant en compte les contraintes économiques.
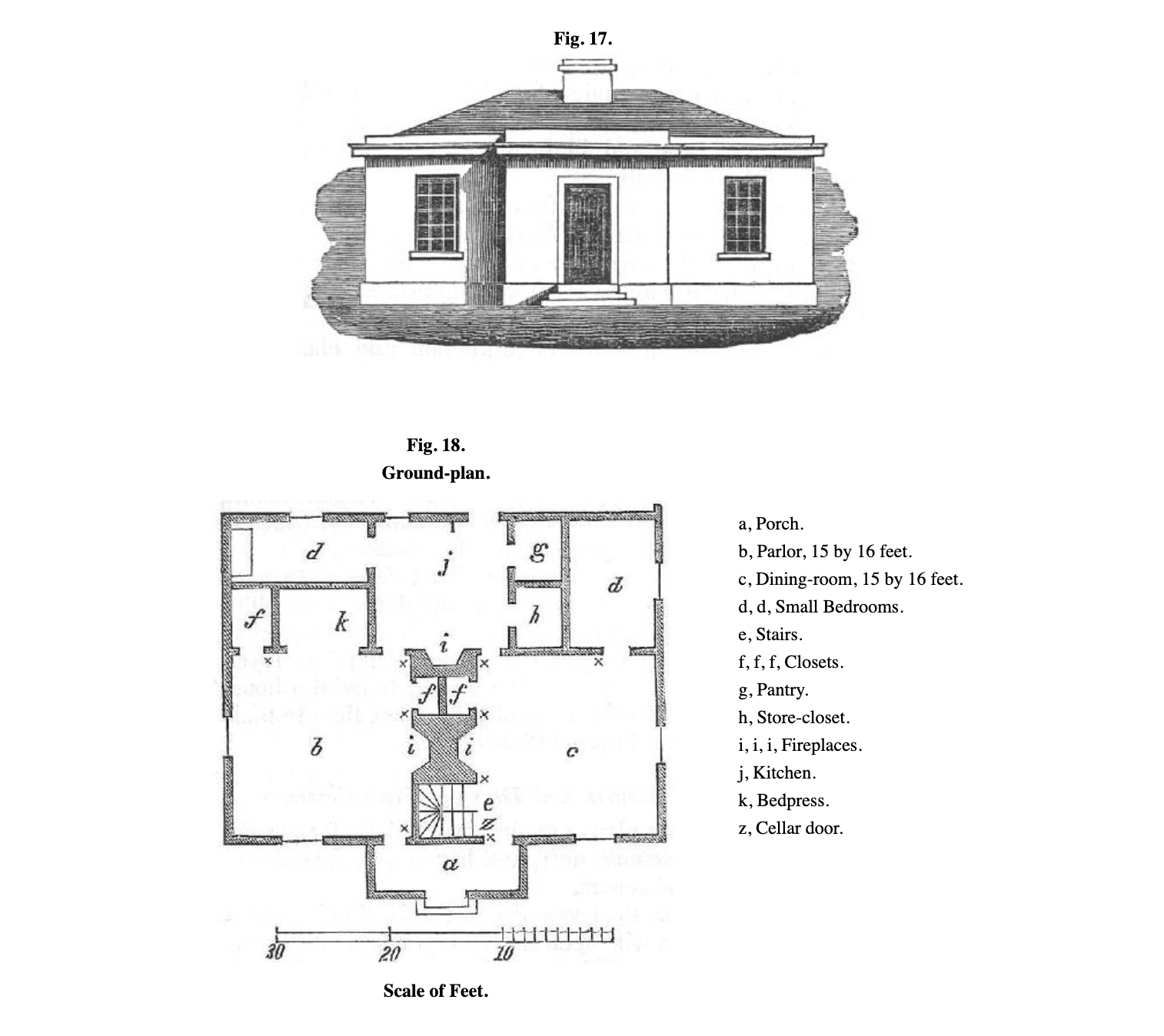
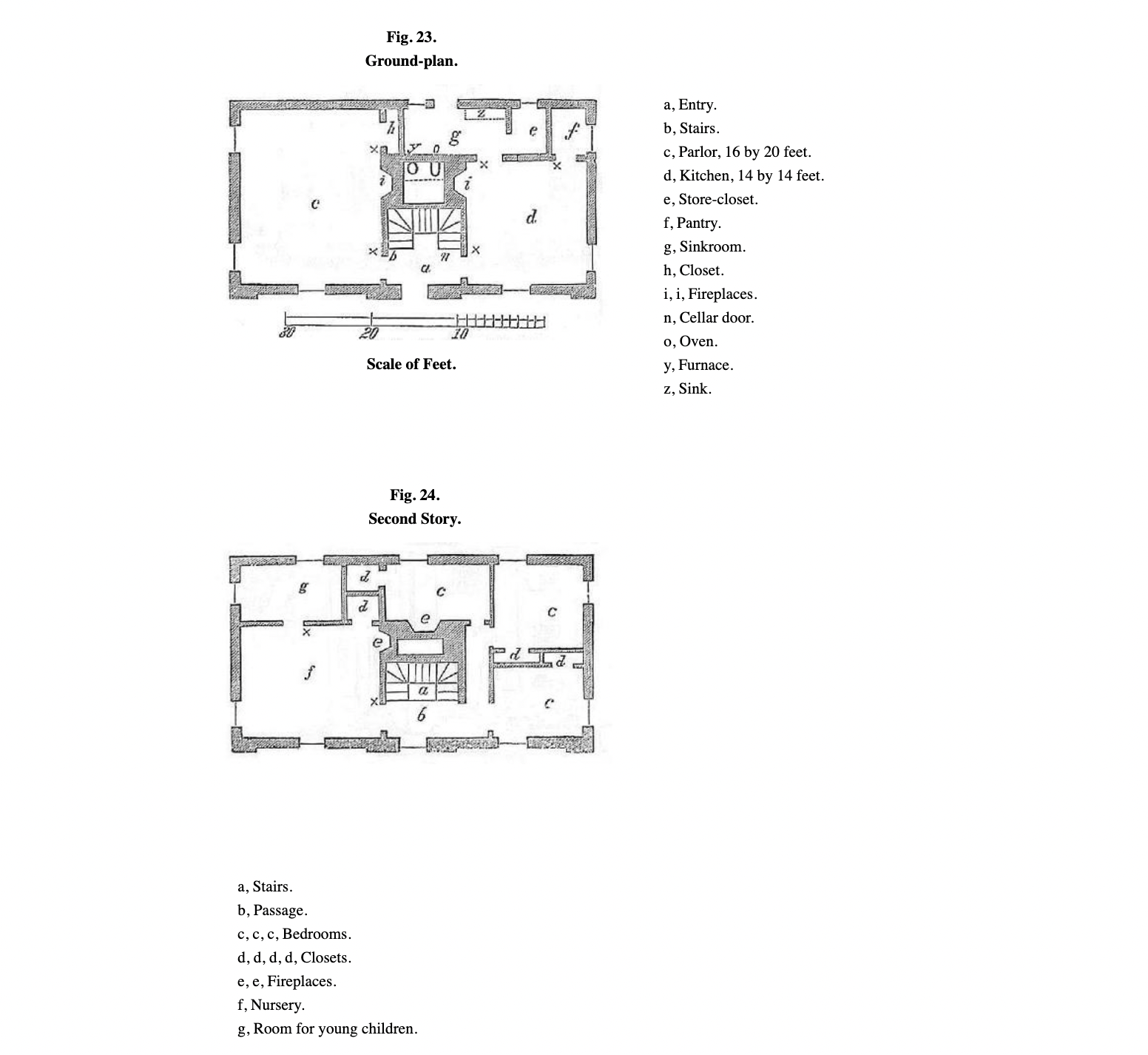
On ne sait pas exactement comment lʼespace de la cuisine est organisé, mais on voit déjà quʼil est central, articulé aux pièces de stockage de la nourriture (pantry), à des placards et à des chambres pour des domestiques. En effet, si Beecher recommande de sʼen passer, elle effectue pragmatiquement plusieurs hypothèses en fonction des arrangements familiaux, avec ou sans personnel de service. Dans une version sans domestiques (fig. 3.12.a), la cuisine occupe toujours une place centrale, et la taille générale de cette pièce est dʼenviron 4 pieds par 4 (soit 4,26m x 4,26m). Si ces 16 mètres carrés semblent un peu restreints, il faut aussi prendre en compte le fait que de nombreuses dépendances accompagnent la cuisine. En outre, on ne mange pas dans cette cuisine, puisquʼil existe un parlor et une eating room qui peuvent aussi être mobilisés au-delà des temps sociaux, par exemple pour le repassage. Mais ces quelques plans constituent une portion congrue de ce premier ouvrage, pour lʼessentiel composé de conseils, parfois des recettes et des recommandations au sujet des tâches en elles-mêmes.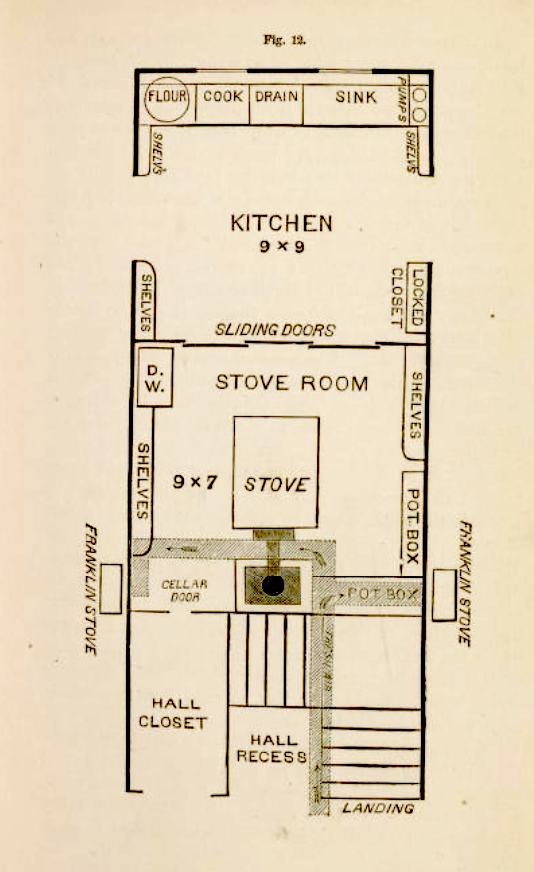 fig. 3.12.a : 1869 : dans ce nouvel ouvrage écrit avec sa sœur, Catharine Beecher propose une maison sans domestiques, tenue toute entière par la maîtresse de maison.
fig. 3.12.a : 1869 : dans ce nouvel ouvrage écrit avec sa sœur, Catharine Beecher propose une maison sans domestiques, tenue toute entière par la maîtresse de maison.
Lʼouvrage de 1869 comporte un plus grand nombre de planches illustrées et, cette fois, ce nʼest plus seulement lʼemplacement de la cuisine dans le plan général qui est proposé, mais bien le design des éléments qui la composent (fig. 3.12.b). Deux principes au moins sont nouveaux ici et méritent dʼêtre relevés : tout dʼabord, les Beecher proposent un plan de travail continu, au-dessous et au-dessus duquel sʼorganisent les rangements. Il y a donc une rupture de paradigme avec le modèle de la cuisine comme boîte vide, dans lequel des éléments de mobilier disparates sont agencés. Ce nʼest pas encore une cuisine équipée : il faudra pour cela que les étagères se transforment en placards, et surtout que les éléments au-dessus et au-dessous du plan de travail soient masqués. Mais le dispositif proposé par les Beecher fait bien figure de protocuisine équipée. Un deuxième principe, peut-être plus discret, tient à lʼusage de contenants spécifiques pour les divers ingrédients fondamentaux de la pratique culinaire. Ceux-ci ne sont pas laissés au hasard ou au caprice de la future maîtresse de maison : bien au contraire, leur quantité et leur taille semblent en lien direct avec le système général de la cuisine. Autrement dit, ce nouvel ouvrage sort de la distance du plan et de son point de vue surplombant, pour offrir, avec sa vue à hauteur de femme, un lien entre lʼéchelle macro (la cuisine, dans la maison, ses murs, ses ouvertures) et micro (les contenants de farine, de sucre, etc.). En cela, la proposition des Beecher peut être considérée comme une proposition de design (Midal 2009, 20), même si son autrice ne sʼen revendique pas -—la discipline, sous ce nom, nʼen est encore quʼà ses balbutiements à cette époque.
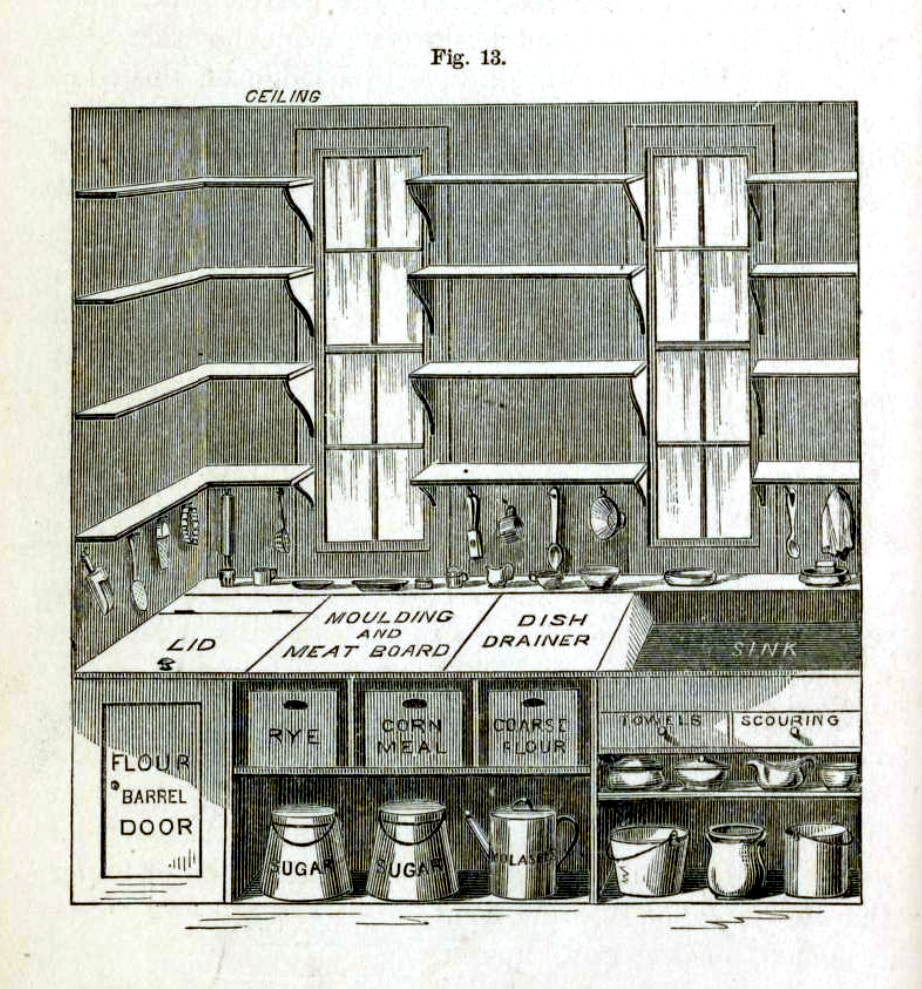
Toutefois, chez les Beecher, la proposition dʼaménagement nʼest pas «  nue  »Â : elle repose sur un ensemble de valeurs plutôt constantes entre la publication de Catharine de 1842, et celle, commune aux deux sÅ“urs, de 1869. Un nouveau chapitre sur les servant·es confirme le dédain des deux autrices pour cette classe de personnes une nouvelle fois désignées comme «  ignorant·es  » dans le sommaire de lʼouvrage. Elles reconnaissent à nouveau la nécessité dʼy recourir, mais rappellent que les bon·nes servant·es sont «  façonné·es par la patience et lʼentraînement  »504 (1869, 315). Ce travail de formation est bien entendu la prérogative de la maîtresse de maison. On observe aussi une forme de continuité entre les valeurs défendues et les recommandations faites à la femme au foyer -—désignée en 1869 comme «  chief minister  », ce qui poussera Dolores Hayden à nommer la figure défendue par les sÅ“urs Beecher «  home minister  », soit pasteure plutôt que ministre. En effet, les valeurs religieuses transpirent dans les conseils donnés. D. Hayden retient «  lʼauto-sacrifice  » et «  lʼisolement domestique  »505 comme les deux aspects principaux de lʼêtre au monde féminin promu par les Beecher (1982, 55). Cette dimension sacrificielle du rôle de la femme au foyer, jugée supérieure par les Beecher, viendrait dʼune disposition au sacrifice dont les femmes seraient pourvues. Des évolutions sont également notoires dʼun ouvrage à lʼautre, en dépit de cette constance des valeurs défendues. Le sujet du nombre de pas, qui sera central dans les futurs développements tayloristes de la science ménagère, sont absents en 1842 mais en 1869, il devient pertinent de les économiser. Aussi le terme de «  laboratoire  », témoin de la scientifisation de la pratique culinaire et domestique, fait-il son apparition dans le second ouvrage. La question de la différence des sexes, si elle reste marquée par le sexisme, semble posée de manière différente dans les deux ouvrages. Dans le premier, Catharine Beecher se livre à de longs développements pointant les limites de lʼidéal démocratique américain : si tout le monde est égal, dit-elle, les désaccords ne peuvent se régler que par la force brute, alors que des hiérarchies claires pourraient prévenir ce genre de désagrément (1842, 140). Et de donner ainsi quelques exemples de rapports de domination qui devraient être maintenus, dont celle de «  lʼhomme vigoureux  » sur «  le sexe plus faible  »506 (141). Plus loin, elle juge les discussions sur lʼégalité des sexes «  frivoles  » et «  inutiles  »507 (155), mais cʼest aussi pour mieux rappeler la valeur des tâches dites féminines :
Cʼest assurément une idée pernicieuse et erronée que de croire que les devoirs qui sollicitent lʼesprit dʼune femme sont mesquins, insignifiants ou indignes du plus haut degré dʼintelligence et de valeur morale. Au lieu dʼaccepter ce sentiment, chaque femme devrait sʼimprégner, dès son plus jeune âge, de lʼimpression quʼelle sʼentraîne à accomplir les tâches les plus importantes, les plus difficiles, les plus sacrées et les plus intéressantes qui puissent mobiliser lʼintellect le plus élevé508 (158).
Il faut donc considérer les tâches dʼune femme comme de la plus haute importance, et, à lire Beecher, cette importance vaut bien celle des tâches qui incombent aux hommes ; toutefois, de telles observations sʼinscrivent dans un maintien de la hiérarchie homme-femme telle quʼelle est prescrite par la religion. En 1869, le propos se fait un peu plus mesuré, et les deux sÅ“urs évoquent la Womenʼs Right Convention (Convention sur les droits des femmes) dont la première édition a lieu en 1848 à Seneca Falls. Cʼest dʼailleurs lors de cette convention que trois ans plus tard, en 1851, dans le Massachusetts, Sojourner Truth tient son célèbre discours «  Ainʼt I a Woman  » (Davis 2019[1981], 52–53). Les Beecher doivent donc composer avec un féminisme émergent plus radical que le leur -—si toutefois on accepte de reconnaître une dimension féministe à leur travail. En 1842, Catharine est très claire au sujet de lʼattitude quʼil convient dʼadopter pour une femme :
Une femme peut décider que, quoi quʼil arrive, elle ne parlera pas jusquʼà ce quʼelle puisse le faire dʼune manière calme et douce. Le silence parfait est un sà »r recours, lorsque lʼon ne parvient pas à maîtriser la situation de manière à pouvoir parler calmement ; et cette détermination, si lʼon y persévère, sera finalement couronnée de succès509 (1842, 152).
On est ici très proche de lʼAnge de Patmore : le poète dira, quelques années plus tard, au sujet de son épouse modèle :
Dans son esprit et ses manières, quʼelle est discrète !
Comme elle nʼa pas dʼart dans son art même ;
Comme elle est franche dans son discours, comme il est doux
Lʼaccord de ses lèvres et de son cœur[^sq] (1858, 49)
Lʼaccord des lèvres et du cœur, on lʼaura compris, permet à lʼépouse de sʼexprimer, mais selon des paramètres assez restreints, notamment une injonction à la discrétion qui invite ni plus ni moins au silence. En 1869, les Beecher, dont les multiples publications montrent bien que, pour leur part, elles ne sʼen tiennent pas au silence ; témoins des Womenʼs Right Convention et de la parole quʼelles rendent audible, elles écrivent :
[si la femme] est une oratrice née, comme Mademoiselle Dickinson, ou une astronome, comme Madame Somerville, ou une chanteuse, comme Grisi, ne laissons pas les règles techniques de la féminité se placer au travers dʼun usage libre de ses capacités  »510 (1869, 316–17).
Cette phrase ouvre toutefois une porte bien vite refermée car :
[…] il y a eu beaucoup de discussions grossières et désagréables dans ces conventions, et une trop grande tendance de lʼépoque à rendre lʼéducation de la femme anti-domestique511.
Autrement dit, les femmes sont puissantes, possèdent des qualités qui leur sont délivrées par Dieu et dont elles seraient bien inspirées de faire usage ; toutefois, le principe régulateur reste toujours la mission domestique, qui prime sur toute forme dʼautonomie ou dʼinventivité. Le travail des Beecher apporte donc des innovations sur le plan de la conception, tout en maintenant un programme conservateur, même pour leur temps. Ce que les femmes gagnent en reconnaissance, elles le perdent en autonomie, précisément parce que la possession de certaines qualités, vues comme un don divin, implique quʼelles suivent lʼinclination dont elles héritent. Les textes des Beecher sont profondément contradictoires et témoignent sans doute des contorsions pratiquées par les autrices pour conserver une forme de cohérence dans leur propos. Un dernier exemple permet de sʼen convaincre. Je disais plus tôt que les vêtements de la femme au foyer se doivent dʼêtre confortables pour Catharine Beecher qui, en 1842, souligne la nécessité de les mettre à lʼépreuve en sʼasseyant, pour veiller à ce quʼils ne soient trop compressifs (117). Le corset ne trouve pas plus grâce aux yeux des sÅ“urs Beecher en 1869 ; mais une concession est faite à lʼapparence que produit cet accessoire, et des dessins sont même proposés pour «  préserver les avantages du corset sans ses avanies  »512 (1869, 164). Faut-il comprendre que la silhouette naturellement féminine ordonnée par le Divin doit sʼaffiner ? Ce nʼest ici quʼun exemple de ces négociations internes auxquelles se livrent les autrices, qui, tout en défendant santé, pureté morale et devoir féminin, fabriquent déjà quelques-unes de ces injonctions contradictoires qui seront critiquées par les féministes de la seconde vague, un petit siècle plus tard. Reste, pour les designers, cette protocuisine pensée pour économiser les pas et soulager la ménagère, qui aura une fortune culturelle considérable, comme je vais le montrer à présent.
Si les Beecher présentent un idéal que lʼon ne dira féministe quʼavec beaucoup de précaution et de nuance, leur proposition, tout en mettant la femme au foyer au centre, propose un partage des tâches qui nʼest pas totalement opposé aux expérimentations socialistes que Dolores Hayden a documentées dans son travail de recherche et que nous avons exposées dans le second chapitre de ce texte. Toutefois, le modèle des Beecher, en faisant école et en étant reformulé, tend à se séculariser et à sʼindividualiser en perdant ses dimensions morales et collaboratives. La figure victorienne de la femme au foyer sacrificielle change tellement que «  lʼéconomie domestique  » revendiquée par les Beecher se transforme en science ménagère. Toutefois, cette transformation ne fait pas des femmes des scientifiques, quand bien même la comparaison de la cuisine avec le laboratoire se renforce au point de devenir un motif récurrent. Au contraire, cette mutation solidifie la position de certain·es expert·es, mais assigne les lectrices (réelles ou imaginaires) de ces guides à une position passive de consommatrice. Cʼest le principal reproche que formule Dolores Hayden à Christine Frederick et Lillian Gilbreth : en développant lʼéconomie domestique avec des valeurs rationalistes et scientifiques (voire scientistes), elles auraient trahi les femmes, et les auraient cantonnées au rôle de consommatrices (Hayden 1985, 285). Je vais examiner les apports de ces deux autrices, sur le plan de la conception et du design. Lʼusagère supposée, on lʼa vu, nʼest pas toujours lʼusagère effective : aussi, il convient dʼanalyser tant la proposition spatiale que le discours sans trop séparer les idéologies des créations quʼelles entourent.
Catharine Beecher, avant de publier ses guides, a tenté dʼenseigner dans des écoles, mais ces tentatives nʼont guère été fructueuses (Dreilinger 2021, 14–15). Pourtant, alors que les sÅ“urs Beecher publient leur ouvrage co-écrit, des universités dédiées aux femmes, aux personnes racisées et indigènes ouvrent aux États-Unis en intégrant pleinement le biais selon lequel ces populations, inférieures en capacités aux hommes blancs, doivent suivre des curriculums spécifiques. La journaliste Danielle Dreilinger, dans son histoire de lʼéconomie domestique, mentionne ainsi lʼouverture dʼun Womenʼs Labor Department au Hampton Institute en 1868, puis le développement de cours spécifiques les années suivantes en Iowa (1871), au Kansas (1873) et en Illinois (1874). Ces départements ou séries de cours se greffent souvent sur des parcours existants, spécialisés en agriculture ; ils sont le résultat de lʼactivisme de femmes (par exemple Margaret Murray Washington) qui en se rendant aux conférences nationales sur lʼagriculture observent que les épouses des agriculteurs dont il est question sont (encore !) les grandes oubliées des programmes de valorisation (Dreilinger 2021, 26–27). La conférence de 1899 à Lake Placid (dans lʼÉtat de New York) représente également un tournant important. Elle réunit dix femmes et un homme513 qui, ensemble, constituent la discipline de lʼéconomie domestique (renommée «  home economics  ») et inaugurent un cycle de conférences qui durera dix ans (Hayes 2010, 42). Ce groupe dʼindividus veut mieux définir cette discipline et, surtout, lui donner une importance équivalente à dʼautres domaines scientifiques (Dreilinger 2021, 27–28). Concernant ces évolutions, Danielle Dreilinger pointe une contradiction interne que jʼai déjà relevée en commentant les écrits des Beecher : faut-il défendre ces projets, qui ont valorisé le travail domestique, et donc le travail des femmes et des personnes racisées, ou, au contraire, critiquer lʼassignation permanente de ces groupes de tâches à des populations minorisées ?
Si de nombreux guides continuent dʼapparaître à cette époque, tous ne proposent pas des arrangements originaux. Danielle Dreilinger parle de la brochure Work for the Colored Women of the South (1894 ; Dreilinger 2021, 16–17 ; fig. 3.13)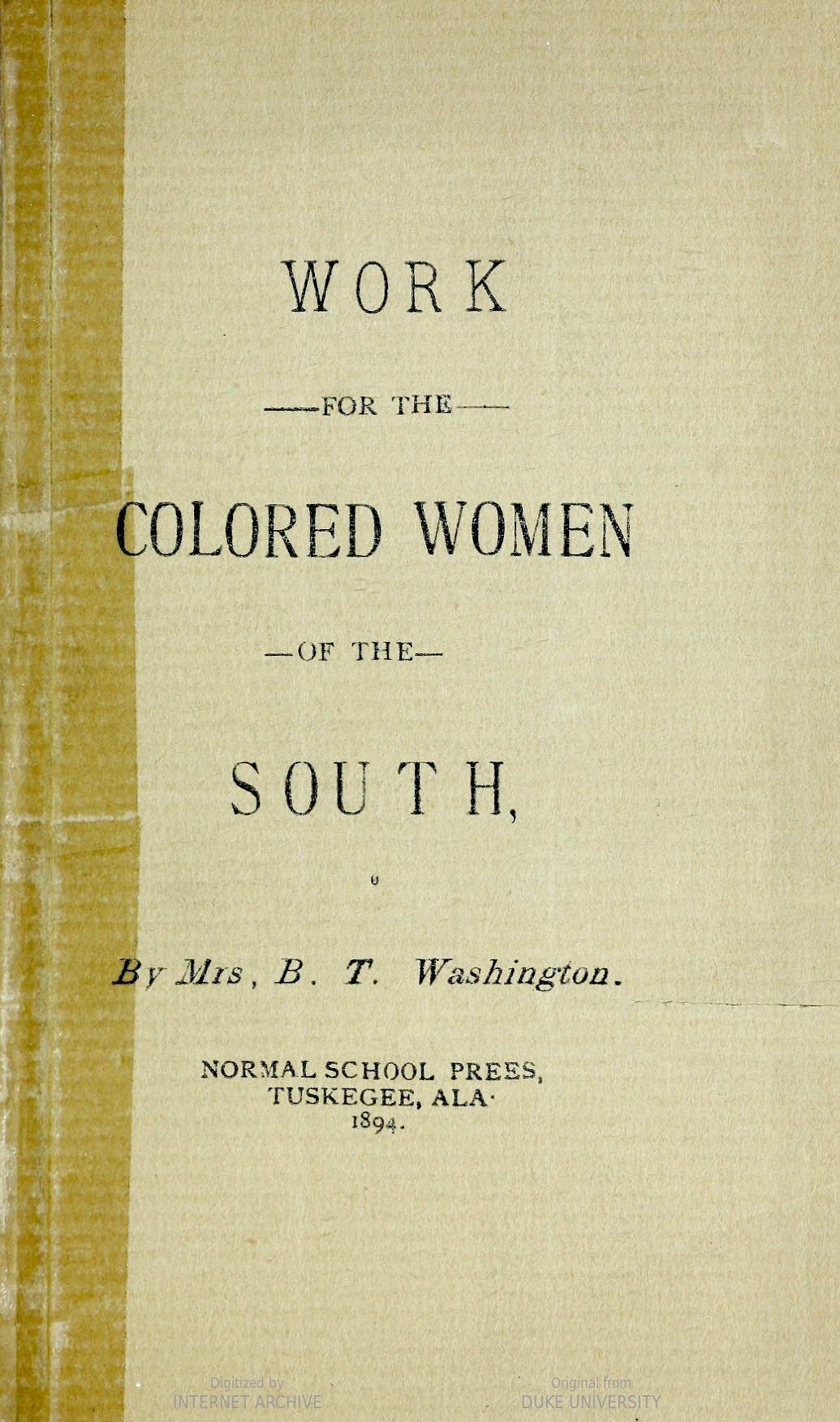 fig. 3.13 : Couverture de l’ouvrage Work for the Colored Woman of the South de Margaret James Murray, 1894. qui mérite dʼêtre mentionnée ici parce quʼelle ne présuppose pas, au contraire de nombreuses autres publications, une lectrice blanche et bourgeoise. On retrouve finalement dans ce texte les habituelles catégories : liste des aliments et de leurs propriétés, chapitre sur lʼéducation des enfants et bien sà »r, lʼinévitable développement sur la ventilation, bien que cet ouvrage ne comporte pas de planches qui permettraient de visualiser la cuisine imaginée pour ces travaux. Pour autant, la fin du XIXe et le début du XXe siècle confirment la centralité des questions domestiques dans le débat public et les imaginaires occidentaux.
fig. 3.13 : Couverture de l’ouvrage Work for the Colored Woman of the South de Margaret James Murray, 1894. qui mérite dʼêtre mentionnée ici parce quʼelle ne présuppose pas, au contraire de nombreuses autres publications, une lectrice blanche et bourgeoise. On retrouve finalement dans ce texte les habituelles catégories : liste des aliments et de leurs propriétés, chapitre sur lʼéducation des enfants et bien sà »r, lʼinévitable développement sur la ventilation, bien que cet ouvrage ne comporte pas de planches qui permettraient de visualiser la cuisine imaginée pour ces travaux. Pour autant, la fin du XIXe et le début du XXe siècle confirment la centralité des questions domestiques dans le débat public et les imaginaires occidentaux. fig. 3.14 : Couverture de la revue Ladies Home Journal de 1912 où publie Christine Frederick. En 1908, Ellen Richards, une des membres fondatrices de la conférence de Lake Placid forme avec ses collègues la American Home Economics Association (Dreilinger 2021, 39) et en 1918, Christine Frederick publie The New Housekeeping, Efficiency Studies in Home Management (des textes initialement publiés dans une rubrique du Ladies Home Journal en 1912 ; fig. 3.14, 2 illustrations), et amorce ainsi des années de travail dont les résultats connaîtront une grande fortune critique, notamment en Europe (Clarisse 2004, 61).
fig. 3.14 : Couverture de la revue Ladies Home Journal de 1912 où publie Christine Frederick. En 1908, Ellen Richards, une des membres fondatrices de la conférence de Lake Placid forme avec ses collègues la American Home Economics Association (Dreilinger 2021, 39) et en 1918, Christine Frederick publie The New Housekeeping, Efficiency Studies in Home Management (des textes initialement publiés dans une rubrique du Ladies Home Journal en 1912 ; fig. 3.14, 2 illustrations), et amorce ainsi des années de travail dont les résultats connaîtront une grande fortune critique, notamment en Europe (Clarisse 2004, 61).
Christine Frederick introduit le premier chapitre de son ouvrage («  Lʼefficience et le nouveau travail domestique  »514) par un récit où elle raconte quʼelle est en train de coudre lorsquʼelle surprend une conversation entre son mari et un certain Mr. Watson. Elle interrompt le propos de ce dernier, interpellée par son évocation de «  lʼefficience »515 appliquée au travail en usine. Elle se présente comme une ingénue, dʼabord un peu sceptique face à lʼévocation de cette solution miracle, mais Mr. Watson lui explique le lien quʼil perçoit entre efficience et travail féminin :
Il nʼy a pas de plus vieux dicton que ‹ le travail dʼune femme nʼest jamais fini ›. Si des principes dʼefficacité peuvent être appliqués avec succès dans tous les types dʼateliers, dʼusines et dʼentreprises, pourquoi ne pourraient-ils pas être appliqués dans la maison ?516 (1913, 7)
À ce sujet, Frederick a une réponse immédiate :
[…] dans une usine, les ouvriers ne font quʼune seule chose, comme coudre des chaussures ou découper des enveloppes, et il est facile de standardiser un ensemble dʼopérations. Mais dans un foyer, il y a des dizaines, oui, des centaines de tâches qui exigent des connaissances et des gestes totalement différents. Il y a le repassage, lʼépoussetage, la cuisine, la couture, la pâtisserie et les soins aux enfants. Il nʼy a pas deux tâches qui se ressemblent517 (1913, 7).
Frederick propose à la suite de cette introduction un développement sur la femme de classe moyenne : pour les classes supérieures, repenser le travail est selon elle inutile puisquʼil peut être délégué. Dès 1912, alors quʼelle écrit pour le Ladies Home Journal, Frederick ouvre chez elle, dans sa maison de campagne, une station de travail pilote destinée à des tests, la Applecroft Home Experiment Station (fig. 3.15).

Le seizième chapitre de The New Housekeeping lui est consacré. Elle défend ainsi lʼidée dʼun espace dʼexpérimentation :
Les médecins ont leurs cliniques, les agriculteurs leurs stations dʼexpérimentation et les chimistes leurs laboratoires, et il semblait tout à fait naturel que les femmes disposent dʼun lieu spécialement consacré à la résolution des problèmes de la maison518 (1913, 249).
Alors que la place des femmes en cuisine nʼest pas contestée, une définition de «  femme  » est produite par le guide qui leur recommande des attitudes spatiales. Dans un tel propos, «  femme  » nʼest pas seulement un donné biologique mais quasiment un métier. On retrouve ici une posture assez proche de celle de Beecher : il sʼagit de revendiquer lʼimportance des travaux féminins, de les élever au rang de nʼimporte quel labeur masculin. Et effectivement, Christine Frederick analyse avec une immense précision le travail en cuisine. Elle décrit, il est vrai, ses propres gestes ; mais elle le fait avec un sens du détail très développé, listant par exemple chaque étape qui permet à une femme de faire la vaisselle (1913, 23–25). Quʼelle utilise sa propre expérience comme référence ne lʼempêche pas de projeter une diversité dʼutilisatrices : elle affirme ainsi avoir effectué des tests avec des femmes de tailles différentes, puis matérialise ses résultats dans un tableau qui fait correspondre à chaque jeu de mensurations une hauteur de plan de travail adéquate (26–27). Elle tient aussi compte du fait que ses usagères puissent être gauchères (52).
Lʼanalyse des gestes par Frederick va donc se matérialiser en une proposition globale. Frederick veut que sa «  Cuisine Efficiente  »519 (1918, 253) soit accessible aux «  petits revenus  »520 (250). Pour cette raison, elle pense un dispositif qui nʼest pas raccordé à lʼélectricité. Elle reconnaît pourtant que lʼélectricité est «  la meilleure servante artificielle des temps modernes  »521, mais elle renonce à y recourir en raison du coà »t de cette source dʼénergie (79). Certes, Michael Faraday a depuis longtemps (1862) sillonné les villes anglaises pour faire la démonstration de son dispositif de raccordement électrique (Giedion 1948, 542) et une cuisine équipée à lʼélectricité était également visible à la World Fair de Chicago en 1893 (Giedion 1948, 543), mais comme Siegfried Giedion nous le rappelle, ces dispositifs furent accueillis avec un peu de réticence, tandis quʼun de leurs représentants vantait un supposé «  goà »t électrique  »522 des aliments préparés avec cette technique523 (542).
En résumé, le recours à lʼélectricité est possible dans les années 1910, mais sa pénétration des habitudes domestiques est encore limitée, au point quʼune autrice comme Frederick puisse imaginer sʼen passer. La théoricienne estime aussi que les cuisines des campagnes posent plus de problèmes que les cuisines des villes, si bien quʼelle concentre son attention sur les premières. Finalement, elle propose une cuisine de 12 par 14 pieds, soit trois fois la surface proposée dans un dessin de Beecher -—sachant que cette cuisine inclut des fonctions que Beecher tenait encore à lʼécart, comme le stockage des aliments, qui tend à cette époque à sortir du garde-manger (pantry) pour investir la cuisine. Frederick présente, ici encore, son projet avec concision : elle insiste sur la présence de fenêtres, bien quʼil ne soit plus seulement question de ventilation mais aussi de lumière et dʼune «  vue en profondeur  »524 qui permet à la travailleuse en cuisine de se reposer les yeux (251). Enfin, elle détaille également lʼhabillage des surfaces : un papier peint lavable pour les murs, et un linoléum au sol, lui aussi choisi pour des raisons économiques (252).
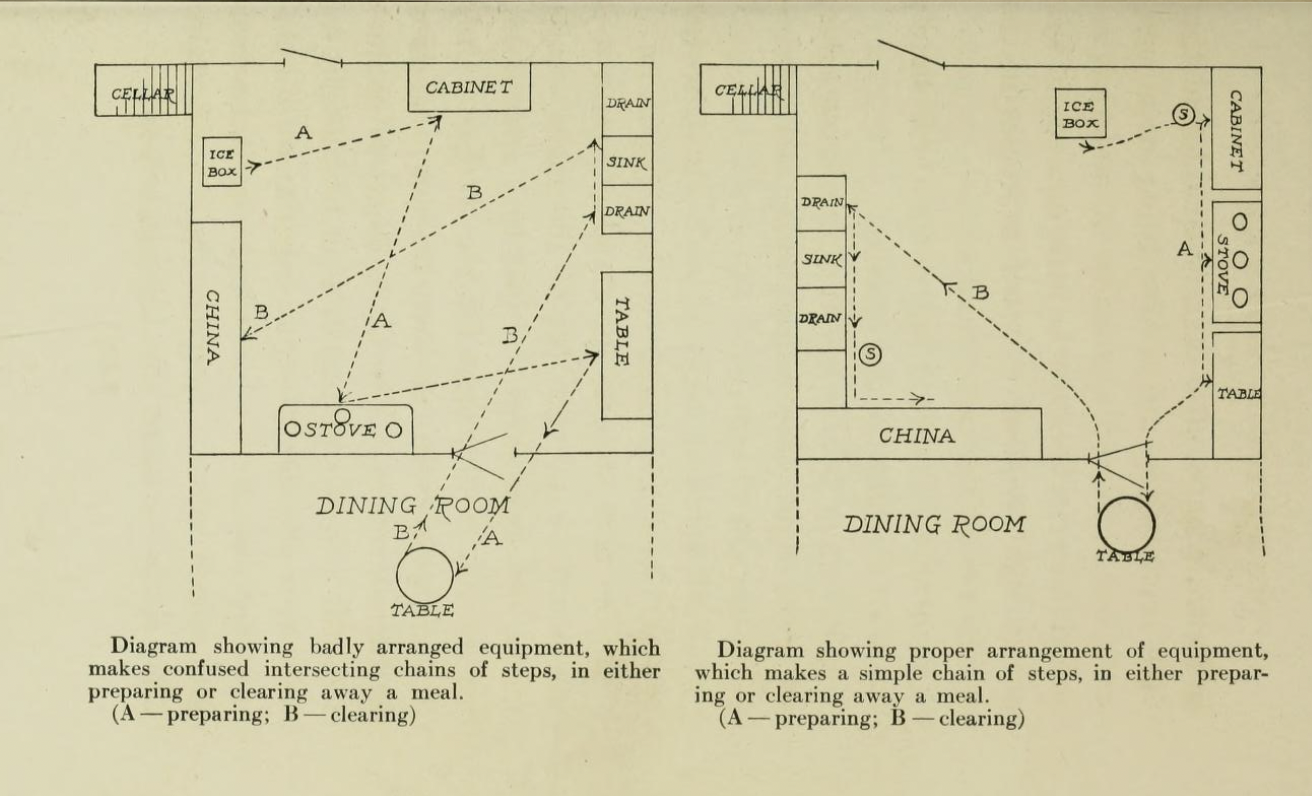
Ces choix dʼéquipements sʼaccompagnent de deux schémas525 disposés lʼun à côté de lʼautre, pour comparaison (fig. 16 ; 1913, 53) : lʼun décrit «  lʼéquipement mal disposé  » et lʼautre présente en contrepoint un arrangement considéré comme préférable. Sur ces deux dessins sont représentés en pointillés les pas de la ménagère. Sur le premier, les déplacements sont nombreux et enchevêtrés pour former dʼinutiles zigzags, tandis que le second présente une chaîne de travail repensée, qui permet de minimiser les mouvements. Frederick a en effet à cÅ“ur de structurer le travail culinaire. Aussi ses descriptions ne visent-elles pas seulement à étayer une entreprise descriptive mais également à former des taxinomies. Cette pulsion classificatrice incarne son projet de management scientifique appliqué à lʼespace domestique et la différencie de Catharine Beecher. Les dimensions éthiques et morales semblent évacuées pour laisser place à un ensemble de conseils très pragmatiques. Ainsi, Frederick décrit de véritables chaînes dʼobjets qui sont reliés par lʼactivité de la ménagère. Chaque objet retient aussi son attention car il sʼagit bien de «  standardiser de façon plus précise nʼimporte quelle tâche du logis  »526 (257). Elle articule des ensembles comme la chaîne glacière (icebox) – placard – feux de cuisson, ou celle qui associe table à découper, vide-ordures et lave-vaisselle (253). Jʼemploie ici le terme de «  chaîne  » à dessein, mais Frederick parle seulement de «  groupe  » ou parfois de «  direction  »527.
Christine Frederick revendique en effet pleinement le lien entre cuisine et usine, et se réfère à la science tayloriste dont les enseignements se répandent alors. En 1911, le consultant Frederick Winslow Taylor publie The Principles of Scientific Management, un ouvrage qui connaîtra un immense succès et une influence considérable sur lʼorganisation du travail dans lʼindustrie. Frederick appartient à une génération de femmes (avec Lillian Gilbreth, que jʼévoquerai ci-après) qui sʼemparent de ces enseignements et procèdent à un transfert dʼidées de lʼusine vers la sphère domestique. Elle écrit ainsi  :
La même idée que celle appliquée aujourdʼhui à lʼagencement des usines – le déplacement du travail dans une seule direction, processus après processus, avec le moins de mouvements parasites possible – a été appliquée à lʼagencement de la Cuisine de lʼEfficience528 (1913, 253).
Elle cite finalement assez peu Taylor dont le nom nʼapparaît que deux fois dans The New Housekeeping. La première fois, il est cité dans lʼanecdote introductive qui montre Christine Frederick conversant avec Mr. Watson. Cʼest ce dernier qui évoque les travaux de Taylor ainsi que ceux de Harrington Emerson, un consultant alors concurrent de Taylor et auteur des «  douze principes de lʼefficacité  »529, un article publié dans Engineering Magazine en 1912. La seconde fois où le nom de Taylor apparaît dans lʼouvrage est un peu plus surprenante : Frederick ne convoque pas lʼingénieur pour informer sa démarche de rationalisation, mais pour tenir un propos progressiste relatif à la rémunération des employés, car, si la ménagère est traitée comme une ouvrière, il nʼéchappe pas à Frederick que la comparaison est plus pertinente entre lʼouvrier·e et les servant·es salarié·es. Elle défend ainsi lʼidée dʼun salaire journalier complété par des «  bonus  »â€¯; cette prime vise à augmenter lʼefficience (toujours elle) de lʼouvrier·e. Cependant, lʼimprégnation de Frederick par les idées rationnelles, sinon rationalistes, liées au management du travail apparaît plus nettement dans ses publications ultérieures. Dans Household Engineering; Scientific Management In The Home, publié en 1923, le ton est donné dès le titre de lʼouvrage ; et ce nʼest nul autre que Harrington Emerson qui en signe lʼavant-propos (suivi de Frank B. Gilbreth, époux de Lillian Gilbreth). Elle ne le cite pas directement dans le texte, mais ses douze principes sont repris à lʼidentique et appliqués au propos de Frederick, soit :
1. Des idéaux. 2. Du bon sens.
3. Des conseillers compétents. 4. Des opérations normalisées.
5. Des conditions normalisées. 6. Des pratiques standardisées.
7. Expédition. 8. Ordonnancement.
9. Fiabilité des dossiers. 10. Discipline.
11. Accord équitable. 12. Récompense de lʼefficacité530 (1923, 9).
Ce transfert de paradigme de lʼusine au foyer génère un certain nombre de contradictions. Frederick en est dʼune certaine manière consciente, puisque, dans sa conversation avec Mr. Watson, elle présente justement des différences entre ces deux espaces et les types de labeur quʼils impliquent. Il est vrai que cela nʼempêchera nullement Frederick de persister dans cette voie. Dolores Hayden est très critique avec le travail de Frederick : pour elle, la mutation dʼun programme de travail en plan de consommation constitue «  la corruption finale de lʼéconomie domestique  »531 (1982, 285), et, si The New Housekeeping nʼest pas aussi clairement tourné vers cette consommation que ses ouvrages ultérieurs, les germes dʼune telle orientation existaient très tôt chez Frederick. En effet, avant même le livre de 1913, Frederick écrit dès 1915 un ouvrage dʼéconomie domestique encore marqué par lʼesprit du livre de recettes : Meals That Cook Themselves and Cut the Costs (Des repas qui se cuisinent tout seuls et réduisent les coà »ts). Dans cet ouvrage, le chapitre IV est intégralement consacré à une méthode de cuisson incarnée par les plaques de cuisson automatiques Sentinel532. Ce chapitre, dans son approche et sa rhétorique, évoque les publicommuniqués contemporains. Il ne sʼagit plus de prescrire des gestes, mais dʼorienter la lectrice vers le produit de consommation qui les autorise. En ce sens, la critique de D. Hayden est juste. Elle porte sur deux aspects : la contradiction interne qui rapproche foyer et usine et lʼidéologie qui sous-tend cette comparaison. D. Hayden écrit :
Alors quʼil sʼagissait dʼune impossibilité logique, puisque le management scientifique exigeait la spécialisation et la division du travail, et que lʼessence du travail domestique privé était son caractère isolé et non spécialisé, Frederick et Gilbreth ont néanmoins créé des ensembles surréalistes de procédures par lesquelles la femme au foyer ‹ gèrait ›, son propre travail ‹ scientifiquement ›, en servant de cadre et dʼouvrière simultanément533 (1982, 285).
Cette proximité avec la consommation, et plus précisément la chaîne de vente, est aussi lisible dans The New Housekeeping. Dans ces pages, Frederick évoque une fonction de la station de test Applecroft qui outrepasse la seule dimension de laboratoire. Pour elle, la station devient une sorte de «  centre dʼéchange  »534 entre les fabricants et la ménagère, voire, elle permet aux fabricants de tester la validité de leurs produits (1913, 257–258 ; Midal 2009, 27). Le statut de la station Applecroft est donc ambivalent, entre dispositif de test destiné à améliorer la conception et dispositif de démonstration visant à séduire une acheteuse. Bien sà »r, la frontière est de toute façon poreuse : le design ne vise pas nécessairement à concevoir des dispositifs hors du circuit de la consommation, et la relation à lʼindustrie et à la vente fait partie de son histoire. Mais entre lʼorientation de Beecher et celle de Frederick, un écart existe : il sʼagit de prescrire les bons gestes et les bonnes attitudes plutôt que dʼy donner accès par un acte dʼachat.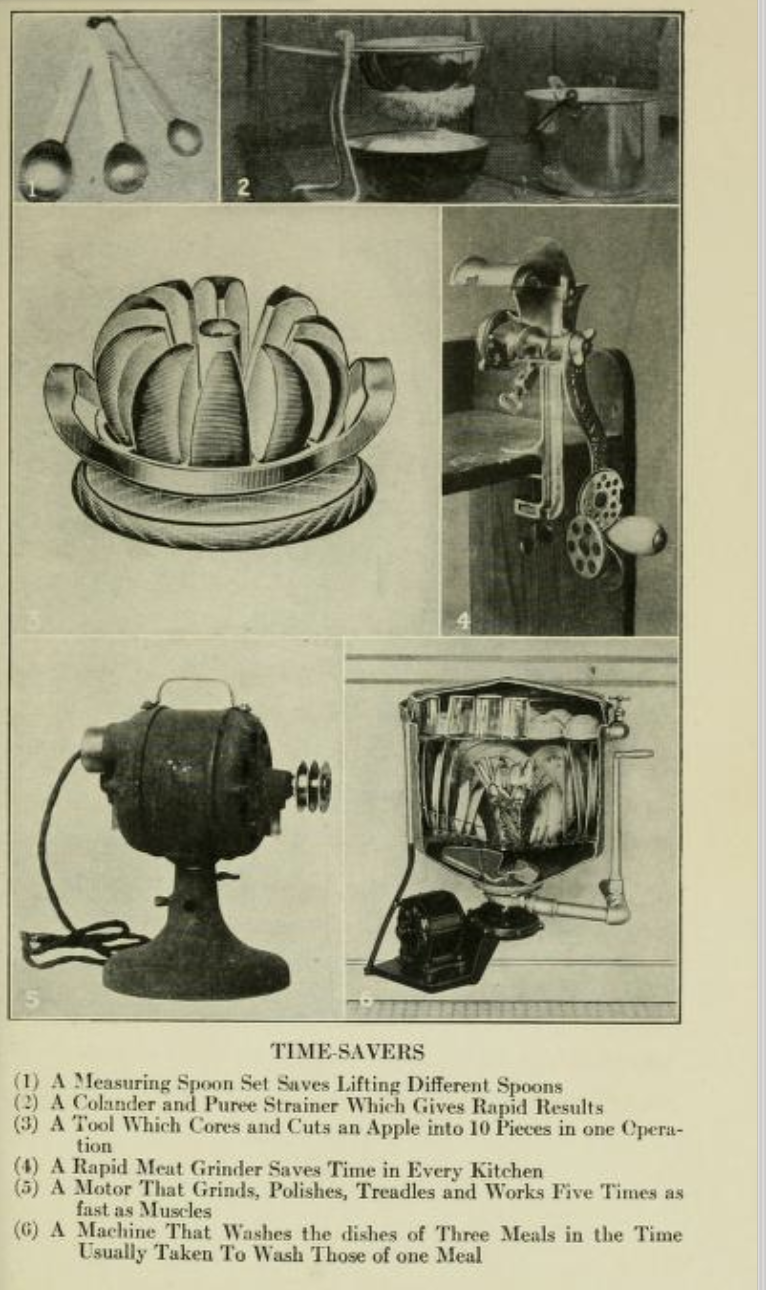 fig. 3.17 : Les planches thématiques classant les fuel savers (économiseurs d’énergie), time savers (économiseurs de temps), etc. p. 63 de The New Housekeeping de Christine Frederick. Source : archive
fig. 3.17 : Les planches thématiques classant les fuel savers (économiseurs d’énergie), time savers (économiseurs de temps), etc. p. 63 de The New Housekeeping de Christine Frederick. Source : archive
Il est possible de nuancer cette critique adressée à Frederick en liant cette attitude de consommation à une disposition générale à lʼéconomie -—dans le sens second dʼune réduction de dépense535. Cʼest un des points les plus saillants de The New Housekeeping : quʼil sʼagisse de carburant, de pas, de temps, voire de «  vitalité  » (1918, 19), le maître-mot est lʼéconomie de moyens. Paradoxalement, ce sont des objets, et donc une dépense dʼargent pour leur achat, qui vont rendre cette économie possible. En 1913, cette contradiction interne nʼéchappe pas à lʼautrice qui affirme quʼune «  partie de lʼéquipement est assez chère, mais [quʼelle sʼ]emploie à le tester pour voir si le travail économisé justifie la dépense  »536 (1913, 254). Effectivement, lʼargument peut sʼentendre, surtout à notre époque, environ un siècle plus tard, où les designers sʼemploient à mieux produire plutôt quʼà tourner complètement le dos à la production, à lʼindustrie ou à la consommation. On trouve donc chez Frederick quelque chose de cette «  production raisonnée  » que les discours convaincus de la réalité du réchauffement climatique appellent de leurs vÅ“ux. Cette obsession pour lʼéconomie, si elle est générale, a des effets intéressants sur la méthodologie de lʼautrice, qui produit alors des taxinomies documentées par des planches thématiques (fig. 3.17). Des ensembles dʼobjets sont réunis dans la catégorie des «  économiseurs de pas  », quand dʼautres sont vus comme des «  économiseurs de carburant  » ou encore «  de temps  » ou de «  labeur  »537 (71). Ces considérations nʼont rien dʼanecdotique : cʼest sans doute parce quʼelle veut réduire les déplacements que Frederick ramène les provisions dans la cuisine, là où Beecher faisait encore déplacer la ménagère dans le garde-manger pour aller les chercher, à lʼexception du sucre et de la farine. Toutefois, la critique de Dolores Hayden reste valide, dans la mesure où elle prend en compte lʼévolution globale de Frederick.
Dix ans après lʼouvrage sur lequel je me suis pour le moment concentré, Frederick publie Selling Mrs. Consumer. Cette fois, la transition semble achevée : le cÅ“ur des ouvrages ne se situe plus dans les usages, mais bien dans la formation dʼune parfaite consommatrice à laquelle Frederick ne sʼidentifie plus. Il suffit pour sʼen convaincre dʼobserver les titres des chapitres du livre, tels que «  Des points pratiques pour vendre des équipements à Madame Consommatrice  » ou encore «  Les instincts féminins et la psychologie de lʼacte dʼachat  »538. Dans lʼintroduction de lʼouvrage, Frederick ne parle plus, comme dans The New Housekeeping, des quarante-huit pièces de porcelaine quʼelle doit laver à lʼissue des repas (1918, 23). Sa position est externe et elle sʼaffirme comme «  porte-parole de Madame Consommatrice  »539 (1928, 3), en utilisant du reste le terme de «  spokesman  », comme si, en devenant expert (sic), elle sʼétait débarrassée de son encombrante condition de femme. Pour Dolores Hayden, la trahison de Frederick repose sur plusieurs concessions, tel le fait de soutenir le système de crédit et la construction de nouvelles maisons -—en dʼautres termes, elle adhère complètement aux valeurs et au fonctionnement général de lʼéconomie de marché productiviste et capitaliste. Sʼil reste des valeurs, elles sont prises dans ce rêve de consommation, où consommer est un devoir patriotique (Hayden 1982, 284). En cela, Frederick annonce lʼéthique étasunienne amorcée lors de lʼeffort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et poursuivie après 1945.
Si Dolores Hayden a des mots assez durs contre Christine Frederick, elle nʼest guère plus enthousiaste concernant sa contemporaine Lillian Moller Gilbreth. Les deux femmes sont souvent évoquées ensemble, et, chez D. Hayden, elles sont désignées comme les «  deux économistes du logis  » qui «  devinrent les idéologues-clés théorisant la maison suburbaine, proconsommation et antiféministe  »540. Les deux autrices se revendiquent effectivement du taylorisme et il semble quʼelles aient collaboré (Bell & Kaye 2002, 7). Cependant, Lillian Gilbreth a eu une très longue carrière qui mérite un examen spécifique.

Elle commence par travailler avec son mari, le consultant industriel et spécialiste de la construction Frank Bunker Gilbreth, avec qui elle a 11 enfants (Penner 2021–22, 33 ; fig. 3.18.a) et qui lʼencourage à mener des études de psychologie541. Cʼest dʼailleurs deux de ses enfants qui raconteront leur expérience de la vie dʼune famille nombreuse (fig. 3.18.b) dans le livre à succès Treize à la douzaine (Cheaper by the Dozen) publié en 1948.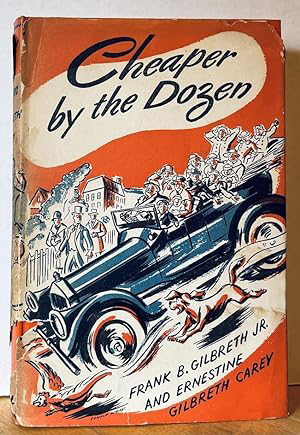 fig. 3.5 : Le livre Treize à la douzaine (1948), en anglais Cheaper by the Dozen. Les époux Gilbreth collaborent autour de la rationalisation du travail en cuisine, et cʼest cette dimension du travail de Lillian qui est la plus connue.
fig. 3.5 : Le livre Treize à la douzaine (1948), en anglais Cheaper by the Dozen. Les époux Gilbreth collaborent autour de la rationalisation du travail en cuisine, et cʼest cette dimension du travail de Lillian qui est la plus connue.
Après la mort de Frank en 1924, Lillian poursuit sa carrière pendant une quarantaine dʼannées. Son travail, jusquʼalors marqué par lʼinvestissement de techniques dʼenregistrement photographique sur lesquelles je reviendrai, connaît des réorientations thématiques et stratégiques. Dans un premier temps, le décès de son mari la place dans une situation économique délicate, puisque lʼentreprise quʼiels ont co-fondée lui rapporte moins dʼargent. Elle a aussi onze enfants dont elle doit assurer lʼéducation (Penner 2021–22, 33). Ce contexte marqué par la nécessité lʼincite à réorienter son positionnement : sa qualité dʼingénieure passe au second plan, au profit de son identité de mère, investie dans The Homemaker and Her Job publié en 1927, trois ans après la mort de son mari. Plus tard, Lillian Gilbreth élargit son champ dʼétude en sʼintéressant au handicap. Cet aspect de sa carrière, moins connu, a été récemment mis en lumière par les recherches de Barbara Penner, professeure dʼhumanités architecturales, et ce sont principalement sur ses travaux que je mʼappuierai pour analyser le travail de lʼingénieure.
La carrière de Lillian Gilbreth commence dès 1914, lorsquʼelle publie The Psychology of Management, en tant que psychologue (Penner 2021–22, 33). Ensuite, elle travaille aux côtés de son mari, qui se consacre aux études du mouvement (motion studies) dans la production industrielle (Freeman 2004, 33). Si le point de vue peut sembler tayloriste, le couple adopte une méthodologie singulière. En effet, comme le remarque Siegfried Giedion, ce nʼest plus seulement le chronomètre qui est roi dans lʼapproche des Gilbreth. On peut mesurer le temps dépensé pour accomplir une tâche, mais alors «  la forme du mouvement reste invisible et ne peut pas être investiguée  »542 (Giedion 1948, 102). fig. 3.19 : Exemple d’image générée par le cyclograph, invention du couple Gilbreth diffusée à partir de 1911 dans leurs publications. Tout lʼeffort des Gilbreth va donc porter sur la captation et la matérialisation du mouvement, que Giedion rapproche de lʼambition de Jules Étienne Marey (Giedion 1948, 104–107 ; Midal 2012, 114), bien que selon lui, les Gilbreth nʼaient jamais cité lʼinventeur français dans leurs travaux (104). Le couple invente ainsi le Cyclograph543 ou Cyclogramme, après avoir tenté dʼutiliser la seule chronophotographie, associée à des fonds noirs et des systèmes de coordonnées (Giedion 1948, 102).
fig. 3.19 : Exemple d’image générée par le cyclograph, invention du couple Gilbreth diffusée à partir de 1911 dans leurs publications. Tout lʼeffort des Gilbreth va donc porter sur la captation et la matérialisation du mouvement, que Giedion rapproche de lʼambition de Jules Étienne Marey (Giedion 1948, 104–107 ; Midal 2012, 114), bien que selon lui, les Gilbreth nʼaient jamais cité lʼinventeur français dans leurs travaux (104). Le couple invente ainsi le Cyclograph543 ou Cyclogramme, après avoir tenté dʼutiliser la seule chronophotographie, associée à des fonds noirs et des systèmes de coordonnées (Giedion 1948, 102).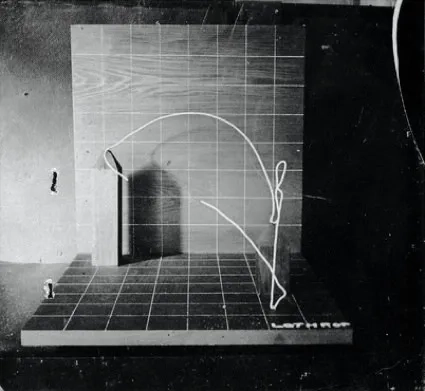 fig. 3.20 : Exemple de maquettes de fil de fer générée sur la base de l’étude du mouvement par les Gilbreth. Siegfried Giedion parle dʼailleurs de ce dispositif comme étant lʼœuvre du seul Frank Bunker Gilbreth544, et décrit la manière dont les sujets humains sont équipés dʼune simple ampoule qui, associée à la chronophotographie, permet de voir apparaître des lignes retranscrivant la trajectoire du mouvement (fig. 3.19), «  sa fluidité, ses hésitations, ses ruptures et ses défauts  » (Midal 2022, 116). Les images ainsi formées sont ensuite traduites en maquettes de fil de fer qui permettent de visualiser le geste en trois dimensions (fig. 3.20). Les Gilbreth inventent également un système de notation du mouvement, le Therblig, matérialisé dans un diagramme des cycles des mouvements simultanés (Simultaneous-Motion Cycle ou SIMO ; Penner 2021–22, 33 ; Gilbreth 1927, 115 ; fig. 3.21). Ce travail est ambivalent : il contient une forme de richesse (les «  hésitations  » relevées par A. Midal) mais comme toute entreprise rationaliste touchant au mouvement, exemplaire du «  mouvement à la fois destructeur et libérateur qui […] port[e] la dynamique de la modernité  », elle court le risque de perdre cette «  fluidité dʼenchaînement qui caractérise nos gestes dʼhumanités  » (Citton 2012, 270–71).
fig. 3.20 : Exemple de maquettes de fil de fer générée sur la base de l’étude du mouvement par les Gilbreth. Siegfried Giedion parle dʼailleurs de ce dispositif comme étant lʼœuvre du seul Frank Bunker Gilbreth544, et décrit la manière dont les sujets humains sont équipés dʼune simple ampoule qui, associée à la chronophotographie, permet de voir apparaître des lignes retranscrivant la trajectoire du mouvement (fig. 3.19), «  sa fluidité, ses hésitations, ses ruptures et ses défauts  » (Midal 2022, 116). Les images ainsi formées sont ensuite traduites en maquettes de fil de fer qui permettent de visualiser le geste en trois dimensions (fig. 3.20). Les Gilbreth inventent également un système de notation du mouvement, le Therblig, matérialisé dans un diagramme des cycles des mouvements simultanés (Simultaneous-Motion Cycle ou SIMO ; Penner 2021–22, 33 ; Gilbreth 1927, 115 ; fig. 3.21). Ce travail est ambivalent : il contient une forme de richesse (les «  hésitations  » relevées par A. Midal) mais comme toute entreprise rationaliste touchant au mouvement, exemplaire du «  mouvement à la fois destructeur et libérateur qui […] port[e] la dynamique de la modernité  », elle court le risque de perdre cette «  fluidité dʼenchaînement qui caractérise nos gestes dʼhumanités  » (Citton 2012, 270–71).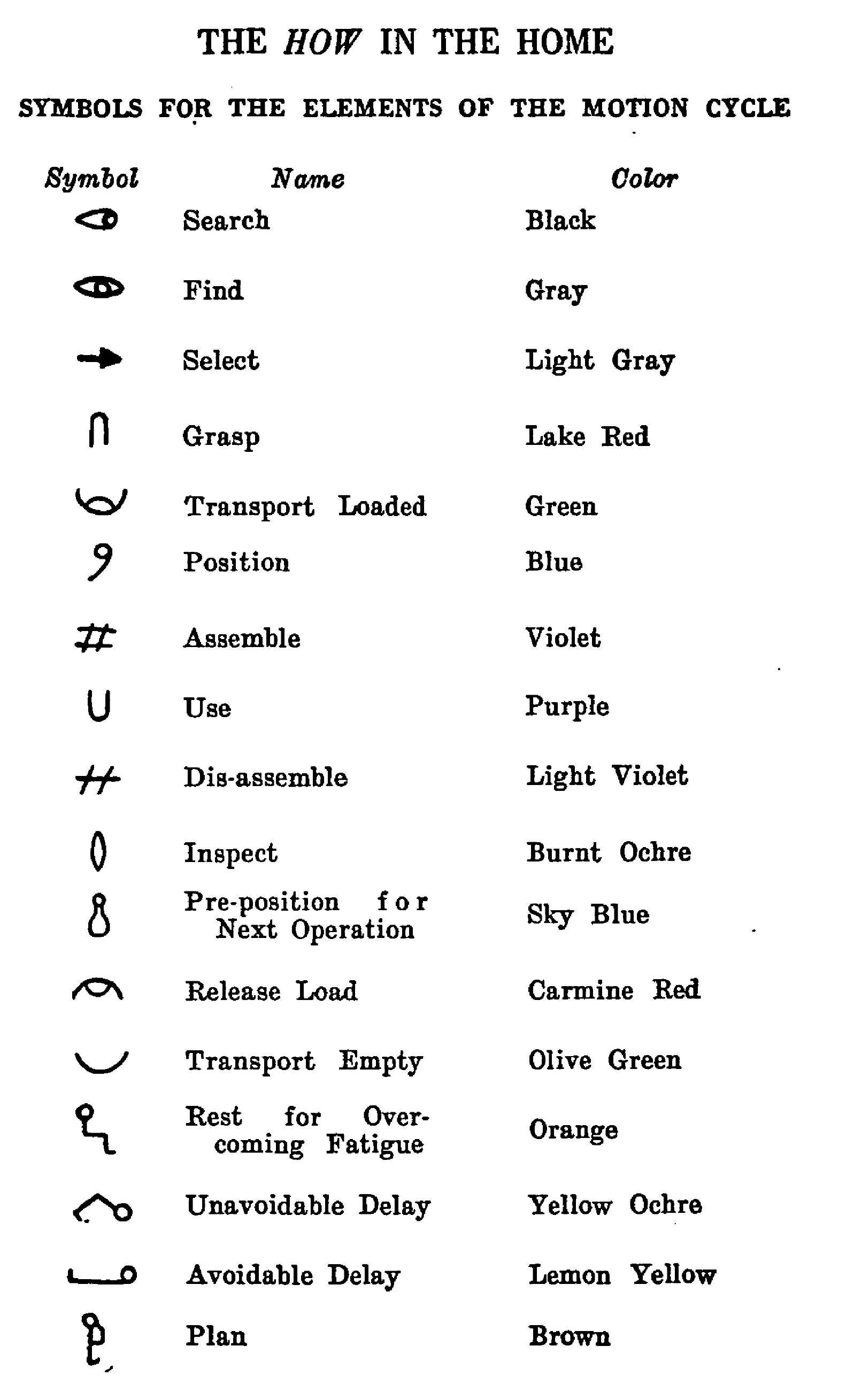 fig. 3.21 : Les diagrammes du Simultaneous-Motion Cycle (ou SIMO) décrivant la notation Therblig ; extrait de The Homemaker and Her Job, p. 115.
fig. 3.21 : Les diagrammes du Simultaneous-Motion Cycle (ou SIMO) décrivant la notation Therblig ; extrait de The Homemaker and Her Job, p. 115.
Ces premières expérimentations concernent le travail en usine, mais Lillian les poursuivra après la mort de son mari, lʼusage des techniques sus-citées lui permettant de faire des propositions reçues comme «  plus crédibles et rigoureuses  »545 (Penner 2021–22, 33) que celles de sa contemporaine Christine Frederick. La cuisine proposée par Lillian Gilbreth nʼest pas focalisée sur lʼéconomie de pas mais sur la fluidité des déplacements. Cet aspect est lisible dans les courbes abstraites retranscrites par le Cyclogramme, qui, pour Siegfried Giedion appartiennent à une plus vaste généalogie dʼimages visant à retranscrire le mouvement, des expérimentations plastiques des Futuristes italiens, au Nu descendant lʼescalier de Marcel Duchamp en passant par les propositions de Paul Klee (Giedion 1948, 106–113). Sur le plan des idées, Lillian Gilbreth se démarque de Catharine Beecher et Christine Frederick à plusieurs égards : contrairement à Beecher, elle ne refuse pas lʼaide domestique, bien au contraire. Elle considère en effet que tout ce qui peut être délégué doit lʼêtre, et que toute aide est bonne à prendre (Penner 2021–22, 34). Dans The Homemaker and Her Job, le propos culmine dans le chapitre final consacré à «  lʼétude de la fatigue  ». De manière intéressante, Gilbreth en considère deux dimensions : psychique et physique (1928, 124). Ce chapitre rend pourtant lisibles les modèles hybrides avec lesquels doivent négocier les autrices de guides dʼéconomie domestique. Si Lillian Gilbreth, en étant engagée comme ingénieure ou en adoptant une approche expérimentale qui se veut scientifique, apparaît comme une figure résolument moderniste, certains éléments de langage lʼattachent encore au modèle prémoderne du guide moral et hygiéniste incarné par les écrits de Beecher, tandis que dʼautres ne sont pas aussi progressistes que lʼon pourrait sʼy attendre. Il est ainsi question dʼune «  vitalité  » que les vêtements adéquats aideraient à conserver ou, plus loin, la femme au foyer est présentée comme la garante de la bonne humeur de la maisonnée. Gilbreth conseille aux mères de veiller à nourrir et bien vêtir les enfants et leur proposer des distractions lorsquʼils paraissent de mauvaise humeur, avant dʼajouter que ces remarques sont également valables pour le mari qui appréciera «  dʼêtre attendu au bout de la rue, de trouver ses pantalons blancs, ses chaussures et sa chemise dʼintérieur, son bol de pommes et le Scientific American à côté de son gros fauteuil  »546 (1928, 128). Le rôle des femmes est donc circonscrit à la cuisine, au service de leur famille, même si Gilbreth milite pour que les tâches soient partagées au sein du foyer.
Toutefois, il semble que ce travail, même lorsquʼil est réparti, est toujours pensé comme un travail de femme délégué -—nous retrouverons cette logique à lʼœuvre chez des femmes salariées dans un contexte plus contemporain (cf. infra.). Les apports de Lillian Gilbreth sont toutefois réels pour la discipline du design. Elle produit un décalage vis-à -vis de la logique de lʼéconomie de pas qui se matérialise dans de nouvelles propositions. Sa première contribution dans le domaine de la cuisine est la Kitchen Practical, quʼelle designe en 1929 pour la Brooklyn Borough Gas Company (fig. 3.22).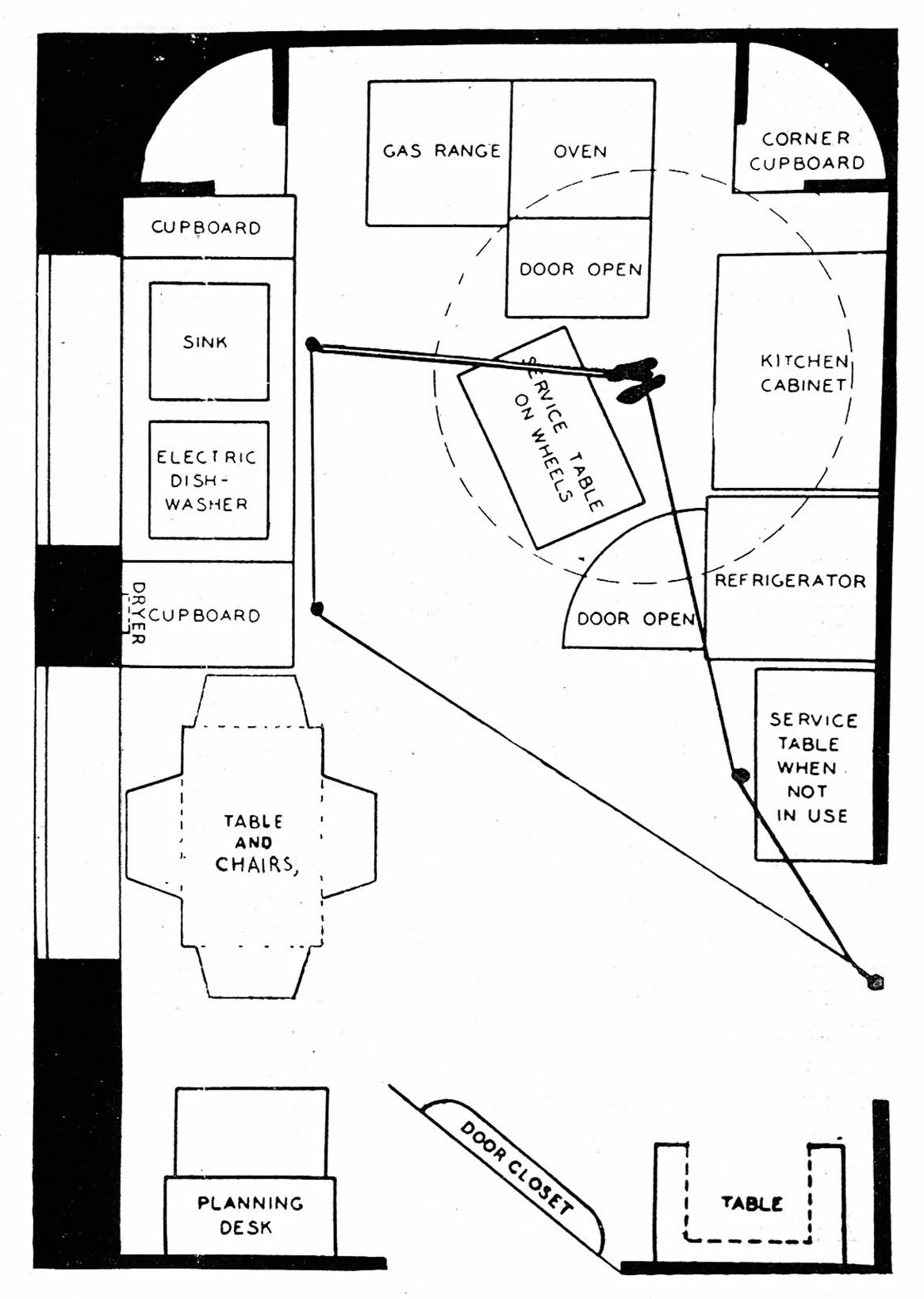 fig. 3.22 : La table sur roulettes de Lillian Gilbreth. Source : revue Architectural Review.
fig. 3.22 : La table sur roulettes de Lillian Gilbreth. Source : revue Architectural Review.
Là , elle propose une «  progression circulaire  »547 (Penner 2021–22, 33) dont le pivot central nʼest plus tout à fait le corps, mais une table mobile sur roulettes (fig. 3.23) qui permet en théorie de fluidifier le travail. Gilbreth parle ainsi dʼune «  courbe de travail  »548 (Penner 2021–22, 34) qui désigne ce que les bras de la travailleuse peuvent atteindre sans peine. Ici aussi, la position de Lillian Gilbreth est ambivalente, comme celles des autres autrices dʼouvrages sur lʼéconomie domestique. Lʼingénieure pose en effet que les usager·es de la cuisine devraient lʼadapter à leurs besoins mais une telle proposition «  sʼaccommode mal de la pression exercée par les industriels pour formuler un standard  »549 (Penner 2021–22, 34). Pour cette raison, Gilbreth transige et propose que la cuisine soit déclinée en trois tailles correspondant aux différents types physiques des usagères.
Sa proposition restera lettre morte. En effet, Barbara Penner montre quʼen dépit du succès de lʼingénieure, qui est encore sollicitée comme consultante en 1955–1960 alors quʼelle est octogénaire, ses propositions sont inégalement suivies. Cʼest donc le standard dʼun plan de travail à 90 centimètres de hauteur (soit environ 36 pouces) qui reçoit lʼaval des industriels bien que cette hauteur, à maintes reprises, nʼapparaisse pas comme une norme idéale. Christine Frederick, nous lʼavons vu, avait également proposé des grilles définissant les tailles des éléments en fonction de la taille de lʼusagère. Une femme de 1m 68, selon elle, devrait travailler sur un plan haut de 79 centimètres (Arndt 2015). Et si les Étasuniennes ont légèrement grandi depuis le début du XXe siècle (elles ont gagné en moyenne 1,2 pouce, soit trois centimètres), cette norme nʼa pas évolué pour autant.

Toutefois, lʼidée dʼun design adaptable nʼa pas complètement été oubliée. Cʼest même la thèse de Barbara Penner qui, tout en adhérant aux critiques de Dolores Hayden, souhaite les tempérer en reliant lʼhistoire de ce «  design flexible  »550 à la seconde carrière de Lillian Gilbreth (2018). En 1944, lʼingénieure publie avec Edna Yost551 Normal Lives for the Disabled. Ce livre est en partie le résultat de sa collaboration avec lʼUS Navy sur des projets de réhabilitation (Penner 2021–22, 34). En 1948, elle produit la Heart Kitchen pour la New York Heart Association (fig. 3.24). Le contexte historique, après la Seconde Guerre mondiale, est différent de celui du début de sa carrière. Barbara Penner rappelle que lʼépoque est marquée par le modèle dʼune cuisine hypertechnologique, où tout est non seulement à portée de pas, mais surtout de bouton (Penner 2018). Cette cuisine de démonstration, documentée dans la brochure «  Heart of the Home  » cible donc les femmes cardiaques, à une époque où le handicap commence à être plus visible dans la culture étasunienne, avec lʼidée à double tranchant de transformer les sujets handicapés en personnes productives. Ceci correspond à lʼapproche de Lillian Gilbreth, qui donne une valeur centrale au travail (Penner 2021–22, 34).  fig. 3.24 : La Heart Kitchen 1948. Source : revue Places.Dans cette cuisine pour cardiaques, Gilbreth envisage logiquement de réduire la fatigue générée par le labeur. Pour Penner, Lillian fait alors évoluer la doctrine élaborée avec son mari, celle de «  la bonne solution une fois pour toutes  »552 (Penner 2018), pour développer lʼidée dʼune forme de flexibilité dans le design. Ces apports de Barbara Penner permettent de nuancer le portrait de Gilbreth brossé un peu durement par Dolores Hayden, lorsquʼelle affirme par exemple à propos de lʼingénieure quʼelle est une «  superwoman imbue dʼelle-même qui a essayé de tayloriser tous les processus de travail de la maison  »553 (Hayden 1982, 275).
fig. 3.24 : La Heart Kitchen 1948. Source : revue Places.Dans cette cuisine pour cardiaques, Gilbreth envisage logiquement de réduire la fatigue générée par le labeur. Pour Penner, Lillian fait alors évoluer la doctrine élaborée avec son mari, celle de «  la bonne solution une fois pour toutes  »552 (Penner 2018), pour développer lʼidée dʼune forme de flexibilité dans le design. Ces apports de Barbara Penner permettent de nuancer le portrait de Gilbreth brossé un peu durement par Dolores Hayden, lorsquʼelle affirme par exemple à propos de lʼingénieure quʼelle est une «  superwoman imbue dʼelle-même qui a essayé de tayloriser tous les processus de travail de la maison  »553 (Hayden 1982, 275).
Deux autres aspects me semblent intéressants à retenir. Même si, je lʼai évoqué, Gilbreth revient parfois à des motifs qui peuvent nous paraître rétrogrades (tel le breadwinner attendu par son épouse, qui lui a préparé son fauteuil et son journal), elle évoque aussi des formes de collaboration intrafamiliales. Celles-ci sont élaborées grâce à une curieuse comparaison entre la famille et le personnel ouvrier de lʼusine. Dans ses schémas (1928, 30, fig. 3.25), elle montre la manière dont un·e superintendant·e554 peut déléguer le contrôle qualité de la chaîne à des intermédiaires, qui, à leur tour, commandent lʼouvrier·e. Dans son ouvrage, Gilbreth applique ce principe théorisé avec son mari à la vie familiale, en expliquant comment lʼaîné dʼune fratrie555 peut en diriger les membres pour brà »ler des feuilles (Gilbreth 1928, 35–37).
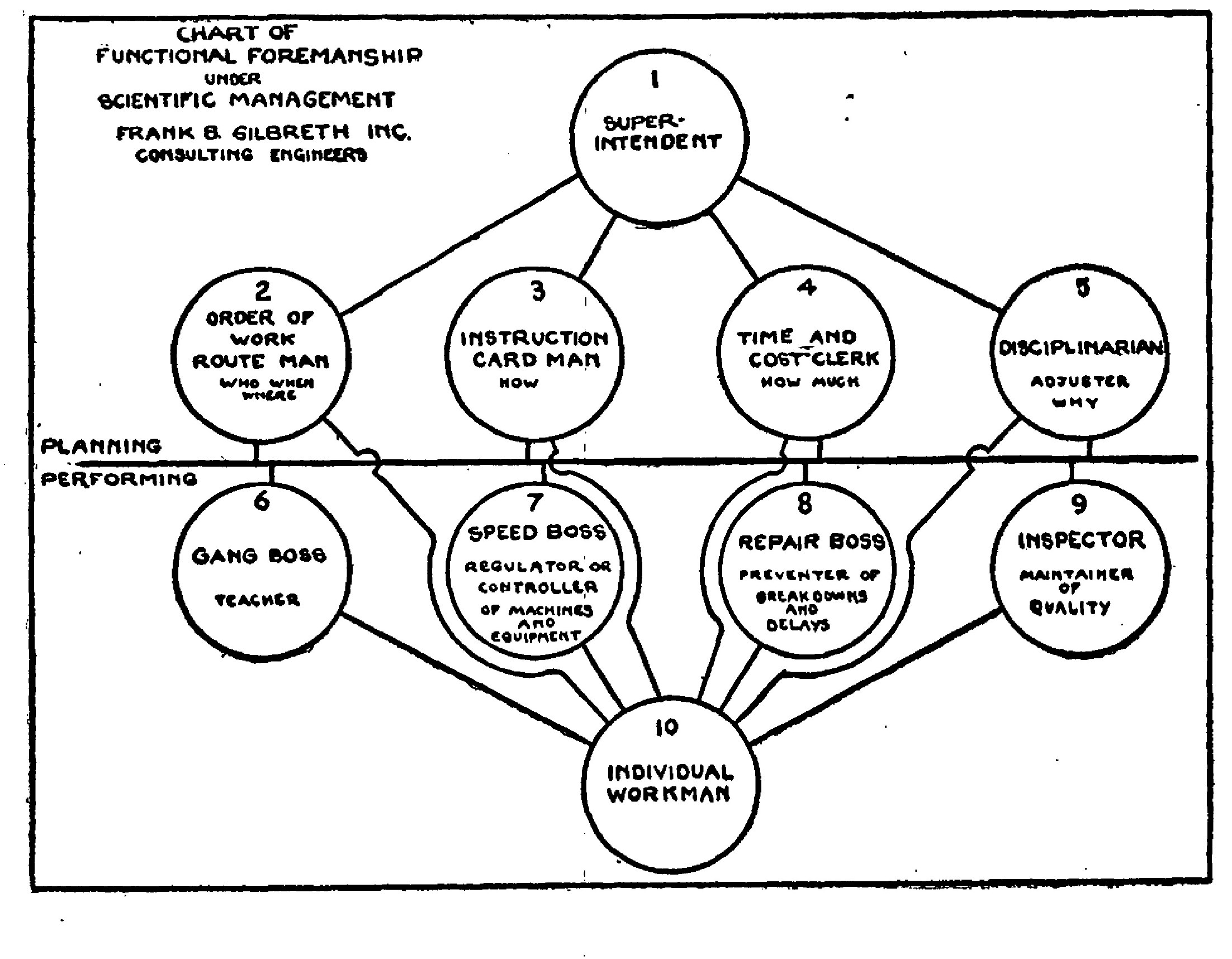
Par ailleurs, si elle reconnaît que le mari peut prendre en charge des tâches (puisquʼil est familier du travail en usine, pour lequel il est salarié), elle suggère quʼil devrait «  former un garçon ou une fille plus âgé·e, ou peut-être les deux, à prendre le relais lorsquʼil est absent  »556 (ibid., 35). Ailleurs, on peut aussi lui reconnaître la volonté dʼaller à lʼessentiel en éliminant les tâches considérées comme inutiles, comme repasser les draps (Penner 2021–22, 34). Lʼéconomie domestique nʼest donc pas inévitablement synonyme dʼidéaux aliénants pour les femmes : dans certains cas, une certaine sensibilité aux réalités du travail domestique accompagne les conseils. Barbara Penner remarque une forme de cohérence à cet endroit chez Gilbreth, puisquʼelle passait fort peu de temps en cuisine ; mais on peut aussi, presque à lʼinverse, reconnaître quʼelle ne profite pas de sa position externe pour produire des standards dʼautant plus inatteignables quʼils ne la concernent pas. Enfin, la «  home manager  » tayloriste incarnée par Gilbreth dans ses livres ne propose pas seulement des méthodes de travail, mais aussi une pensée qui relève de la discipline du design. Pour repenser la cuisine, elle approche son espace comme dispositif, dʼun point de vue macroscopique qui nʼisole pas les outils ou les fonctions mais les relie entre elles. Elle affirme ainsi :
Un fauteuil avec un livre à proximité et une lampe de lecture bien réglée représentent beaucoup plus quʼun fauteuil, un livre et une lampe, chacun choisi indépendamment, peut-être uniquement pour leur couleur et leur forme, et disposés sans relation particulière lʼun avec lʼautre557 (Gilbreth 1928, 3–4).
Elle relie du reste cette approche aux processus de conception industriels :
Si ceux qui fournissent le savon, lʼeau, les éviers, la vaisselle, etc., qui sont tous des facteurs dans le lavage de la vaisselle, pouvaient regarder lʼopération une seule fois, ou mieux encore, lʼeffectuer eux-mêmes, nous aurions un bien meilleur équipement dans un court laps de temps558 (Gilbreth 1928, 117).
Il existe chez Gilbreth un attrait pour lʼindustrie qui est différent de lʼadhésion au tout-consommation quʼincarne Christine Frederick. Gilbreth se concentre sur lʼefficience, ce qui peut conduire à la classer un peu vite du côté des avocat·es dʼun capitalisme sans bornes. En réalité, la lecture de ses textes révèle un propos sinon ambivalent, du moins hétérogène et porteur dʼautres valeurs que la seule efficacité. La notion de partage des tâches émerge, et la conception de la cuisine est envisagée comme un travail global, holistique, et enfin créatif, où lʼon peut exprimer son individualité.
Catharine Beecher, Christine Frederick et Lillian Gilbreth sont des personnalités incontournables qui ont marqué lʼhistoire de lʼéconomie domestique. Si leurs valeurs et idées sont parfois très différentes, deux éléments leur sont communs. Premièrement, leurs Å“uvres respectives sont traversées de tensions et de contradictions qui ne tiennent pas toujours à leurs propres inscriptions sociales et pratiques (entre le foyer et la vie publique dʼautrice, par exemple), mais qui révèlent des paradoxes profonds liés à lʼidéal des deux sphères en Occident, et particulièrement aux États-Unis. En effet, nous verrons plus loin que lʼindustrie déborde sur le travail domestique, dans ses principes et son organisation, alors même que le capitalisme repose sur un concept du travail qui nʼinclut pas le travail domestique. Dès lors, des transferts de valeurs et de savoirs sʼopèrent en dépit de ce contexte idéologique. Deuxièmement, les trois autrices dont nous avons étudié le travail sont encore trop peu intégrées à lʼhistoire du design, malgré les efforts de chercheuses comme Dolores Hayden, Barbara Penner et Alexandra Midal. Il est possible que les théoriciennes de lʼéconomie domestique seront véritablement considérées comme des designers (comme ayant contribué à lʼhistoire du design) lorsque cette histoire sera envisagée de manière intersectionnelle. Ainsi, Beecher nʼest pas seulement une femme qui designe, mais une designer Quaker, blanche, antiféministe et abolitionniste ; Christine Frederick est une femme blanche qui souscrit à la doctrine capitaliste et adhère aux valeurs bourgeoises de son époque ; enfin, Lillian Gilbreth apparaît comme une femme blanche, privilégiée malgré son veuvage qui se dédie aux questions de handicap, mais dʼune manière qui peut reproduire des effets de bord validistes (Penner 2018). Cʼest aussi en remarquant qui est absente dans cette histoire des femmes en cuisine -—les femmes noires, marronnes, indigènes, handicapées, lesbiennes, bisexuelles559, etc. -—que la discipline dépassera ses biais traditionnels (Midal 2012, 21). Pour lʼheure, je vais de nouveau investir cette histoire de lʼéconomie domestique, pour envisager la manière dont ces premiers travaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ont transpiré dans la conception de la cuisine moderne, telle que nous la connaissons, et telle que nous lʼavons — ou pas— dépassée.
Lʼhistoire de lʼéconomie domestique est souvent pensée comme un phénomène étasunien, et pour cause : ses dimensions tayloristes et son lien profond au capitalisme de consommation la relient directement à des mutations économiques et politiques où les États-Unis ont joué un rôle majeur. Toutefois, il importe de décaler ce regard et dʼobserver la manière dont lʼéconomie domestique a été mobilisée en Europe, et plus particulièrement en France. Il existe des liens directs entre les figures étasuniennes et la figure française la plus connue, Paulette Bernège (1893–1976 ; fig. 3.26). Cette philosophe de formation560 (Cardoso 2018, §3) et journaliste est même la disciple française de Frederick, position explicitée dans un ouvrage au beau titre évocateur, Si les femmes faisaient les maisons, publié en 1928. Nous allons voir que les contradictions pointées chez les spécialistes étasuniennes de lʼéconomie domestique trouvent en Europe et en France des formulations similaires mais aussi originales. fig. 3.26 : Portrait de Paulette Bernège (1930). Paulette Bernège sʼimpose comme expert du travail domestique dès 1923, en devenant la rédactrice en chef de la revue Mon Chez Moi (fig. 3.27). Elle contribue également à LʼArt Ménager561, Éducation Ménagère et sera la directrice de la revue Mon bureau (Henry 2003, §5). Elle crée également la Ligue dʼOrganisation Ménagère en 1924–25 (Clarke 2005, 140 ; Dumont 2012, 10).
fig. 3.26 : Portrait de Paulette Bernège (1930). Paulette Bernège sʼimpose comme expert du travail domestique dès 1923, en devenant la rédactrice en chef de la revue Mon Chez Moi (fig. 3.27). Elle contribue également à LʼArt Ménager561, Éducation Ménagère et sera la directrice de la revue Mon bureau (Henry 2003, §5). Elle crée également la Ligue dʼOrganisation Ménagère en 1924–25 (Clarke 2005, 140 ; Dumont 2012, 10). fig. 3.27 : La revue Mon Chez Moi, numéro datant de 1926. Sa carrière débute dans un contexte, les années 1920, où sont créées les écoles ménagères. On retrouve donc, comme aux États-Unis, quoiquʼun peu plus tardivement, cette double inscription de lʼéconomie domestique dans des écoles spécialisées et sous forme de communication de masse par des expertes dans des revues, livres et sur dʼautres supports -—Paulette Bernège est une habituée des conférences internationales (Dumont 2012, 57) et autres émissions de radio (Clarke 2005, 143) tandis que certains de ses ouvrages sont traduits en allemand, hollandais, polonais, et italien (Bernège, 1935). Elle publie aussi à un rythme très soutenu : si son De la méthode ménagère (1928), publié par Dunod comme la traduction des écrits de Frederick et de Taylor (Ribeill 1989, 59), connaît un succès prolongé, et même une longévité «  exceptionnelle  » (Clarke 2005, 143), elle publie plus de dix autres ouvrages entre 1926 et 1950, tels que Les Rapports financiers entre époux (1929), Jʼinstalle ma cuisine (1933), Le Ménage simplifié ou la Vie en rose (1935), Le Livre de comptes de la femme économe (1936), Lʼaluminium ménager (1941) ou encore Le blanchissage domestique (1950) (fig. 3.28.a & b).
fig. 3.27 : La revue Mon Chez Moi, numéro datant de 1926. Sa carrière débute dans un contexte, les années 1920, où sont créées les écoles ménagères. On retrouve donc, comme aux États-Unis, quoiquʼun peu plus tardivement, cette double inscription de lʼéconomie domestique dans des écoles spécialisées et sous forme de communication de masse par des expertes dans des revues, livres et sur dʼautres supports -—Paulette Bernège est une habituée des conférences internationales (Dumont 2012, 57) et autres émissions de radio (Clarke 2005, 143) tandis que certains de ses ouvrages sont traduits en allemand, hollandais, polonais, et italien (Bernège, 1935). Elle publie aussi à un rythme très soutenu : si son De la méthode ménagère (1928), publié par Dunod comme la traduction des écrits de Frederick et de Taylor (Ribeill 1989, 59), connaît un succès prolongé, et même une longévité «  exceptionnelle  » (Clarke 2005, 143), elle publie plus de dix autres ouvrages entre 1926 et 1950, tels que Les Rapports financiers entre époux (1929), Jʼinstalle ma cuisine (1933), Le Ménage simplifié ou la Vie en rose (1935), Le Livre de comptes de la femme économe (1936), Lʼaluminium ménager (1941) ou encore Le blanchissage domestique (1950) (fig. 3.28.a & b).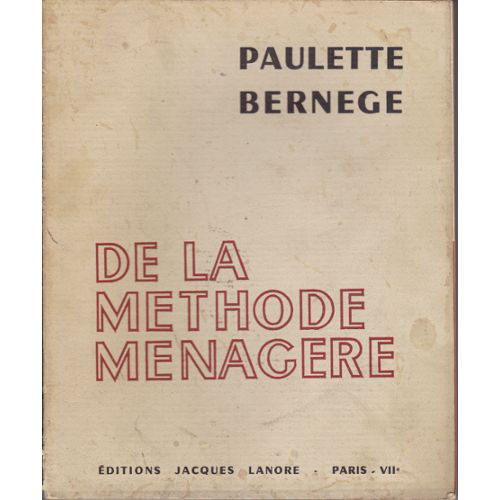 fig. 3.28.a : Ouvrage de Paulette Bernège : La méthode ménagère (1928).
fig. 3.28.a : Ouvrage de Paulette Bernège : La méthode ménagère (1928).
La première mission de Paulette Bernège est clairement affirmée : comme ses condisciples étasuniennes, elle entend revaloriser un travail domestique trop souvent non reconnu, dʼautant que la Première Guerre mondiale a consacré dʼautres figures du travail féminin comme «  la munitionnette, la soudeuse ou lʼinfirmière  » (Martin 1987, 90). En 1935, dans son Ménage Simplifié ou La vie en rose, fig. 3.28.b : Ouvrage de Paulette Bernège : Le ménage simplifié ou la vie en rose (1935). Paulette Bernège sʼinsurge contre les expressions toutes faites comme «  Ma femme ne fait rien, elle fait son ménage  » ou contre la pratique consistant à écrire «  Sans profession  » sur les «  formulaires officiels  » (Bernège 1935, 9). Il est vrai que lors du recensement de 1926 (neuf années plus tôt), on lit que «  la femme qui nʼexerce aucune profession et ne fait que son propre ménage repondra néant  » (Martin 1987, 89). Le programme, qui fait suite à ce cadrage préliminaire rappelant que les tâches domestiques sont un travail, semblera familier aux lecteurices : Bernège sʼinspire de lʼapproche tayloriste de Frederick pour proposer de réduire le nombre de pas en cuisine, sʼinsurgeant par exemple dans la brochure Si les femmes faisaient les maisons (1928) contre lʼexistence de «  distances vampire  » qui privent la ménagère dʼune énergie précieuse (Bernège 1928, fig. 3.29). Comme elle, elle imagine une cuisine sans domestiques, où la ménagère est responsable de la majeure partie des tâches. Mais Bernège se distingue de son modèle étasunien, même si elle publie dans de nombreuses revues qui comportent des encarts publicitaires. Malgré cela, elle manifeste une grande méfiance à lʼégard de la consommation et considère même son économie domestique, pensée comme une éducation domestique, comme un remède aux achats impulsifs et malavisés.
fig. 3.28.b : Ouvrage de Paulette Bernège : Le ménage simplifié ou la vie en rose (1935). Paulette Bernège sʼinsurge contre les expressions toutes faites comme «  Ma femme ne fait rien, elle fait son ménage  » ou contre la pratique consistant à écrire «  Sans profession  » sur les «  formulaires officiels  » (Bernège 1935, 9). Il est vrai que lors du recensement de 1926 (neuf années plus tôt), on lit que «  la femme qui nʼexerce aucune profession et ne fait que son propre ménage repondra néant  » (Martin 1987, 89). Le programme, qui fait suite à ce cadrage préliminaire rappelant que les tâches domestiques sont un travail, semblera familier aux lecteurices : Bernège sʼinspire de lʼapproche tayloriste de Frederick pour proposer de réduire le nombre de pas en cuisine, sʼinsurgeant par exemple dans la brochure Si les femmes faisaient les maisons (1928) contre lʼexistence de «  distances vampire  » qui privent la ménagère dʼune énergie précieuse (Bernège 1928, fig. 3.29). Comme elle, elle imagine une cuisine sans domestiques, où la ménagère est responsable de la majeure partie des tâches. Mais Bernège se distingue de son modèle étasunien, même si elle publie dans de nombreuses revues qui comportent des encarts publicitaires. Malgré cela, elle manifeste une grande méfiance à lʼégard de la consommation et considère même son économie domestique, pensée comme une éducation domestique, comme un remède aux achats impulsifs et malavisés.
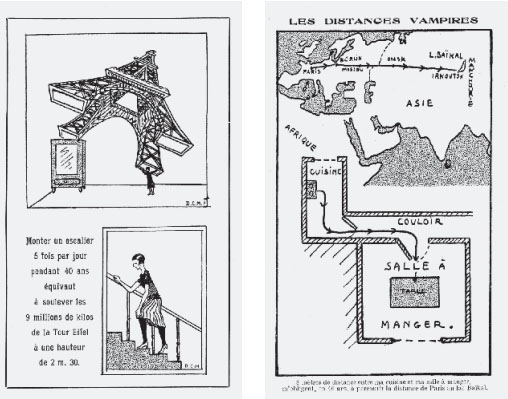

Ceci la place bien sà »r dans une position intenable : elle prêche lʼembellissement de la maison (Clarke 2005, 146), et même la coquetterie de la ménagère (Bernège 1935, 12–13), mais le tout dans le respect dʼune rigoureuse «  science des achats  » (1935, 168).
Paulette Bernège partage donc certaines des contradictions de ses contemporaines étasuniennes, et en incarne dʼautres, comme cette relation ambiguë avec la consommation. Elle occupe aussi une place particulière dʼexperte dans une discipline de lʼéconomie domestique qui connaît une reconnaissance nationale. En 1919, la loi Astier intègre lʼenseignement ménager aux cursus techniques dʼÉtat (Henry 2003, 128). Onze années plus tard, Bernège crée lʼécole de Haut Enseignement ménager, un établissement qui constitue en fait une tentative de matérialiser le projet plus ambitieux dʼun institut universitaire (Clarke 2005, 145). La chercheuse Jackie Clarke rappelle en effet que la vision de lʼenseignement ménager de Bernège est très large : loin de se limiter à lʼapprentissage de quelques gestes, elle incluait la psychologie et lʼurbanisme (145) :
Bernège affirma clairement que cette institution ne devait pas avoir pour seule vocation de former les ménagères mais de préparer les femmes à occuper des fonctions professionnelles dans des secteurs liés à la rationalisation du foyer, tels que le design et le développement de nouveaux produits (Clarke 2005, 145).
Il ne sʼagit donc pas de former des ménagères, ou, en tout cas, pas seulement. Si on reproche souvent aux expertes en économie domestique de prêcher en faveur dʼune vie quʼelles ne vivent pas, la dimension de «  Cheval de Troie  » revêtue par le travail au foyer est envisagée pour toutes les femmes, et pas uniquement pour lʼautrice. Du reste, cette posture empouvoirante de Paulette Bernège fait face aux conservatismes de son époque : ceux des hommes qui lʼentourent, et le sien. Odile Henry écrit que la journaliste est raillée pour ses discours en faveur dʼune scientifisation du travail ménager, alors que ses collègues masculins qui professent les mêmes conseils tayloristes ne subissent pas de telles moqueries (2003, 126).
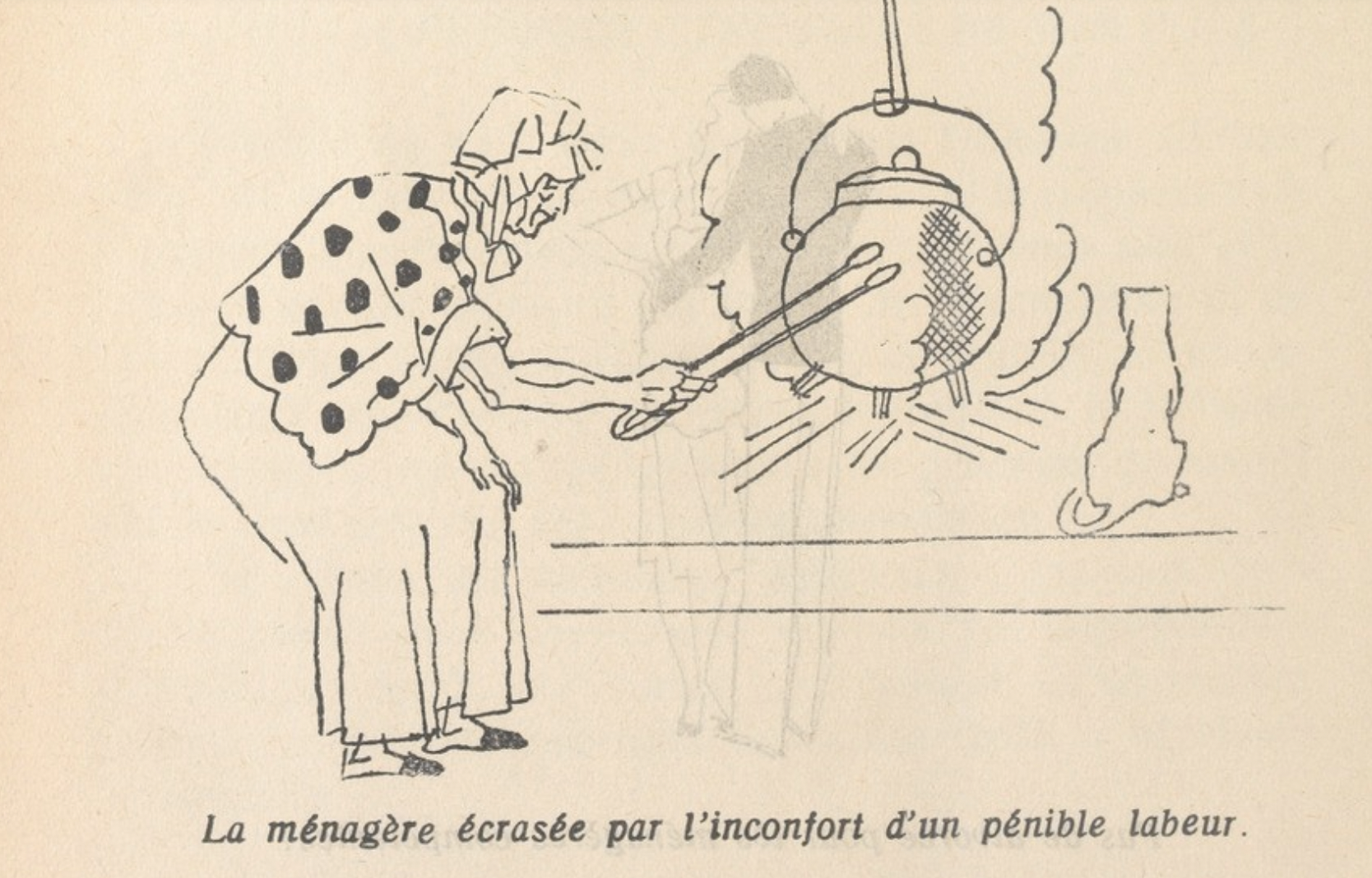

Bernège a beau professionnaliser la ménagère pour la rêver en ingénieure domestique, ses objectifs avoués sʼinscrivent dans une morale familialiste manifeste. Les premières pages du Ménage Simplifié sont explicites à cet égard. Paulette Bernège, après avoir rappelé la valeur du travail ménager, nous fait une promesse : «  Pas de divorce pour les ménagères compétentes !  » (1935, 11). Ce slogan efficace est une des marques de son style enlevé. Il sʼaccompagne dʼune illustration représentant un couple enlacé562 (fig. 3.30). La centralité de la famille nʼest donc pas remise en question. «  [T]oute ménagère porte en elle lʼâme dʼune directrice  », dit Bernège (1935, 18), mais cette direction est bien circonscrite et le divorce est conçu comme lʼéchec à éviter absolument. Ici, Paulette Bernège recourt aux statistiques et annonce que le taux de divorcées est très faible aux États-Unis chez les anciennes élèves des écoles dʼéconomie domestique (1935, 10) : il est implicite que ce faible taux est synonyme de réussite.
La doctrine tayloriste sʼinsère donc dans cette pensée paradoxale, entre revendication féministe dʼune capacité à faire et enfermement dans le schéma du couple hétérosexuel monogame scellé par un mariage unique. Pour Bernège, il sʼagit moins de décrire des tâches individuelles que dʼinculquer une méthode. Le corps de la ménagère, comme celui de lʼouvrier avant elle, est en son cÅ“ur. Jackie Clarke insiste en effet sur la dimension pédagogique de lʼapproche de Paulette Bernège. Il sʼagit de répéter les gestes et de mobiliser une «  mémoire musculaire  » (Clarke 2005, 152). En produisant les bons mouvements, la ménagère peut augmenter la cadence ; son corps devient plus habile, et si le corps sʼaméliore, lʼesprit, lui aussi, est plus sain. Il sʼagit bien de chronométrer le temps passé à réaliser une tâche, dans lʼesprit du Taylorisme : et Bernège de chiffrer à 7,3 milliards dʼheures annuelles la perte de temps de travail pour lʼéconomie française à cause des cuisines mal conçues (Dumont 2012, 58). Il convient aussi pour la théoricienne de répéter ces tâches pour sʼaméliorer. Ce sont donc plusieurs registres qui sʼinvitent en cuisine : celui de lʼusine, mais aussi celui de la salle de sport et du salon de beauté. Jackie Clarke, qui explicite cette relation particulière de Paulette Bernège au taylorisme, nous rappelle quʼil existe chez elle un «  culte de la précision […] valorisé pour lui-même  » (Clarke 2015, 152).
Chez Bernège, peut-être plus encore que chez ses collègues étasuniennes, se devine un aspect qui me semble central dans le design des cuisines : souvent, lʼobjet du processus de conception est moins lʼévier ou le placard que le corps de la ménagère lui-même (cf. infra., p. XX). La doctrine tayloriste repose sur une conception du corps comme machine (Braverman 1974, 124 ; Clarke 2005, 149) et Bernège prolonge ce motif dans son propos comme dans ses images (fig. 3.32). Chez elle, on trouve donc les prémices de cet idéal moderniste de la forme juste, du «  Good Design  » que défend Edgar Kaufman Jr. après-guerre (Midal 2009, 111) ou encore cette idée de la gute Form chère à Max Bill. Sauf que cette «  forme juste  », déjà pensée de manière transverse, continue entre intérieur et extérieur, entre forme et fonction (Midal 2009, 111), est aussi celle du corps.
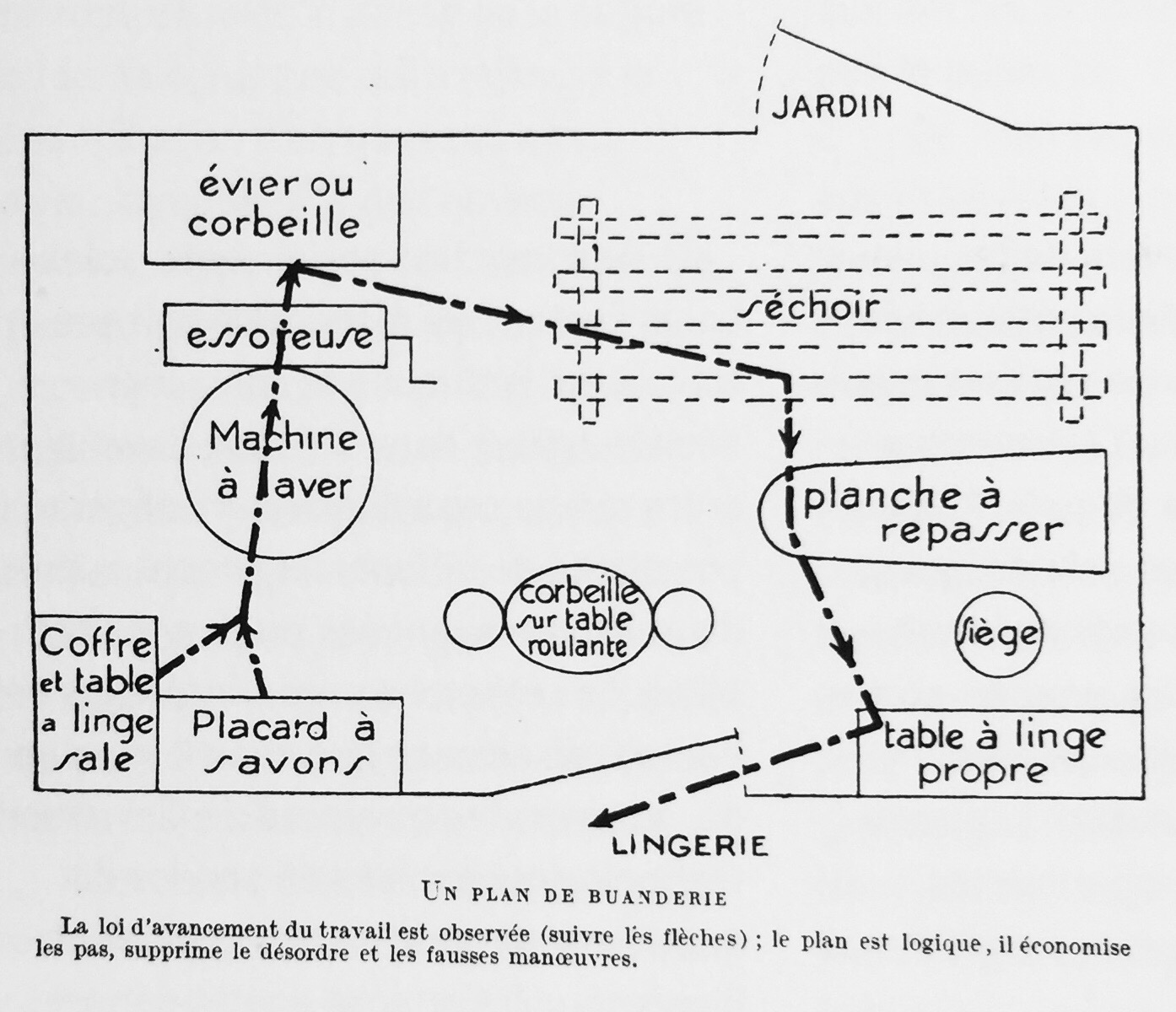
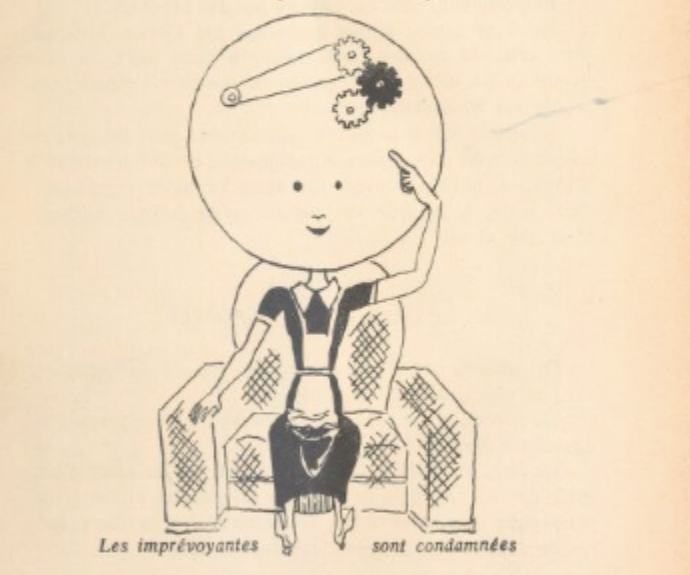
Dans Le Ménage simplifié, Paulette Bernège interpelle ainsi ses lectrices : «  Femmes redressez-vous !  » (1935, 14). Cet écho au Manifeste du Parti Communiste563 nʼimplique nullement des idéaux liés à la lutte des classes. Il incarne très bien le fil sur lequel ne cessent de danser lʼéconomie domestique et ses représentantes : lʼempouvoirement tient plus souvent dans ces écrits dʼune tonalité que dʼun véritable programme. Pire, lʼhexis corporelle ou «  ingénierie de lʼêtre humain  » (Clarke 2005, 155), suggérée par Bernège ici, bien quʼelle puisse être reliée à des intérêts sanitaires (protéger les femmes des maux de dos, en évoquant souvent, et à raison, les postures inclinées ; Bernège 1935, 14, 25) évoque aussi la nécessité pour la ménagère de rester séduisante, agréable à regarder -—ce que lʼon rapprochera difficilement dʼun programme féministe. Enfin, Jackie Clarke rappelle justement que le pouvoir incarné par la figure de la ménagère organisée est tout relatif. Elle écrit :
le recours à des techniques de gestion scientifiques dans la maison permettait de positionner les femmes comme des cadres, même si elles nʼavaient dʼautre personnel à diriger quʼelles-mêmes (Clarke 2005, 142).
La figure dʼune directrice qui ne dirige pas grand-chose émerge alors ; à moins de considérer lʼarmada des petits génies de la vie domestique -—les machines électroménagères -—comme autant dʼouvrier·es. En outre, cette dimension désempouvoirée de la ménagère fait écho à la propre position de Bernège dans lʼurbanisme et lʼarchitecture de son époque. Lʼautrice appartient à de nombreuses organisations et sʼintéresse aux productions théoriques de son temps (et contribue dʼailleurs avec des articles trop peu connus) mais nʼest globalement pas écoutée par les édiles politiques qui pensent alors le logement des classes moyennes et ouvrières. Sa brochure, Si les femmes faisaient les maisons, pourtant dédicacée au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Louis Le Loucheur (en charge des programmes de construction dʼalors), reste lettre morte -—mais tout comme la proposition de maisons économiques du Corbusier (Dumont 2012, 63).
De manière générale, Paulette Bernège est tout de même souvent raillée pour ses prises de position en faveur dʼune crédibilisation de la science ménagère, pensée en connexion avec lʼarchitecture (Henry 2003, 126). Parmi les personnes qui comprennent lʼintérêt du travail de Bernège, se trouve Henry Le Châtelier, disciple français et traducteur de Taylor pour qui la science ménagère permet aux futures générations de «  suc[er]le goà »t de la science dès la mamelle  » (Chatelier 1914, 32 in Clarke 2005, 154). Une telle proposition est riche de connotations : on y retrouve la centralité de la science (sinon du scientisme) dans lʼéducation au début du XXe siècle ; le lien entre savoir féminin et savoir des enfants ; et enfin, la manière dont lʼexpertise féminine, même lorsquʼelle est reconnue, traîne toujours lʼhéritage de sa sexuation «  femelle  » et du devoir moral de reproduction qui lui est attaché.
Paulette Bernège, quant à elle, souscrit sinon à la métaphore de lʼallaitement, au moins à lʼidée dʼun devoir éducatif envers les femmes. Jackie Clarke note dʼailleurs quʼil existe une dimension moins connue du travail de Bernège qui tient à ses composantes pédagogiques. Elle relève le lien inattendu entre la pensée de la journaliste et les théories émergentes de lʼéducation alternative alors élaborée par Maria Montessori (Clarke 2005, 148–153) : et pourtant, lʼapproche du corps-machine développée par le taylorisme semble difficilement compatible avec le développement de lʼenfant tel que le conçoit M. Montessori. Selon Jackie Clarke, cʼest le primat donné au travail pratique, et à lʼapprentissage par le faire, qui constitue le point de convergence entre deux idéologies apparemment antithétiques. Cʼest un point que je souhaiterais souligner dans le travail de Bernège, et qui me semble important à réactiver dans une pensée contemporaine de la cuisine, quand bien même lʼenseignement ménager peut sembler obsolète. Lʼidée de transmission par la pratique, souvent mobilisée aujourdʼhui au sujet du design et de la pédagogie564, possède peut-être un ancrage historique particulièrement pertinent et porteur en cuisine, et si Paulette Bernège est attachée à ce faire au féminin, elle se distingue aussi par une pensée concomitante du temps libre.
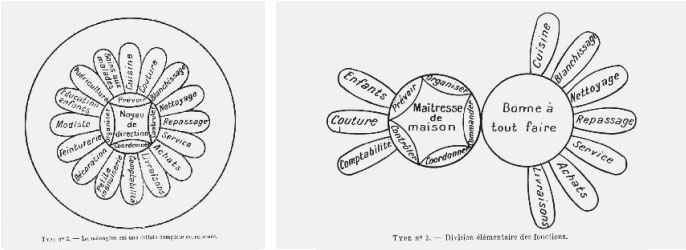
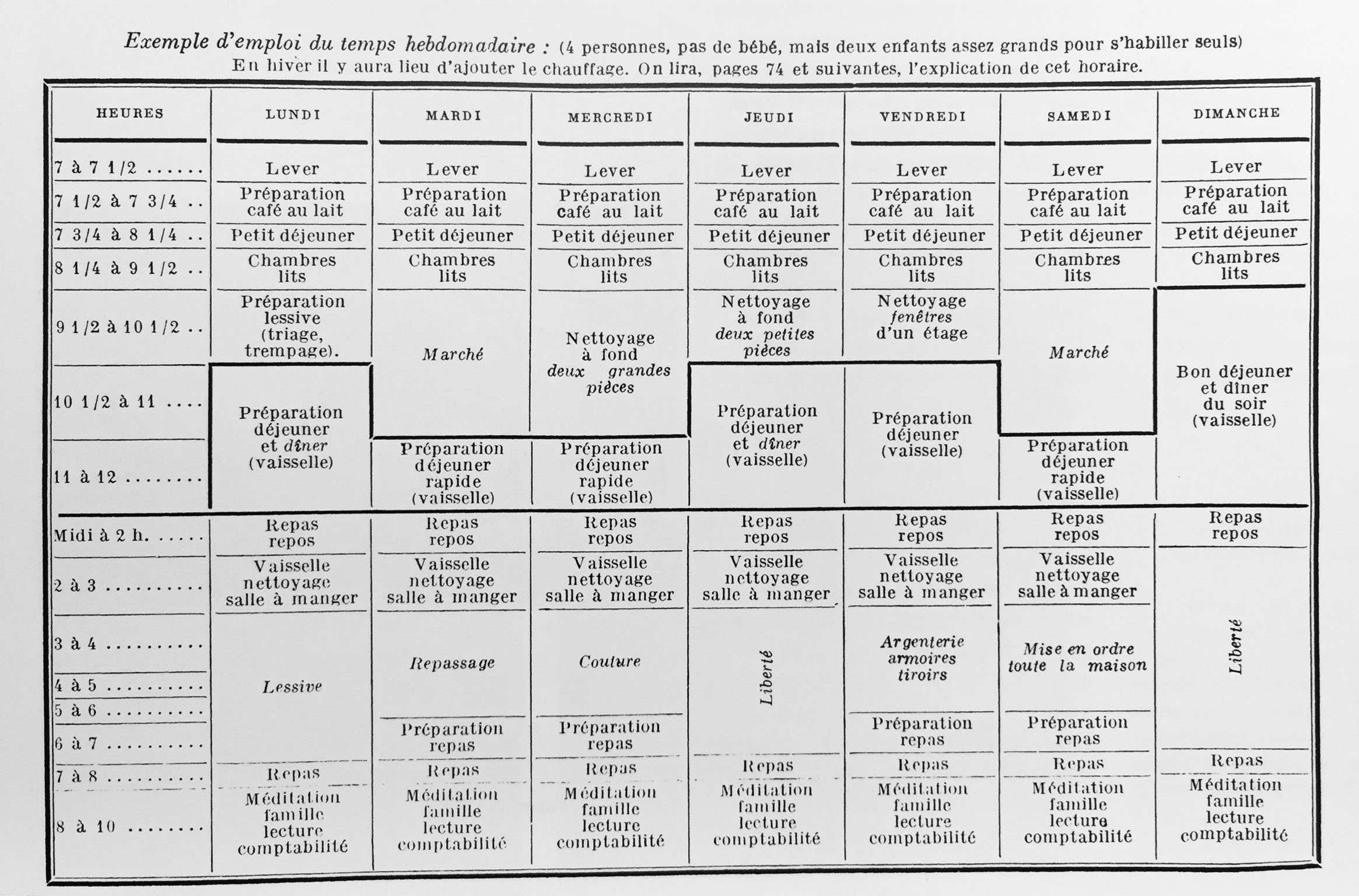
Dans les plannings (fig. 3.33, 2 illustrations) quʼelle publie (1928), elle découpe très soigneusement le temps -—dʼune manière qui nʼest pas étrangère à nos approches contemporaines, à renfort dʼapplications de gestion de lʼemploi du temps et de bullet journals. La portion de la semaine consacrée au temps libre de la ménagère est assez congrue dans cette proposition : environ une heure les midis, après le repas ; puis le jeudi de 15h à 19h et le dimanche de 14h à 19h. Dans ces semaines scriptées à lʼheure près, on constate de nouveau à quel point la ménagère doit être dédiée à sa famille. Mais ces deux plages du jeudi et du dimanche, joliment nommées «  Liberté  », en modifiant le sens dʼinscription du texte, font imaginer une subjectivité qui nʼest pas seulement celle de lʼouvrière domestique rationalisant chaque minute de temps disponible.
Dans le Ménage Simplifié, Bernège propose de «  rendre chaque journée plus longue en la faisant plus pleine  » (87) : dès le début du XXe siècle, alors que les femmes nʼont pas encore pleinement investi le domaine du travail salarié, se dessine déjà cette chasse au temps libre féminin qui deviendra un sujet brà »lant aux XXe et a fortiori au XXIe siècle565.
Si Paulette Bernège nʼest guère écoutée par les édiles françaises, cʼest en Allemagne que le modèle dʼune cuisine rationnelle, fonctionnelle, sort des pages des guides dʼéconomie domestique pour sʼincarner dans une proposition dʼarchitecture. Margarete Schütte-Lihotzky566 conçoit en effet la cuisine de Francfort ou «  la mère de toutes les cuisines équipées  »567 (Webster 2021–22, 38) à partir de 1925 dans le cadre du projet de construction du Nouveau Francfort (fig. 3.34) dirigé par Adolf Meyer, ancien collaborateur de Gropius (Clarisse 2004, 77), et par lʼarchitecte allemand Ernst May. Pour ce grand programme de réhabilitation, centré sur certains quartiers comme Römerstadt pensé en réponse à la crise immobilière (Webster 2021–22, 38), May rassemble une équipe de seize personnes, où la seule femme, Schütte-Lihotzky, est en charge de repenser lʼéquipement de la cuisine. Elle est la première femme à être diplômée en arts appliqués de lʼAcadémie des Arts Appliqués de Vienne. Cʼest dans cette ville quʼelle observe un fort afflux de migrant·es après la Première Guerre mondiale (Sudjic 2014, 262–263) et sʼinvestit dans les camps qui se matérialisent pour y installer lʼeau et lʼélectricité, dans le contexte de la grande épidémie de grippe de 1918 (Sudjic 2014, 263). Par Adolf Loos, que nous avons déjà croisé dans ces pages, elle fait la rencontre dʼErnst May (Sudjic 2014, 263 ; Henderson 2005, 234). Le contexte politique de la République de Weimar, qui va bénéficier aux expérimentations du Bauhaus -—notamment la Haus am Horn et sa cuisine en L -—est aussi favorable aux projets sociaux dʼenvergure. fig. 3.34 : Couvertue du magazine Das Neue Frankfurt (Le nouveau Francfort). Source : https:
fig. 3.34 : Couvertue du magazine Das Neue Frankfurt (Le nouveau Francfort). Source : https:
La cuisine de Francfort se distingue par sa taille réduite, de 6,27 m2 (Clarisse 2004, 78), dʼautant plus exiguë quʼau début du XXe siècle, en Europe, le stockage de la nourriture est communément intégré à cette pièce de la maison. Cette cuisine (fig. 3.35), sans doute une des plus célèbres de lʼhistoire du design -—au point quʼelle possède une aura mythique -—prend place dans des logements pour travailleur·ses pensés par des urbanistes, architectes et hygiénistes. Les maisons intègrent une cour, et les quartiers dans lesquels elles prennent place ne sont pas pensés en fonction de la voiture automobile (Webster 2021–22, 39). Enfin, ces logements sont raccordés au chauffage, au gaz, à lʼélectricité et à lʼeau courante (Clarisse 2004, 78).

Fait important, ils sont préfabriqués et impliquent des processus industriels quʼErnst May contribue à implanter à Francfort. Cette contrainte matérielle (la préfabrication) ainsi que lʼesprit du temps font de la cuisine de Francfort un produit standardisé. La forte contrainte de place donne lieu au choix dʼoptions versatiles, tel cet évier double bac en béton qui peut se couvrir dʼun couvercle pour augmenter lʼespace de travail.
Lʼévier nʼest quʼun des nombreux équipements qui distinguent cette proposition, et qui ont sans doute contribué à lʼélever au rang de marqueur dans lʼhistoire du design. Catherine Clarisse rappelle le nombre et la singularité de ces éléments : on trouve ainsi, dans la cuisine de Margarete Schütte-Lihotzky un garde-manger, une marmite norvégienne permettant de faire longuement mijoter les plats, une planche à repasser escamotable et des choix de revêtement de surface spécifiques (une laque bleue pensée pour éloigner les mouches, nous dit Catherine Clarisse). Aussi la taille réduite de la pièce nʼempêche-t-elle nullement de penser un plan de travail continu, dans le prolongement des projections de Catharine Beecher. Comme chez Beecher, lʼespace sous le plan est rentabilisé pour stocker des ingrédients comme la farine ; chez Schütte-Lihotzky, les contenants sont redessinés pour devenir des modules aux faces carrées pour éviter la perte de place (fig. 3.36). fig. 3.36 : Les contenants en métal proposés dans la cuisine de Francfort, partie de la conception de Margarete Schütte-Lihotzky. Là où lʼespace sous le plan de travail nʼest pas occupé de la sorte, lʼespace libre est utilisé pour stocker un tabouret, dont Catherine Clarisse nous dit quʼil est «  très peu confortable  » (2004, 80) et dont la silhouette est évocatrice du laboratoire scientifique. Une lampe unique, montée sur un trolley, achève de faire du plan de travail de la cuisine une sorte de paillasse. Les chercheureuses Genevieve Bell and Joseph «  Jofish  » Kaye rappellent ainsi que lʼanalogie entre cuisine et espace expérimental faisait lʼobjectif dʼun processus conscient chez lʼarchitecte Margarete Schütte-Lihotzky qui évoque en effet «  une cuisine en forme de laboratoire, avec des types spécifiques de surfaces de travail, de tiroirs et de placards pour des fonctions et des ustensiles spécifiques  »569 (Bell & Kaye 2002, 63).
fig. 3.36 : Les contenants en métal proposés dans la cuisine de Francfort, partie de la conception de Margarete Schütte-Lihotzky. Là où lʼespace sous le plan de travail nʼest pas occupé de la sorte, lʼespace libre est utilisé pour stocker un tabouret, dont Catherine Clarisse nous dit quʼil est «  très peu confortable  » (2004, 80) et dont la silhouette est évocatrice du laboratoire scientifique. Une lampe unique, montée sur un trolley, achève de faire du plan de travail de la cuisine une sorte de paillasse. Les chercheureuses Genevieve Bell and Joseph «  Jofish  » Kaye rappellent ainsi que lʼanalogie entre cuisine et espace expérimental faisait lʼobjectif dʼun processus conscient chez lʼarchitecte Margarete Schütte-Lihotzky qui évoque en effet «  une cuisine en forme de laboratoire, avec des types spécifiques de surfaces de travail, de tiroirs et de placards pour des fonctions et des ustensiles spécifiques  »569 (Bell & Kaye 2002, 63).
Les cuisines évoquées précédemment témoignent des ambivalences des femmes défendant lʼéconomie domestique, entre revalorisation du travail féminin et esquive de ce travail au travers dʼune carrière dʼexperte. La cuisine de Francfort, quant à elle, incarne les tensions qui traversent le design et lʼarchitecture de son temps, tensions renforcées par les problématiques de genre liées à lʼinscription de Margarete Schütte-Lihotzky dans sa discipline. La cuisine de lʼarchitecte viennoise prolonge les intentions des tenantes de lʼéconomie domestique, en approchant le travail de la ménagère sous un angle rationnel. Ce regard est favorisé par les idéologies tayloristes en vigueur à cette époque mais aussi par lʼhéritage du Werkbund, notamment incarné par le Bauhaus, qui prête à la standardisation des vertus démocratiques (Midal 2009, 100–102). Mais le rationalisme, dans lʼhistoire du design, nʼest jamais seulement une simple focalisation sur les besoins au détriment des esthétiques. Au contraire, le goà »t de lʼefficience et lʼidéal de la juste matérialisation sʼincarnent fréquemment dans une «  esthétique de la réduction  » (Midal 2009, 102) qui, si elle se veut neutre, ne lʼest en aucun cas.

Il faut donc, dans cette histoire critique de la cuisine, démêler ce qui tient du rationalisme et ce qui relève dʼesthétiques de la rationalité. Sans vouloir trop strictement séparer la forme du fond (ce qui, particulièrement en design, serait assez vain), il faut tout de même faire la différence entre des éléments qui incarnent lʼefficience visuellement, et les usages concrets -—et ce dʼautant plus que, comme le rappelle lʼhistorienne de lʼart Gwendolen Webster, la cuisine de Margarete Schütte-Lihotzky nʼest plus uniquement une cuisine dans un habitat ouvrier, mais un type, une pièce de musée, de catalogue, vouée à représenter une époque et ses intentions, au prix de raccourcis ou de simplifications que je détaillerai plus loin. Pour la journaliste June Freeman, lʼapport européen dans le design contemporain des cuisines se situe à cet endroit : il ne sʼagit pas uniquement de «  lisser un peu plus les processus de travail dans la cuisine, mais de refléter visuellement cette nouvelle efficience  »570 (2004, 33). La cuisine de Francfort difficile à analyser dans la mesure où elle existe plusieurs fois : comme lieu concret, décliné en quelques 15 000 exemplaires571 entre 1926 et 1930 (Clarisse 2004, 78) et comme type, consacré dans lʼhistoire du design comme lʼorigine de nos cuisines occidentales contemporaines.
Cette permanence de lʼimage de la cuisine de Francfort peut facilement faire oublier la réalité de ses déclinaisons, et donc de ses usages. Les supports visuels qui font la promotion des cuisines modernes, alors innovantes, dans les années 1930 tendent à accentuer ses dimensions rationnelles en les représentant hors du temps, hors du vivant, comme sur lʼaffiche Die Praktische Küche qui fait la promotion dʼune exposition au Museum de Bâle (1930, fig. 3.37). La cuisine en question, designée par lʼarchitecte Rudolf Preiswerk, est déconnectée de la boniche, des fumées grasses, et même de lʼespace euclidien. Projetée dans lʼidéal de la ligne claire et de la perspective axonométrique, elle se présente plutôt comme le type quʼelle incarne, plutôt que comme un espace parcouru dʼusages. Gwendolen Webster, lorsquʼelle revisite la cuisine de Francfort en 2021–22 pour The Architectural Review, rappelle cet écart entre les équipements effectivement installés, et ceux qui ont été retirés de leur contexte dʼorigine pour être conservés dans des musées :
Malgré lʼeffort de May en direction de la standardisation, LA cuisine de Francfort nʼa jamais existé. La taille et la disposition dépendaient du lieu dʼinstallation et de la phase de construction, de multiples adaptations et ajustements furent introduits, les dispositions ainsi que les couleurs variaient énormément, et enfin les cuisines de démonstration étaient différentes de leurs équivalents fonctionnels572 (Webster 2021–22, 41).
Cette observation est confirmée par les illustrations qui accompagnent le propos de Webster. Là où les manuels dʼhistoire choisissent souvent la même photographie des années 20 pour représenter la création de Margarete Schütte-Lihotzky, ici plusieurs variantes plus ou moins fonctionnelles de cette cuisine sont confrontées. À ces écarts dʼune cuisine à lʼautre sʼajoutent le contraste entre usages projetés et usages concrets.
Pour Gwendolen Webster, la caractéristique clé de la cuisine de Francfort ne réside pas dans les multiples équipements (bien que ceux-ci soient importants) mais dans lʼaccès ménagé vers la cuisine. Cʼest une considération cruciale pour mon travail, car à se concentrer sur «  la cuisine  », je pourrais oublier sa place relative dans un plan dʼensemble, celui du logis. La cuisine de Francfort est étroitement associée à un salon. Selon ses matérialisations, la porte qui les fait communiquer peut être coulissante ou montée sur gonds (Webster, 2021–22, 41). La construction de ce passage (fig. 3.38) participe de la définition des usages et des pratiques de la ménagère, non seulement en cuisine, mais plus globalement au foyer. Ainsi, cette articulation au salon permet de servir aisément les plats, mais aussi de jeter un Å“il sur les enfants qui jouent (Webster, 2021–22, 41).
Toutefois, usage possible et usage effectif sont deux choses bien différentes. Dans les faits, selon Gwendolen Webster, le passage se retrouve obstrué par de gros sofas, héritage du mobilier victorien qui, sʼil est critiqué par les tenants de lʼéconomie de formes moderniste, nʼa pour autant pas disparu des habitus de classe des usager·es réel·les. La question de lʼusage effectif est hautement historique : un usage bien pensé, à une époque, peut se révéler comme un véritable écueil quelques années plus tard. Ainsi, G. Webster observe quʼavec le temps, cette ouverture vers le salon est aisément interprétée comme un espace libre, où a pu se loger, par exemple, un réfrigérateur. Il ne faut donc pas confondre la séduction de lʼimage573, qui participe à fabriquer le mythe historique, avec le projet en tant que tel. Et dʼailleurs, sʼil est admis que cette cuisine est mythique, quʼen ont retenu les cuisines du XXe siècle plus tardif ?
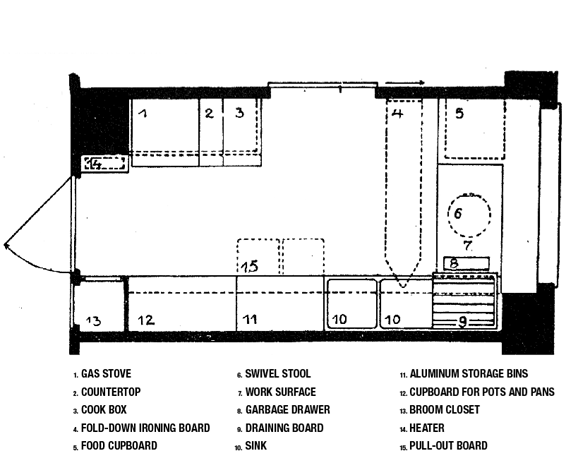
Concernant la pratique propre à Margarete Schütte-Lihotzky, il est certain quʼune partie du projet social a été perdue en route, ou relocalisée. Ses propositions politiquement progressistes sont en effet rejetées par le gouvernement nationaliste socialiste dʼAdolf Hitler arrivé au pouvoir en 1932–33, qui y voit un «  gloubiboulga bolchévique  »574 (Webster, 2021–22, 42). De son côté, Margarete Schütte-Lihotzky est sollicitée par Ernst May pour poursuivre son travail en Russie à partir de 1930575 : son équipe designe alors des villes entières, comme Magnitogorsk. Schütte-Lihotzky fait également des propositions pour des écoles à Cuba (Sudjic 2014, 262). En outre, lʼancêtre de la cuisine équipée possède une forte ressemblance avec les modèles qui émergent dans les années 50, après-guerre, et qui sont alors associés aux discours technophiles sur lʼélectroménager. Il ne faut toutefois pas oublier que cette proposition est liée à un contexte, celui dʼun foyer pensé selon des idéaux socialistes, ou le linge, par exemple, est lavé dans des équipements collectifs proposés dans lʼimmeuble. Catherine Clarisse nous met ainsi en garde contre la séduction de la cuisine de musée et sa «  photogéni[e]  » (Clarisse 2004, 83) :
À force de répéter depuis soixante-quinze ans que cette cuisine est performante, on a certainement oublié que le plus innovant pour cette période était sans doute la préfabrication, lʼeau courante et lʼunique suspension électrique. Mais pour ce qui est de la vaisselle faite à la main, de la cuisson des mets et du trempage du linge dans la marmite norvégienne, du travail debout seule, du stockage des denrées sans réfrigérateur, de lʼéclairage en plafond sur trolley, ce modèle est-il encore bien dʼactualité ?
À lʼimpossible nul·le nʼest tenu·e, et on ne saurait reprocher à une architecte viennoise de nʼavoir pas imaginé à la perfection il y a 100 ans nos usages contemporains. La précaution de Catherine Clarisse est utile néanmoins, puisquʼelle autorise à passer outre le vernis «  vintage  » de la cuisine de Francfort pour véritablement saisir la nature de son héritage.
À chaque fois que jʼai évoqué une théoricienne de lʼéconomie domestique, jʼai interrogé la manière dont ses discours et ses actes se relient à un programme potentiellement féministe. Je dis bien «   potentiellement  », car je suis plus intéressé par la portée dʼun travail, que par lʼattribution anachronique de la qualité de «   féministe  » à des femmes qui ont vécu dans des contextes historiques bien différents du nôtre. Le fait que Margarete Schütte-Lihotzky ait été reconnue de son vivant comme architecte ne doit pas la dispenser de cet examen, ce qui lui accorderait une sorte de privilège masculin par procuration -—même si son travail nʼa été reconnu quʼà lʼapproche de ses quatre-vingt-dix ans. Les recherches plus récentes sur la cuisine de Francfort mettent en lumière un autorat où Margarete Schütte-Lihotzky joue un rôle moins central. Sans rien retirer à lʼarchitecte ni sous-estimer ses contributions, Gwendolen Webster affirme quʼune grande partie de la cuisine était déjà conçue lorsque lʼarchitecte viennoise a rejoint lʼéquipe dʼErnst May. Schütte-Lihotzky affirme même plus tard dans ses écrits quʼelle a subi des pressions de la part de ses collègues masculins pour que la cuisine soit associée à son nom, puisquʼil était stratégiquement intéressant de faire la publicité dʼune «  cuisine pour les femmes par les femmes  »576 (Webster 2021–22, 39) -—peut-être au détriment dʼautres aspects de ces logements auxquels elle a contribué ? Si la cuisine de Francfort est donc une cuisine éminemment médiatique, son architecte elle-même lui a peut-être davantage apporté sur le plan de la représentation que de la conception. Et en effet, Schütte-Lihotzky a été la «  porte-parole  »577 (Webster 2021–22, 39) de cette cuisine par le jeu dʼun biais de genre : même «  sorties  » de la cuisine, les femmes qui ne lui sont plus assignées peuvent en subir les connotations négatives en lui étant associées.
Pourtant, de son propre aveu, Schütte-Lihotzky nʼavait jamais cuisiné de sa vie (Kinchin & OʼConnor 2011, 20 ; Meah 2016, 44 ). Elle était même assez ambivalente au sujet de la relation entre genre et architecture ; il est possible également que sa constante association avec la cuisine de Francfort, au détriment du reste de son travail, lʼait lassée au point de vouloir sʼen détourner : comme en cinéma, où seules les réalisatrices sont sommées dʼexpliquer leur «  caméra au féminin  », les femmes architectes sont souvent invitées à expliquer la relation entre genre et architecture, ou plutôt entre leur genre et leur production architecturale, ce dont leurs collègues masculins nʼont en général jamais à répondre. Dans les faits, son travail est empreint des idées socialistes de son temps, qui parfois se colorent dʼune approche que lʼon pourrait dire féministe : ainsi, à Francfort, Schütte-Lihotzky convainc Ernst May dʼintégrer les femmes célibataires dans ses projets de logements sociaux, plutôt que de les séparer des familles, dans des ghettos, ce qui leur permet de proposer leurs services domestiques contre rémunération (Sudjic 2014, 264). Lʼarchitecte associe donc une pensée située concrète à sa pratique de lʼarchitecture, mais sa position de femme lʼenferme au point, peut-être, de la figer dans une figure de «  femme designant pour les femmes  ». Pour cette raison, il convient de valoriser son travail, tout en se méfiant des effets de halo qui nous poussent à faire lʼhistoire dʼune femme plutôt que dʼune autre578, tout comme, auparavant, on a pu faire lʼhistoire des hommes plutôt que des femmes. Jʼachève ici ce parcours historique, mais il existe bien dʼautres théoriciennes de lʼaménagement de la cuisine auxquelles il faudrait consacrer des essais détaillés : Irene Witte pourrait bien être la Paulette Bernège allemande, tandis quʼen Espagne, Pilar Primo de Riveira579 a associé son engagement franquiste à lʼécriture de guides sur la domesticité ; en Allemagne, à nouveau, la docteure Erna Meyer publie un guide peu différent des écrits de Christine Frederick (Giedion 1948, 526) et au Canada, cʼest Phyllis Wilson Cook qui est une des premières femmes à publier un article dans une revue académique dʼarchitecture en 1935 et qui défend une cuisine rationnelle (Adams & Tancred 2000, 40). Ce sont aussi, enfin, des anonymes comme cette «  femme de ferme  »580 citée par Siegfried Giedion (1948, 303), qui donne son plan pour réaliser une petite maison permettant dʼéconomiser des pas. Pour paraphraser Bernège, nous pouvons nous demander à quoi ressembleraient les maisons si les femmes les concevaient mais aussi à quoi ressemblerait le monde sʼil était admis quʼelles lʼont toujours fait.
La cuisine nʼa pas toujours existé, en tout cas, pas selon le modèle dʼune boîte rationalisée remplie dʼoutils électriques. Lʼévidence de la cuisine équipée nʼen est pas une et jʼai tâché de la replacer dans son histoire, en lʼarticulant, comme dʼautres avant moi (Alexandra Midal et Dolores Hayden notamment), au travail des femmes et à leur inscription dans le domaine de lʼéconomie domestique. Si ces femmes y occupent une place ambivalente, la lecture qui peut être faite de leur investissement et de leur héritage lʼest tout autant. Étaient-elles des designers ? Répondre par la négative nous ferait prendre le risque dʼune invisibilisation ; pourtant, leur production, sans être totalement immatérielle, peut par endroits relever davantage de la théorisation, de la prescription et de la poétisation que de véritables propositions de projet. Il est certain que Margarete Schütte-Lihotzky était davantage une designer que Catharine Beecher (ne serait-ce que socialement, et même sur le plan de la contribution matérielle). Une question parallèle peut être adressée à ces figures (plutôt quʼaux femmes prises individuellement) : étaient-elles féministes ?
Les deux questions me semblent finalement assez vaines : lʼobjet de mon examen doit être les conditions auxquelles ces femmes peuvent nous apparaître comme designers, comme féministes, comme designers féministes581. Il me semble donc que les analyses que jʼai livrées des travaux des sÅ“urs Beecher, de Christine Frederick, Paulette Bernège et Margarete Schütte-Lihotzky mettent en évidence le fait que le féminisme, comme praxis, est une activité négociée. Sʼaffirmer comme femme créatrice est un geste féministe, puisque tout, dans les sociétés patriarcales, est agencé pour empêcher ce positionnement. Toutefois, et cʼest le trait des cultures dominantes, il nʼest pas rare que des personnes issues de minorités soient sélectionnées, acceptées comme lʼexception qui confirme la règle : la femme choisie pour être architecte sʼest sà »rement battue pour le devenir, mais son intégration, plus quʼune percée, peut sʼavérer stratégique, comme la justification a posteriori dʼune fiction égalitariste que lʼarchitecture se raconte à propos dʼelle-même. Les théoriciennes de lʼéconomie domestique nʼéchappent pas à cette instrumentalisation, pas plus quʼelles ne résolvent ce paradoxe : occupées à fonder leur carrière sur la cuisine, elles y passent finalement bien moins de temps (et dans certains cas, pas du tout) que les femmes auxquelles elles sʼadressent.
Lʼéconomie domestique, elle-même, est traversée de contradictions : il faut économiser (du temps, des pas), mais pour cela il faut dépenser (de lʼargent). La femme au foyer ne saurait apparaître comme une oisive : on met alors lʼaccent sur ses efforts, on les valorise, tout en cherchant à les réduire et à faciliter les tâches. Si lʼeffort importe, les compétences comptent tout autant : et les écrits dʼélever ce travail au féminin, si précis et technique quʼon en vient à se demander pourquoi il se limite à la sphère de la cuisine… Cette valorisation technique, qui reste tout de même la «  fiction dʼune qualification professionnelle  » (Leymonerie 2012, 56), si elle possède en apparence quelque chose de féministe, réclame alors son contrepoint. Mobiliser les vertus reproductives et morales de la mère permet de désamorcer cet empouvoirement naissant en associant des savoir-faire à un espace délimité. Il en résulte que la femme au foyer, ou la boniche, est un paradoxe vivant. Quʼelles soient Home Minister, Mrs. Consumer ou encore Home Manager, ces figures héritent des hésitations de leurs têtes penseuses, ces «  captives volontaires  » (Leymonerie 2012, 56) qui sont à la fois des objets et des agents (Clarke 2005, 155). Lʼéchec de lʼéconomie domestique à véritablement empouvoirer les femmes participe de lʼabandon de la cuisine et plus largement de lʼespace domestique, perçu comme une prison. Dolores Hayden le met bien en évidence lorsquʼelle affirme dans les années 1980 quʼ«  il nʼest pas nécessaire pour les féministes de souscrire au concept victorien de la sphère féminine, mais plutôt dʼaccepter que la sphère féminine comme une base essentielle, matérielle et historique  »582 (Hayden 1982, 303). Pour la chercheuse, lʼespace domestique a été trop vite récupéré par le capitalisme, sans que des idéaux alternatifs soient considérés.
Quels ont été les apports des théoriciennes domestiques ? Si leur contribution à lʼautonomie féministe est hétérogène et contradictoire, leurs apports en termes de design sont parfois tout aussi flous. On parle beaucoup du plan de travail, mais il est possible que lʼinfluence de Catharine Beecher à ce sujet ait été surestimée. Leslie Land, dans son étude de la hauteur des plans de travail et du placement du four dans les cuisines étasuniennes, observe en effet que cette innovation du plan de travail continu, si elle est souvent attribuée à la théoricienne (y compris dans ces lignes qui reconnaissent lʼapport de lʼautrice), peut tout aussi bien, sinon plus, être reliée à la production de lʼentreprise Hoosier (2005). L. Land explique en effet comment, malgré les recommandations de Christine Frederick et Lillian Gilbreth au sujet des hauteurs de plan de travail, un seul standard -—la hauteur de plan à 90 centimètres (36 pouces) -—sʼest imposée pour devenir une mesure unique aux États-Unis. Peu importe que ces autrices, et bien dʼautres après elles, aient affirmé que faire la vaisselle, couper des légumes ou pétrir une pâte sont des tâches essentiellement différentes, qui réclament des postures distinctes et donc des hauteurs de plan variables selon les individus. Peu importe, aussi, que le four bas ait été au cours de lʼhistoire régulièrement critiqué (Land 2005, 57), notamment parce quʼil impose une posture penchée très précaire pour le dos. L. Land montre en effet que les industriels (Hoosier, notamment), dʼabord engagés pour produire des équipements durables, ont dà » trouver avec la crise de 1929 des moyens de continuer à vendre des fours qui nʼavaient en réalité pas besoin dʼêtre remplacés (2005, 46). Lʼesthétique streamline qui, dans les années 1925–40, devient dominante aux États-Unis et en Occident, impose ses lignes continues et ses courbes tendues évocatrices dʼune conception aérodynamique, susceptibles dʼincarner la vitesse et le progrès technique propres à la modernité.
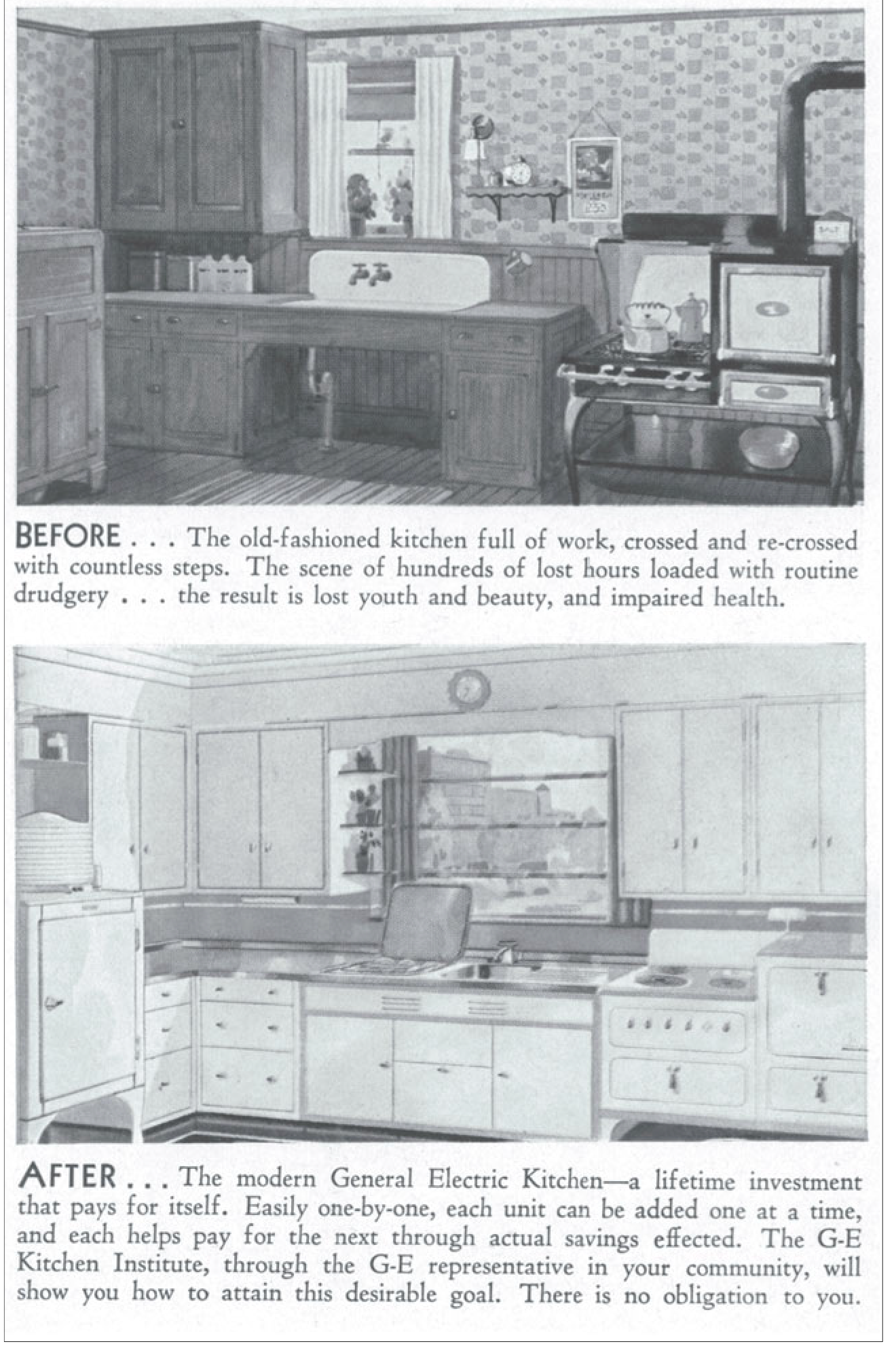
La séduction dʼun plan de travail continu répond davantage à cette esthétique et à lʼargument de vente quʼelle rend possible quʼà un véritable souci de praticité (Land 2005, 53). Imposer ce registre de formes permet aux industriels de continuer à vendre en situation de crise, dans la logique du capitalisme productiviste. Les groupes de consommateurs ont bien affirmé et défendu leur préférence pour des équipements à la hauteur ajustée (2005, 57), mais in fine, cʼest la séduction de lʼunité visuelle qui a prévalu (fig. 3.39). Là où la hauteur repère, dictant toutes les autres, aurait dà » être celle du fond de lʼévier (et non de sa partie haute), cʼest le four, qui en se rangeant sous le comptoir, en a dicté les dimensions.
Réexaminer lʼhistoire du design avec une approche queer et féministe implique de procéder avec prudence. Le premier mouvement, dans une telle entreprise, semble logiquement de visibiliser les femmes oubliées par une histoire patriarcale : mais ce geste, sʼil est féministe, peut avoir des conséquences négatives en starifiant des figures phares. Ceci peut conduire à la disparition de lʼhistoire de certaines femmes mais aussi de toute une somme dʼacteurices impliqué·es dans les processus de conception et de fabrication. Si on ne peut pas redonner un nom à toustes les anonymes qui ont participé à cet effort, on peut au moins sʼabstenir dʼhéroïser des femmes après avoir héroïsé des hommes pendant des décennies. Cette prudence repose sur deux volontés : celle de préférer des histoires complexes, impliquant une multiplicité dʼacteurices, à des récits simples faisant dʼune seule personne le créateur génial dʼune innovation ; celle de proposer une perspective intersectionnelle qui nʼest pas dupe de lʼinscription sociale et raciale des femmes qui parviennent à se tailler une place dans le monde très masculin du design. Les figures célèbres dont jʼai traité ne doivent nullement être considérées les inventeures uniques de certaines formes de cuisine, mais plutôt comme des figures médiatiques, qui avaient conscience de cet état de fait, et qui ont modelé leur carrière sur ce modèle. Les images quʼelles ont produites ont suffisamment de force et peuvent nous persuader quʼelles sont à lʼorigine de tel ou tel apport -—mais le plus souvent, lʼorigine de ces innovations est plurielle. Ce mouvement est quasiment inverse à celui que produit une volonté féministe de recentraliser certaines figures : cʼest bien dans cette double volonté, visibiliser sans héroïser, que lʼhistoire de la cuisine doit encore être constituée.
Il importe enfin dʼanalyser ces figures avec rigueur, surtout celles qui sont associées à lʼéconomie domestique, car elles sont contre toute attente pérennes et susceptibles de connaître un renouveau aujourdʼhui, dans les années 2020. Les travaux dʼAlexandra Midal, Leslie Land, Penny Sparke ou Barbara Penner témoignent depuis les années 2005–10 dʼune volonté de déconstruire lʼhistoire patriarcale du design pour mettre en évidence les contributions des femmes. Par ailleurs, la culture populaire, caractérisée par une conscience grandissante des conséquences de la crise climatique mais aussi séduite par le DIY et les modes de vie alternatifs, est particulièrement disposée à valoriser des influenceur·ses (et surtout des influenceuses) qui défendent un mode de vie domestique marqué par la «  sobriété  », la débrouillardise et le retour à des savoirs oubliés. Il convient donc de ne pas seulement relier ce phénomène culturel aux seules sensibilités écologistes mais à une histoire plus ancienne, qui permet de visibiliser encore un peu plus la dimension éminemment médiatique de ces contenus. Si les premières théoriciennes de lʼéconomie domestique proposent des modèles qui paraissent parfois «  directement issues dʼune farce biopolitique foucaldienne  »583 (Penner 2018), elles doivent sans doute être valorisées, sinon pour leurs contributions directes aux questions de conception, du moins pour leur posture initiale. En effet, au-delà de la seule valorisation du travail féminin, il y a encore aujourdʼhui quelque chose de radical à affirmer la possibilité dʼune science qui ne se fait pas en laboratoire mais entre les murs de la maison individuelle.
Et la cuisine, dans tout cela ? Comment a-t-elle changé, au gré de cet intérêt soudain que lui portent successivement les économistes du foyer, les tayloristes et les architectes entre 1850 et 1950 ? De quelle cuisine a accouché la science domestique ? Ce qui reçoit plus dʼattention gagne logiquement plus dʼimportance : or, lʼhistoire de la cuisine contredit ce principe, au point que Catherine Clarisse considère le modèle des années 50 -—qui résulte de lʼhistoire que nous avons traversée -—comme une «  pauvre petite cuisine  » (2004, 23 ; Leymonerie 2006, §16). Que la cuisine se rationalise pour faire économiser les pas et elle rétrécit ; quʼelle se rationalise en condensant ses équipements, et cʼest un plan de travail continu qui se matérialise, au mépris des nécessités dʼusage. En somme, la cuisine émerge, entre 1850 et 1950, au cÅ“ur dʼun faisceau de négociations contradictoires : les femmes doivent être à lʼaise, mais seulement si cela ne contrevient pas au projet économique et esthétique de la modernité ; les femmes sont les maîtresses de la maison, sauf sʼil est plus simple de concevoir la cuisine comme une petite boîte dont elles sont captives.
Dans ce champ conflictuel, le modèle qui semble prévaloir est traversé par des dynamiques conjointes de rétrécissement et de la fusion. Dʼautres mouvements marquent lʼhistoire de la cuisine : notamment, le fait de fusionner ou de dissocier cuisine et salle à manger fait lʼobjet selon les époques de positionnements différents, justifiés par les conventions dʼhygiène, les questions de ventilation, et souvent, en dernier lieu, lʼexpérience des usager·es qui vivent et travaillent dans cet espace. La taille, on lʼa vu, est également un marqueur de classe puissant quand il sʼagit de la cuisine, surtout dans les modèles contemporains où le plan de travail se décroche du mur pour fusionner avec la table à manger dans lʼîlot central, plus ou moins sculptural. La cuisine change donc de forme pour accompagner les changements des usages, représentation sociale comprise. Or, je lʼai évoqué, que les femmes aient quitté ou non la cuisine pour le travail salarié, elles sont toujours affectées par lʼidée sous-jacente que celle-ci est leur espace. Il nʼest peut-être plus le leur dans le sens où elles y seraient confinées, mais il reste à elles, pour elles, en tant quʼusagères projetées. Jʼai évoqué les femmes qui avaient contribué à façonner lʼidée de la cuisine moderne : à présent, je vais examiner la manière dont la cuisine les produit, en retour. À cette occasion, jʼutiliserai la question de Paulette Bernège comme invitation à penser. Si les femmes faisaient les maisons… Pourquoi ne les font-elles pas ? Quel système les empêche-t-il de les faire ? Et que se passe-t-il quand, contre toute attente, elles y parviennent ?
Avant dʼexister concrètement comme usagères de la cuisine, les femmes sont des usagères projetées de cet espace. On me rétorquera peut-être quʼen 2024, une telle projection est dépassée : les femmes sont bien intégrées sur le marché du travail, et de nombreuses politiques dʼinclusivité et dʼégalité leur garantissent une place inédite sur le marché du travail salarié. Jʼai déjà eu lʼoccasion de montrer que ce paysage nʼest pas aussi rayonnant quʼil y paraît. Il est déjà contestable que les femmes soient effectivement les égales des hommes sur le marché du travail ; et en y regardant dʼun peu plus près, il apparaît que ce ne sont pas toutes les femmes qui bénéficient de cette intégration. Du reste, de nombreux travaux, en sociologie notamment, ont montré comment le travail domestique, même lorsquʼil est partagé, est encore considéré comme un travail de femme. On le sent parfois poindre dans des éléments de langage -—une femme qui dira faire ses vitres, son ménage (Chollet 2015, 195) -—ou, par effet miroir dans les postures des hommes, telle celle de «  lʼhomme élève  » pointée par Jean-Claude Kaufman (2022[1992], 260), de lʼhomme qui «  aide  » (Kaufman, 2015[2005], 282) mais dont le travail vient en annexe ou dans lʼaprès-coup. La cuisine est donc un espace de femmes, mais quʼelles ne conçoivent pas. Les femmes sont pourtant nombreuses dans les écoles de design, même très largement dominantes dans les classes584 sur le plan numérique. Toutefois, que ce soit dans les revues, les festivals ou les expositions, ce sont les hommes qui dominent encore la profession du design (Brunet & Geel 2023, 217) : dès quʼil y a reconnaissance publique, les femmes passent au second plan.
Nous lʼavons vu plus haut, faire une histoire féministe du design est une gageure, et cʼest une entreprise qui comporte plus dʼun piège. Ces pièges rejouent, au fond, ceux qui jalonnent le parcours des femmes en design et en architecture. Jʼai déjà évoqué, dans lʼintroduction de cet écrit la manière dont les femmes ont été systématiquement traitées comme «  sujets seconds  » en architecture (cf. infra., p. XX). Jʼaimerais à présent expliciter davantage la manière dont les femmes sont exclues du domaine de lʼarchitecture, et les conditions auxquelles elles y sont exceptionnellement intégrées585. Certaines de ces observations, si elles sʼappliquent à dʼautres populations minorisées, doivent aussi être pensées à lʼintersection dʼautres oppressions. Jʼévoquerai donc tour à tour lʼinvisibilisation et lʼinstrumentalisation du travail des femmes, puis je parlerai plus spécifiquement de la misogynie et de ses formes. Je séparerai pour plus de clarté mon propos à ce sujet en deux catégories : cette misogynie dite «  crasse  », parce quʼelle est habituelle, générique, et repose sur des principes classiques qui tendent à traverser tous les domaines de la vie et toutes les disciplines du savoir (association du féminin à la faiblesse, la folie, la beauté, la coquetterie, la sensiblerie, etc.) et une forme de misogynie plus subtile (ce qui ne la rend nullement plus acceptable), spécifique à la discipline de lʼarchitecture -—ou du moins, aux arts, comme en témoigne leur histoire. Tout ce propos prépare un renversement, soit un parcours des manières, des postures et des méthodes qui rendent possible le fait de lutter contre le patriarcat dans le domaine de lʼArchitecture et à travers lui -—spécifiquement, en réinventant la domesticité et la cuisine.
Le premier effet du sexisme, pour les femmes, se traduit souvent dans les arts, les sciences par une pure et simple absence. Celle-ci peut être concrète : pendant longtemps, ne pas laisser les femmes sʼinscrire à lʼuniversité était un des plus sà »rs moyens de sʼassurer quʼelles ne deviennent ni avocates, ni architectes, ni médecins. Lorsque les femmes trouvent les moyens de faire malgré ces embà »ches, il est encore possible dʼignorer leurs accomplissements ou de les réécrire dans lʼombre des hommes qui ont partagé leur vie et parfois leurs ateliers : il faut ainsi découvrir un peu tard que la méridienne Barcelona signée par Mies van der Rohe est en réalité co-réalisée par Lily Reich (Dietsch 1981, 73–74) ; on apprend un peu tard que Sonia Delaunay586 ne devait pas tout à Robert, et que, étant designer textile, elle ne se contente pas de réaliser des Å“uvres jumelles à celles de son époux (Bonnet 2006, 46) ; enfin, on se souviendra avoir entendu parler au sujet du Bauhaus de figures comme Johannes Itten, Walter Gropius, Marcel Breuer ou Mies van der Rohe mais plus rarement, voire jamais, de Lily Arndt, Alma Siedhoff-Buscher (Brunet & Geel 2023, 217), Anni Albers, Léna Bergner, Gunta Stölzl, Ljuba Monastirsky, Otti Berger, Lis Beyer, Elisabeth Mueller, Rosa Berger, Ruth Hollós ou encore Lisbeth Oestreicher. fig. 3.41 : Photo de Lux Feininger reproduite par Elizabeth Otto & Patrick Rössler (2019) ainsi que les informations fournies pour cette légende. L’image montre les membres de l’atelier de tissage du Bauhaus en 1927, de haut en bas : Gunta Stölzl (à gauche), Ljuba Monastirskaja (à droite), Grete Reichardt (à gauche), Otti Berger (à droite), Elisabeth Müller (pull clair à motifs), Rosa Berger (pull sombre), Lis Beyer-Volger (au centre en col blanc), Lena Meyer-Bergner (à gauche), Ruth Hollós (extrême droite) et enfin Elisabeth Oestreicher. Les noms présents dans cette deuxième partie de liste (à partir de Bergner) sont ceux de femmes présentes sur une photographie prise par Lux Feininger en 1927 (fig. 3.41). Toutes sont inscrites à lʼatelier de tissage, parce quʼon leur a affirmé, en dépit des opinions égalitaristes par ailleurs affichées par Gropius, quʼil est le seul auquel elles ont accès (Brunet & Geel 2023, 217) sous prétexte de les préserver des dures tâches des autres ateliers, métal ou bois (Otto & Rössler 2019, 17). Ce nʼest vraisemblablement quʼune des multiples tactiques mises en place par Gropius pour réduire le nombre de femmes dans lʼécole (ibid.). En amont (étudier, produire) ou en aval (diffuser, signer), le faire des femmes est donc, en architecture et en design, comme dans de nombreux autres domaines, rendu invisible, ou parfois, illisible, quand bien même leur contribution est avérée.
fig. 3.41 : Photo de Lux Feininger reproduite par Elizabeth Otto & Patrick Rössler (2019) ainsi que les informations fournies pour cette légende. L’image montre les membres de l’atelier de tissage du Bauhaus en 1927, de haut en bas : Gunta Stölzl (à gauche), Ljuba Monastirskaja (à droite), Grete Reichardt (à gauche), Otti Berger (à droite), Elisabeth Müller (pull clair à motifs), Rosa Berger (pull sombre), Lis Beyer-Volger (au centre en col blanc), Lena Meyer-Bergner (à gauche), Ruth Hollós (extrême droite) et enfin Elisabeth Oestreicher. Les noms présents dans cette deuxième partie de liste (à partir de Bergner) sont ceux de femmes présentes sur une photographie prise par Lux Feininger en 1927 (fig. 3.41). Toutes sont inscrites à lʼatelier de tissage, parce quʼon leur a affirmé, en dépit des opinions égalitaristes par ailleurs affichées par Gropius, quʼil est le seul auquel elles ont accès (Brunet & Geel 2023, 217) sous prétexte de les préserver des dures tâches des autres ateliers, métal ou bois (Otto & Rössler 2019, 17). Ce nʼest vraisemblablement quʼune des multiples tactiques mises en place par Gropius pour réduire le nombre de femmes dans lʼécole (ibid.). En amont (étudier, produire) ou en aval (diffuser, signer), le faire des femmes est donc, en architecture et en design, comme dans de nombreux autres domaines, rendu invisible, ou parfois, illisible, quand bien même leur contribution est avérée.
Il existe en art des cas célèbres dʼhommes qui ont étouffé la création de leur compagne. Dans ces exemples, le couple dʼartistes peut se transformer, au fil des années, en lʼassociation dʼun artiste reconnu avec sa muse, sa secrétaire, son agente : on pense à Camille Claudel et Rodin, ou encore Josephine et Edward Hopper (Laing 2017). Mais lʼinvisibilisation des femmes nʼest pas le seul fait dʼun compagnon égoïste ou jaloux587. Il arrive même quʼen dépit des meilleures volontés du conjoint-collaborateur, les femmes soient systématiquement placées dans les ornières de leur discipline. Lʼarchitecte et urbaniste Denise Scott Brown écrit à ce propos en 1975 un article célèbre («  Sexisme et star system en architecture  »588) qui relate les discriminations quʼelle subit au quotidien, en tant quʼarchitecte femme. Elle met dʼailleurs quatorze ans à publier ce texte589, par peur des conséquences quʼil pourrait avoir sur sa carrière. Scott Brown passe une grande partie de sa carrière dans une collaboration dʼagence avec Robert Venturi, avec qui elle co-signe le fameux ouvrage Lʼenseignement de Las Vegas590 (1972). Elle observe tout dʼabord dans son article :
Jʼai […] rencontré des formes de discrimination peu banales lorsque, au milieu de ma carrière, jʼai épousé un collègue et lié ma vie professionnelle à la sienne, alors quʼil devenait célèbre, sinon riche. Jʼai vu comment on a fait de lui un gourou de lʼarchitecture, sur la base -—jusquʼà un certain point -—de notre travail en commun et de celui de notre agence (2014[1975], 66).
Et de lister les formes outrancières ou insidieuses que peut prendre le sexisme dans sa carrière : oubli de son nom dans les crédits des Å“uvres co-produites, et autres «  petites vexations  » (67) que lʼactivisme queer et féministe dʼaujourdʼhui nomme volontiers des «  micro-agressions  »591. Lʼintérêt du propos de D. Scott Brown se situe dans les liens quʼelle tisse entre le sexisme de son milieu et un autre phénomène observable dans les métiers de la création : la starification. Si elle déplore le fonctionnement de la discipline de lʼarchitecture quʼelle désigne comme un «  boyʼs club  »592, elle est aussi interpellée par la manière dont les personnes qui collaborent avec elle et son mari sont également invisibilisées par la critique. Elle écrit :
De même que le sexisme fait de moi la dactylo et la photographe de mon mari, le star system fait de nos associés des «  seconds couteaux  » et de nos employés des automates  » (69).
Plus loin, elle explique que starification et sexisme sont deux systèmes qui sʼentretiennent mutuellement, comme Muriel Plana lʼobserve encore aujourdʼhui au sujet des arts en général (2021, 133). Les critiques fonctionnent comme des «  faiseurs de roi  » (71) : or, le prestige du roi qui rejaillit sur celui qui le couronne serait moindre si la personne ainsi élevée était une femme -—ou dans les mots de D. Scott Brown : «  [l]a récompense est encore moindre à couronner une reine  » (71). Une dynamique similaire à cette relation entre le critique et lʼarchitecte organise les rapports entre lʼarchitecte et son protégé (plutôt que protégée). Le texte de D. Scott Brown est donc précieux dans la mesure où il permet de relier le sexisme à dʼautres phénomènes culturels systémiques qui gangrènent les disciplines de lʼarchitecture et du design. Certes, elle évoque les vexations vécues sur le plan individuel : absence dʼinvitation à tel événement, relégation aux «  dîners dʼépouses  » (68), etc. Mais elle montre aussi la manière dont cette impossible représentation de lʼarchitecte comme femme, ou de la femme comme architecte, détermine les rapports sociaux dans la discipline, y compris entre hommes.
Il me semble quʼun grand nombre des affirmations de Scott Brown restent justes aujourdʼhui, et se vérifient dans dʼautres milieux de la création (Steward 2023, 51). En effet, lʼadage selon lequel les «  temps changent  » et «  les choses sʼaméliorent  » est régulièrement contredit. En 2023, en consultant la page de lʼéditeur français Mardaga consacrée à Lʼenseignement de Las Vegas, je constate que Denise Scott Brown nʼest pas créditée, avant de réaliser quʼil est fait mention, sans biographie contrairement aux deux autres auteurs, dʼun certain Scott Brown… Robert. La femme architecte disparaît à nouveau, et même deux fois : comme autrice, et comme femme, littéralement absorbée par son mari.
Lʼeffacement vécu par les femmes architectes et designers au cours de la carrière se poursuit dans le travail historiographique. Ce nʼest guère étonnant : si les critiques adoubent des «  rois  » et autres «  monstres sacrés  », les documents disponibles sur une discipline vont logiquement favoriser les hommes, et il se trouve que design et architecture sont deux disciplines dans lesquelles les revues jouent un rôle crucial de diffusion des images et des idées. Claire Brunet & Catherine Geel, dans leur histoire du design, évoquent la manière dont les femmes, avec constance, sont oubliées des récits des grands mouvements de lʼhistoire du design (Arts & Crafts, Bauhaus, Radicaux Italiens) où «  surnagent  » à grand peine quelques figures (2023, 219). Les travaux qui visibilisent les femmes peuvent être ambivalents, tels les écrits de Siegfried Giedion. Il préfère en effet les mettre en scène en tant quʼusagères en plein époussetage, que de véritablement traiter de leur «  implication dans des travaux de conception  » (Brunet & Geel 2023, 220), même si Alexandra Midal voit tout de même dans lʼévocation de Beecher un geste instaurant une «  lignée féminine, si ce nʼest féministe, de lʼorigine du design  » (2012, 106). Dans un sous-chapitre de sa somme La mécanisation au pouvoir (1948), Siegfried Giedion reconnaît effectivement lʼapport dʼun «  mouvement féministe  » et lui consacre même un chapitre, «  Le mouvement féministe et le foyer rationnel  »593. Dans ce passage, il identifie la révolution féministe (le mouvement féministe de la première vague) comme étasunienne, par rapport à un système européen «  quasi-féodal  »594 (1948, 513). Mais, à la ligne suivante, le progressisme devient la prérogative dʼEuropéennes inspirées par le saint-simonisme et le fouriérisme, face à des Étasuniennes rendues responsables de leur condition : elles seraient «  moins ouvertes à telles vues  »595 (513). Ce passage du texte est globalement difficile à démêler. Giedion exclut le féminisme de son étude mais reconnaît tout de même les apports de Beecher et Frederick. Il a cependant la critique mordante : lorsquʼil parle des «  avocates de la science domestique  » qui «  essaient de rassembler les différentes surfaces et ustensiles, cʼest pour observer quʼen pratique «  leur chaîne de production ne se comportait pas de manière plus cohérente que le contenu dʼun grenier  »596 (612).
Du chemin a bien sà »r été parcouru depuis les écrits de Siegfried Giedion en 1948. Dans son célèbre article «  Made in Patriarchy  » (1986), Sheryl Buckley déplore lʼabsence des femmes dans lʼhistoire du design, et la relie à une focalisation sur certains types de design au détriment dʼautres. Tout comme la pratique culinaire nʼa dʼintérêt pour les hommes que si elle est requalifiée en gastronomie (cf. infra. p. XX), la couture ne rentre dans lʼhistoire que configurée au service du design textile réalisé par «  des designers hommes qui incarnent la persona du génie  »597 (Buckley 1986, 5). Les femmes sont exclues dʼune histoire du design qui se concentre sur la pensée (liée à cette figure du démiurge génial) plutôt que sur le travail manuel («  craft  »). Par effet retour, lʼexclusion des femmes des récits dévalue ce travail manuel et contribue à abstraire une discipline qui repose pourtant sur le dessein par le dessin -—soit sur une association étroite, faite dʼaller-retour incessants entre théorie et pratique.
En 2020, Buckley revisite son propos dans «  Made in Patriarchy II  ». Elle fait le point sur une historiographie qui sʼest enrichie de contributions féministes sur le design (dont certaines sont citées dans ces pages) tels les travaux de Anthea Callen sur mouvement Arts & Crafts, les ouvrages de Dolores Hayden (dont The Grand Domestic Revolution), Judy Attfield, Pat Kirkham ou encore Philippa Goodall, ou encore lʼouvrage collectif Women and Craft (1987). Buckley affirme quʼun véritable mouvement de réécriture de lʼhistoire du design sʼest affirmé en Angleterre dans les années 1980, et, si elle le différencie de la trajectoire étasunienne, les deux traditions ont tout de même intégré avec succès les apports du féminisme de seconde vague. Buckley observe ainsi que «  lʼhistoire du design a bénéficié de synergies fructueuses avec les études culturelles  »598 pour former un contexte où «  ignorer les questions de féminisme et plus largement de genre était académiquement moins acceptable  »599 (2020, 26). Toutefois, cʼest ici que le contexte français est tristement singulier. Dans leur histoire du design publiée en 2023, Claire Brunet et Catherine Geel mentionnent les écrits de Judith Attfield et Cheryl Buckley pour remarquer lʼabsence des femmes dans lʼhistoire du design. Mais on pourrait aussi bien déplorer lʼabsence de ces théoriciennes dans les corpus accessibles : Attfield, C. Buckley, Goodall ne sont pas traduites en français600 ; Dolores Hayden est enfin traduite en français par les éditeurs B42 en 2023, trente après sa publication anglophone. Alexandra Midal, Claire Leymonerie, Claire Brunet et Catherine Geel (pour ne citer quʼelles) traitent de la place des femmes dans leurs travaux écrits et publiés en français -—mais leur approche ne relève pas en premier lieu des études de genre ou des théories queer. Ceci nʼest pas entièrement de leur fait ; nul·le ne peut tout écrire et commenter. Ce manque français est néanmoins sensible et affecte encore lʼenseignement du design en France.
On peut regretter ainsi que le genre ne soit mobilisé que partiellement, ou sans les outils critiques adéquats. Ainsi Catherine Geel et Claire Brunet intègrent à leur histoire du design un curieux chapitre, «  Le sexe des modernes  » (2023, 225–227). Dans cette partie du texte, la question du genre apparaît en relation au goà »t, problème en effet central. Mais au cÅ“ur de ces interrogations, le propos sur le genre nʼest pas complètement clair. Il est reproché au vocabulaire militant (même si on ne sait pas dans quels groupes) dʼêtre appropriable par le marché -— comme si ce problème était celui du geste politique initial et pas celui du capitalisme. Et pour soutenir cet argumentaire, les autrices mobilisent les travaux dʼEric Marty, professeur de littérature auteur dʼun texte au titre identique à celui du chapitre (Le sexe des modernes) où il explique en quelques 512 pages que Judith Butler nʼest pas à lʼorigine dʼune pensée fondatrice sur le genre, puisque des hommes lʼont bien sà »r fait avant iel. Le chapitre de C. Brunet et C. Geel se termine sur la «  recherche dʼune meilleure égalité  » (2023, 227) et une évocation du travail de Judith Attfield, réalisée en citant son directeur de thèse, Daniel Miller qui valorise chez son ancienne doctorante sa «  politique du respect  » et son «  absence de condescendance  » (227). Faut-il comprendre ici que les femmes ne doivent pas être trop désagréables pour valider leur ticket dʼentrée dans lʼhistoire du design ? Jʼavoue que le chapitre mʼa laissé perplexe -—et ce dʼautant plus quʼil conclut une grande partie de lʼouvrage, sans que cette citation soit commentée. Une histoire féministe du design oblige à cette question : par quels procédés, et jusquʼà quel point telle ou telle figure est-elle invisibilisée ? Être présente dans le récit historique nʼest pas suffisant, si lʼappareil critique nécessaire nʼest pas lié à la production, sʼil nʼest pas disponible dans un contexte linguistique et culturel donné. Le constat suivant sʼimpose : être visible ne permet pas dʼéchapper au contexte patriarcal, et pose de nouveaux problèmes aux femmes qui ont déjà réussi cet exploit.
Si être invisible est le problème, il serait tentant de considérer la situation inverse comme une possible solution : en devenant visibles comme architectes professionnelles, les femmes auraient la possibilité de rompre avec le schéma patriarcal de leur discipline. Toutefois, la situation est bien plus complexe et devenir visible peut tout aussi bien créer de nouveaux problèmes. Dans ce cas, le sexisme se réagence plutôt que dʼêtre réellement vaincu. Je lʼai évoqué précédemment avec le cas de Margarete Schütte-Lihotzky, qui parvient à construire sa carrière mais se trouve enfermée dans des sujets «  de femme  », quand bien même elle pratique lʼarchitecture au même titre que les hommes qui lʼentourent. On pourrait alors sʼintéresser à la manière dont la femme architecte existe souvent en solitaire, comme figure unique, dont le trait principal est dʼêtre une femme -—ce qui fait écho au fameux «  complexe de la Schtroumpfette  » pensé par Katha Pollitt. Pour Pollitt, les représentations fictionnelles601 qui présentent une femme unique dans un groupe dʼhommes contribuent à cristalliser lʼidée que les femmes sont dʼabord définies par cet être-femme. Là où dʼautres personnages seront définis par leur personnalité, ou leurs compétences, la femme est… juste une femme. Ce schéma, selon Pollitt, renforce lʼidée selon laquelle «  [L]es filles existent seulement à travers leur relation aux garçons  »602 (1991). Si ce principe est lisible dans les fictions, on le retrouve aussi comme dynamique dans le champ social. Ainsi, dans le groupe dʼarchitectes de Ernst May, Schütte-Lihotzky se voit confier ce qui, dans la discipline de lʼarchitecture, se rapproche le plus dʼun «  travail de femme  ». Lorsquʼelle semble starifiée, elle lʼest selon des modalités qui vont renforcer le caractère incongru de sa présence. Certes, on lui reconnaît le fait dʼavoir été la première femme diplômée de lʼécole dʼArts Appliqués de Vienne (Clarisse 2004, 77) -—mais être systématiquement représentée comme exception peut constituer un piège. En insistant sur ce cas isolé, les représentations médiatiques, ou même les discours qui participent de lʼenseignement de lʼarchitecture et du design tendent à consacrer la présence dʼune femme architecte comme anomalie.
Les dangers de cette tendance élective ont été pointés par dʼautres minorités. Lʼessayiste Morgan M. Page a évoqué cette question au sujet des femmes trans (et plus largement des personnes trans) qui, nouvellement placées sous le feu des projecteurs, nʼapparaissent dans la presse que sous la formule du «  première personne trans à … »603. Selon elle, cette modalité de communication pose problème pour les personnes intéressées, coupées de leur histoire et condamnées à sans cesse être découvertes, sans véritablement être vues dans leur singularité. De plus, le motif est également dommageable pour les disciplines de référence, happées par le paradigme de la nouveauté -—on reconnaît ici un écueil similaire à celui que rencontre le design face à la promotion de lʼinnovation (cf. infra., p. XX). Tous ces phénomènes produisent un effet de bord qui peut affecter les femmes apparemment intégrées et reconnues dans leur discipline, dont lʼarchitecture : lʼinstrumentalisation, ou en anglais «  tokenization  ». Dans ce contexte, les femmes, comme la Schtroumphette, nʼont pas de valeur en tant quʼindividus, mais en tant que femme, ou pis, comme «  femme de service  » qui permet à une discipline, une industrie ou une entreprise de se rassurer sur lʼabsence de sexisme en son sein.
Par effet rétroactif, ce risque réel de lʼinstrumentalisation peut conduire certaines femmes à craindre de se déclarer féministes dans leur environnement professionnel, dans la mesure où cet engagement politique peut encore être tourné en dérision, à cause de représentations associées aux femmes, qui seraient marquées par lʼexcès dʼémotions et le manque de professionnalisme (colère, «  hystérie  », etc.) (Lapeyre 2021, 164–65). En résumé, et pour suivre à nouveau Cheryl Buckley, il est facile dʼexclure les femmes de lʼarchitecture, soit directement (elles ne sont pas présentes) soit en rendant leur présence affirmée impossible, invisible ou difficile à maintenir. Sans dire que les femmes designers produisent un design spécifiquement féminin, on peut tout de même remarquer que le travail des femmes, parce quʼil émerge dʼautres contextes, mobilise ponctuellement des savoir-faire ou des esthétiques qui rendent ses productions difficilement assimilables par lʼHistoire du design (Buckley 2020, 20). Il peut sʼagir de ces «  choses sauvages  » ou «  wild things  » théorisées par Judy Attfield et auxquelles Cheryl Buckley se réfère dans ses travaux. Ces productions relèvent dʼun «  bas design  » et tombent souvent, pour les historien·nes dʼart et du design, en dehors du périmètre de la discipline. J. Attfield les réintègre à son travail, tandis que Buckley pointe la manière dont ces objets moins designés, plus proches de lʼartisanat sont aisément rejetés par une lecture moderniste de lʼhistoire du design. Ainsi, réintégrer les femmes à lʼhistoire et à la pratique du design ne répond pas seulement dʼune nécessité éthique féministe, mais participe plus largement à un projet dʼenrichissement du regard sur la discipline, dont le spectre a pu être réduit par des lectures conservatrices séparant strictement ce qui relève du design et ce qui devrait en être exclu.
Les femmes architectes étant invisibles, leur visibilisation et la promotion active et positive de leur travail est sans doute plus souhaitable quʼun long catalogue des formes de la misogynie, qui engendrera au contraire beaucoup dʼépuisement et peu dʼavancées réelles. Jʼaurais cependant tendance à faire un pari différent604 : cʼest précisément en regardant en face la misogynie (ainsi que le classisme, le racisme, etc.) à lʼœuvre dans lʼarchitecture que celle-ci peut-être repensée, non seulement pour devenir moins discriminante, ou plus «  inclusive  », mais pour que ses fondements tout entiers soient rebâtis. Il existe également tout un ensemble de textes fondateurs du design qui devraient être revisités. Il est impensable, encore de nos jours, de ne pas faire lire Vers une architecture de Le Corbusier (1923) ou Design pour un monde réel de Victor Papanek (1974) aux étudiant·es débutant en design. Pourtant, ces ouvrages sont maillés de propos sexistes qui, au-delà de leur effet vexatoire, produisent bien de la marginalisation en traitant les femmes comme des sujets externes à la discipline du design. Victor Papanek relie ainsi le design -—du monde réel, nous dit-il -—à une lecture mythifiée de ses origines lorsquʼil écrit :
II y a des millions dʼanneÌes, il a bien dà » se faire quʼun homme des cavernes tue un lieÌ€vre, le mange dans sa grotte et jette les os par terre. Sa femme lʼaura alors certainement supplieÌ de les jeter aÌ€ lʼexteÌrieur, pour garder la caverne propre et bien rangeÌe (1974, 94–95).
Chez Ettore Sottsass, on retrouve ce motif du «  premier geste de design  », qui étonnamment est réalisé par une femme… qui fabrique un collier de coquillages (Champenois 2005). On reconnaît chez les deux designers cette double peine imposée par le sexisme dans le domaine du design, telle quʼelle est analysée par Cheryl Buckley : les femmes peuvent soit rester sur la touche, soit produire ce quʼon attend dʼelles -—des objets «  féminins  ». Aussi ce retour à la figure fantasmée de «  lʼhomme de cro-magnon  » a-t-il pour effet corollaire de produire un sujet femme anhistorique : là , depuis tout temps, elle est aussi en dehors du champ du design ou cantonnée aux mêmes tâches par destin. Dans une intéressante mutation, le sujet «  femme  » peut même quitter son statut de personne : «  la  » femme ne saurait être une architecte puisquʼelle sert, métaphoriquement, à personnifier lʼarchitecture. Ainsi, le designer Gianni Pettena peut affirmer :
[Gordon Matta-Clark et moi] préférions, sans nous connaître, adorer notre femme, lʼArchitecture, sans lʼobliger à se prostituer dans les rues pour de lʼargent (Dautrey & Quinz 2014, 76).
Outre lʼassociation regrettable entre travail du sexe et compromission morale605, on reconnaît ici un motif dans lequel «  la femme  » est complètement objectifiée comme discipline : il ne saurait y avoir de femmes en architecture, dès lors, puisque celle-ci existe déjà , dans la figure de lʼArchitecture-épouse associée à lʼhomme architecte. Jʼévoque ces formulations malheureuses à dessein, sans volonté de distribuer des «  bons points  » qui permettraient de sauver la création de tel ou tel designer. Les travaux de Sottsass, Papanek ou encore Pettena me semblent essentiels à lʼHistoire du design : mais il convient de situer lʼhéritage de ces grandes figures dans le contexte de leur pensée, qui nʼest pas seulement une pensée du design, mais aussi du genre, même si elle est faite de biais, sur un plan anecdotique et dʼaucun·es diront sans arrière-pensée.
Dʼautres designers et architectes parlent plus fréquemment de la position des femmes en architecture et il peut en résulter des propos ambivalents, voire contradictoires. Le Corbusier est un exemple emblématique dʼune telle hétérogénéité de propos -—sans parler des pratiques, puisquʼil a tout de même collaboré avec Charlotte Perriand durant de longues années. Le Corbusier est tout autant capable dʼaffirmer lʼimportance des femmes architectes (Dumont 2012, 62), que de recourir à des motifs sexistes pour défendre sa vision de lʼarchitecture. Jʼai aussi déjà évoqué la manière dont lʼarchitecte et designer oubliait bien facilement ses principes (notamment, sa passion pour le ripolin unificateur des surfaces) lorsquʼil sʼest agi de poser une marque sur le E2027 dʼEileen Gray (cf. infra., p. XX). Par ailleurs, sa défense des femmes architectes contraste avec la place qui leur est accordée dans sa lecture de la vie quotidienne proposée dans la revue Population :
La liberté par lʼordre, cʼest précisément le thème proposé au constructeur dʼun foyer, ce foyer pouvant désigner lʼabri dʼun homme, dʼun couple, dʼune famille avec un, deux, quatre, six enfants (1948, 420).
Ici, les femmes disparaissent même sur le plan linguistique, absorbées par le «  couple  » quʼelles forment avec un homme vu comme architecte de son foyer, à la suite de lʼArchitecte qui en a pensé la structure. Et vingt-cinq années plus tôt, dans son ouvrage célèbre Vers une architecture (1923) il propose une comparaison qui fait écho au «  collier  » de la femme préhistorique de Sottsass :
Les Louis XV, XVI, XIV ou le Gothique, sont à lʼarchitecture ce quʼest une plume sur la tête dʼune femme ; cʼest parfois joli, mais pas toujours et rien de plus.
Au-delà de lʼassociation sexiste des femmes au décor et donc à la superficialité, on retrouve ce phénomène qui caractérise beaucoup des textes de designers et architectes sur leur discipline : les femmes nʼy apparaissent jamais que sous lʼangle dʼun éternel féminin emblématisé par la locution «  la femme  » et, de biais, par le jeu de la métaphore, qui aligne à nouveau lʼarchitecture et les femmes -— comme objet de la passion de lʼarchitecte qui leur voue sa vie. Le Corbusier utilise ce type de rhétorique à plusieurs reprises, et de manière significative concernant son travail réalisé à Alger. Lʼhistorienne de lʼarchitecture Zeynep Çelik décrit ainsi la manière dont Le Corbusier idéalise lʼarchitecture vernaculaire algérienne, tout en souscrivant au projet colonial français (Çelik 2000[1992], 322). Elle évoque le recueil Poésie sur Alger de lʼarchitecte en ces termes :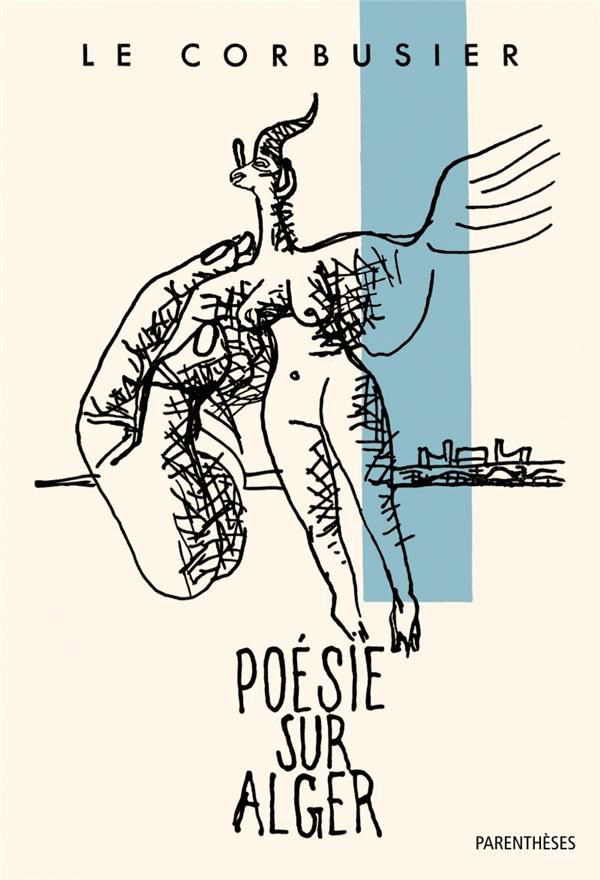 fig. 3.42 : Couverture de la Poésie sur Alger de Le Corbusier (1950), illustrée par ses soins.
fig. 3.42 : Couverture de la Poésie sur Alger de Le Corbusier (1950), illustrée par ses soins.
Lʼesquisse de couverture de Poésie sur Alger représente un corps féminin-licorne (?), ailé, aux hanches souples et à la poitrine généreuse (la ville/poème ?) caressé délicatement par une main (la main de lʼarchitecte ?) sur la ligne dʼhorizon du nouvel Alger. Ce type dʼanalogie, qui revendique la domination du territoire colonisé comme corps féminisé (en lʼoccurrence, la réincarnation de sa beauté par lʼintervention de lʼarchitecte), nʼest pas inédit dans le discours français sur lʼAlgérie606 (Çelik 2000[1992], 326 ; fig. 3.42).
On retrouve donc ce même motif : des femmes qui ne sʼappartiennent pas, a fortiori si elles ne sont pas blanches, et qui sont absorbées par lʼespace -—soit celui, symbolique, de la discipline de lʼarchitecture, soit celui de la ville, vue comme matière à modeler par un ordonnateur tout puissant. Je montrerai plus loin comment les femmes sont régulièrement fusionnées lʼespace dans lequel elles se meuvent, en particulier cette cuisine qui est censée être leur «  domaine  ».
Ce type de décentrement peut inciter certaines praticiennes, plutôt que dʼadopter une posture féministe, à se décaler de leur identité de femme, voire à se dissocier du groupe des femmes pour assurer leur carrière dʼarchitecte. Ce phénomène qui consiste pour une personne minorisée à renoncer à la solidarité collective de son groupe de référence pour choisir de réussir selon les règles des dominant·es est incarné par une figure désignée en anglais comme la «  pick-me girl  » ou la «  choisis-moi  ». Popularisée sur les réseaux sociaux, cette figure permet de dénoncer la manière dont certaines femmes acceptent les injonctions qui leur sont faites, critiquent les autres femmes auxquelles elles reprochent volontiers leur hystérie, et espèrent, plus ou moins consciemment, la validation des hommes (par lʼemploi, le couple, etc.) en adhérant à la nécessité de cette validation. Lʼarchitecture et le design ne sont pas immunisés contre de telles attitudes. Catherine Clarisse évoque ainsi la manière dont certaines architectes parlent de leurs usagères comme de «  bonnes femmes  » (2004, 17) : si les femmes ne sont pas des sujets en architecture, se distancier du groupe «  femmes  » peut ainsi apparaître comme une stratégie intéressante pour celles qui veulent faire carrière. La professeure de Lettres Martine Delvaux évoque dans un entretien ce type de dynamique comme étant lʼeffet de ces boyʼs club évoqués précédemment (Greusard 2019). Elle écrit ainsi que «  [f]aire partie des boysʼ, du club, cʼest se trouver élue à lʼextérieur de la féminité et du côté du pouvoir  », avec lʼimpression «  dʼy avoir échappée belle  »607. Cet exposé permet de visualiser la manière dont les femmes existent peu, pas ou mal en architecture ou en design. Mais le grief ne tient pas seulement à la représentativité de genre dans une profession, car la misogynie ordinaire ne tient pas seulement les femmes à lʼécart. Elle crée aussi tout un système de valeurs qui influence à son tour les registres formels et esthétiques des productions. Jʼai déjà évoqué, en introduction, la manière dont le projet moderne du début du vingtième siècle repose sur un ensemble sémantique qui associe futurité, masculinité et puissance quʼelle oppose, selon une dynamique binaire, au passéisme, à la nostalgie, la féminité et la sensiblerie. Ce sont aussi des qualités formelles qui vont recouper ces oppositions : formes économiques, primat de la fonction sur la forme, rationalité, aérodynamisme, vont sʼopposer au décor, au raffinement, au vernaculaire et au goà »t de lʼexcès. Ces oppositions rejouent la binarité de genre, mais permettent aussi de solidifier des hiérarchies de race (entre formes civilisées et archaïsme du «  sauvage  ») et de classe (entre bon goà »t bourgeois et vulgarité populaire). Enfin, ce bon goà »t bourgeois est aussi celui de lʼhétérosexualité, opposé aux excès kitsch du camp608 queer. Le journaliste Steve Izma évoque ainsi les mots de Louis Sullivan, architecte face à un building : «  Voici lʼhomme pour vous… une force virile, un mâle entier… il chante la chanson du pouvoir procréateur  »609 (Izma 1989). Dans les mots de Penny Sparke, «  le modernisme est spécifique à un genre  »610 (2013, 81). Elle évoque dʼailleurs la manière dont la discipline du design a participé à concrétiser la division entre espace extérieur et espace domestique, en faisant de lʼespace extérieur celui de la conception architecturale (par les hommes) et de lʼespace domestique celui de la décoration intérieure (plutôt par les femmes) (Sparke 2013, 81).
À cet égard, la figure de Margarete Schütte-Lihotzky peut être mobilisée : pas comme «  première à …  », mais plutôt comme lʼautrice dʼune proposition dʼaménagement intérieur qui fait fi de ces divisions, pour appliquer des principes rationalistes à une pièce de vie. Il ne sʼagit pas de suivre cette division hiérarchique entre rationalisme et décor, puisque jʼen ai justement pointé les soubassements misogynes. Plutôt, le parcours que je viens dʼeffectuer doit être compris comme un appel à rendre aux femmes la place qui a été la leur dans lʼhistoire du design et de lʼarchitecture, en ayant pleine conscience que ces leviers de visibilisation ne sont pas intrinsèquement progressistes, et que, sans théorie critique féministe, ils sont voués à répéter des schèmes sexistes qui, tous différents soient-ils de lʼexclusion, enferment tout de même les femmes à une place limitante pour elles-mêmes, comme pour leur discipline. Par théorie critique, jʼentends également un geste politique fort, au-delà du «  rééquilibrage permanent  » du côté des professionnel·les (Brunet & Geel 2023, 227) ou dʼune «  plus agréable répartition des rôles  » (Clarisse 2004, 211). Ce panorama mʼa permis de rassembler quelques «  perles  » de designers et dʼarchitectes ; mais il ne sʼagit pas de se contenter dʼun tel catalogue et de son effet de choc. Dans les pages qui suivent, je vais mʼattacher à montrer comment ce contexte peut être affronté et quels précédents historiques permettent dʼimaginer une boîte à outils féministe applicable au design des cuisines.
Jʼai critiqué plus tôt lʼaccent mis sur le parcours des minorités réussissant à intégrer telle ou telle discipline, et condamné·es, dès lors, à figurer comme «  premier·e à … » plutôt quʼà être reconnu·e pour la réalité de leurs contributions. À ce titre, jʼai évoqué Margarete Schütte-Lihotzky, première femme à intégrer une école dʼarts appliqués à Vienne. Si on peut sʼémouvoir de la lecture qui est faite de cette intégration, il nʼen reste pas moins que lʼéducation, notamment académique, est un point clé pour que les femmes puissent accéder aux professions dʼarchitecte ou de designer. Tout comme une approche féministe du design permet à la fois de faire place aux femmes et de sortir la discipline de ses ornières, penser une éducation féministe au design permet de réaliser des objectifs de justice sociale tout en déplaçant les moyens et les fins de la pédagogie. Au sujet dʼune appropriation féministe de lʼespace, lʼœuvre collaborative Womanhouse est très souvent évoquée. Cet espace dʼinstallations et de performances a été conçu et habité en 1971–72 par les artistes et enseignantes Judy Chicago611 et Miriam Schapiro, ainsi quʼune vingtaine de leurs étudiantes (Taramarcaz 2023, 132). À lʼorigine, Schapiro est contactée par une institution, la CalArts, pour développer un programme dʼenseignement de lʼart féministe (Schapiro in Morineau & Pesapane 2017). En lʼabsence dʼun bâtiment prêt à les accueillir, les deux enseignantes, sur la suggestion de lʼhistorienne de lʼart Paula Harper, décident de louer collectivement une maison pour 25 dollars par mois chacune612. Celle-ci devient un espace dʼenseignement, dʼhabitation et dʼexposition (fig. 3.43.a & b). fig. 3.43.a : La Womanhouse fondée par Judy Chicago et Miriam Schapiro en 1971–72 aux États-Unis. Pour J. Chicago, le déplacement vers une maison, siège de la domesticité, séparée de tout campus, est un moyen dʼamener des problématiques féminines et féministes jusquʼalors ignorées par lʼinstitution, comme le travail domestique, les violences sexistes et sexuelles, la maternité, la grossesse, etc. La maison, par ailleurs, nʼest pas envisagée comme une somme de murs à transformer en école : elle fournit au contraire, grâce à la typologie du foyer séparé en pièces ayant chacune une fonction, un espace dʼexposition déjà traversé par une forte charge symbolique, à lʼopposé du white cube qui est alors la norme en art contemporain. Ce désir dʼinvestir la sphère domestique plutôt que de la transcender par la carrière artistique est aussi palpable dans les moyens choisis par les étudiantes pour les Å“uvres, performances et installations. J. Chicago le rappelle :
fig. 3.43.a : La Womanhouse fondée par Judy Chicago et Miriam Schapiro en 1971–72 aux États-Unis. Pour J. Chicago, le déplacement vers une maison, siège de la domesticité, séparée de tout campus, est un moyen dʼamener des problématiques féminines et féministes jusquʼalors ignorées par lʼinstitution, comme le travail domestique, les violences sexistes et sexuelles, la maternité, la grossesse, etc. La maison, par ailleurs, nʼest pas envisagée comme une somme de murs à transformer en école : elle fournit au contraire, grâce à la typologie du foyer séparé en pièces ayant chacune une fonction, un espace dʼexposition déjà traversé par une forte charge symbolique, à lʼopposé du white cube qui est alors la norme en art contemporain. Ce désir dʼinvestir la sphère domestique plutôt que de la transcender par la carrière artistique est aussi palpable dans les moyens choisis par les étudiantes pour les Å“uvres, performances et installations. J. Chicago le rappelle :
des années plus tard, [une des étudiantes] mʼa dit quʼelle nʼavait pas voulu suivre de cours de sculpture à Fresno parce quʼon voulait lui faire faire des cubes blancs. Et elle nʼavait pas envie de faire des cubes blancs. Elle voulait se servir des matériaux et des techniques avec lesquels elle se sentait à lʼaise, parmi lesquels les fils et lʼaiguille, le tissu, la couture. (Schapiro in Morineau & Pesapane 2017)

Ainsi, comme on le voit dans le documentaire réalisé en 1974 par Johanna Demetrakas, les pièces de la maison deviennent des installations interconnectées : la salle de bain Lipstick est repeinte en rouge ; la cuisine devient un monochrome rose ; le salon mute en espace pour les performances et pièces de théâtre, telle Cock & Cunt (fig. 43.c),
 fig. 3.43.c : Les personnages de HE et SHE dans Cock & Cunt où deux femmes affublées de parties génitales géantes miment lʼacte (hétéro)sexuel, ou Leaʼs Room, une performance de Karen LeCocq & Nancy Youdelman, où une femme applique des séries infinies de couches de maquillage. Dans Maintenance, Sandra Orgel repasse un grand drap, ou brosse le sol de la scène. Les Å“uvres mobilisent directement les gestes et habitus du travail domestique : elles le donnent à voir et le reconnectent à de multiples formes dʼoppression et expliquent, ce faisant, lʼabsence des femmes de lʼhistoire de lʼart en même temps quʼelles produisent des formes leur permettant dʼécrire une nouvelle histoire féministe des pratiques plastiques («  herstory  » plutôt «  history  » selon le concept de lʼautrice Robin Morgan). Les Å“uvres constituent une part essentielle de lʼintérêt de la Womanhouse, mais il faut les resituer dans lʼexpérience de vie qui a été traversée par les enseignantes et leurs étudiantes. Ce travail artistique a en effet été rendu possible par la collaboration de femmes ayant pleinement investi la réfection de la maison. Avant de créer, il sʼest donc agi de rénover, aménager, autrement dit de penser lʼespace de vie commun selon des modalités qui relèvent du design. Lʼexpérience dure peu de temps, mais Judy Chicago transporte les acquis de cette expérience dans un nouveau projet réalisé avec Sheila de Bretteville, le Womanʼs Building, une école dʼart entièrement dédiée aux femmes. La Womanhouse initiale doit donc être comprise comme une contribution à lʼhistoire du design pour deux raisons au moins : comme espace collaboratif de travail dʼaménagement féministe, et comme prototype dʼun «  projet pédagogique  » (Martini & Taramarcaz 2023, 9) plus vaste. Cette maison, aujourdʼhui démantelée, est également intéressante comme représentation.
fig. 3.43.c : Les personnages de HE et SHE dans Cock & Cunt où deux femmes affublées de parties génitales géantes miment lʼacte (hétéro)sexuel, ou Leaʼs Room, une performance de Karen LeCocq & Nancy Youdelman, où une femme applique des séries infinies de couches de maquillage. Dans Maintenance, Sandra Orgel repasse un grand drap, ou brosse le sol de la scène. Les Å“uvres mobilisent directement les gestes et habitus du travail domestique : elles le donnent à voir et le reconnectent à de multiples formes dʼoppression et expliquent, ce faisant, lʼabsence des femmes de lʼhistoire de lʼart en même temps quʼelles produisent des formes leur permettant dʼécrire une nouvelle histoire féministe des pratiques plastiques («  herstory  » plutôt «  history  » selon le concept de lʼautrice Robin Morgan). Les Å“uvres constituent une part essentielle de lʼintérêt de la Womanhouse, mais il faut les resituer dans lʼexpérience de vie qui a été traversée par les enseignantes et leurs étudiantes. Ce travail artistique a en effet été rendu possible par la collaboration de femmes ayant pleinement investi la réfection de la maison. Avant de créer, il sʼest donc agi de rénover, aménager, autrement dit de penser lʼespace de vie commun selon des modalités qui relèvent du design. Lʼexpérience dure peu de temps, mais Judy Chicago transporte les acquis de cette expérience dans un nouveau projet réalisé avec Sheila de Bretteville, le Womanʼs Building, une école dʼart entièrement dédiée aux femmes. La Womanhouse initiale doit donc être comprise comme une contribution à lʼhistoire du design pour deux raisons au moins : comme espace collaboratif de travail dʼaménagement féministe, et comme prototype dʼun «  projet pédagogique  » (Martini & Taramarcaz 2023, 9) plus vaste. Cette maison, aujourdʼhui démantelée, est également intéressante comme représentation.

Elle incarne la possibilité dʼune domesticité dont le confort ne vise pas les hommes et les enfants mais bien les femmes, dans un travail domestique pensé et réalisé par et pour elles-mêmes*. Womanhouse* porte la marque de lʼutopie dans ses intentions comme dans la durée éphémère de son existence : elle est aussi une forme médiatiquement visible de ce qui peut se produire quand concevoir, créer et habiter ne sont plus séparés. Dʼautres initiatives non revendiquées sous la forme identifiable de lʼœuvre, et donc moins connues, ont jalonné lʼhistoire méconnue de lʼarchitecture faite par des femmes, sur lesquelles je vais mʼarrêter à présent.
Sans tomber dans un catalogue exhaustif, qui nʼest pas lʼobjet de cette étude, on peut évoquer ici des entreprises féministes amatrices, populaires ou «  grassroots  » qui sʼincarnent moins clairement dans des images emblématiques, faciles à faire circuler, mais qui sont riches dʼenseignements. Dans les années 1970, aux États-Unis et ailleurs, de nombreuses communautés se forment dans le contexte du mouvement hippie. Ces groupes cherchent à inventer des espaces de vie alternatifs, en dehors du capitalisme, des styles de vie écocidaires, du couple hétérosexuel, et parfois, en dehors de tous ces contextes à la fois. Il sʼagit de vivre sans argent, sans électricité, avec lʼaide dʼun ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Certaines zones géographiques font figure «  dʼArcadie  » à cet égard, comme la Californie du Nord (Kramer 2021) ou lʼOregon du Sud ; des lieux comme Lavender Hill appartiennent aussi à cette histoire (Lecerf Maupoix 2023, 13). Elles sont la destination dʼun mouvement qui renonce à la ville et à ses vicissitudes pour vivre autrement, même si, dans les faits, ce rêve est dʼabord réservé à une frange privilégiée, blanche et de classe moyenne de la population étasunienne (Vider 2021, 85). Toutefois, les personnes LBGTQIA+ qui engagent ce type de projet peuvent aussi compenser leur manque de ressources économiques et matérielles en mettant le peu quʼelles possèdent en commun (86). Cʼest notamment le cas de femmes lesbiennes qui vont rapidement construire des projets dʼhabitat et de travail communs. Ce lesbianisme politique appliqué à lʼarchitecture repose parfois sur des formes de séparatisme (Vider 2021), cʼest-à -dire un mode de vie sans hommes, au-delà du seul choix de partenaire romantico-sexuel·le. Les Womenʼs Lands ou le collectif Womenshare (fig. 3.44) rassemblent ainsi des lesbiennes désireuses de quitter la ville et dʼinventer de nouvelles relations.
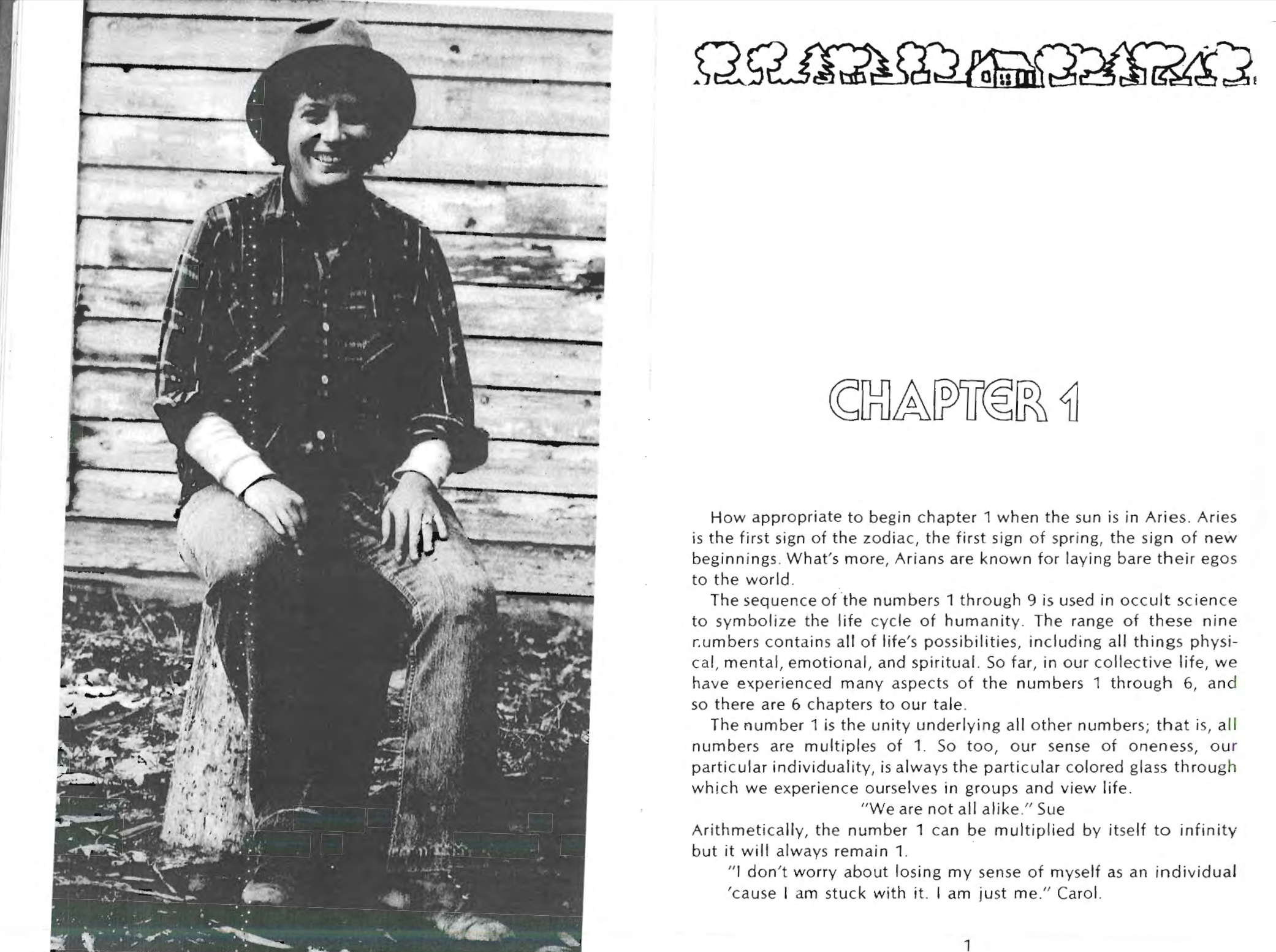
Si ces femmes ne sont pas (ou pas nécessairement) architectes de formation, leurs projets sʼancrent en général sur une mobilisation de savoir-faire et une éthique du DIY plutôt codés comme masculins. Dans Country Lesbians, The Story of the WomanShare Collective613, les membres dudit collectif racontent leur histoire. Seuls leurs prénoms les identifient. Au fil des pages, Sue, Nelly, Dian, Carol et Billie décrivent leurs occupations, leur relation au domus, et le cheminement qui les a menées à fonder Womanshare et à partager un lieu de vie. Les témoignages sont entrecoupés de textes, dessins et recettes de cuisine (fig. 3.45) qui relient les dimensions affectives, sexuelles, politiques et domestiques de leur projet. Une des femmes, Carol, mentionne justement dans lʼouvrage son travail en cuisine et son lien avec lʼoppression de classe : en voyant sa mère résister au travail domestique, elle a développé une aversion pour ce dernier quʼelle associe à une forme dʼaliénation. Elle écrit :
[…] je me mettais toujours à mon service en cuisine en criant, en donnant des coups de pied et en protestant tout du long. Même après des années de vie avec des femmes dans une situation dʼégalité réelle, la peur de la cuisine est toujours présente. Cʼest en luttant avec mes sÅ“urs que je commence à trouver une issue à ce dilemme614.
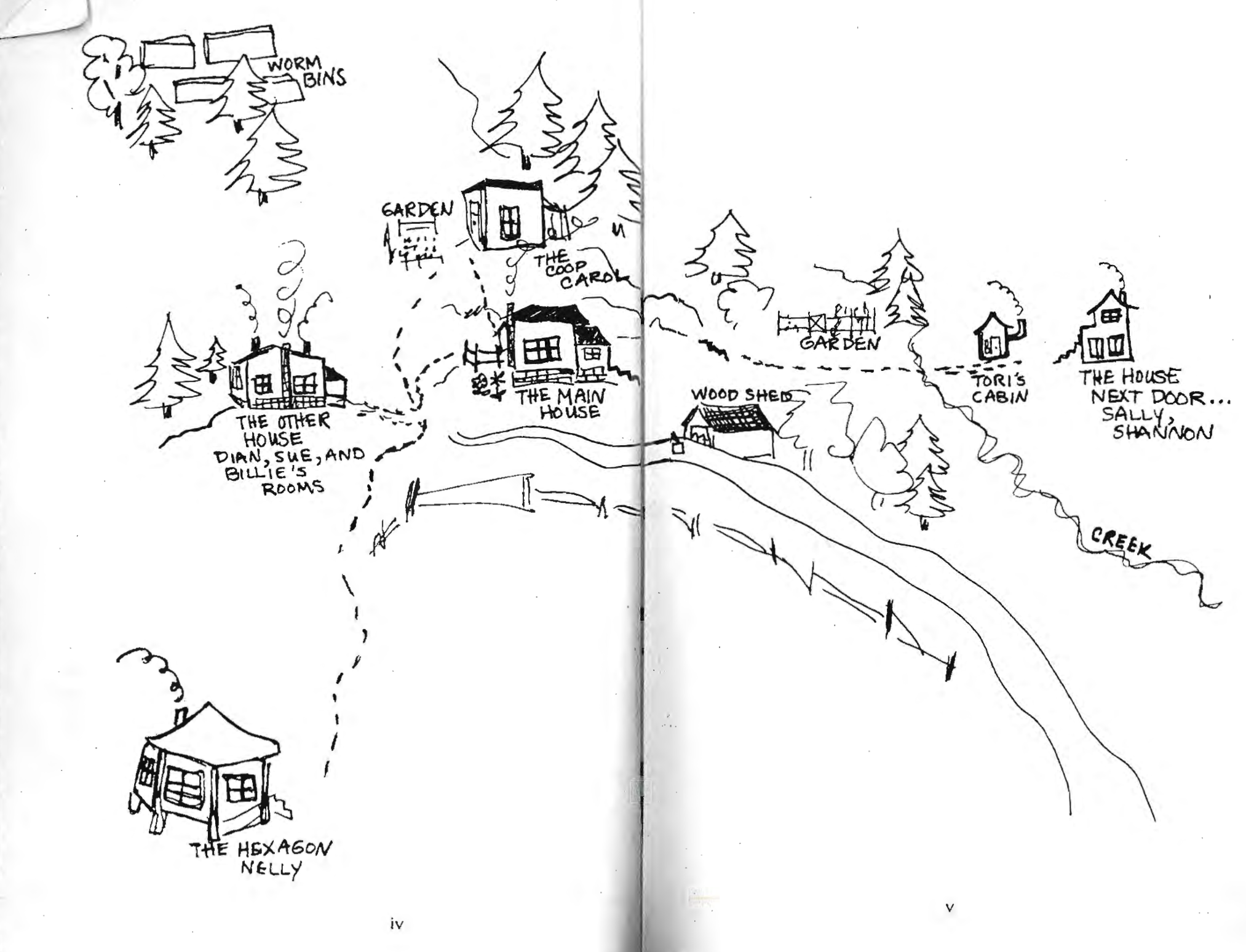
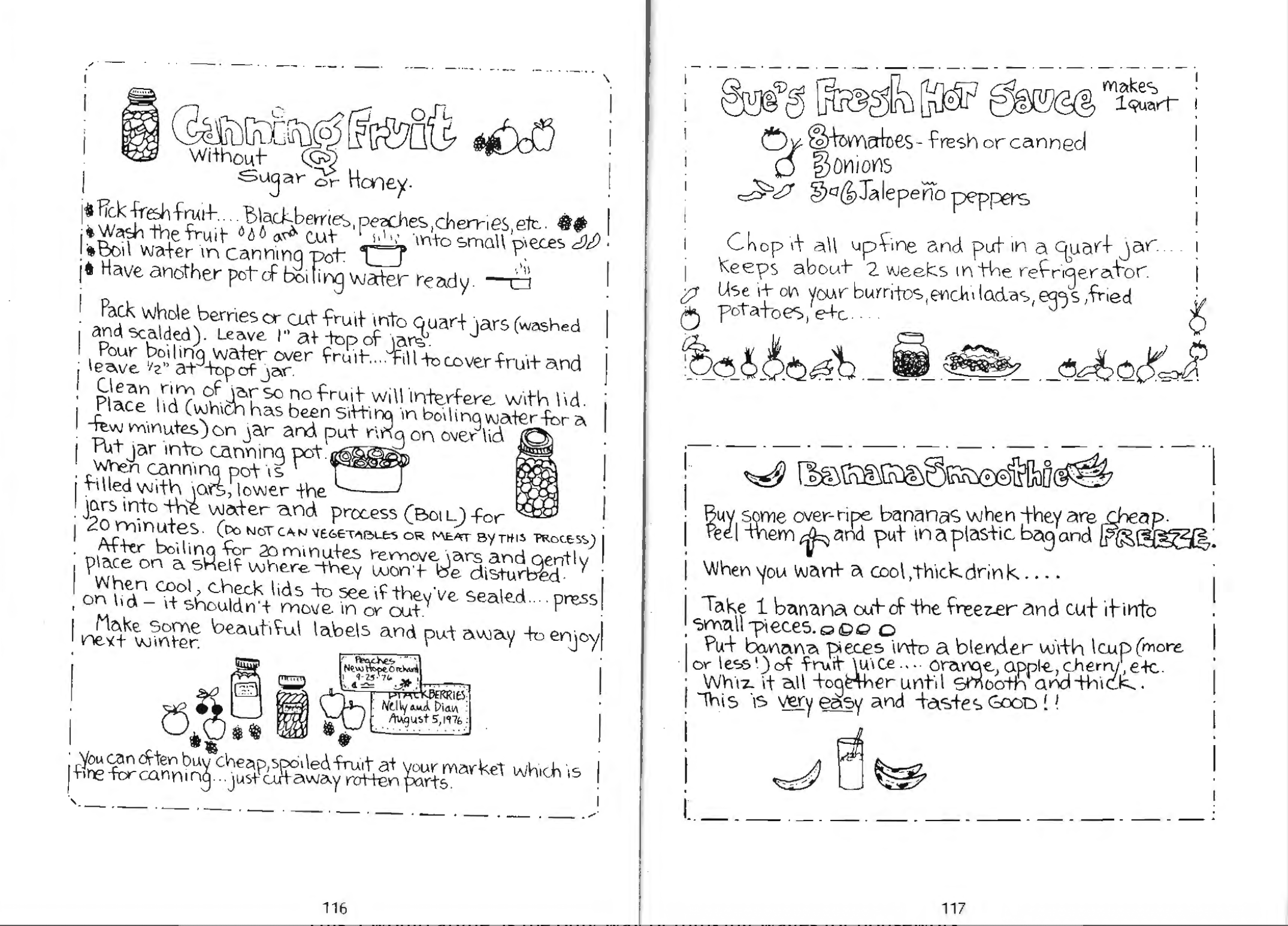
Ces communautés ne possèdent donc pas des fonctionnements équitables par défaut, du fait dʼêtre habitées par des femmes ou même par des lesbiennes. Dʼautres formes dʼoppression (race, classe, validité) traversent les rapports entre participantes, tandis que lʼéducation patriarcale des unes et des autres maillent encore la relation à lʼhabitat et à la cuisine. La communauté nʼest donc pas un ailleurs opposé à la domus conventionnelle, mais lʼoutil de la construction dʼune alternative. En sʼautonomisant, les lesbiennes investies dans ces communautés retracent des continuités, notamment sur le plan du travail. Il sʼagit de cuisiner, mais aussi de réparer sa maison, sans que ces actions soient vues comme la prérogative dʼune personne en fonction de son genre. Toutefois, ces activités ne produisent pas une proposition architecturale lisible selon les codes des disciplines de lʼarchitecture et du design. Paradoxalement, les zines et tracts publiés par ces collectifs615 prennent la forme de manifestes, traitent dʼhabitat et dʼarchitecture, mais ne sont pas identifiables, pas plus quʼils nʼont été reçus, comme des manifestes dʼarchitecture. La difficulté à sʼinscrire en tant quʼarchitecte apparaît donc à nouveau pour les sujets femmes, dont les productions hybrides sortent facilement du champ de certaines disciplines créatives comme le design (Sparke 2020, 20). Ce point concerne la réception, et mérite dʼêtre équilibré par un regard sur la production. Les textes militants tendent aussi (et sans que cela soit dommageable) à se focaliser sur lʼattitude et lʼapproche, plutôt que sur le résultat. Ils empouvoirent en donnant des pistes dʼaction, plutôt que des études de cas de réalisations. Ainsi, Heresies 11, numéro 3 de la revue du même nom, paru en 1981 et consacré aux femmes et à lʼarchitecture616, contient un article de Gerda R. Wekerle qui présente des pistes concrètes pour une saisie féministe des espaces de vie : coopératives pour mères célibataires, workshops dʼinformation sur lʼaccès au logement social ou encore réparation de maisons abandonnées (Wekerle 1981). Mais il nʼexiste pas de proposition de design, incarnée par le dessin, qui matérialiserait ces intentions politiques. Lʼarticle précédent, écrit par Margrit Kennedy expose bien des exemples de formes, mais reproduit lʼidée dʼune création spécifiquement féminine car toute en rondeurs et en courbes617. Ces productions sont donc ambivalentes pour un regard contemporain, en plus de constituer des archives fragiles, relativement peu diffusées malgré les efforts de numérisation et de mise en ligne de militant·es ces dernières années. Elles abordent lʼarchitecture, mais offrent davantage un regard sur un mode de vie quʼune proposition spatiale. Lʼécart nʼest peut-être pas si grand entre le style de vie et lʼhypothèse de projet : mais il nʼapparaît pas lisiblement dans les pages dʼécrits dont le caractère fragmentaire est davantage un moyen plastique de résistance aux récits normatifs quʼun véritable défaut.
Par ailleurs, la fondation dʼéco-communautés nʼest pas la prérogative des lesbiennes.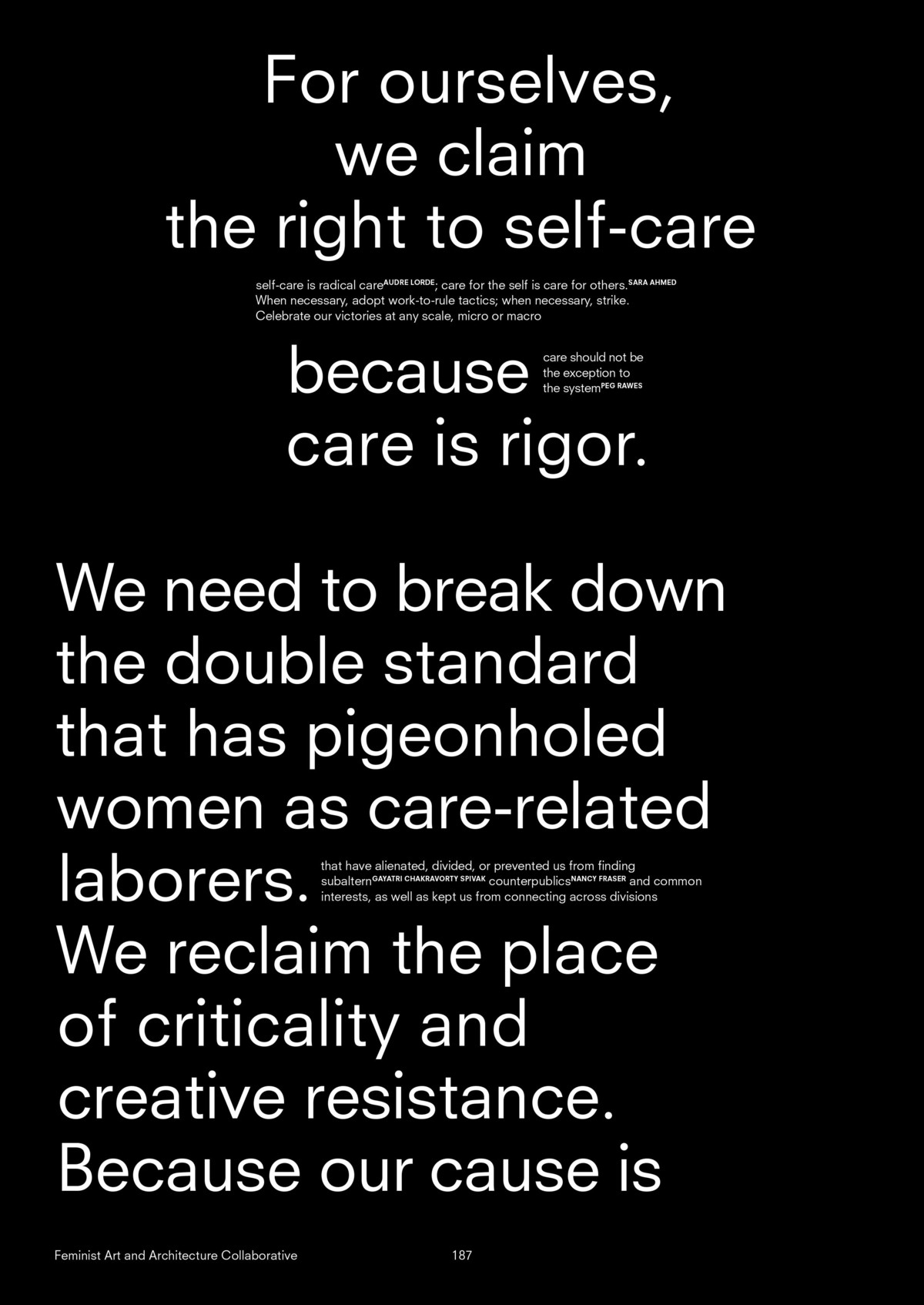 fig. 3.46.a . Les enjeux sont peut-être un peu différents pour les hommes gays, qui cherchent plutôt à combattre la solitude résultant du patriarcat, et à produire des formes de care parfois absentes de milieux traversés par la promiscuité sexuelle ou lʼinjonction à celle-ci. La lutte politique passe donc par la réinvention de styles de vie qui supposent eux-mêmes de repenser lʼhabitat.
fig. 3.46.a . Les enjeux sont peut-être un peu différents pour les hommes gays, qui cherchent plutôt à combattre la solitude résultant du patriarcat, et à produire des formes de care parfois absentes de milieux traversés par la promiscuité sexuelle ou lʼinjonction à celle-ci. La lutte politique passe donc par la réinvention de styles de vie qui supposent eux-mêmes de repenser lʼhabitat. fig. 3.46.b : : Le Harvard Manifesto ; deux images extraites du manifeste rédigé par le Feminist Art and Architecture Collaborative (FAAC) auquel appartiennent Ana MarÃa León, Andrea J. Merrett, Armaghan Ziaee, Catalina MejÃa Moreno, Charlotte Kent, Elaine Stiles, Emma Cheatle, Jennifer Chuong, Juliana Maxim, Katherine Guinness, Louisa Iarocci, Martina Tanga, Olga Touloumi, Rebecca Choi, S Surface, Saher Sohail, Sarah Parrish, Tessa Paneth-Pollak. Source : https:
fig. 3.46.b : : Le Harvard Manifesto ; deux images extraites du manifeste rédigé par le Feminist Art and Architecture Collaborative (FAAC) auquel appartiennent Ana MarÃa León, Andrea J. Merrett, Armaghan Ziaee, Catalina MejÃa Moreno, Charlotte Kent, Elaine Stiles, Emma Cheatle, Jennifer Chuong, Juliana Maxim, Katherine Guinness, Louisa Iarocci, Martina Tanga, Olga Touloumi, Rebecca Choi, S Surface, Saher Sohail, Sarah Parrish, Tessa Paneth-Pollak. Source : https:
Cette évocation de la relation des femmes avec lʼarchitecture peut, par effet de loupe, donner lʼimpression dʼune absence complète des femmes architectes dans leur discipline, ou dʼune relation très asymétrique à la production. En réalité, il existe bien sà »r un corpus conséquent de propositions architecturales réalisées par femmes et je continuerai dʼen citer tout au long de ces pages. Jʼaurais pu choisir dʼévoquer lʼouvrage Making Space -—Woman and the Man Made Environment, publié par le collectif Matrix en 1984 et qui rassemble un grand nombre dʼinitiatives, ou encore des exemples rassemblés par la récente initiative Womenʼs Work: London. Mené entre autres par la journaliste britannique Kate Youde, ce projet vise à produire une nouvelle carte de Londres visibilisant les contributions des femmes à lʼarchitecture (Youde 2022 ; fig. 3.47). Mais je vais mʼintéresser à deux cas spécifiques, plus proches dans le temps de mes exemples précédents. Ces deux projets ont en commun de ne pas avoir été réalisés, ce qui semblera peut-être contre-intuitif, voire contre-productif. Un regard féministe sur lʼarchitecture ne devrait-il pas se concentrer sur de «  véritables  » propositions, incarnées par le béton davantage que le dessin ? Cʼest justement ce présupposé quʼil me semble nécessaire de déconstruire.
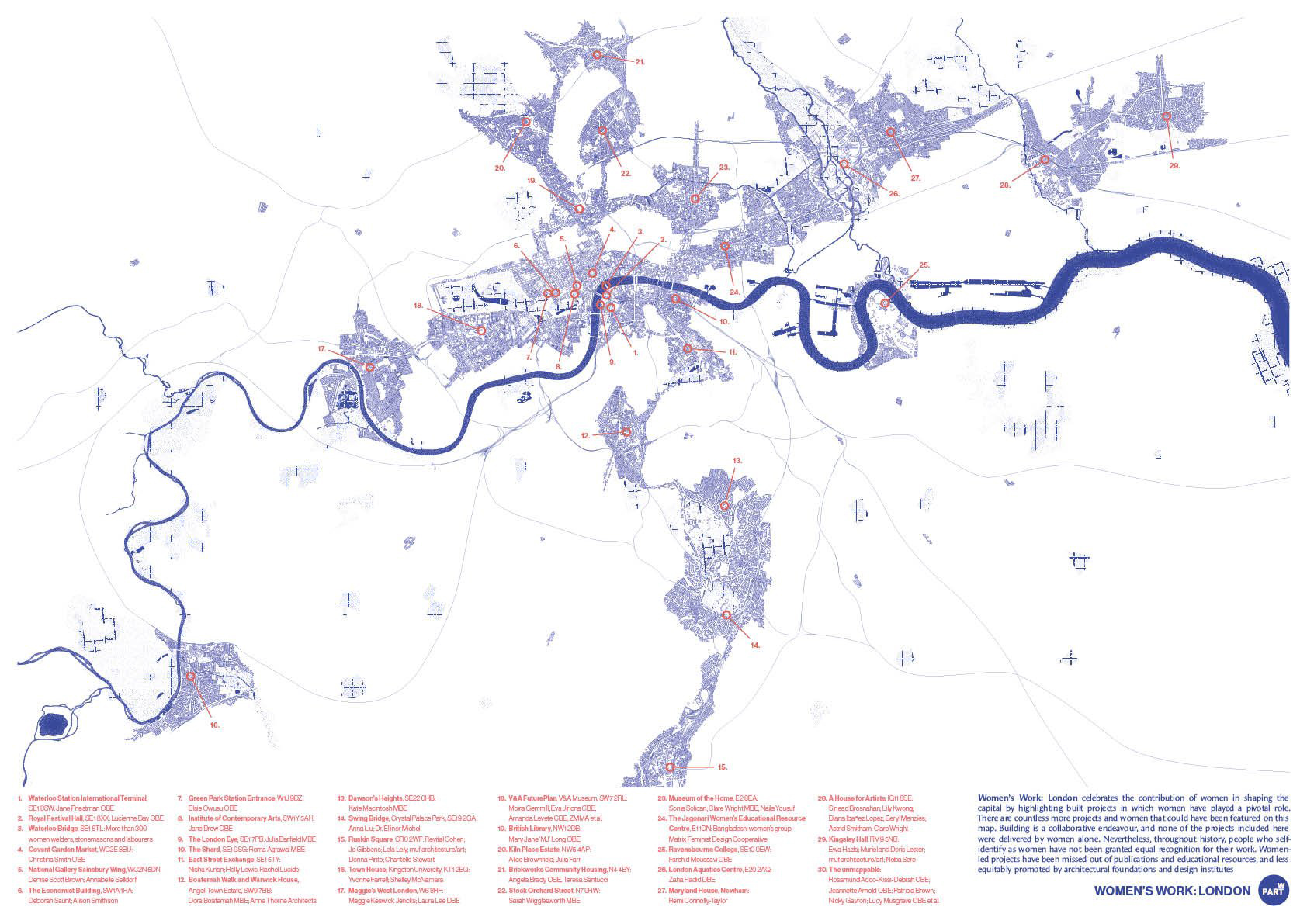
«  Le ménage est une tâche sans pitié et interminable. Cʼest dʼun ennui qui met les nerfs à rude épreuve. Qui en veut ? Personne !  »[^1wx] (Fox 2017). Ces mots sont prononcés par Frances Gabe, une femme méconnue dans lʼhistoire de lʼarchitecture, dont le travail a été redécouvert à la faveur dʼune nécrologie publiée par le New York Times à sa mort en 2016619. La maison inventée par Frances Gabe illustre bien ce qui se produit quand on pose sur le logis un regard féministe. Si on part du principe que les femmes passent plus de temps à rendre habitables les maisons quʼà véritablement les habiter, cʼest lʼensemble des tâches fabriquant lʼhabitabilité (Findeli 2015, 61) quʼun·e architecte doit penser, avant de sʼattaquer aux fonctions habituelles que sont dormir, prendre les repas ou encore prendre soin de lʼhygiène du corps. Révoltée par la rigueur des tâches de nettoyage de la maison, comme ses mots le montrent bien, Frances Gabe invente à la fin des années 1970 une maison autonettoyante. fig. 3.49.a : Portrait de Frances Gabes en 1979 avec une maquette de sa maison auto-nettoyante. Source : The Los Angeles Times. Protégé par un brevet en 1984, lʼhabitat proposé par Gabe est équipé en son sein de jets dʼeau, buses dʼair chaud et dʼévacuations au sol permettant de nettoyer en une seule fois lʼintégralité du logis (fig. 3.49.b ; 3.50). Des réservoirs spéciaux pour le produit de lavage sont prévus, ainsi quʼun système spécifique pour la vaisselle et les vêtements qui sont inclus dans le concept général. Le principe est donc ni plus ni moins celui dʼun lave-vaisselle fusionné avec un lieu de vie, dans lequel lʼinventrice a vécu à Newberg dans lʼOregon, en perfectionnant son invention pendant vingt-neuf ans. Lʼinvention possède bien sà »r quelque chose dʼamusant : sans dire que le dispositif ne fonctionne pas (un segment dʼinformations locales sur KGW en 1990 indique le contraire), il est évident que la production de masse dʼun tel dispositif serait très coà »teuse.
fig. 3.49.a : Portrait de Frances Gabes en 1979 avec une maquette de sa maison auto-nettoyante. Source : The Los Angeles Times. Protégé par un brevet en 1984, lʼhabitat proposé par Gabe est équipé en son sein de jets dʼeau, buses dʼair chaud et dʼévacuations au sol permettant de nettoyer en une seule fois lʼintégralité du logis (fig. 3.49.b ; 3.50). Des réservoirs spéciaux pour le produit de lavage sont prévus, ainsi quʼun système spécifique pour la vaisselle et les vêtements qui sont inclus dans le concept général. Le principe est donc ni plus ni moins celui dʼun lave-vaisselle fusionné avec un lieu de vie, dans lequel lʼinventrice a vécu à Newberg dans lʼOregon, en perfectionnant son invention pendant vingt-neuf ans. Lʼinvention possède bien sà »r quelque chose dʼamusant : sans dire que le dispositif ne fonctionne pas (un segment dʼinformations locales sur KGW en 1990 indique le contraire), il est évident que la production de masse dʼun tel dispositif serait très coà »teuse.
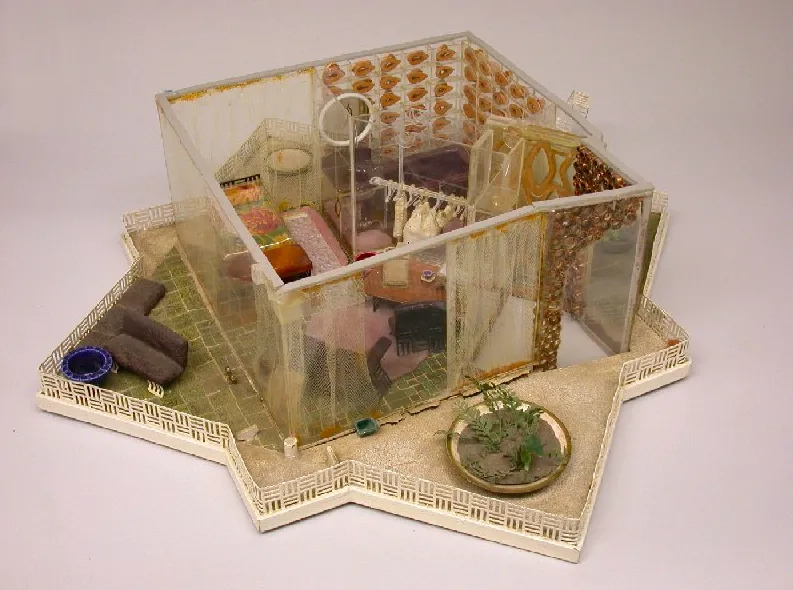
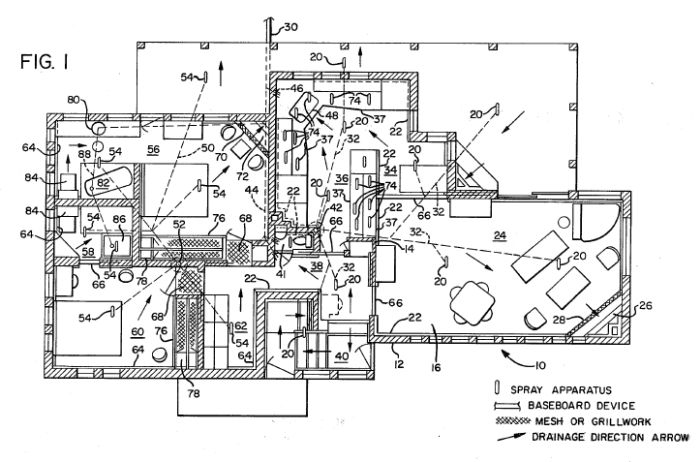
De nombreuses questions restent en suspens : en effet, si le temps de lavage est raccourci, et si le séchage a bien été pensé, il nʼen reste pas moins quʼun tel dispositif nʼest fonctionnel que dans une maison parfaitement rangée et dénuée dʼéquipements fragiles. Gabe avait anticipé une partie de ces problèmes, en choisissant des revêtements de sol adaptés et en utilisant des boîtes en plastique pour protéger les meubles (Fox 2017). Toutefois, cette maison unique peut constituer une figure, pas au même titre que la cuisine de Margarete Schütte-Lihotzky, produite en série et véritablement utilisée par de multiples usager·es, mais en tant que retournement radical de la pensée de la maison. Frances Gabe, qui sʼétait inventé un patronyme après la fin de son premier mariage (Fox 2017) livre une proposition unique, isolée, mais néanmoins précieuse qui doit pousser les designers à remettre en cause les principes les plus élémentaires de leur méthodologie. En effet, sʼil semble évident quʼune maison est faite pour être habitée, un passage par une forme de rébellion féministe pourrait nous amener à intégralement repenser les modes de vie. Je montrerai aussi plus avant comment lʼexternalisation des tâches vers des machines domestiques tient lieu de camouflet, puisque ce sont souvent les femmes qui ont hérité de la manipulation et de lʼentretien des objets en question. Frances Gabe a dʼailleurs bien conscience de cette «  arnaque  » en concevant sa maison, qui est une réponse à lʼasservissement des femmes au ménage. Elle déclare ainsi : «  Le problème avec les maisons est quʼelles sont dessinées (designed) par des hommes. […] Ils fabriquent bien trop dʼespace et après vous vous retrouvez à vous en occuper  »620 (Walker 2017). Paradoxalement, elle préfigure avec sa réponse féministe la smart house du XXIe siècle : mais plutôt que de relier des caméras et des écrans dans un rêve mêlant panoptique et domesticité, elle choisit dʼutiliser le réseau interne de la maison pour soulager la ménagère, dans une démarche de care globale et assumée vis-à -vis de lʼespace.
 fig. 3.50.b : Frances Gabe dans sa maison. Source : New York Times.
fig. 3.50.b : Frances Gabe dans sa maison. Source : New York Times.
Cette attitude de refus fait bien sà »r écho à celle de Paulette Bernège, précédemment évoquée, qui envisage un monde où les femmes font les maisons, expression qui forme dʼailleurs le titre dʼun de ses ouvrages publié en 1928. Dans ce livre figure un texte frappant qui la rapproche à plusieurs titres de celle de Frances Gabe. «  Le tuyau : élément essentiel de civilisation  » est un plaidoyer pour penser les maisons autour de leurs réseaux. Sa langue peut nous amuser, de même que quelques prévisions non réalisées : au demeurant, la proposition de Bernège est dʼune immense intelligence, et montre bien ce qui est perdu, en architecture, à ne pas considérer des points de vue multiples, dont celui des femmes. Cette vision, Bernège le revendique, est celle de la «  ménagère  » (1989[1928], 61). Et la journaliste déplie ainsi une métaphore filée où la maison est vue comme un corps, soit la somme de «  systeÌ€mes nettement distincts, isoleÌs, canaliseÌs (nerveux, circulatoire, digestif, respiratoire, reÌnal, lymphatique, etc.)  » (62). Dans cette architecture sensible, le tuyau est une clé pour penser le logis selon des modalités renouvelées. Le tuyau, dit Bernège, possède deux extrémités : penser le tuyau de gaz, cʼest donc se poser la question de lʼentreprise qui le distribue (avec modalités et qualités de produit) mais aussi imaginer, côté sortie, la gazinière privée, outil bien ou mal conçu, et qui détermine un grand nombre dʼinteractions. Contrairement à la conception traditionnelle de la maison comme «  boîte à remplir avec des marchandises produites en masse  »621 (Hayden 1982, 23), qui sera encore renforcée après la Seconde Guerre mondiale, Bernège évoque un tissu de connexions existant dans la maison, mais aussi le foyer en tant quʼil appartient à une superstructure plus vaste. Si cette pensée en réseau peut sembler en avance sur son temps, elle sʼaccompagne aussi dʼun certain enthousiasme pour le progrès et la croissance.
Selon Bernège, «  [p]us les eÌchanges se multiplieront et seront aiseÌs, plus riche et puissante sera la vie de la maison  » (63). La véritable originalité de Bernège se situe dans le développement qui découle de cette première étape. Sʼenthousiasmer pour de nouvelles technologies nʼest pas si original, à son époque ; en revanche, repenser les maisons selon des modalités qui sont encore très pertinentes de nos jours, voilà qui est remarquable. Pour la journaliste, la multiplication des tuyaux (eau, gaz, électricité, chutes dʼordures, etc.) provoque la prolifération des compteurs : il convient donc de les rassembler et de penser le contenant destiné à les accueillir. Lʼaccès aux tuyaux eux-mêmes doit être réfléchi. Ce nʼest pas seulement au labeur des réparateurices que pense Bernège, mais aussi au ménage rendu nécessaire par la succession de cloisons démolies lorsquʼil faut accéder à une gaine ou à un conduit. Elle propose donc de «  centralis[er] au maximum […] tous les fils et tuyaux dans une grosse canalisation qui les groupera toutes, qui sʼouvrira facilement dʼun bout à lʼautre et permettra ainsi dʼatteindre sans bris, fracas, ni difficultés, les points endommagés  » (65). Elle affirme que cette approche imite celle du corps humain. Mais là où le corps humain, une fois lʼâge adulte atteint, possède une taille a priori fixe, la maison continuera de croître. Aussi Bernège propose-t-elle que les constructeurs «  laissent un espace pour les tuyaux à venir  » et «  donnent [aux] tuyauteries des calibres tels que la consommation actuelle puisse être largement dépassée sans nécessiter une réinstallation complète des canalisations  » (66). Qui a déjà passé une après-midi en compagnie dʼun·e technicien·ne Orange ou Bouygues ne pourra que soupirer de désarroi en constatant quʼil y a un siècle déjà , une penseuse de lʼarchitecture avait tout à fait anticipé nos besoins actuels. Certes, son effort prospectif possède les limites de son imagination622, puisquʼelle projette des tuyaux pour «  le vide, lʼair comprimé, lʼ[…]ozone  » plutôt que pour la 5G ou la fibre… Encore que son article sʼachève avec la mention suffisamment large des «  échanges de pensée  » et dʼun futur «  télautographe  » ajoutant lʼimage au son du téléphone, pas si éloigné des usages du Web actuel.
Maison autolavante ou super-tuyau : ces projections peuvent sembler trop fantaisistes, voire incongrues. Pourtant, ces propositions concrètes (pour Gabe) ou fictives (pour Bernège) sont clairement articulées à un discours à chaque fois situé du côté des «  ménagères  » et de leurs besoins -—dont le premier est de diminuer au maximum la charge du ménage, grand absent des scénarios des designers et des architectes. Dans les deux cas, il sʼagit de penser un réseau : celui qui nettoie la maison au complet, ou ceux qui relient le domicile à toutes les matières, ressources et informations nécessaires à son fonctionnement. Ces projections, aussi loufoques soient-elles, trouvent des échos chez dʼautres féministes. Cette idée du tuyau unique existe également quelques années plus tard, en 1935, chez Alice Constance Austin, dont Dolores Hayden parle de manière étendue dans The Grand Domestic Revolution (cf. infra. p. XX). Austin, comme Bernège ou Gabe, tient en horreur les tâches ménagères et rivalise dʼinventivité pour les réduire à leur portion congrue. Elle imagine des meubles encastrés pour éviter les zones à poussière, des carrelages chauffants qui permettraient de se débarrasser des tapis623 et invente bien sà »r un système de livraison de repas en cohérence avec sa maison sans cuisine (Hayden 1982, 283). Plus que des tuyaux, ce sont carrément des tunnels qui passent sous les maisons pour livrer les repas et le linge propre : ce changement dʼéchelle ne lui fait nullement perdre sa logique rationnelle, puisquʼelle imagine que lʼélectricité, lʼeau et le gaz soient également reliés par ces galeries. Cet imaginaire du réseau continue dʼinfuser les créations féministes contemporaines. En 2021, presque un siècle après la projection de Bernège, Nadia Campo Woytuk, Karey Helms et Marie Louise Juul Søndergaard, chercheuses en design, proposent leur projet Scaling Bodily Fluids for Utopian Fabulations. Il sʼagit dans leur démarche dʼexplorer le pouvoir des fluides corporels pour penser la «  survie collaborative  »624.

Très inspirées par la vie «  avec le trouble  » défendue par Donna J. Haraway (dʼailleurs évoquée dans le titre de la thèse de Marie Louise Juul Søndergaard), elles proposent une fiction spéculative dans laquelle les fluides corporels que sont le sang menstruel, lʼurine et le lait circulent à vue dans une superstructure de tuyaux entrelacés sur les façades des immeubles (fig. 3.51). Sang et urine sont ainsi utilisés comme engrais pour les plantes, tandis que le lait maternel625  » peut être bu par des humains ou des animaux. Du tuyau de Bernège aux Bodily Fluid Infrastructures, les impératifs de la maison sont retournés sur eux-mêmes par un regard féministe et même queer qui refuse dʼabord lʼassignation ménagère, avant dʼinventer de nouvelles connexions transcorporelles et interespèces.
Quʼaccomplit une architecture féministe ? Il est difficile de répondre à une telle question sans tomber dans de plates généralités. Il est aussi délicat de se décaler de la seule libération des femmes architectes, pour considérer la libération de toutes les femmes par les espaces quʼelles habitent. Déplacer le regard sur lʼarchitecture sur un sujet-femme qui serait intrinsèquement mieux préparé à concevoir lʼhabitat nʼest pas sans risque. Dans la revue heresies, lʼassociation femme et bâti produit son lot dʼessentialisations, condamnant les femmes à réaliser «  une architecture de femmes  », comme elles ont pu être sommées de produire une «  écriture au féminin  ». Si ces affirmations ont pu avoir leur sens dans le contexte du féminisme de seconde vague, il est clair aujourdʼhui quʼelles peuvent sʼavérer enfermantes et aliénantes, en même temps que potentiellement transphobes. Lʼidée selon laquelle les femmes seraient plus proches de la Nature, notamment en raison de leur capacité gestatrice, est autant un motif de la culture dʼextrême droite que de certaines idéologies new age et écologistes -—les secondes étant moins éloignées de la première quʼil nʼy paraît. Yoni sacré, connexion à Gaïa ou à la terre nourricière sont autant de motifs libérateurs en apparence, qui finissent toutefois par ramener les femmes à un destin reproductif ou par exclure les personnes qui nʼappartiennent pas à cette catégorie en vertu dʼune lecture qui donne le primat à «  La Nature  ».
Toutefois, il existe des pistes écoféministes permettant de déconstruire ce jeu dʼassociations. Les femmes sont sans doute mieux disposées à penser lʼhabitat, mais pas parce que leur corps est une forme de «  première maison  ». La connexion des femmes à lʼhabitat, jʼespère lʼavoir montré ici, naît dʼune longue histoire de mise au rebut. Ce nʼest pas de la maison dont les femmes sont maîtresses, mais de sa souillure, et de lʼimpératif sans cesse renouvelé dʼy faire le ménage. À passer tant de temps en compagnie des déchets, les siens et ceux des autres, une connexion se crée et fait penser lʼespace autrement. Cʼest ce quʼévoque dans ses écrits la chercheuse Stacy Alaimo, lectrice de lʼécrivaine Ana Castillo. Le personnage de la fiction lue par Alaimo est décrite en train de se débarrasser de produits chimiques, quʼelle imagine ensuite se répandre «  dans les fosses septiques des gens, les potagers, les robinets de cuisine et le thé infusé au soleil  »626 (Alaimo 2010, 76). Ce qui transparaît ici nʼest pas un lien privilégié à la Terre, ou à toute matérialisation métaphorique de celle-ci, mais plutôt une sensibilité, construite et héritée, à la souillure et à la porosité entre les espaces. Les femmes architectes et designers semblent disposées à élaborer des réseaux de tuyaux -—comme une réponse politique au mur et au ripolin qui ont marqué lʼhistoire de lʼarchitecture.
Écartées, invisibilisées, ignorées, lʼhistoire des femmes en architecture est maillée de trous générés par les mentions oubliées quand ce ne sont pas les absences de celles qui nʼont jamais pu arriver jusquʼà ce statut dʼarchitecte, encore très masculin malgré sa forme lexicale épicène. Une binarité forte existe entre «  faire la cuisine  » (au sens de designer celle-ci, pour des femmes architectes) et «  vivre en cuisine  » comme le fait la «  boniche  » que je vais dans les pages à venir tâcher de réhabiliter. Il ne sʼagit pas de dire quʼêtre une boniche est désirable : en lʼétat actuel des sociétés occidentales (et peut-être au-delà ), ce travail subi ne saurait constituer une perspective de libération. Cʼest donc comme figure, aux côtés dʼun·e cyborg ou dʼune sorcière, que la boniche doit être mobilisée. Comprendre la nature exacte de son travail est la première marche à gravir pour accomplir cette transformation.
En cuisine, on peut donc travailler (comme la boniche) ou travailler à inventer la manière dont les autres travaillent (comme les architectes). Mais sʼagit-il bien des seuls choix disponibles ? Jʼai évoqué précédemment (cf. infra., p. XX) la manière dont les pratiques en cuisine (culinaires ou non) se réinventent au contact des technologies du numérique et des medias sociaux. Lʼévocation du compost et des potagers, sur laquelle sʼachève la partie précédente, pourra sembler bien éloignée de ces considérations. fig. 3.52.a : Lisa de House on Boone. Sa famille, prise en photo sur son compte Instagram @farmhouseonboone, 8 novembre 2023. Pourtant, les médias sociaux ont facilité lʼémergence dʼune ménagère réinventée qui offre une sorte de troisième voie à la binarité que jʼai problématisée, et qui oppose la femme au foyer à lʼarchitecte. Sur YouTube, Instagram ou encore TikTok, de nombreuses femmes jeunes ou dʼâge moyen exposent leurs modes de vie fondés sur une forme de retour en cuisine. Les raisons de ce retour sont multiples, et font le lit de positions tout aussi hétérogènes : il peut sʼagir dʼun «  retour  » à un mode de vie perçu comme plus écologique, ou proche de la Nature (les femivores) ou encore dʼun projet culturel et religieux qui rend centrales la famille nucléaire et la répartition genrée des rôles parentaux (les tradwives). Dans certains cas, le mode de vie peut rester urbain mais être repensé en termes de conséquences environnementales (le zéro déchet ou Zero Waste). Enfin, il peut sʼagir dʼapproches moins clairement identifiables, mais qui sʼintéressent à lʼorganisation et à la rationalisation des tâches, le plus souvent pour des femmes qui sont aussi investies sur le plan professionnel. Ces différentes actrices pourront réaliser tout ou partie de ces actions : lister ses repas de la semaine pour moins gaspiller (batch cooking), fabriquer sa lessive ou ses lingettes réutilisables, faire son pain, fabriquer des jeux pour leurs enfants, construire un poulailler, cuisiner entièrement le repas de Noë l ou encore battre du beurre en crème. Jʼavais évoqué ce type de pratiques en commentant le travail de S. Hayes dans le deuxième chapitre. Mais puis-je encore dire, comme précédemment au sujet de Mimi Thorisson, que le processus de médiatisation «  annule la domesticité  » (cf. infra., p. XX) ?
fig. 3.52.a : Lisa de House on Boone. Sa famille, prise en photo sur son compte Instagram @farmhouseonboone, 8 novembre 2023. Pourtant, les médias sociaux ont facilité lʼémergence dʼune ménagère réinventée qui offre une sorte de troisième voie à la binarité que jʼai problématisée, et qui oppose la femme au foyer à lʼarchitecte. Sur YouTube, Instagram ou encore TikTok, de nombreuses femmes jeunes ou dʼâge moyen exposent leurs modes de vie fondés sur une forme de retour en cuisine. Les raisons de ce retour sont multiples, et font le lit de positions tout aussi hétérogènes : il peut sʼagir dʼun «  retour  » à un mode de vie perçu comme plus écologique, ou proche de la Nature (les femivores) ou encore dʼun projet culturel et religieux qui rend centrales la famille nucléaire et la répartition genrée des rôles parentaux (les tradwives). Dans certains cas, le mode de vie peut rester urbain mais être repensé en termes de conséquences environnementales (le zéro déchet ou Zero Waste). Enfin, il peut sʼagir dʼapproches moins clairement identifiables, mais qui sʼintéressent à lʼorganisation et à la rationalisation des tâches, le plus souvent pour des femmes qui sont aussi investies sur le plan professionnel. Ces différentes actrices pourront réaliser tout ou partie de ces actions : lister ses repas de la semaine pour moins gaspiller (batch cooking), fabriquer sa lessive ou ses lingettes réutilisables, faire son pain, fabriquer des jeux pour leurs enfants, construire un poulailler, cuisiner entièrement le repas de Noë l ou encore battre du beurre en crème. Jʼavais évoqué ce type de pratiques en commentant le travail de S. Hayes dans le deuxième chapitre. Mais puis-je encore dire, comme précédemment au sujet de Mimi Thorisson, que le processus de médiatisation «  annule la domesticité  » (cf. infra., p. XX) ?

Après avoir parcouru lʼhistoire des théoriciennes de lʼéconomie domestique, Mimi Thorisson (ou ses émules, comme la très dix-neuviémiste Lisa de Farmhouse on Boone,(fig. 3.52.a & b) mʼapparaît moins comme une figure véritablement nouvelle que comme une nouvelle version de Christine Frederick ou de Lillian Gilbreth. Les prescriptions opérées par cette dernière lui sont dʼautant plus faciles à formuler quʼelles ne lʼatteignent pas : comme femme mariée, puis comme veuve, Gilbreth ne passe pas sa vie en cuisine. Ses ouvrages projettent donc une vie de mère au foyer dont elle ne fait pas lʼexpérience au premier chef. On retrouve des échos de ce paradoxe dans le monde contemporain, lorsque les femmes influenceuses se revendiquant du hashtag #tradwives sont accusées de ne pas être tout à fait honnêtes au sujet de leur expérience : le simple fait de parler de sa vie de femme au foyer sur les médias sociaux élève en effet lʼintéressée à un statut supérieur, ou a minima, rend celui-ci public, et peut-être seulement performatif. Lʼautrice dʼessais et de fictions Camille Azaïs, dans un petit livret consacré aux homemakers, prend acte de ce miroir déformant :
Finalement, dans tous les articles et commentaires écrits en réponse à celui de Peggy Orenstein, il y a pour moi un biais invisible qui fausse le débat. Ils ont tous été écrits par des femmes qui, elles aussi, écrivent depuis leur maison. Quʼelles soient dʼaccord ou pas avec ce qui est dit, elles sont pigistes, bloggeuses (sic). Elles ont donc la possibilité dʼorganiser leur journée entre temps domestique et temps professionnel. Et celle de prendre la parole au nom des autres. Elles écrivent depuis cette liberté là . (2022, 53)
Il serait donc tentant de balayer ces initiatives dʼun revers de main, au titre de leur superficialité -—une analyse facilement renforcée par la condamnation fréquente des médias sociaux, facilement accusés de produire une réalité alternative et mensongère.
Plutôt que dʼopposer un «  vrai  » travail en cuisine et son avatar dit «  virtuel  », il me semble urgent de remobiliser lʼactivité domestique comme travail, et de lʼhistoriciser. En réinscrivant les influenceuses dans une histoire du labeur en cuisine, le changement de statut des femmes face à la production peut devenir plus lisible. En effet, avec lʼindustrialisation de la production, notamment alimentaire au début du XXe siècle, les femmes ne se sont pas seulement déplacées vers la sphère du travail salarié. Elles ont aussi perdu toute une somme de savoirs quant à la production de nourriture et de consommables nécessaires au quotidien (tissus, bougies, etc.) (Hayden 1982, 26 ; Meah 2016, 42). La période après-guerre, dʼabord aux États-Unis, puis dans le monde occidental, a vu les travailleuses domestiques se déplacer de la production vers la consommation. Les courants du zéro déchet ou du homemade nʼincarnent donc pas seulement une bascule médiatique de la production en cuisine, mais constituent une forme de réactivation de savoirs considérés comme négligés ou perdus. Les procès en artificialité adressés à ces influenceuses relèvent dʼune critique juste des pratiques, mais courent aussi le risque de reconduire une forme de discours misogyne : plutôt que de demander aux femmes si elles sont de vraies femmes, sans maquillage et prothèses en silicone, on aura tôt fait de leur demander de justifier dʼun «  vrai  » travail qui serait dissimulé par le dispositif de la vidéo YouTube ou de la story Instagram. Par ailleurs, ces contenus répondent (en même temps quʼils les prolongent) de nouvelles injonctions faites aux femmes dans un contexte dʼeffondrement écologique et économique : au motif que la vie contemporaine serait malsaine ou productrice de déchets, ce sont encore les femmes qui sont mises au travail pour trouver des alternatives, les fabriquer et composer leur planning pour aménager des particules bien rares de temps libre. Ce nʼest peut-être plus lʼAnge de maison mais lʼ@angedemaison qui veille à présent par-dessus lʼépaule de celles qui pensent échapper à leur devoir : les médiums ont changé, mais le message nʼest-il pas le même ?
Pour imaginer des échappatoires, il convient dʼinvestir la cuisine comme lieu de production. Que font, au juste, les femmes en cuisine ? Si les injonctions à sʼoccuper du logis sont constantes, leur contenu spécifique, en termes de tâches, a-t-il évolué ? Jʼai évoqué ci-dessus de grands changements de paradigme, dʼune ère de la production à une ère de la consommation, pour arriver aux temps actuels qui fusionneraient les deux modèles. Comment le design a-t-il équipé ces rôles des femmes productrices ou consommatrices ? En quoi le travail de production domestique se distingue-t-il de la production capitaliste industrielle ? Le design, qui relève justement de logiques industrielles, participe-t-il dʼun possible transfert de modèle de lʼusine à la cuisine ?
La «  théorie des deux sphères  » aligne une différence de genre sur une distinction spatiale : les hommes du côté de lʼespace public et du salariat, les femmes à la maison, appliquées au travail domestique non rémunéré. Sans doute réducteur, ce motif binaire peut cependant constituer un point de départ pour penser les compatibilités, jeux dʼinterdépendance et rapport dialectiques qui existent, sinon entre deux groupes humains, entre deux typologies de travail. Cʼest dʼailleurs le premier enjeu dʼune telle entreprise : visibiliser le travail domestique en tant que labeur, et non comme un à -côté négligeable du «  vrai  » travail qui serait salarié. Notre exploration de la cuisine moderne, ci-avant, fait état dʼun ensemble conséquent de porosités entre lʼusine et la cuisine. Lorsque le modèle tayloriste infuse les pratiques et les processus de conception de ce lieu, on peut en effet supposer que les deux sphères, si lʼon tient à maintenir cette distinction, se contaminent et sʼinfluencent. Néanmoins, il est aussi nécessaire et politiquement significatif de ne pas faire de cette taylorisation le seul vecteur de reconnaissance du travail domestique. Dans une telle perspective, le travail domestique ne serait travail quʼà la mesure de sa pénétration par les pratiques dʼusine. Or, la situation est plus complexe, et sans vouloir retracer des limites entre travail domestique traditionnel et travail domestique taylorisé, il importe de ne pas réduire la valeur intrinsèque du travail des femmes à ses formes les plus lisibles, qui prendront nécessairement lʼapparence du travail déjà reconnu comme tel, et déjà valorisé sur une place de marché.
À la suite de la chercheuse en histoire et économie sociale Andrea Komlosy, je reconnais que le terme «  travail  » est un «  caméléon linguistique  »628 (2018, 7), dont la définition dépend des personnes, des usages, ainsi que des contextes géographiques et historiques dans lesquels il sʼinsère. Plutôt que dʼinitier un long travail philologique sur la question, qui ne ferait que répéter les travaux dʼAndrea Komlosy, je tiens plutôt à former une définition contextuelle de ce terme, utile pour questionner notre compréhension du design des cuisines. Ainsi, le terme «  travail  » doit ici se comprendre comme un terme-parapluie qui regroupe des pratiques hybrides, constitue un ensemble de tâches effectuées le plus souvent pour un tiers, fà »t-il familial (époux, épouse, enfants, voire ami·es) ou relevant dʼune entité externe (État, entreprise, etc.). Le monde occidental actuel -—et même au-delà , puisque son modèle est mondialisé -—est caractérisé par une conception du travail associée de manière très serrée à la fabrication et à lʼéchange de biens et de services (Komlosy, 2018, 15). Le logiciel capitaliste repose en effet, au moins de manière déclarative, sur la disponibilité dʼagent·es sur une place de marché, qui proposent leur force de travail en échange dʼune rémunération matérialisée par lʼargent. Or, ce fait des échanges capitalistes (force de travail convertie en compensation pécuniaire) a fait rétrécir la conception de ce qui compte comme travail -—et ce, même dans les critiques marxistes du marché (Komlosy 2018, 15). Andrea Komlosy écrit ainsi :
Ce point de vue [partagé par les libéraux et les Marxistes, ndla] ne signifie pas nécessairement que les activités nécessaires à la survie immédiate, telles que le travail domestique de subsistance, nʼétaient pas vues et reconnues. Cependant, elles étaient généralement considérées comme une partie de la nature, une propriété naturelle des femmes dans lʼidéologie de la famille bourgeoise, ou, dʼun autre côté, comme des exceptions et des vestiges des modes de production et de vie précapitalistes, qui passeraient du monde naturel à la sphère économique soit par le biais de la marchandisation (pour les libéraux), soit au travers de la socialisation (pour les socialistes)629.
Le travail domestique réalisé par les femmes est donc perçu au mieux comme une forme obsolète, au pire comme un prolongement de leur capacité «  naturelle  » de reproduction des enfants. Que le projet soit celui du profit maximal ou de la dictature du prolétariat, le travail féminin reste sur la touche, un à -côté sous qualifié (en termes de compétences) du fait dʼêtre non qualifié (par les concepts).
Cette division peut conduire à la reproduction dʼéchelles de valeurs qui valident inévitablement la supériorité du travail salarié, plutôt masculin. On rencontre fréquemment ce type dʼanalyse, y compris dans des ouvrages qui se revendiquent du socialisme -—par exemple, dans le Envisioning Real Utopias dʼErik Olin Wright. Pour penser des modes de transformation sociale, E. O. Wright évoque les processus de reproduction sociale630, compris en tant quʼils «  reproduisent la structure sous-jacente des relations sociales et des institutions de la société  »631 (Wright 2010, 274). Ces processus sont divisés entre «  reproduction active  » et «  reproduction passive  »632. Même si le travail ouvrier et les relations entre collègues comptent dans cette «  reproduction passive  », il apparaît que lʼon retrouve un schème binaire dont les termes (association aux activités quotidiennes, aux petits gestes) peuvent in fine participer à dévaloriser encore le travail féminin au logis. Ceci me semble dʼautant plus possible que les termes «  actif  » et «  passif  » recouvrent des positions de genre dans lʼactivité sexuelle, quʼil est facile de binariser encore davantage en formant les chaînes sémantiques féminin-passif-faible et masculin-actif-fort. Aussi une théorie complexe du travail est-elle nécessaire, qui associe finement production et *re-*production, en politisant ce dernier terme : la reproduction sociale, dans le monde bourgeois, sʼappareille en premier lieu de la reproduction par les enfants et donc du ventre des femmes et des personnes sexisées.
Le travail dʼErik Olin Wright, en dépit de cette potentielle limite, reste utile pour penser la question du travail sans la caricaturer. Car, en lisant Marx, on aura tôt fait dʼen reproduire les catégories de pensée au sujet du marché du travail, qui sont partiellement caduques du fait des formes inédites et éclatées que prend le salariat aujourdʼhui. E. O. Wright parle ainsi dʼune «  variété de tâches qui sont encapsulées en ‹ boulots ›  »633. Dès lors, il est donc nécessaire de saisir le travail comme une notion impure, dont la lisibilité a toujours été compromise : soit en excluant certaines formes de labeur de ses limites (principalement, le travail domestique), soit parce que le capitalisme a fait évoluer les modalités dʼemploi vers un modèle de plus en plus éclaté, dʼabord par la spécialisation de ses agent·es dans un «  boulot  », puis par la segmentation de ce «  boulot  » en sous-tâches externalisables et sous-traitables634. Jʼaborderai donc la cuisine en usine, avec la conscience que lʼusine nʼest plus le lieu de production central quʼil a été. Dans son modèle des XIXe et XXe siècles, lʼusine produisait les biens consommés localement ou semi-localement, et produisait aussi entre travailleureuses une conscience de classe dont Marx estimait quʼelle conduirait à la révolution du prolétariat. De nos jours, lʼusine est délocalisée, le prolétariat est «  diffus et segmenté  » (Gonzalez 2022[2012–13], 21) et les travailleureuses pauvres louent plus quʼiels ne vendent leur force de travail, rendant difficiles la solidarité de classe et chancelants les moyens traditionnels de lutte comme la grève. Dans les lignes qui suivent, je mʼattacherai donc dʼabord à établir la valeur du travail domestique en en questionnant la nature, ainsi quʼà faire état des stratégies (grève, demande dʼun salaire ménager) qui permettent de lʼétablir. Puis, jʼapprocherai dans un second temps un autre «  faire-usine  » de la cuisine. En effet, on a vu que le travail domestique est fréquemment dévalorisé car il est considéré comme «  naturel  ». Or, dire cela nʼimplique pas seulement quʼil soit fait de bon cÅ“ur, presque par instinct (selon une lecture sexiste) et lʼexclusion de la technique de lʼespace domestique en est un autre effet de bord. Non que la technique nʼait pas sa place en cuisine : plutôt, elle nʼest jamais vue comme étant lʼoutil des femmes et, si oui, cet outil est souvent conçu par des hommes pour les femmes. De nouveau, je déplacerai donc la question du partage du labeur sur le terrain du design, pour comprendre comment lʼéquipement technique de ces chaînes tayloristes en cuisine participent de lʼoppression de genre, race, classe vécue par les femmes en cuisine. Il me faudra enfin faire un état des lieux des présences techniques numériques en cuisine, afin de voir si une techno-boniche serait plus à même de sʼémanciper -—ou si elle est encore un avatar de lʼoppression patriarcale.
Comment réparer lʼimage du travail domestique pour en mesurer collectivement toute la valeur ? En considérant lʼimage des deux sphères évoquée plus tôt, il convient de commencer la réparation par un effort de tissage ou de construction dʼun chaînon manquant dans le continuum travail-production de valeur. Avec Maya Gonzalez et Jeanne Neton, je considérerai ainsi quʼil nʼexiste pas une opposition travail domestique/travail salarié, mais plutôt une dialectique entre deux espaces liés : la «  sphère médiatisée directement par le marché  » (MDM) et «  la sphère médiatisée indirectement par le marché  » (MIM) (2022, 11), ce qui revient à considérer que toutes les sphères appartiennent au monde capitaliste, bien quʼelles soient potentiellement différemment affectées par ce dernier. En effet, lʼéconomie occidentale capitaliste «  suppose que les seules activités qui ont une réalité et une valeur sont celles dans lesquelles lʼargent change de main  »635 (Rowe 2003). La division privée/public repose donc sur un concept de valeur étroitement associé à la génération dʼun revenu matérialisé par lʼargent. Le travail domestique sʼen trouve donc dévalué en même temps que situé dans une sphère apolitique «  hors-économie  ». Une telle conception se retrouve dʼailleurs chez Siegfried Giedion, que jʼai mobilisé pour documenter la taylorisation du travail domestique. Il affirme ainsi que «  [l]a maison et lʼusine ne sont pas comparables en tous points de vue  » et que lʼon «  ne peut guère parler de ‹ production › domestique  » (1948, 512). Moins catégorique, Erik Olin Wright se demande : «  préparer un repas à la maison devrait-il être considéré comme faisant partie de ‹ lʼéconomie › ?  »636 (2010, 118). La suite de son propos, si elle examine de multiples formes de structuration économique (socialisme dʼÉtat, régulation sociale-démocrate, démocratie associative, etc.) nʼévoque plus ce thème -—tout au plus est-il question du care des personnes âgées et des enfants, qui ne sont que deux formes du travail domestique, comme nous le verrons plus avant. Ainsi, même si lʼon accepte que le travail à la maison relève dʼune économie, il est tentant dʼisoler celle-ci, ou de la conceptualiser comme une annexe «  à part  » du monde capitaliste. Erik Olin Wright cite dʼailleurs les travaux de J. K. Gibson-Graham637 qui dépeint le capitalisme comme étant constitué dʼéconomies multiformes, parmi lesquelles «  lʼéconomie domestique  » (Gibson-Graham 2006  ; Wright 2010, 124). Même si ce nʼest pas lʼintention première de Gibson-Graham, une telle segmentation peut conduire à séparer à nouveau le travail domestique de lʼéconomie capitaliste lue comme dominante ou principale. Pis, cette séparation pourrait se produire au désavantage de la maison, vue au mieux comme le site dʼune sous-production, ou dʼune production de choses de peu. Le travail domestique semble ainsi avoir usurpé la qualification de travail (Komlosy 2018, 80).
Les théories féministes de la reproduction sociale ont Å“uvré à repenser la nature du travail domestique, et plus encore son statut économique. Lʼactiviste Morgane Merteuil nous rappelle que ce courant de pensée se divise entre le «  mateÌrialisme ‹ radical ›  », qui a vu «  lʼexploitation du travail domestique des femmes [comme] un mode de production aÌ€ part entieÌ€re  » et lʼapproche marxiste «  qui relie cette exploitation speÌcifique des femmes au systeÌ€me capitaliste  » (2017, 70). M. Merteuil lit, au-delà des divergences entre les deux tendances, une volonté commune de lire la famille «  comme un lieu dʼexploitation économique à part entière  » (70). Cette exploitation existe dans un continuum qui la relie au travail salarié. Cʼest parce que les femmes assurent les tâches domestiques, et quʼelles les assument gratuitement, que leurs maris peuvent proposer leur propre force de travail sur une place de marché. Bien entendu, cette affirmation est à nuancer. Elle nʼest valide que dans le présent propos, qui sʼintéresse spécifiquement aux femmes travaillant à domicile. Il importe également de se remémorer la critique de bell hooks face aux thèses de Betty Friedan et autres militantes féministes qui «  étaient tellement aveuglées par leur propre expérience quʼelles ont ignoré le fait que lʼimmense majorité des femmes […] travaillaient déjà à lʼextérieur du foyer et occupaient des emplois qui ne les affranchissaient pas de leur dépendance aux hommes ni ne leur permettait dʼêtre économiquement indépendantes  » (hooks 2017[1984], 193 ; Davis 2019[1981], 207). Ainsi, quand les femmes sont au foyer (et il est important de se rappeler quʼelles ne le sont pas toutes, et pas toujours), leur travail ne se fait pas, par définition, à lʼusine ; mais on pourrait dire que lʼespace domestique est le soubassement de lʼusine, sa fondation secrète grâce à laquelle la disponibilité de la main-dʼœuvre masculine est possible. Le fait dʼêtre embauchée à lʼusine ne préserve nullement de ce destin.

Déjà dans les années 1980, Angela Davis décrit la manière dont les femmes sont de «  doubles perdantes  »638 (2019[1981], 205), lorsquʼelles voient leur savoir-faire (tisser, cuisiner, fabriquer des bougies) se déplacer vers la production de masse, tandis quʼelles doivent se contenter dʼun labeur peu estimé. On pourrait ajouter quʼelles le sont triplement, lorsque la survie de leur famille implique quʼelles soient salariées, en plus dʼassurer un travail peu valorisé à domicile. La mise en évidence de lʼarticulation entre usine et foyer a constitué un des enjeux du féminisme de la deuxième vague, notamment de ses branches dʼinspiration marxiste en France et aux États-Unis. Cʼest dʼailleurs par lʼillustration et le design graphique des autopublications féministes que ces idées sont le plus efficacement mises en évidence. Si le design dʼespace est directement concerné par le réaménagement du foyer, le design graphique peut participer dʼun processus de visibilisation des relations qui existent entre les fameuses «  deux sphères  », ou plus exactement, entre deux formes interdépendantes de labeur. Un visuel célèbre du collectif londonien See Red Womenʼs Workshop publié en 1974 (fig. 3.54) montre ici des femmes travaillant à la chaîne, qui nettoient, repassent, prennent soin de leurs enfants et de leur époux. Cette chaîne se prolonge jusquʼà gagner une usine en arrière-plan. À gauche du visuel, un homme descend de la chaîne et rejoint une foule de travailleurs anonymes prête à sʼengager dans lʼusine, suggérant lʼidée que la chaîne produit directement cette force de travail, prête à son tour à être convertie en biens fabriqués en série. Lʼimage est accompagnée du slogan «  Le capitalisme dépend aussi du travail domestique  »639. Cette image et ces mots font écho à la question posée dans les pages du journal français Le Torchon brà »le deux ans plus tôt : «  Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?  » (Pagès 2023, 212–13). Le titre de la publication est du reste évocateur dʼune lutte qui prend ses sources au plus près des outils de la domesticité. Rendre visible le point de jonction entre usine et logis a donc été un des axes des luttes féministes des années 1970, pour mettre en évidence la dépendance entre deux sphères dʼabord vues comme compatibles plutôt que maillées. Avant de considérer la cuisine comme usine, il importe donc de rappeler quʼelle en a été considérée comme le soubassement.
Ce jeu dʼinterdépendance a de nombreuses conséquences qui permettent dʼen finir, une fois pour toutes, avec lʼidée que le travail à la maison aurait une valeur moindre par rapport au travail «  productif  » de lʼusine comme du bureau. Lʼimage du soubassement a le mérite de souligner lʼimportance du labeur féminin, et transpose lʼidée dʼun travail qui ne fait pas tout à fait partie du capitalisme, et qui en est plutôt la «  condition de possibilité  »640 (Davis 2019[1981], 211). Toutefois, lʼimage dʼun travail souterrain ne rend pas intégralement compte du lien qui lie travail salarié et travail domestique. La pandémie du COVID, en 2020, a en effet mis en évidence le fait que le foyer nʼest pas seulement un socle, mais aussi une chambre dʼabsorption et de compensation des chocs économiques (Gonzalez & Neton 2022[2012–13], 15). Pendant cette période, plus particulièrement à la faveur des multiples confinements en Occident, de nouvelles tâches sont apparues, à hauteur de vingt heures hebdomadaires par ménage (Gonzalez & Neton 2022[2012–13], 16). Celles-ci ont majoritairement incombé aux femmes comme récipiendaires naturelles de ces corvées. Une telle situation, pour toute exceptionnelle quʼelle soit, permet de rappeler ce fait : un travail gratuit nʼest pas pour autant situé en dehors du champ économique. Pis, cʼest justement sa gratuité qui en fait la pierre angulaire dʼun système non soutenable qui combine habilement exploitation rémunérée et exploitation non rémunérée. Enfin, Maya Gonzalez et Jeanne Neton rappellent que le moment du confinement a vu la sphère du travail absorber le logis (plutôt que lʼinverse). Cette fusion entre les espaces de la production et de la reproduction montrent que «  les deux sphères  » peuvent continuer dʼapparaître comme une clé de lecture, à condition dʼadmettre que les sphères ne sont pas des boîtes, quand bien même lʼusine et la maison se synthétisent aisément en de jolis pictogrammes aux bords aussi fermés que ceux dʼune maison de poupée. Elles se contaminent, se superposent, deviennent «  floues  » (Gonzalez & Neton 2022[2012–13], 17) ; et ce flou participe aussi, paradoxalement, dʼune invisibilisation du travail non payé. Nommer cette invisibilité importe, mais implique aussi un examen attentif de ce que recouvre la notion de «  travail domestique  » avant dʼenvisager de le revaloriser.
Quel est le contenu dʼun programme de valorisation du travail domestique ? Et surtout, comment le design peut-il outiller cet effort ? Avant dʼapporter des éléments détaillés, il me faut observer que la réponse à cette question dépend dʼune définition dudit travail, qui peut être de deux natures au moins. Soit, très littéralement, on peut lister les tâches ou «  gestes ménagers  » (Kaufmann 2015[2005], 5) qui sont réalisées dans une cuisine, et sʼemployer à les catégoriser. Soit, on peut abstraire le raisonnement et approcher cette interrogation de manière plus symbolique. Ainsi, on pourrait autant dire que le travail domestique consiste à laver, repriser, essuyer, aspirer, épousseter, récurer, réparer, cirer, étendre, gratter, égoutter… que le décrire comme ce qui reproduit les enfants, produit le capitalisme, la bourgeoisie, ou encore lʼhétérosexualité. Du point de vue des designers, la première compréhension nʼest pas anecdotique par rapport à la seconde. Pire, passer tout de suite au plan symbolique risquerait de rejouer le drame de lʼinvisibilisation du travail féminin : vu comme inintéressant, peu spécialisé ou ennuyeux, il peut être tentant de le délaisser pour se concentrer sur les idées et sur les concepts. Les deux aspects sont bien entendu liés : cʼest que Jean-Claude Kaufmann nomme «  lʼintégration ménagère  », lorsquʼil affirme que «  ‹ [f]aire le ménage › (au sens des choses) cʼest aussi faire le ménage (au sens des personnes), constituer la famille  » (2022[1992], 79). Ce tableau schématique me permet de clarifier les niveaux pratique et symbolique que jʼévoque plus haut :
| des actions composent des tâches… | … qui produisent : | |
|---|---|---|
| CUISINER [ couper, hacher, foncer, décongeler, broyer, étaler… ] | ALIMENTE LA FORCE DE PRODUCTION DU MARI PARTICIPE À LʼÉLEVAGE DES ENFANTS (voir chapitre IV) | |
| LAVER [ frotter, savonner, briquer, essuyer, époussetter, rincer, détâcher, …] | PRODUIT LE STATUT SOCIAL DE LA FAMILLE PRODUIT LA BLANCHEUR (voir ci-dessous) | |
| DÉCORER [ accrocher, parer, couvrir, protéger, agrémenter, colorer, …] | PRODUIT LE STATUT SOCIAL DE LA FAMILLE PRODUIT LE LIEN SOCIAL DE LA FAMILLE | |
| RÉPARER [ scotcher, coller, visser, masquer, consolider, renforcer, coudre, repriser, …] | PRODUIT LE STATUT SOCIAL DE LA FAMILLE PRODUIT LE CONFORT POUR LES HABITANT·ES DU LOGIS |
La militante Abby Morton Diaz donne une liste très exhaustive des gestes qui incombent à la femme au foyer dans A Domestic Problem en 1875 :
Dresser les tables, les débarrasser, maintenir les lampes ou les appareils à gaz en ordre, polir les poêles, les couteaux, lʼargenterie, la ferblanterie, les robinets, les boutons, etc.; laver et essuyer la vaisselle ; sʼoccuper de la nourriture laissée aux repas ; balayer, y compris le grand balayage du vendredi, le balayage quotidien limité et le balayage à la pelle qui revient souvent ; nettoyer la peinture ; laver les lunettes, les fenêtres, les rideaux de fenêtre ; mettre en conserve et conserver les fruits ; la fabrication de sauces et de gelées, de conserves et de cornichons ; la fabrication et la cuisson du pain, des gâteaux, des tartes, des puddings ; la cuisson des repas et des légumes ; le maintien en bon état des lits, de la literie et des chambres à coucher ; lʼarrangement des meubles, lʼépoussetage et le ‹ ramassage › ; la préparation, à lʼheure prévue et dans lʼordre prévu, des trois repas ; laver le linge, le repasser, y compris les chemises et autres ‹ choses amidonnées › ; prendre soin du bébé, nuit et jour ; laver et habiller les enfants, réguler leur comportement, confectionner ou faire confectionner leurs vêtements, et veiller à ce quʼils soient en bon état, de bon goà »t, exempts de saleté, et adaptés au temps et à lʼoccasion ; faire pour elle-même ce que ses besoins personnels exigent ; arranger des fleurs ; recevoir de la compagnie ; soigner les malades ; ‹ laisser tomber › et ‹ laisser sortir › en fonction des enfants qui grandissent ; rapiécer, repriser, tricoter, crocheter, tresser, matelasser "641.
Bien entendu, cette liste nʼest plus complètement pertinente, 150 ans après son écriture. Mais les fonctions «  macro  » que sont nourrir, nettoyer, laver, fabriquer restent des catégories valides. En lisant cette liste, il apparaît que les savoir-faire de la travailleuse domestique sont très hybrides. Certains relèvent de la production, dʼautres de lʼentretien ; enfin, un grand nombre de ces gestes sont accomplis pour dʼautres (enfants, mari, animaux domestiques). Tricoter ou fabriquer le pain apparaissent bien comme des gestes de production, qui sont aujourdʼhui pour tout ou partie déplacés dans le champ de lʼindustrie et des loisirs créatifs. Une dernière liste, produite par Luce Giard accentue encore lʼimmense hybridité de lʼeffort nécessaire :
En cuisine, il faut toujours calculer son temps, son argent, ne pas dépasser le budget, ne pas surestimer sa propre vitesse dʼexécution, ne pas mettre en retard lʼécolier. Il faut savoir évaluer en un clin dʼœil ce qui sera le plus avantageux comme prix, comme préparation, comme saveur. Il faut savoir improviser avec brio, quand le lait ‹ tourne › sur le feu, quand sortie de son emballage et dégraissée la viande se révèle insuffisante pour quatre convives, ou quand Mathieu amène à lʼimproviste un petit camarade pour dîner et quʼil faut ‹ allonger › un peu le reste de pot-au-feu que je comptais leur servir ce soir. Il faut se souvenir que les Guy ont déjà eu du chou à la saucisse de Morteau lors de leur dernière visite et que Béatrice ne supporte pas le gâteau au chocolat, ou que le seul poissonnier du quartier fermera exceptionnellement toute cette semaine (Giard 1994b, 280).
Il semble, à lire Luce Giard, que seule une écriture plus poétique restitue lʼentremêlement intime des gestes de peu et des compétences sous-estimées qui composent la vie en cuisine. Une autre observation découle de lʼeffort analytique de description : le travail domestique comporte une forte composante contextuelle. Si une femme cuit du pain pour le vendre, elle pourra être boulangère ; mais si elle performe cette tâche à la maison, elle est simplement bonne épouse (Gonzalez & Neton 2022, 26). Ainsi, il est peut-être biaisé de se demander ce quʼest le travail domestique pour les femmes, puisquʼil «  ne se définit pas comme un travail effectué à la maison, mais comme un travail de femme  » (26). Toutefois, lʼapproche inverse est aussi possible : plutôt que de renoncer à une éprouvante liste dʼactions, toutes rassemblées par leur point commun -—être réalisées à la maison par des femmes -—, on pourra identifier un ensemble de travaux transverses qui sont potentiellement aliénants. Angela Davis observe en effet que de nombreuses femmes, à lʼépoque où elle écrit (le début des années 80) accueilleraient avec joie un «  househusband  » qui prendrait en charge les corvées. Mais pour lʼautrice et activiste, cela «  ne changerait pas vraiment la nature du travail en tant que tel  »642 (2019[1981], 201). Pour A. Davis, le travail domestique est «  invisible, répétitif, épuisant, non-productif, non-créatif  »643 : vu ainsi, il semble fatal quʼil fasse partie des «  des opérations, des gestes […] qui ne sont pas comptés  » et que lʼon retrouve «   chaque époque  » (Huyghe 2018[2015]b, 21). Si jʼai fait de lʼinvisibilité la dimension problématique transverse de ce sous-chapitre, chacun des autres termes mérite que je mʼy arrête. Je mʼemparerai en particulier des concepts de répétition et de non-productivité.
La raison principale pour laquelle le travail domestique nʼapparaît pas comme «  productif  » ne tient peut-être pas seulement à son association aux femmes, mais repose sans doute aussi sur sa nature même, fondamentalement répétitive. On connaît lʼexpression «  le travail dʼune femme nʼest jamais terminé  »644. Il ne sʼagit pas ici de suggérer que les femmes seraient plus perfectionnistes que les hommes ; il est plutôt dans la nature du ménage, de la cuisine et des autres tâches de devoir sans cesse être recommencées. La poussière balayée, la voici qui revient ; les sols propres se salissent inévitablement ; et chaque poignée dʼheures passées appelle la nécessité de la préparation dʼun nouveau repas (Davis 2019[1981], 200). Le film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman (1975), en est lʼexploration la plus frappante. Lʼhistoire de Jeanne ne peut atteindre de but ou de résolution, tant elle est prise dans le cycle permanent du retour du même645 (cf. infra). Une autre qualité du travail domestique se greffe à cette répétitivité : il sʼagit de son aspect invisible, non pas au niveau social, mais au niveau le plus littéral de la perception. Nombre dʼautrices ont pointé la nature exaspérante du ménage, à cet endroit : il ne se voit que lorsquʼil nʼest pas fait (Davis 2019[1981], 201 ; Chollet 2015, 164). La répétitivité, enfin, affecte également les gestes eux-mêmes. Il existe comme un gigantesque mouvement perpétuel qui relie les objets de la domesticité, tous réunis par lʼexpérience du va-et-vient : balai, serpillière, éponge à vaisselle, fouet à œufs, fer à repasser, jusquʼaux bras de la mère berçant son enfant. À la transparence du geste ménager, il faut enfin ajouter pour un effet maximal celle des tâches interstitielles, trop ténues pour être perçues comme telles. Ainsi, dans les années 1970, Ivan Illich parle dʼun «  travail de lʼombre  »646 dans lequel il classe le fait de faire les courses au supermarché, aller à la banque ou encore faire la queue dans un commerce (Komlosy 2018, 70). Illich défend lʼidée que ce travail ne crée pas de valeur, ce qui lui vaudra dʼêtre critiqué par des autrices féministes. Pour ma part, jʼobserverais plutôt que cette absence de valeur accordée par la société vient justement de la qualité de ces tâches.
Le travail domestique est donc enfermé dans une boucle logique sans fin : il est gratuit parce que invisibilisé, invisibilisé parce que gratuit. Il est fait par les femmes parce quʼil nʼa pas de valeur, et il nʼa pas de valeur parce quʼil est fait par les femmes. Difficile dʼidentifier des causes et donc des lieux dʼintervention pour le design, dans un tel processus circulaire. Il est probable que la recherche dʼune cause initiale soit assez vaine et les symptômes, en tant que designers, nous intéressent sans doute davantage. Parler dʼinvisibilité revient ainsi à faire de la question un problème dʼordre visuel, ce qui en Occident est fréquent avec la primauté de la vision sur les autres sens (Berger 1972). En réalité, le travail domestique est aussi victime dʼun trou de langage. Dans ses travaux fondés sur des entretiens avec des couples, Isabelle Clair parle de la difficulté à «  dire  » la tâche (2007, 250). Cela éclaire en partie le fait que la prise en charge collective de ces tâches nʼait jamais fait lʼobjet dʼun débat public (Méda & Périvier 2007, 19–20). Repenser la cuisine est donc tout autant un problème de design que pour les arts et les médias. La question de la prise de forme de la cuisine est directement liée à celle de la concrétisation, dans le langage, des gestes, habitus et expériences qui sont ceux de la housewife. Jʼai évoqué plus tôt la WomanHouse en tant quʼexpérience de collaboration autour dʼun projet non seulement artistique mais aussi architectural ; sa dimension esthétique, en tant quʼelle mobilise des savoir-faire méprisés et des actions ordinaires, est également capitale. Dʼautres travaux récents, sur des supports différents, me semblent accomplir un travail similaire, tels le documentaire Lʼhistoire oubliée des femmes au foyer de Michèle Dominici (2021) ou lʼouvrage auto-ethnographique et généalogique Nos mères de Karine Bastide & Christine Détrez (2020). Réinventer les formes et le langage est nécessaire pour rendre compte dʼun temps qui sʼaligne mal avec les exigences du capitalisme647.
Nommer la domination des schèmes visuels ne revient pas à vouloir les écarter ; en tant que graphiste, jʼaurais du mal à assumer une telle position. Il est même probable que les images (de toutes sortes) ont la capacité à combler les trous de langage quʼoccasionnent les listes comme celle que jʼai produite plus haut, ou la longue énumération de Abby Morton Diaz, qui fait écho à dʼautres écrits du même type648. Il me faut restituer la cohérence de chaînes de gestes, plutôt que nommer de manière segmentée telle ou telle action. La chaîne évoque un mouvement sans fin (Pagès 2023) qui crée des zones dʼhybridité, en même temps quʼelle fait disparaître le temps non occupé. Les schémas de Paulette Bernège montraient bien à quel point le temps de loisir des femmes au foyer était compté ; presque un siècle plus tard, aux États-Unis, Brigid Schulte fait le même diagnostic, évoquant un «  temps en confetti  »649 (2014) pour des femmes qui cumulent emploi salarié et travail à la maison. Le temps libre féminin ou les «  minutes de bonheur  »650, comme les désigne Lilian Gilbreth (Penner 2018) sont comptées et aisément grignotées. Le temps partagé avec les enfants, en particulier, est ambigu : faut-il le compter comme loisir, alors même quʼil implique des tâches comme préparer un repas, faire couler un bain ou aider à faire les devoirs ? (DeVault 1995, 1 ; Szabo 2013, 626) Les hommes bénéficient quant à eux de manière structurelle de la séparation foyer-travail et peuvent plus aisément séparer les deux temps de la journée ou de la semaine (Szabo 2013, 626). À lʼopposé, le temps des femmes ne bénéficie pas de frontières aussi claires (DeVault 1991, 5). Il suffit de penser, par exemple, aux repas de famille (à Noë l, entre autres) censés être des moments de détente collective, bien vite finis pour les femmes aussitôt que la table doit être débarrassée ou quʼil faut se lever pour faire couler le café. Cʼest peut-être aussi pour cette raison que le travail domestique est disqualifié, ou méprisé : pris dans des chaînes de temps familial, ou au cÅ“ur dʼautres activités, il nʼest pas immédiatement compris, encore et toujours, comme un travail.
Hybride, le travail domestique est aussi paradoxal. Faire le ménage, quʼil sʼagisse dʼune tâche réalisée comme femme au foyer ou comme personnel «  technicien·ne de surface  » est souvent perçu comme une tâche peu qualifiée, cʼest-à -dire un ensemble de gestes qui ne requièrent pas de spécialisation ou dʼéducation particulière -—ce qui ne dit rien, par ailleurs, de la pénibilité du travail en question. Toutefois, la question même de la «  qualification  » au travail ménager est traversée de contradictions. Le motif récurrent du «  partage des tâches  » dans le foyer est particulièrement animé par ce sujet. Jʼai déjà évoqué la manière dont le travail domestique, même lorsquʼil est partagé, est toujours considéré comme le travail des femmes. Ainsi, on pourra dire que les hommes «  donne[nt] un coup de main  »651 (Hayes 2010, 193), plutôt quʼils ne participent à lʼentretien dʼune maison qui est aussi la leur. Lʼaveu dʼincompétence et un comportement visant à lʼétablir, est une attitude possible des hommes face aux corvées domestiques. Les recherches en sociologie sur le partage des tâches mettent en évidence ces figures discrètement démissionnaires : Jean-Claude Kaufmann parle de «  lʼhomme élève  » (2022, 260), tandis que François de Singly les désigne comme de «  grands enfants  » lorsquʼil décrit les espaces de repos pour hommes prévus par la chaîne de grands magasins Marks & Spencer en prévision de lʼinévitable lassitude que vivront ces clients vus comme de simples accompagnateurs de leurs épouses préposées aux courses (2007, 36). Cʼest aussi, dans le même ouvrage, la figure de «  lʼhomme second  » qui fait surface, notamment lorsquʼune enquêtée désigne son conjoint comme «  le prolongement de sa main  » (Mougel-Cojocaru & Paris 2007, 159). En lisant des témoignages issus de contextes très différents, en France, dans la classe moyenne étudiée dans Lʼinjustice ménagère, ou aux États-Unis avec les homemakers interviewé·es par Shannon Hayes, on retrouve ce personnage, ou plus précisément cette attitude de laisser-faire, comme sʼil existait pour les hommes une incapacité intrinsèque à se saisir dʼun tel labeur. Ainsi, Kelly, enquêtée de S. Hayes, observe que son mari «  ne peut pas apprendre à lessiver le sol  », pour conclure : «  [ç]a le dépasse, pour je ne sais quelle raison  »652. En France, lʼenquêtée Agnès constate à propos de son compagnon quʼil «  nʼest pas aidé, le pauvre garçon  » (Gaviria & Letrait 2007, 201), au point de le soupçonner de «  sabotage  » (193). Bien sà »r, on pourra juger ces propos rabaissants et humiliants : mais il y a aussi quelque chose de stratégique à plaider lʼincompétence, sur au moins deux plans : les hommes évitent ainsi (et selon les statistiques, encore avec succès) une véritable prise en charge de leur part dans ce travail, et, en se dissociant dʼun travail vu comme féminin, assoient leur masculinité.
Le travail domestique est donc hyperqualifié et sous-qualifié, selon les contextes où on le mobilise. Lorsquʼil doit être fait par un homme, il est perçu comme difficile et spécialisé ; lorsquʼil doit être compensé, ou rémunéré, il devient soudainement sous-qualifié. Jʼai évoqué précédemment comment la scientifisation de la cuisine a donné lieu à la création de carrières pour des proto-influenceuses comme Lilian Gilbreth ou Paulette Bernège. Il faudrait bien sà »r mentionner toutes les initiatives dʼécoles ménagères, en France, aux États-Unis et plus largement en Occident. Mais professionnaliser lʼenseignement du travail domestique ne le fait nullement monter en gamme. Jʼai encore en mémoire mon propre parcours scolaire, particulièrement au collège, où les formations «  sanitaire et social  » étaient brandies comme une forme de sanction pour les élèves femmes aux résultats les plus faibles. En professionnalisant la cuisine et le logis, on court aussi le risque dʼaugmenter le niveau dʼexigence associé à la tâche, et de la rendre plus chronophage. Là aussi, un souvenir personnel a été saisissant dans mon parcours de recherche. En 2023, en visite à lʼexposition Plateau volant, motolaveur, purée minute · Au salon des Arts ménagers (1923–1983) au MUCEM (Marseille653), je mʼattarde devant une vidéo explicative des années 1950654 présentant la méthode pour repasser une chemise. Marquage des plis, sens de repassage, préparation dʼun mélange pour amidonner le col : tout est détaillé et montre un ensemble de gestes techniques précis, mais, plus encore que la vidéo, ce sont les réactions des visiteuses (ayant entre 50 et 60 ans) qui mʼont interpellé, tant elles soupiraient. Elles nommaient dans leurs discours le fait que cʼétait bien ainsi que les choses se passaient «  avant  » et quʼelles avaient effectivement vu leurs mères réaliser ces tâches. La tâche ménagère demande donc à être décortiquée : «  repasser le linge  » est une expression qui recoupe bien des réalités. Par ailleurs, la réaction des visiteuses du MUCEM me rappelle que la tâche est souvent dénigrée, perçue comme une corvée. Face à elle, trois actions sont possibles : la réaliser, lʼabandonner (et là , renoncer aux cols amidonnés) ou la déléguer.
La désignation du travail domestique en tant que travail ne mène pas nécessairement à sa revalorisation. Cʼest dʼailleurs une contradiction qui traverse le travail tout entier, notamment dans son approche par les théories marxistes. En effet, il existe dans les pensées de gauche une tension entre adhésion au travail et à la figure du travailleur (lʼidéal de société pouvant être fondé sur le modèle de lʼusine) et son rejet, dans la mesure où le travail est jugé comme inséparable dʼun système capitaliste quʼil faut abolir (Vishmidt 2010, 82). Lʼhistoire des écoles ménagères en France est traversée par cette contradiction. Là où Paulette Bernège les défendait comme le socle de la revalorisation du travail féminin, grâce au levier de la scientifisation, elles sont aujourdʼhui rejetées, soit par les institutions (notamment celle, scolaire, qui en fait ses «  classes poubelles  »), soit au niveau des individus et du groupe social des femmes qui, à la manière de cette visiteuse du musée, regarde la tâche ménagère technicisée comme un repoussoir. À partir de 1936, en France, un concours récompense la «  meilleure ménagère de France  » (Bouillon 2022, 142). Il est pas intéressant de considérer quʼon peut élever une pratique en empruntant aux codes sociaux dʼautres disciplines plus rayonnantes. Si les architectes ont des prix, pourquoi pas les ménagères ? Cette compétition se tient de 1936 à 1939, puis de 1949 à 1970 sous le nom de concours de «  la Fée du logis  » (ibid.). Dans lʼexposition Plateau volant, motolaveur, purée minute, on apprend que ce concours qui a connu de nombreuses critiques pour sexisme a été renommé «  concours national de lʼéconomie familiale  » en 1971 avant sa suppression655. Je ne veux pas suggérer ici que cette compétition aurait dà » être maintenue : dans le contexte de la lutte pour les droits des femmes, dénoncer les soubassements sexistes dʼune telle initiative semble même très à propos. Jʼobserve toutefois que sa suppression met en évidence lʼimpossible réconciliation entre un projet de revalorisation du travail considéré comme «  féminin  » et un agenda politique concentré sur les droits des femmes. Dans un cas, professionnaliser le travail permet sans doute de voiler son assignation à un groupe spécifique de personnes, les femmes. Dans lʼautre, lʼémancipation se fait au prix du rejet du logis, qui peut être non effectif (jʼévoquerai plus loin la «  double journée  ») ou faire à nouveau le jeu du capitalisme (les externalisations).
Il nʼexiste pas de définition uniforme de la tâche ménagère, car même le geste le plus simple est soumis à des interprétations individuelles (Giard 1994b, 283). Par ailleurs, et cʼest peut-être là un des rares universels de la condition humaine, il apparaît que tout environnement doit être entretenu, ne serait-ce quʼa minima. Même cellui qui abandonne toute notion de ménage doit bien encore se nourrir : le travail domestique me semble donc un incontournable, même si sa domesticité même est mouvante et peut être repensée. Lʼimage stéréotypée de la femme au foyer, résistante malgré les évolutions sociales, peut faire oublier le fait que le contenu des tâches a changé au cours de lʼhistoire, et que lʼindustrialisation de la production des biens nʼest pas un facteur anodin dans cette évolution. À ce sujet, Dolores Hayden souligne le fait que lʼindustrialisation ne libère pas nécessairement les femmes des tâches, mais plutôt quʼelle en change la nature (1982, 12) : les femmes ne doivent ainsi plus fabriquer les bougies, mais nettoyer les globes des lumières au gaz ; elles ne doivent plus tisser, mais le coton industriel augmente leur charge de lessive, car il doit être lavé plus souvent que le lin (Schwartz Cowan 1989, 65). Organiser la prise en charge de la tâche peut donc avoir deux objets principaux : repenser de manière interne les gestes derrière un intitulé (par exemple, «  repasser  ») et, de manière externe, penser lʼexécution et la compensation de la tâche. Cʼest à ce dernier aspect que je vais à présent mʼintéresser.
Jʼai évoqué la manière dont «  revaloriser  » nʼétait pas une stratégie au contenu évident. En tout cas, elle ne désigne pas un programme clair et, selon les traditions et les auteurices qui ont théorisé cette question, les attitudes sont différentes, voire divergentes. Andrea Komlosy résume bien lʼhétérogénéité des positionnements à ce sujet, quand elle évoque la contestation régulière de la nature de «  travail  » du travail domestique :
Les stratégies visant à remédier à cette situation délicate sont très divergentes, allant du dépassement (par la professionnalisation des travaux ménagers) à la rémunération (salaires pour les travaux ménagers), en passant par la revalorisation sociale (par la reconnaissance morale, la répartition obligatoire entre les membres adultes du ménage ou les cotisations dʼassurance sociale)656 (Komlosy 2018, 80).
Lʼautrice ajoute que, pour reconnaître les tâches domestiques comme travail, il faut reconnaître chaque activité comme travail -—ce que jʼai entrepris précédemment, notamment en mʼemployant à proposer de nouvelles catégories générales de compréhension. Rémunérer lʼexécution de la tâche ménagère est un moyen évident de revalorisation qui obéit aux principes fondamentaux du capitalisme : a une valeur ce qui est convertible en argent sur une place de marché. Mais le dire nʼélucide pas les modalités de la compensation. Qui est payé pour faire ce travail ? Face à cette question, deux solutions se sont imposées : on a pu imaginer rémunérer les femmes pour leur travail à la maison ou payer dʼautres personnes sur le modèle du salariat ou de la prestation.
Revaloriser nʼest pas une entreprise limitée aux travaux non rémunérés des femmes au foyer. La pensée féministe (et même toute pensée minoritaire) peut être comprise comme un effort pour changer «  ce qui compte comme savoir  »656:1 (Haraway 1988, 580). Mais le cas précis du travail domestique se heurte, nous lʼavons vu, aux contradictions internes du capitalisme. Aussi le travail à la maison pourrait-il compter en commençant à compter les heures passées à lʼexécuter, et en le compensant par une rétribution pécuniaire. Cʼest la revendication première du mouvement Wages for Housework qui sʼinscrit dans le contexte des luttes féministes étasuniennes de la deuxième vague. Il est fondé par Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici, Brigitte Galtier et Selma James en 1972, lors de la troisième conférence du Womenʼs Lib à Manchester657. Silvia Federici publie un ouvrage au nom identique en 1975. Au même moment, des groupes émergent avec des revendications similaires dans dʼautres pays du monde (Robert 2017, 58). Aux États-Unis apparaît un slogan comme Black Women for Wages for Housework (fig. 3.54) ; au Québec, la question sera saisie par le CFI (Collectif Féministe International), notamment dans la revue Québecoises deboutte ! et en Suisse par le journal Lʼinsoumise de Genève (Toupin 2016 ; Vergès 2019, 111 ; Robert 2017, 58). Selon lʼhistorienne Camille Robert, la revendication dʼun salaire ménager dans les revues féministes au Québec nʼest pas immédiatement lisible dans les articles publiés (2017, 101). Il est vrai que les sujets possibles sont multiples pour les groupes féministes de lʼépoque : santé reproductive, violences conjugales, accès à lʼavortement, maternité, internationalisation de la lutte, sexualités, égalité salariale, accès aux espaces dominés par les hommes… Autant de sujets qui restent dʼailleurs parfaitement dʼactualité en 2023. Le numéro 0 de la revue française Le Torchon brà »le montre bien quʼil nʼy a pas de lien évident entre la critique de lʼassignation ménagère et la revendication dʼun salaire qui lui est associé. Par conséquent, le thème du salaire ménager a pu disparaître des publications féministes, et parfois revenir en force, comme cela a été le cas au Québec en 1977 dans la revue Les Têtes de Pioche (Robert 2017, 103). Plusieurs arguments soutiennent la demande dʼune compensation du travail domestique. Il sʼagit tout dʼabord dʼune demande dʼégalité : si le travail des hommes est compensé dans le secteur privé, pourquoi le travail des femmes ne le serait-il pas, a fortiori sʼil bénéficie aux hommes salariés ?

Cette rémunération permet aussi de soutenir dʼautres luttes féministes liées, comme la promotion de lʼautonomie financière des femmes -—un point clé, encore à ce jour, pour se soustraire aux violences domestiques658. Camille Robert repère également un enjeu subjectif de cette lutte concernant les conséquences physiques et psychologiques du travail domestique et dʼinvestir un «  droit à la fatigue  » (2017, 104). Enfin, Sylvia Federici, co-fondatrice du mouvement, voit aussi dans la lutte pour le salaire domestique un espace stratégique, permettant aux femmes de sʼorganiser (Vergès 2019, 113). Mariarosa Dalla Costa défend dans cet esprit lʼidée dʼune grève du travail domestique. Reconnaître cette activité comme travail ne revient donc pas à la laisser glisser vers la sphère du capitalisme, dans un seul souci pécuniaire : cela permet aussi de transférer une forme de conscience de classe et des stratégies de luttes à la classe des femmes, particulièrement la classe des femmes au foyer. La chercheuse en sciences politiques Louise Toupin écrit en effet :
Les femmes, par leur travail, sont donc le pivot de lʼ«  autre usine  »659, lʼusine «  sociale  », située à côté de lʼusine «  économique  », et cachée par cette dernière (Toupin 2016).
Voilà qui donne un sens nouveau à lʼidée de «  cuisine-usine  » explorée dans ce chapitre : la cuisine ne serait pas seulement une usine en tant quʼelle produit des choses, mais dans la mesure où elle constitue LʼAutre usine du capitalisme, son reflet dans un miroir déformant, lieu dès lors disponible aux grèves, à la syndicalisation et à toute forme de mobilisation rendue nécessaire par les conditions dʼexploitation.
Le concept de salaire ménager se heurte bien sà »r à des limitations politiques et économiques. Au XXIe siècle, en Occident, le «  second salaire  »660 qui est celui des femmes nʼapporte plus un complément de revenu appréciable, comme cela a pu être le cas dans les années 1950 ou 1960 pour les familles blanches661, mais constitue une part des gains absolument nécessaires à la survie économique du ménage (Hayes 2010, 125). Un salaire ménager fonctionnel devrait donc sʼaligner sur les salaires du secteur privé : sans quoi, les femmes risquent bien de cumuler revenu dʼune entreprise et revenu domestique -—ce qui ne ferait que renforcer le problème existant de la «  double journée  » (Hochschild 2012). Une autre critique fréquente adressée au concept de salaire domestique en pointe le sexisme potentiel. En effet, certaines voix se sont élevées pour dénoncer le fait que salarier ce travail permet dʼenchaîner un peu plus les femmes au logis, et de renforcer le contrôle bureaucratique sur leurs existences (Komlosy 2018, 35). Le fait même que des personnalités dʼextrême droite se soient positionnées en faveur dʼun tel dispositif nʼest pas indifférent. En 2012, Marine Le Pen a fait face à de nombreuses critiques en inscrivant dans son programme la création dʼun salaire parental, ce qui était, selon ses détracteur·es, opposé à la lutte pour «  lʼégalité des sexes  » (Rosset 2022). Elle a dʼailleurs depuis retiré cette proposition du programme du Rassemblement National. Il est dommage que personne nʼait alors rappelé à ce moment-là quʼil sʼagissait dʼune énième instrumentalisation par lʼextrême-droite de pensées et luttes venues de la gauche. Au demeurant, le fait de rémunérer les femmes au foyer peut servir un agenda conservateur, surtout si ce salaire sert à limiter les choix des intéressées.
Pour mieux le comprendre, on peut considérer un instant que le salaire ménager existe peut-être déjà , de manière oblique, sous la forme de certains subsides dʼÉtat. Cʼest en tout cas lʼanalyse que font Dominique Méda et Hélène Périvier de lʼAPE (Allocation Parentale dʼÉducation) créée en 1994. Cette aide nʼétait pas intrinsèquement dirigée vers les femmes, mais dans les faits, ce sont elles qui en ont majoritairement bénéficié. D. Méda et H. Périvier observent que lʼAPE a été critiquée comme un salaire ménager qui ne disait pas son nom ; pour elles, le dispositif a pu servir à dissuader les femmes moins diplômées de retourner vers lʼemploi (2007, 23 ; 94). Dʼautres analyses lisent comme un salaire domestique dʼautres formes dʼaides sociales, comme le congé maternité (Komlosy 2018, 36), tandis que Camille Robert évoque quant à elle certaines aides dʼétat québécoises, des pensions de veuves de guerre aux aides aux allocations familiales. Ici, le glissement est autorisé par un jeu dʼéquivalences entre aide sociale et salaire domestique : ce nʼest plus exactement le travail qui est compensé, ou même lʼeffort de la tâche, mais une condition. On pourrait tout aussi bien contester lʼidée quʼune aide sociale possède le statut de compensation. En résumé, le salaire domestique, avant dʼêtre la création dʼun mouvement, reste une hypothèse non formalisée et un point de débat.
Angela Davis offre un regard critique essentiel sur lʼhypothèse du salaire ménager, notamment celle proposée par Wages for Housework. Dans un chapitre consacré à «  lʼobsolescence  » du travail domestique, elle sʼinterroge : «  Sʼil était possible de simultanément en finir avec lʼidée que les tâches ménagères sont le travail des femmes et de les redistribuer de manière égale entre hommes et femmes, cela constituerait-il une solution satisfaisante ?  »662 (2019[1981, 200). A. Davis traite cette question en mettant en évidence le présupposé des personnes en faveur dʼun dispositif de compensation financière pour les femmes au foyer. Pour lʼautrice et militante, cette forme dʼactivisme repose sur un implicite : le capitalisme ne peut pas fonctionner sans le travail gratuit des femmes. A. Davis propose donc dʼobserver lʼexemple de la situation des femmes en Afrique du Sud dans le contexte de lʼApartheid :
Dans la société sud-africaine, où le racisme a poussé lʼexploitation économique à lʼextrême limite, lʼéconomie capitaliste trahit sa séparation structurelle de la vie domestique dʼune manière particulièrement violente. Les architectes sociaux de lʼApartheid ont simplement déterminé que le travail des Noir·es rapportait plus de profits lorsque la vie domestique était presque intégralement supprimée663 (2019[1981, 211).
Dans ce système, les hommes noirs sont considérés comme une force de travail exploitable, et leurs épouses et enfants comme encombrant·es et inutiles. Il sʼagit certes dʼun exemple précis, qui plus est, hors dʼun cadre de référence occidentale, mais il a le mérite de montrer que le lien dʼinterdépendance entre travail domestique et travail salarié nʼest peut-être pas aussi immuable quʼil y paraît. Par ailleurs, A. Davis affirme que la condition des travailleureuses de lʼentretien est un indice de lʼimpasse du salaire ménager. Un travail salarié peut être source de maltraitances -—et A. Davis parle alors du film dʼOusmane Sembène La noire de… (1966), que jʼévoquerai ci-après et qui en est une illustration criante. Pour lʼautrice, il est urgent que les femmes investissent les mêmes espaces professionnels que les hommes, car cʼest là quʼelles pourront sʼorganiser politiquement contre le système capitaliste (219). Si lʼargument sʼentend, il ouvre néanmoins des questions au sujet du travail domestique. Les femmes au foyer sont cantonnées à leur domicile ou à leur logis, en apparence. En cela, leur isolement préfigure la solitude des travailleureuses employé·es à la tâche qui ne possède plus de lieu commun pour structurer une lutte de classe. Mais nous avons vu précédemment que des formes de solidarité existent, et que celles-ci ne sont pas apolitiques. Autrement dit, avant de penser un salaire domestique, ne faudrait-il pas penser la manière dont ces travailleuses pourraient créer un syndicat ménager ?
On pourra trouver que je mʼéloigne du design pour être au plus près des efforts de réforme sociale. Mais cʼest peut-être un des écueils possibles de cette étude et des entreprises de re-design de la cuisine quʼil faut pointer pour adopter une posture juste. Pour lʼautrice Marina Vishmidt, la cuisine de Francfort de Margarete Schütte-Lihotzky souffre précisément de ce problème, dans la mesure où elle «  propose une solution de design à une question sociale  »664 (Vishmidt 2010, 84). M. Vishmidt relativise sa critique en rappelant que le design peut bien sà »r se préoccuper de questions sociales. Mais pour elle, le fait de redesigner la cuisine implique de prendre la femme au foyer là où elle est. Cette dernière est alors libérée «  en tant que femme au foyer  » plutôt que «  dʼêtre libérée de sa condition de femme au foyer  »665 (ibid.). Certaines analyses pourraient donc ouvrir sur des solutions de design (améliorer le quotidien des femmes au foyer) tandis que dʼautres seraient lʼobjet de la lutte des classes, moins immédiatement saisissables pour les designers. Il me semble quʼil faut envisager une situation multifocale. Les anarcho-syndicalistes défendent par exemple lʼidée selon laquelle adopter une perspective révolutionnaire nʼempêche en rien de travailler par ailleurs sur des réformes. Il me semble que le design peut être envisagé de la même manière : ici, la discipline servira à rendre le quotidien plus plaisant, ailleurs, il pourra outiller la lutte (ne serait-ce quʼen termes de signes, comme le montre la longue tradition de lʼaffiche et du tract politiques). Pour lʼheure, jʼabandonne cette apparente impasse du salaire ménager, pour mʼintéresser à une seconde possibilité pour revaloriser le travail domestique, celle-là même qui suscitait le scepticisme dʼAngela Davis : lʼexternalisation des tâches sur des travailleureuses spécialisé·es.
Si le travail domestique mérite un salaire, pourquoi ne pourrait-il pas se professionnaliser au point de devenir une possibilité dʼemploi pour un ensemble de travailleureuses employé·es ? Cette question semble avoir déjà une réponse puisque, contrairement au salaire ménager, il existe bel et bien un ensemble de métiers qui relèvent de cette catégorie du travail domestique. Lʼexternalisation du travail lié au foyer nʼest pas un phénomène nouveau : les classes aristocratiques, en Europe, sʼen sont déchargées sur la classe des domestiques ; les classes bourgeoises ont pu asseoir leur pouvoir en refusant également de prendre en charge ce travail associé à la souillure. Jʼai déjà évoqué la manière dont cet emploi relève dʼune double mise à distance : dʼabord sur le plan de la tâche elle-même, que les plus aisé·es nʼassurent pas ; et au niveau architectural, qui sépare les travailleureuses de leur employeur·ses par un ensemble de sections spatiales (le Grand Commun à Versailles, ou encore le modèle de la chambre de bonne pour les demeures bourgeoises). Autrement dit, cet arbitrage social nʼest pas une abstraction et se traduit directement sur la manière dont lʼhabitat est structuré. Inversement, en fixant les relations de pouvoir dans le bâti -—en définissant par exemple des espaces où les un·es ne vont pas, et qui sont réservés aux autres -—le design dʼespace fait plus que de rendre visibles ces dynamiques dans la mesure où il structure directement ces relations de pouvoir.
À la fin du XXe et au début du XXe siècles, lʼexternalisation des tâches ménagères sur une main-dʼœuvre féminisée et peu qualifiée a été facilitée par deux phénomènes concomitants. Premièrement, le vieillissement de la population en Occident, et la fin de la prise en charge des plus âgé·es par leurs familles a rendu nécessaire le recours au «  service à la personne  » en masse (Devetter & Rousseau 2011). En partie pour cette raison, cette typologie de travail a été identifiée dans les années 2000 en France comme un gisement dʼemplois bienvenu dans un contexte où les chiffres du chômage étaient croissants. On reconnaît bien ici un écueil repéré par Dolores Hayden : lorsquʼun problème est identifié comme relevant du domaine privé, sa solution apparaît naturellement comme individuelle. Ce concept de «  service à la personne  » est utilisé par lʼÉtat français dans sa communication, notamment visuelle, au sujet dʼun dispositif fiscal censé faciliter le recours à de tels services (fig. 3.55) fig. 3.55 : Logo du service à la personne en France. On le retrouve sur une variété de sites Web, institutionnels et privés.. Ce terme de «  service  » est très opaque, et de nombreuses autrices féministes se sont employées à nommer lʼeffet global de brouillage quʼil produit, notamment entre des activités typologiquement très différentes dʼentretien du bâti et du soin aux personnes (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes, etc.) (Tronto, Devetter & Rousseau 2011  ; Chollet 2015, 179 ; Fraisse 2021, 28). Si le brouillage est si effectif, cʼest que les limites qui séparent une activité de lʼautre ne sont peut-être pas si claires. Par exemple, préparer un repas pour des enfants pourrait aisément être catégorisé comme «  activité culinaire  », et donc relever du travail domestique. Mais on prépare rarement un repas pour des enfants sans les faire manger, avec tout ce que cela implique de soin et de travail émotionnel. Une fois ce care accompli, il faut bien laver la vaisselle, ranger la cuisine, etc. : on retourne ainsi au travail domestique. Autrement dit, se décharger du travail domestique consiste souvent à transférer un peu de sa vie vers un·e travailleur·se. Cʼest particulièrement sensible dans les tâches qui impliquent les personnes dépendant·es : la force de travail requise est tout autant temporelle, physique quʼémotionnelle, comme lʼa fort bien montré Caroline Ibos dans ses travaux (2012, 112–13).
fig. 3.55 : Logo du service à la personne en France. On le retrouve sur une variété de sites Web, institutionnels et privés.. Ce terme de «  service  » est très opaque, et de nombreuses autrices féministes se sont employées à nommer lʼeffet global de brouillage quʼil produit, notamment entre des activités typologiquement très différentes dʼentretien du bâti et du soin aux personnes (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes, etc.) (Tronto, Devetter & Rousseau 2011  ; Chollet 2015, 179 ; Fraisse 2021, 28). Si le brouillage est si effectif, cʼest que les limites qui séparent une activité de lʼautre ne sont peut-être pas si claires. Par exemple, préparer un repas pour des enfants pourrait aisément être catégorisé comme «  activité culinaire  », et donc relever du travail domestique. Mais on prépare rarement un repas pour des enfants sans les faire manger, avec tout ce que cela implique de soin et de travail émotionnel. Une fois ce care accompli, il faut bien laver la vaisselle, ranger la cuisine, etc. : on retourne ainsi au travail domestique. Autrement dit, se décharger du travail domestique consiste souvent à transférer un peu de sa vie vers un·e travailleur·se. Cʼest particulièrement sensible dans les tâches qui impliquent les personnes dépendant·es : la force de travail requise est tout autant temporelle, physique quʼémotionnelle, comme lʼa fort bien montré Caroline Ibos dans ses travaux (2012, 112–13).
Lʼexternalisation déplace le problème du travail domestique plus quʼil ne le résout. Mais qui sont les personnes à qui est délégué ce travail ? Une analyse trop rapide nous ferait applaudir un tel déplacement qui permet aux femmes dʼêtre «  libérées  » de la charge domestique. Cʼest oublier que ce travail est en général transféré à des femmes pauvres, migrantes, racisées, souvent sans-papiers (Nakano Glenn 1992, 7–8 ; Falquet & Moujoud 2010, 172–73). Dès le début du XXe siècle, la classe bourgeoise française recourt à une main-dʼœuvre migrante constituée de femmes italiennes, portugaises, espagnoles et allemandes (Falquet & Moujoud 2010, 174). Dès les années 50, elles sont remplacées par les femmes des Territoires dʼOutre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), puis, avec lʼIndépendance de lʼAlgérie (1962), par des femmes algériennes. La classe des domestiques va donc devenir majoritairement racisée. Si celle-ci est rémunérée pour ses services, il sʼagit souvent dʼemplois précaires qui rejouent des dynamiques propres à lʼesclavage ou à lʼexploitation coloniale. Par ailleurs, le dispositif administratif du Bumidom proposé à partir de 1963 par le député Michel Debré facilite et accélère la venue de femmes en métropole pour proposer leurs services. Ce bureau, sous couvert de facilitation de lʼemploi, soutient en réalité un agenda politique double : contrôler la natalité en faisant partir les femmes, et limiter la participation aux luttes de décolonisation en cours (Haddad 2018, 199).
Cette histoire française sʼinscrit dans un contexte plus global qui voit les métiers de service être mondialisés dans la seconde partie du XXe siècle (Anderson 2000 ; Ibos 2012, 125). Tandis que les usines sont délocalisées dans les pays du Sud où la main dʼœuvre industrielle est moins chère, le service domestique se délocalise aussi – pas territorialement, mais de manière atomisée, dans les corps des personnes déplacées, notamment par les crises politiques (Anderson 2000, 30). Si la cuisine est donc un appareil de production du genre dans le contexte du foyer, elle produit aussi et tout autant la race et la classe. Le rapport employeuse/employée est exemplaire à cet égard. Françoise Ega, dite MamʼEga, travailleuse domestique et militante née en Martinique, décrit dans Lettres à une noire (2000) les relations spécifiques qui relient les maîtresses blanches à leurs employées noires. Ce nʼest pas seulement que les unes se libèrent aux dépens des autres ; cʼest plutôt que la féminité blanche se construit par opposition à la féminité noire, à qui elle délègue des tâches (et la saleté qui les accompagne) pour affirmer sa supériorité (Anderson 2000, 147). Françoise Ega évoque par exemple la manière dont une employeuse insistait pour appeler son employée «  Renée  », parce que cʼétait le prénom de la personne qui lʼavait précédée à ce poste (Desquesnes, 2016/17 ; Ega, 2000). : travail de femme, le travail domestique est aussi un lieu de dépersonnalisation, quand la nature de la tâche avale celle qui le réalise.
Ce témoignage écrit de Françoise Ega fait écho au film dʼOusmane Sembène, La Noire de… (1966), qui raconte lʼhistoire de Diouna (Thérèse NʼBissine Diop), une jeune Sénégalaise employée à Dakar par une famille blanche en vacances. À lʼissue de lʼété, Diouna, dont les services ont été appréciés, se voit offrir par le couple un emploi de nourrice en France. Arrivée à Antibes, elle vit une désillusion : on ne lui confie nullement le soin des enfants, réservé à une nourrice blanche, mais le travail domestique dans la maison. Comme dans le récit de Françoise Ega, la dépersonnalisation semble être une condition de lʼemploi proposé. À Diouna, séduite par la promotion de classe que constitue un emploi en France et qui rêve déjà de rendre ses amies jalouses grâce à ses beaux habits achetés en ville, lʼemployeuse impose le port dʼun tablier pour remplacer ses tenues quʼelle juge trop élégantes. Bien que ce ne soit jamais explicité, la rivalité autour du regard masculin du mari plane sur la scène où la maîtresse blanche attrape physiquement Diouna pour lui nouer un tablier autour de la taille (fig. 3.56.a & b) au prétexte quʼelle nʼest «  pas à la noce  ». Elle lui intime ensuite de préparer un «  bon riz au mafé  ». Diouna sʼexécute, tout en observant intérieurement que ce riz nʼa rien de traditionnel et que jamais le cuisinier de Dakar nʼen a préparé : il est une production exotique destinée à ses maîtres blanc·he·s, heureuxes de lʼexhiber devant leurs invité·es -—comme les masques africains dont sont ornés les murs de leur pavillon et qui se tiennent an arrière-plan dans un grand nombre de scènes, comme un rappel du continuum de possessions coloniales dans lequel est inscrit le corps de Diouna.


Après avoir été victime des commentaires racistes des hôtes, Diouna doit entendre sa maîtresse lui expliquer que cela nʼest pas grave, et définir pour elle la nature de son expérience666. Pour raconter lʼhistoire de son personnage, Ousmane Sembène associe les scènes de la vie ordinaire et les pensées du personnage restituées en voix over, ce qui rend au personnage la capacité de parler (Spivak, 1988), et la subjectivité dont ses interactions avec les maîtres blanc·hes la privent. Cette scène du tablier et du dîner me semble être particulièrement significative du point de vue du design. Elle montre comment des objets ordinaires, mobilisés dans des gestes quotidiens, peuvent devenir le support de la domination -—Blanche dans le cas présent.
Il ne sʼagit pas de surinvestir la discipline du design, et dʼimaginer quʼune conception différente du tablier aurait permis à Diouna de se libérer. En revanche, tout·e designer qui sʼapproche de la cuisine pour en repenser la spatialité ou les accessoires doit prendre acte de ces «  scripts  » (Akrich 1994 ; Van Oost 2004) qui traversent les usages et constituent des instruments de marginalisation et dʼoppression. Par ailleurs, le design graphique, en particulier, possède la capacité de prolonger ou de déconstruire des représentations stéréotypées aux conséquences délétères. Si les femmes sont associées par un discours sexiste à lʼespace domestique, les femmes noires y sont peut-être encore davantage cantonnées en raison des représentations sexistes et racistes qui les affectent (Desquesnes 2016, 49). Les représentations culturelles participent à naturaliser lʼidée que la place des femmes noires est à la maison, mais pas leur maison, plutôt celle des employeuses blanches. Le stéréotype raciste de la «  mammy  » incarné en particulier par la servante noire jouée par Hattie McDaniel dans Autant en emporte le vent (1950) a été fixé par cette fiction et celles qui lʼont suivie, mais aussi par les productions du design graphique, notamment du packaging. Lʼidentité visuelle dʼune marque étasunienne comme Aunt Jemima (fig. 3.57) en est lʼexemple le plus connu : la marque de produits alimentaires est ainsi représentée par une femme noire, le front ceint dʼun fichu. Le perpétuel sourire qui habille le visage du personnage est un indice visuel fort des valeurs associées à la mammy : au service de ses maîtres, elle montre une sollicitude constante, une joie servile qui gomme le rapport de force à lʼœuvre.
En somme, les productions du design graphique participent ici dʼune forme de gaslighting qui crée de toutes pièces une expérience subjective positive de lʼasservissement. Par ailleurs, ces images qui habillent des produits alimentaires participent au paysage visuel de la cuisine, quand bien même celle-ci nʼaccueillerait pas de travailleuse noire. Des marques comme Aunt Jemima, Uncle Benʼs, Banania, Negrita (et bien dʼautres) prolongent des formes de domination coloniale, et produisent en miroir une blancheur éloignée de la production, du travail peu qualifié et de la souillure. Selon la curatrice Dianne Harris, ces servant·es noir·es de papier jouent même le rôle de «  doublures  » en lʼabsence de domestiques réel·les (2013, 93). Identifier les discriminations spécifiques dont sont lʼobjet les personnes racisées dans lʼespace domestique nʼest quʼune facette dʼun travail qui en possède en fait deux. La seconde, qui pourrait facilement être oubliée, consiste à nommer les positivités (au sens extra-moral) produites par la circulation de ces images. La production de blancheur, donc dʼun neutre qui ne se nomme jamais667, est en effet un enjeu central de la domesticité et donc de la cuisine.

Les femmes blanches bourgeoises peuvent se libérer de la charge domestique en lʼexternalisant : ce faisant, elles transfèrent le travail qui leur était assigné à dʼautres femmes. Le genre et la race sont produits simultanément dans ce processus, et ils se traduisent en signes visuels qui ont tout à voir avec les gestes concrets du ménage.
Cependant, ces processus peuvent être difficiles à saisir, en raison de lʼidentité Blanche elle-même, dont le contenu est contradictoire. Richard Dyer écrit à ce propos :
Lʼidentité blanche est fondée sur des paradoxes percutants : une cosmologie profondément corporelle qui valorise la transcendance du corps ; la notion dʼêtre à la fois une sorte de race et la race humaine, un sujet individuel et un sujet universel ; un engagement envers lʼhétérosexualité qui, pour que la blancheur soit affirmée, implique que les hommes luttent contre leurs désirs sexuels et que les femmes nʼen aient pas ; lʼaccent mis sur lʼaffichage de lʼesprit tout en maintenant une position dʼinvisibilité ; en somme, le besoin dʼêtre toujours tout et rien, littéralement très présent et pourtant apparemment absent, à la fois vivant et mort668 (1997, 39).
Le terme «  blancheur  » fig. 3.57.b : Quelques représentations du stéréotypes de la mammy : l’actrice Hattie McDaniel dans le rôle de Mammy, dans le film Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939).
désigne lʼidentité blanche, soit lʼensemble des valeurs auxquelles adhère, sans toujours le conscientiser, un ensemble de personnes qui produit activement sa différence dʼavec les non-blanc·hes. Cette blancheur se traduit aussi visuellement, comme le montre Richard Dyer dans son étude : lumière des peintures religieuses, éclairage hollywoodien ou éléments de langage sont autant de signes plus ou moins discrets qui codent la supériorité des individus concerné·es. À ce titre, le ménage nʼest pas seulement le travail dont les femmes blanches se déchargent : il est aussi, littéralement, impliqué dans la production de surfaces immaculées, dans le blanchissement du linge, et donc dans une production de blanc codée positivement avec un fort sous-texte colonial et racial. Nos expressions communes en sont le symptôme : montrer «  patte blanche  », «  blanc comme neige  », être «  blanchi  » quʼil sʼagisse dʼun processus juridique ou financier, sont toutes des formules qui connotent la probité, la vérité et la bonté. Elles ont pour effet corollaire de coder comme innocent·es et pures les personnes rattachées à cette blancheur symbolique : les Blanc·hes.
fig. 3.57.b : Quelques représentations du stéréotypes de la mammy : l’actrice Hattie McDaniel dans le rôle de Mammy, dans le film Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939).
désigne lʼidentité blanche, soit lʼensemble des valeurs auxquelles adhère, sans toujours le conscientiser, un ensemble de personnes qui produit activement sa différence dʼavec les non-blanc·hes. Cette blancheur se traduit aussi visuellement, comme le montre Richard Dyer dans son étude : lumière des peintures religieuses, éclairage hollywoodien ou éléments de langage sont autant de signes plus ou moins discrets qui codent la supériorité des individus concerné·es. À ce titre, le ménage nʼest pas seulement le travail dont les femmes blanches se déchargent : il est aussi, littéralement, impliqué dans la production de surfaces immaculées, dans le blanchissement du linge, et donc dans une production de blanc codée positivement avec un fort sous-texte colonial et racial. Nos expressions communes en sont le symptôme : montrer «  patte blanche  », «  blanc comme neige  », être «  blanchi  » quʼil sʼagisse dʼun processus juridique ou financier, sont toutes des formules qui connotent la probité, la vérité et la bonté. Elles ont pour effet corollaire de coder comme innocent·es et pures les personnes rattachées à cette blancheur symbolique : les Blanc·hes.
La propreté est aussi un marqueur de classe. Les discours médicaux (notamment hygiénistes) et publicitaires lui associent des valeurs positives, tandis que la saleté, par effet miroir, reste le domaine des servant·es racisé·es (Harris 2013, 96), en même temps quʼelle permet de «  [s]ouligner la fétidité des classes laborieuses  » (Denêfle 1995). Certaines images produites par la publicité française et étasunienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle sont éloquentes à cet égard. Ainsi, un visuel faisant la promotion de la Lessive de la Ménagère (1892, fig. 3.58) dit aux consommateurices que le produit «  blanchirait un n*gre  ».

Un visuel pour le savon Dirt Off (années 1930) montre un homme noir, caricaturé selon des codes racistes669, dont le bras apparaît blanc sous lʼeffet de son lavage de mains (fig. 3.59.a). Il fait écho à une représentation très similaire dans une campagne pour le savon La Perdrix ou pour la Javel SDC (fig. 3.60). Une même capacité transformatrice est attribuée à la lessiveuse Chappée, lorsquʼun personnage noir découvre avec étonnement une femme noire «  blanchie  » dans le ventre de la machine (fig. 3.59.a). fig. 3.60.a : Ensemble de publicités représentant des personnes noires « lavées  » de la couleur de la peau par des produits d’hygiène ou des produits d’entretien : la lessiveuse Chappée. Dans les années 1950, les publicités pour le savon prolongent ces tropes : Roland Barthes évoque ainsi dans ses Mythologies les réclames Omo, dans lesquelles «  la saleté est un petit ennemi malingre et noir qui sʼenfuit à toutes jambes du beau linge pur  » (Barthes 1970[1957], 37). Ces publicités condensent dans leurs visuels les valeurs respectivement associées à la blancheur et à son envers. La lessive, et, par extension, tout le travail ménager et les pratiques dʼhygiène, portent ainsi une double mission civilisatrice : elle évacue le sale, associé aux classes pauvres, en même temps quʼelle blanchit des «  populations auxquelles on souhaite le plus grand bien en les faisant ressembler à soi, cʼest-à -dire en les blanchissant  » (Delaunay 1994, §17). Le produit vanté, dans ces images, est également associé aux vertus symboliquement purificatrices de lʼeau (Fahmy 2023, 179–180).
fig. 3.60.a : Ensemble de publicités représentant des personnes noires « lavées  » de la couleur de la peau par des produits d’hygiène ou des produits d’entretien : la lessiveuse Chappée. Dans les années 1950, les publicités pour le savon prolongent ces tropes : Roland Barthes évoque ainsi dans ses Mythologies les réclames Omo, dans lesquelles «  la saleté est un petit ennemi malingre et noir qui sʼenfuit à toutes jambes du beau linge pur  » (Barthes 1970[1957], 37). Ces publicités condensent dans leurs visuels les valeurs respectivement associées à la blancheur et à son envers. La lessive, et, par extension, tout le travail ménager et les pratiques dʼhygiène, portent ainsi une double mission civilisatrice : elle évacue le sale, associé aux classes pauvres, en même temps quʼelle blanchit des «  populations auxquelles on souhaite le plus grand bien en les faisant ressembler à soi, cʼest-à -dire en les blanchissant  » (Delaunay 1994, §17). Le produit vanté, dans ces images, est également associé aux vertus symboliquement purificatrices de lʼeau (Fahmy 2023, 179–180).
Il serait aisé de balayer dʼun revers de main ces publicités, en les reliant à un passé colonial révolu. Mais si les publicités pour le linge deviennent moins ouvertement racistes tout au long du XXe siècle, elles conservent ce codage qui associe blancheur (du linge), blancheur (des individus) et pureté (morale et physique). Les publicités étasuniennes des années 1950 évacuent ce motif de lʼhomme ou de la femme noir·e blanchi·e, au profit dʼune focalisation sur la blancheur de leurs personnages féminins. Mais ces publicités célèbrent une blancheur qui nʼest jamais seulement celle du linge. Il ne sʼagit pas uniquement, dans leurs discours, de produire le propre : le blanc doit être plus blanc que blanc (fig. 3.61). fig. 3.60.a : Publicité pour la Javel S. D. C. Optiquement, le blanc est lʼabsence de couleur, le résultat de la synthèse lumineuse de tout le spectre coloré. La volonté de représenter ce blanc extrême résulte en des propositions graphiques étonnantes, comme dans cette publicité Oxydol où le drap devient un trou dans lʼimage (fig. 3.61), qui incarne de manière saisissante ce «  tout et rien  » de lʼidentité blanche évoquée par Richard Dyer (1997, 39). Le théoricien décrit la manière dont le blanc nʼest pas seulement relié aux autres couleurs (quʼil synthétise) mais aussi à la lumière brillante, à la translucidité (1997, 39 ; 115) et à un ensemble de valeurs centrales dans la culture occidentales : la divinité (108), la connaissance (109) et la pureté morale (36). Une publicité Omo effectue ce lien en toutes lettres dans son slogan «  Omo ajoute lʼéclat à la blancheur  »670 (fig. 3.61, page suivante). Ces discours publicitaires font écho aux idéaux modernistes dʼaprès-guerre en architecture, où domine le goà »t pour les grandes surfaces ripolinées (notamment chez Le Corbusier) et les baies vitrées transparentes. Lʼadoption de cette esthétique nʼest pas unilatérale : Dianne Harris montre justement comment les visuels de maisons destinées à la classe moyenne blanche créent plutôt des environnements colorés, pastel. Ceux-ci ne sont pas moins significatifs de la blancheur, mais lʼarticulent différemment, à travers la multiplication des possessions élégantes (2013, 96) : en étant «  tout et rien  », la blancheur peut se localiser où elle lʼentend, et parfois de manière contradictoire. Enfin, lʼapparition de visuels focalisés sur les femmes blanches, plutôt que sur des personnages noirs blanchis, ne doit pas nous faire imaginer que cette dernière représentation disparaît tout à fait. Une publicité française Total rejoue ce motif, même sʼil est voilé par lʼusage dʼun nounours (fig. 3.61). De nos jours, il nʼest pas rare que des marques soient épinglées pour avoir mobilisé cet imaginaire raciste de la peau lavée et blanchie, comme ce fut le cas pour Dove ou encore Nivea en 2017.
fig. 3.60.a : Publicité pour la Javel S. D. C. Optiquement, le blanc est lʼabsence de couleur, le résultat de la synthèse lumineuse de tout le spectre coloré. La volonté de représenter ce blanc extrême résulte en des propositions graphiques étonnantes, comme dans cette publicité Oxydol où le drap devient un trou dans lʼimage (fig. 3.61), qui incarne de manière saisissante ce «  tout et rien  » de lʼidentité blanche évoquée par Richard Dyer (1997, 39). Le théoricien décrit la manière dont le blanc nʼest pas seulement relié aux autres couleurs (quʼil synthétise) mais aussi à la lumière brillante, à la translucidité (1997, 39 ; 115) et à un ensemble de valeurs centrales dans la culture occidentales : la divinité (108), la connaissance (109) et la pureté morale (36). Une publicité Omo effectue ce lien en toutes lettres dans son slogan «  Omo ajoute lʼéclat à la blancheur  »670 (fig. 3.61, page suivante). Ces discours publicitaires font écho aux idéaux modernistes dʼaprès-guerre en architecture, où domine le goà »t pour les grandes surfaces ripolinées (notamment chez Le Corbusier) et les baies vitrées transparentes. Lʼadoption de cette esthétique nʼest pas unilatérale : Dianne Harris montre justement comment les visuels de maisons destinées à la classe moyenne blanche créent plutôt des environnements colorés, pastel. Ceux-ci ne sont pas moins significatifs de la blancheur, mais lʼarticulent différemment, à travers la multiplication des possessions élégantes (2013, 96) : en étant «  tout et rien  », la blancheur peut se localiser où elle lʼentend, et parfois de manière contradictoire. Enfin, lʼapparition de visuels focalisés sur les femmes blanches, plutôt que sur des personnages noirs blanchis, ne doit pas nous faire imaginer que cette dernière représentation disparaît tout à fait. Une publicité française Total rejoue ce motif, même sʼil est voilé par lʼusage dʼun nounours (fig. 3.61). De nos jours, il nʼest pas rare que des marques soient épinglées pour avoir mobilisé cet imaginaire raciste de la peau lavée et blanchie, comme ce fut le cas pour Dove ou encore Nivea en 2017.

Ces représentations sont importantes fig. 3.5 : Quelques publicités racistes par omission : Total. au-delà de la pratique publicitaire. Elles révèlent et prolongent des imaginaires racistes et coloniaux qui sont tout à fait liés à la question de la «  boniche  » et informent la construction de genre de cette figure. Les femmes peuvent vivre collectivement le sexisme, mais les femmes blanches possèdent un rôle particulier dans le patriarcat occidental. Elles sont représentées à la fois comme inférieures aux hommes blancs, et supérieures aux personnes racisées. Dès lors, leur rôle est essentiel dans la construction de la masculinité, qui repose sur la possession de son envers, mais en tant que celui-ci est une féminité blanche, à la fois civilisée et civilisatrice.
fig. 3.5 : Quelques publicités racistes par omission : Total. au-delà de la pratique publicitaire. Elles révèlent et prolongent des imaginaires racistes et coloniaux qui sont tout à fait liés à la question de la «  boniche  » et informent la construction de genre de cette figure. Les femmes peuvent vivre collectivement le sexisme, mais les femmes blanches possèdent un rôle particulier dans le patriarcat occidental. Elles sont représentées à la fois comme inférieures aux hommes blancs, et supérieures aux personnes racisées. Dès lors, leur rôle est essentiel dans la construction de la masculinité, qui repose sur la possession de son envers, mais en tant que celui-ci est une féminité blanche, à la fois civilisée et civilisatrice.

Pour Richard Dyer, la femme blanche (en tant que figure) est «  le site de la blancheur véritable  »671. Les conséquences pour les femmes blanches sont complexes. Elles peuvent se traduire par une domination des femmes racisées sur lequel leur travail domestique est reversé. Mais les études montrent aussi que cette libération est partielle -—ce qui nʼenlève rien au préjudice raciste constaté. Recourir à une «  femme de ménage  » ne libère pas complètement les femmes blanches en couple hétérosexuel de leur charge de travail, car ce sont souvent encore elles qui doivent gérer la relation avec lʼemployée ou ranger le domicile en prévision de son passage (Devetter & Rousseau 2013). Les femmes ont en quelque sorte la «  responsabilité sociale du propre  » (Denèfle 1995, 117). Cette injonction à produire le blanc, dans toutes ses dimensions, appartient à un vaste ensemble de tâches dont le dénominateur commun est tout autant le logis que le corps des femmes et leur place symbolique dans la société. Sylvette Denèfle parle ainsi «  [d]es images des femmes nettes, lisses dont le corps nʼa pas le droit à lʼobésité, à la déformation, aux odeurs animales  » (63). Autrement dit, il ne saurait exister un programme féministe en cuisine qui ne prenne acte de la co-dépendance entre construction du genre de la boniche et construction de sa race et de sa classe, tant la production du corps féminin et de ses espaces a toujours une relation avec une saleté qui ne renvoie jamais seulement à lʼaccumulation matérielle de la poussière, mais bien à un régime symbolique sous-jacent.
Les tâches ménagères sont multiples, hybrides et sont en contact les unes avec les autres par le jeu des usages. Dans une même minute, on peut sʼoccuper dʼun enfant qui mange, passer un coup dʼéponge sur la table, et se préoccuper des factures à payer. En Occident, cet ensemble dʼactions est réuni sous le nom vague de «  travail domestique  », opposé au travail salarié au bureau et à lʼusine. Pour comprendre si la cuisine, en particulier, est une usine, jʼai abordé la nature de ces tâches. Le tableau que jʼai proposé plus haut met en évidence des «  zones  » thématiques, plutôt que des catégories nettement séparables de gestes : en premier lieu, le foodwork théorisé par Michelle Szabo (2013) permet de ne pas oublier les courses et le travail du potager lorsquʼil est question de pratiques culinaires. Dans lʼesprit de cette catégorie, il conviendrait de parler dʼun babywork ou kidwork, qui recouvrerait tous les soins apportés aux enfants. Dans un contexte de vieillissement de la population en Occident, cette catégorie mériterait même dʼêtre étendue à toutes les personnes dépendantes, âgées ou malades notamment. Troisièmement, le ménage constitue une des catégories majeures du travail domestique, et peut-être la plus emblématique, notamment à travers ses objets (seau, balai, plumeau, serpillière).
Ces trois grandes catégories sʼinterpénètrent, et sont elles-mêmes réunies par un même enjeu symbolique global. Le foodwork produit les repas, le babywork re-produit les individus, et le ménage produit la propreté et donc la blancheur. Tous ces gains de la domesticité peuvent être vus comme secondaires, par rapport à ce qui est devenu le produit du foyer après la Seconde Guerre mondiale, la «  satisfaction émotionnelle et le bonheur  »672, compris comme bourgeois, blanc, hétérosexuel (DʼEmilio 1983, 469). Ainsi décrit, le travail domestique possède une forte valeur, à la fois matérielle et symbolique. Toutefois, les externalités positives concrètes de ce travail sont souvent éclipsées dans les représentations communes, qui en font un travail «  naturel  », facile et donc gratuit -—cʼest-à -dire un travail de femme. Rémunérer ce travail constitue une solution mais prend le risque de reproduire dans le foyer les oppressions de classe déjà à lʼœuvre au bureau et à lʼusine. Le déléguer en le rémunérant implique également des rapports de pouvoir au niveau de la race et de la classe. Mais ces conséquences du travail domestique que sont la production raciste de blancheur ou encore la reconduction de lʼexploitation des travailleur·ses pauvres ne sont pas des à -côtés : elles font partie des produits de la domus ou encore de la cuisine. Ainsi, si la cuisine est une usine, elle ne lʼest pas seulement en tant quʼhéritière des méthodes tayloristes, mais aussi en tant que fabrique concrète des inégalités.
En quoi la cuisine est-elle une usine ? Tout lʼobjectif de ce chapitre a consisté à en découdre avec le motif des «  deux sphères  » qui, après avoir constitué un idéal, constitue un motif descriptif sans doute incomplet et anachronique. Par sa binarité, il fait imaginer deux espaces sociaux distincts, peut-être interdépendants, et ne rend pas justice à toutes les zones dʼinterpénétration et dʼimpureté qui caractérisent deux lieux hautement utiles sur les plans matériel et symbolique au capitalisme : le foyer (et, par extension, la cuisine), et les lieux de la production industrielle. Mais le verbe «  être  » est comme souvent un piège : la cuisine nʼest pas une usine, malgré la rime. Je me suis donc attaché à observer de plus près ce qui apparaît lorsquʼon considère la cuisine comme usine : ses productions invisibilisées, sa valeur marchande (ou en soutien de lʼéconomie marchande) oubliée, le rôle de travailleuse des «  boniches  » quʼon estime naturellement liées à cet espace ou encore la production de blancheur qui soutient lʼhégémonie blanche. Faire ce lien permet de compenser un biais possible dʼune analyse de design qui verrait la cuisine comme objet du projet : la cuisine nʼest pas seulement un espace que les architectes peuvent penser et dessiner, mais aussi le lieu potentiel où peuvent se déployer des projets divers. Autrement dit, elle peut autant être un moyen quʼune fin.
Avant dʼêtre équipée et fabriquée en série dans des usines, la cuisine a donc été pensée comme lieu dʼexportation de pratiques industrielles alors naissantes. Le transfert de la pensée tayloriste des chaînes de fabrication vers le logis est au cÅ“ur dʼun changement de paradigme : lʼéconomie domestique fait place à «  lʼingénierie domestique  »673 (Giedion 1948, 522). Mais cette technicisation de lʼespace domestique est hétérogène et ambivalente. Il nʼest pas certain que les femmes qui pensent alors la cuisine dans leurs écrits (de Beecher à Frederick, en passant par Gilbreth et Bernège) puissent être considérées comme des designers ; en même temps, ne pas les intégrer à lʼhistoire du design constituerait un oubli majeur. Elles se tiennent sur une ligne de crête en termes de statut (designer, ou non ?) comme de discours : à la fois progressistes (des femmes autonomes, autrices, qui revendiquent les compétences féminines) et prises au piège des associations genrées entre femme et cuisine (idée dʼun destin domestique, injonctions sur lʼapparence physique, sacralisation du mariage, etc). Selon les sources, des statuts différents leur sont accordés, tel ce rôle de «  conseillère domestique  »674 que Penny Sparke concède à Christine Frederick (2013, 78). Si elles sont des designers de manière asymétrique, cʼest peut-être aussi que cette figure du designer ou de lʼarchitecte a directement influencé ce qui était visible comme design et comme architecture. De la même manière, parler de la cuisine qui sʼindustrialise avec lʼimportation de méthodes tayloristes ne doit pas faire oublier que les productions industrielles étaient souvent, en premier lieu, des productions de lʼespace domestique (Perkins Gillman 2013[1903], chap. V ; Davis 2019[1981], 207), avant que la révolution industrielle ne déplace ces savoir-faire vers dʼautres lieux.
Si autant dʼénergie a été dépensée à penser la moindre tâche, cʼest que le travail domestique nʼa rien dʼévident, que ce soit au niveau du contenu, des méthodes ou de la valeur dʼestime. Pour de nombreuxes penseureuses, son statut même de travail pose question et invite à distinguer travail domestique et travail ménager (Delphy 2009a[1998], 71) ou travail et service domestique (Moujoud & Falquet 2010, 171). Cette dernière distinction vise à différencier le travail réalisé par lʼhabitante du travail délégué à une personne externe à la cellule familiale. Il est juste dʼobserver que le travail nʼest pas de même nature, selon quʼon le fait pour soi ou pour les autres. Mais dans les deux cas, il est intégré au circuit économique, soit parce quʼil permet au mari du couple hétérosexuel de proposer sa force de travail sur le marché, soit parce quʼil permet aux deux membres du couple dʼêtre ainsi «  libérés  », et dʼaccéder à un double salaire. Les contours flous du travail domestique, parfois requalifié en service domestique par le jeu de lʼexternalisation, rendent parfois difficile sa reconnaissance comme une charge. Au fond, ce travail, plutôt que dʼêtre regardé de près, est dʼabord lʼobjet dʼun système de transferts multiples, des hommes vers les femmes (parfois vers les enfants), des femmes blanches vers les travailleureuses racisé·es. Il est systématiquement lʼobjet dʼune négociation, dʼun «  arbitrage entre ‹ faire › et ‹ faire faire ›  » (Devetter & Rousseau 2011, 79). Lʼidéal consistant pour les femmes à se libérer de la cuisine apparaît donc comme une chimère : se débarrasser de cette charge, cʼest inévitablement la confier à dʼautres, sans doute plus minorisé·es que soi, à qui on donne le rôle de doublure (Davis 2019[1981], 214).
Repenser le travail domestique implique donc, peut-être, de sortir de la fausse solution du «  faire faire  ». Vu comme peu qualifié, sous-rémunéré, dénué de reconnaissance sociale, le travail ménager recouvre pourtant une multiplicité de savoir-faire. Cʼest dʼailleurs un des apports majeurs des théoriciennes de lʼéconomie domestique : lʼobjectif dʼéconomie de moyens, de pas et dʼénergie va de pair avec une attention rigoureuse aux tâches performées et à leur impact sur le corps de la femme au foyer. À ces savoir-faire concrets, associant force physique et précision du geste, il faut associer les productions immatérielles du travail en cuisine et au foyer : produire la famille, produire la nation, produire la blancheur, produire la féminité et donc en miroir, la masculinité du conjoint. En effet, la théorisation du capitalisme tardif met en évidence le fait que ce dernier ne produit plus seulement «  des biens mais la vie sociale elle-même  »675 (Hardt & Negri 2000, xiii ; Corsani 2007, 107). Le capitalisme cognitif apparaît en effet comme un contexte où «  [l]e savoir, les savoir-faire, le langage et lʼaffect sont les enjeux fondamentaux de la production aujourdʼhui  »676 (Corsani 2007, 107). Opposer strictement cuisine et usine présente donc un risque : figer une figure finalement ancienne de la révolution industrielle, et en faire lʼincarnation unique du capitalisme. Je me garderai dʼévacuer tout à fait lʼusine : si elle est de moins en moins présente en Occident, à la suite des délocalisations vers les pays du Sud et de la désindustrialisation qui en résulte, elle reste essentielle à lʼéconomie comme aux vies humaines. Lʼinvisibilisation du travail ouvrier délocalisé peut dʼailleurs être mis en parallèle avec lʼinvisibilisation du travail de lʼouvrière domestique677. Cette fois, ce nʼest donc plus lʼusine qui inspire la cuisine, mais lʼinverse. Regarder lʼusine depuis la cuisine semble même plus pertinent. En effet, il est possible que le travail domestique soit un mode de travail678 plus quʼun travail à part entière dont le paradigme informe, par effet rétroactif, de nouvelles formes de travail précaires contemporaines. Marina Vishmidt le souligne :
on peut considérer le fait de sortir les sphères de travail du calcul du salaire comme un prototype des conditions dʼembauche dans un capitalisme placé sous le signe de la ‹ dévalorisation ›一 un capitalisme où un engagement sans bornes, un investissement personnel et une absence de limites temporelles et spatiales des travaux ménagers, comme ceux de la production artistique, deviennent le modèle et qui, de plus en plus, ne cherche pas à se valoriser par le biais dʼun travail salarié régulier et dʼinstitutions de reproduction élargie telles que lʼÉtat-providence (qui a permis dʼemployer la main-dʼœuvre à moindre coà »t), mais par le biais dʼun dépouillement direct des actifs grâce au travail à temps partiel, précaire et réglementé, et à la privatisation des institutions collectives679 (2010, 57).
Autrement dit, la cuisine sʼest taylorisée au vingtième siècle, mais, en régime post-moderne, cʼest le modèle de la travailleuse pauvre et invisible (souvent racisé·e) qui est devenu la forme dominante de lʼemploi dans le modèle économique néo-libéral (Hayden 2002[1984], 155). Ainsi, la comparaison boniche/ouvrière est peut-être plus urgente que le rapprochement cuisine/usine. Reconnaître la boniche comme ouvrière permettrait de valoriser son travail. Cette proposition peut tenir à condition de ne pas oublier que les femmes étaient présentes dans les usines aux XIXe et XXe siècles, notamment pendant les Trente Glorieuses. Si Moulinex voulait «  libérer  » les femmes au foyer, ce sont bien des ouvrières littéralement attachées à ses chaînes de production (Gallot 2015, 74–75) qui fabriquaient les robots ménagers censés assister les bourgeoises les plus fortunées -—faire, ou faire faire (Devetter & Rousseau 2011, 79), encore et toujours.
Considérer usine et cuisine comme deux faces de la pièce que serait le capitalisme produit une image mentale inadéquate pour penser les transferts de savoir-faire, de culture et de luttes qui se produisent entre ces deux espaces de référence. Lʼillustration du See Red Womenʼs Workshop peut ici être convoquée à nouveau, dans la mesure où elle propose plus quʼune mise en évidence dʼinterdépendances entre travail salarié et travail domestique. Cuisine et usine (et plus largement, nouveaux espaces de travail) sont reliées par une forme de chaîne continue. Les savoir-faire basiques (faire le pain, les bougies, etc.) quittent la cuisine pour être pris en charge par lʼusine ; le taylorisme fait retour dans la cuisine ; la travailleuse domestique invisibilisée lègue le paradigme de la microtâche sans valeur aux travailleureuses «  zéro heure  » du capitalisme de plateformes… et ainsi de suite. Mais ces transferts sont-ils uniquement voués à reproduire des formes dʼoppression ? Nʼexiste-t-il pas, au cÅ“ur de ces enchevêtrements, des espaces pour la réappropriation, lʼempouvoirement, voire la lutte ? On a beaucoup parlé pendant et après le confinement lié au COVID des porosités qui ont fait entrer le bureau (plutôt que lʼusine, cette fois) dans lʼespace domestique. Visioconférence par Teams ou Zoom, travail accessible sur un cloud, voire stratégies de délocalisation immobilière dans des zones moins chères du globe (Jones 2023) : lʼespace domestique a été recomposé par cette expérience et les nouveaux habitus quʼelle a contribué à banaliser. Mais ces possibilités de transferts existaient de manière antérieure, comme notre étude lʼa montré. Aussi, toute porte ouverte doit être considérée comme possédant un double sens de circulation ; le bureau a bien contaminé la cuisine (le foyer), mais la cuisine et la domesticité quʼelle sous-tend peuvent aussi déborder sur lʼespace du travail salarié.
Je voudrais offrir pour finir ce chapitre deux exemples très différents de ces transferts. Lʼétude de cas permet normalement de solidifier un argumentaire, et non de conclure. Pour autant, ces deux projets me semblent ici tout indiqués pour amorcer la suite de ma réflexion. Le premier consiste en une suite dʼateliers filmés par Zhou Xiaohui (周晓慧), une femme chinoise qui poste ses contenus sur Youtube sous le nom de Ms. Yeah (fig. 3.62 ; Cho 2017). Lorsque jʼai commencé mes recherches sur la cuisine vers 2016–17, les contenus filmés de cette jeune chef mʼont fait une forte impression. On voit dans ces différentes vidéos lʼemployée sur son lieu de travail et déployant des ressources dʼingéniosité pour cuisiner des plats de la gastronomie chinoise comme des pains à la vapeur bao ou des nouilles de riz (mais aussi des recettes plus «  internationales  » comme la pizza).

Ces plats ne sont pas préparés dans une cuisine commune comme on en trouve parfois dans les lieux de travail, mais dans lʼopen space où lʼemployée est assise à son poste, devant un bureau équipé dʼun ordinateur. Lʼobjectif consiste donc à cuisiner des plats ambitieux en détournant des objets de la vie en entreprise ou du quotidien : Ms Yeah propose ainsi de préparer un barbecue avec des pièces récupérées sur un climatiseur (épisode 43), de fabriquer de la barbe à papa avec une perceuse (épisode 12) ou encore de détourner une unité centrale dʼordinateur pour rôtir un canard (épisode 113). La pratique culinaire comme lʼinvention dʼoutils à partir dʼéléments récupérés ou hackés sont au cÅ“ur de son travail. Dʼailleurs, Ms Yeah reconnaît que les recettes nʼont peut-être pas de qualités gustatives particulières680 et que le sens de sa pratique se situe dans la réception des vidéos, pensées comme humoristiques. Pour ma part, je lis dans cette proposition une forme de double hacking : à lʼheure où les cuisines se professionnalisent grâce aux chaînes YouTube de multiples influenceuses, Ms Yeah réalise de manière astucieuse le mouvement inverse, et produit de la valeur au sein dʼune pratique déjà rémunérée. fig. 3.61 : Extrait d’une vidéo de Ms Yeah. En outre, cette manière dʼinvestir à lʼexcès le repas dʼentreprise produit un décalage intéressant, en exagérant la productivité et lʼesprit dʼinitiative habituellement valorisés par les grands groupes, en poussant ceux-ci dans dʼabsurdes extrêmes.
fig. 3.61 : Extrait d’une vidéo de Ms Yeah. En outre, cette manière dʼinvestir à lʼexcès le repas dʼentreprise produit un décalage intéressant, en exagérant la productivité et lʼesprit dʼinitiative habituellement valorisés par les grands groupes, en poussant ceux-ci dans dʼabsurdes extrêmes.

Un second exemple illustre cette porosité entre bureau et espaces domestiques. Dans un article publié avant la crise du COVID (en 2018), le collectif feminist architecture (feminist architecture collaborative) critique la manière dont les grandes entreprises étasuniennes se sont adaptées à lʼintégration dʼemployées femmes, en construisant des toilettes spécifiques et, plus récemment, en proposant des pièces de lactation (lactation rooms). Dans un pays où le congé maternité est quasiment inexistant, lʼentreprise garantit ainsi le retour de ses employées et leur productivité, tout en revendiquant une approche «  inclusive  ».
Les autrices de lʼarticle présentent ainsi lʼimage dʼun tel dispositif, une capsule Mamava (fig. 3.63) , en préfabriqué, dans laquelle lʼemployée peut sʼisoler pour tirer son lait :
dans des centres économiques comme New York, les personnes éduquées de la ‹ classe créative › se voient proposer des produits sur le lieu de travail dans de nouvelles nuances dʼhospitalité -—y compris des espaces pour le lait maternel. Parmi la série de produits qui permettent de prendre soin de soi en prévention du surmenage, il semble plus raisonnable de consommer le soin qui soit le plus adapté à nos besoins. Mais si ce soin nʼest accessible quʼen étant membre dʼun club, que sous la forme de biens de consommation, il ne fait quʼaggraver lʼexploitation de ceux qui ne peuvent pas avoir accès à une meilleure situation, qui ne peut être quʼélective et jamais méritée681.
En dʼautres termes, le problème du «  faire ou faire faire  » qui touche les femmes salariées dans leur vie au foyer, quʼelles délèguent en partie à des femmes pauvres, trouve dʼautres formulations sur le lieu de travail. Hybridité et impureté peuvent être des moyens créatifs de lutter contre lʼaliénation au travail ou au foyer ; elles sont aussi les qualités anciennes des vies minorisées, notamment celle des femmes. Quand le travail ne peut être délégué, parce quʼil implique le corps de la mère, lʼentreprise accepte de se laisser déborder par la domesticité ; ou plutôt, elle contient celle-ci dans une capsule, voire subsume son corps auparavant confiné entre les murs de la domus. Selon le collectif feminist architecture, nous devons «  repositionner la culture du travail qui élude, efface et réduit le corps  ». Elles demandent : «  Où pouvons-nous incuber un avenir politique dont on nous dit quʼil est féminin ?  »682 (2018).

Les entreprises capitalistes, particulièrement celles qui sont issues de la Silicon Valley ou souscrivent à sa culture, sont tout à fait prêtes à garantir ce type de porosités dans la mesure où elles y trouvent un intérêt pour leur croissance : espaces de relaxation, de sieste ou piscine à balles ont rejoint depuis plusieurs années déjà le vocabulaire architectural de lʼespace de travail inventé par les start-ups. Tandis que la maison se vide de sa production, que la cuisine devient surfaces lisses, voire lieu dʼexposition digne dʼun white cube, le bureau se remplit dʼespaces cosy imitant le confort de la domesticité -—quand le bureau ne sʼinvite pas au milieu du salon dans le cadre du télétravail. Les théoriciennes de lʼéconomie domestique voulaient réduire le nombre de pas ; les travailleuses de la double journée maximisent les leurs et comptent sur leur montre connectée Fitbit (Dreilinger 2021, XX).
Dans les deux cas, le corps féminin est mis au travail, selon des modalités quʼil convient encore de préciser. Nous avons vu que lʼexternalisation sur dʼautres personnes était une impasse : quʼen est-il de lʼexternalisation sur des machines ? Faut-il se débarrasser de cet «  être-boniche  »â€¯? Lʼouvrière domestique doit-elle rendre son tablier, et doit-elle accepter le gadget électronique ou numérique quʼelle reçoit en échange ?
Chris Bergeron, Valide, 2022[2021], p. 192.
Camille Azaïs, Homemakers, 2022, p. 8.
Le travail domestique semble impossible à éviter : et si on y parvient, cʼest en général quʼil est assuré par dʼautres que nous, que ces personnes soient rémunérées ou non. Ce labeur, qui peut ainsi sembler particulièrement fixe du fait des logiques dʼassignation (genrées, raciales, de classe) qui lui sont associées, est traversé par un mouvement perpétuel de délégation dans lequel le travail culinaire nʼest pas en reste. Cette «  patate chaude  », selon lʼexpression familière, se déplace constamment de la boniche vers les autres membres du logis, vers du personnel employé à domicile ou encore vers du personnel externe au foyer -— à lʼinverse, elle lui revient, aussi, quand les personnes à qui le travail a été délégué ne lʼexécutent pas. Lʼespace architectural de la cuisine fait plus quʼaccueillir ce mouvement. Lui-même est traversé au fil de lʼHistoire par dʼincessants remous et déplacements, notamment celui de ses placards, qui migrent des meubles pour intégrer les murs, avant de quitter les murs pour redevenir mobilier, notamment dans lʼemblématique îlot central qui devient prépondérant à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. En 1998, La cuisine désintégrée des frères et designers Erwan et Ronan Bouroullec semble annonciatrice de cette mutation (fig. 4.1.a). Si, au début du XXe siècle, la cuisine est dʼabord conçue comme une boîte que viennent tapisser placards et étagères, elle semble, avec les deux designers, retourner au statut dʼobjet. Leur cuisine est indépendante des murs, voire même de toute forme de cloison. Elle ne désigne plus le vide qui sʼanime entre les placards et les casseroles accrochées de toutes parts, mais se compose dʼun bloc autonome qui pourra faire jaillir un «  faire-cuisine  » de nʼimporte quel espace où il sera raccordé à lʼeau et à lʼélectricité. fig. 4.1.a : La cuisine désintégrée des frères Bouroullec, 1998, Cappellini, Italie. Prototype développé avec l’aide d’une subvention du VIA.
fig. 4.1.a : La cuisine désintégrée des frères Bouroullec, 1998, Cappellini, Italie. Prototype développé avec l’aide d’une subvention du VIA.
Cette cuisine des Bouroullec a été partiellement pérenne. On retrouve dans lʼîlot central aujourdʼhui démocratisé une concentration des fonctions et une volonté de penser un bloc (le meuble) plutôt quʼune surface (le mur). Cependant, comme les cuisines désertées précédemment étudiées, la séduction visuelle de ce bloc repose en partie sur une forme dʼabstraction. Dans les photos qui communiquent autour du projet, comme dans les esquisses préparatoires (conservées au Centre Pompidou, fig. 4.1.b), cette cuisine-bloc existe sans nourriture, sans paquets de céréales ou de farine, sans boîte de Doliprane ou vide-poches, et, presque inévitablement, sans humains. Il lui manque, au fond, ce «  bric-à -brac de toute cuisine  »683 que les chercheureuses (notamment en études alimentaires ou food studies) nomment comme inévitable, au motif quʼelle serait lʼaspect le plus vivant de lʼespace-cuisine (Kaye & Bell 2002, 48). Le projet de début de carrière des frères Bouroullec semble à lʼopposé incarner un objectif de flexibilité. Plutôt que de penser un espace sur mesure, comme on pourrait imaginer un manteau sur mesure, la cuisine désintégrée constitue une forme de prêt-à -porter architectural, qui peut en théorie sʼinsérer dans nʼimporte quel espace préexistant. Et si rien nʼinterdit dʼimaginer des robots ou un four prendre place dans cette «  cage  » somme toute assez vide, ce nʼest pas ce qui est donné à voir et à fantasmer.
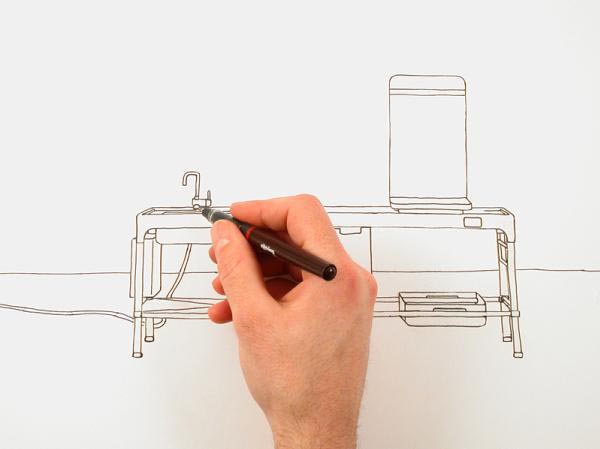
En effet, ce nʼest pas seulement le registre de formes qui peut sembler «  minimal  » ou dépouillé. Les fonctions elles-mêmes semblent avoir subi une forme de rétrécissement, au cÅ“ur duquel ne subsistent que les essentielles arrivées dʼeau et autres feux électriques.
Ce modèle de lʼîlot des Bouroullec (ou encore du module ou du chariot) nʼa été pérenne quʼà demi. Du côté du design visible en expositions ou en écoles, les mobiles et autres chariots constituent une typologie bien identifiable de la cuisine. En 2021, les designers Audrey Bigot, Antoine Pateau et Valentin Martineau proposent Biceps Cultivatus, une «  cuisine low tech  » (fig. 4.2). On retrouve les principes de la cuisine désintégrée, associés à des fonctions supplémentaires de conservation, de gestion de déchets (grâce à un lombricompost) et de production (dans le «  module de production hors-sol  »).

Ce type de projet est passionnant, mais ses principes comme son esthétique restent souvent cantonnés à des propositions qui ne trouvent pas le chemin de la grande distribution. Le principe du mobilier central prend donc plutôt forme dans lʼîlot contemporain, tandis que cet idéal dʼune cuisine dépouillée contraste avec la multiplication des équipements de cuisine qui sont aujourdʼhui proposés, notamment des objets électroménagers plus ou moins innovants.
Le succès récent et toujours actuel dʼémissions culinaires telles que Top Chef est associé au soutien de sponsors comme Beko ou Neff, qui proposent des équipements électroménagers au grand public. Si la cuisine est très évidemment affaire dʼarchitecture, il est impensable dʼévoquer la pensée de son espace sans parler des objets qui en composent le paysage. Dans la proposition des Bouroullec, ces objets sont absents, tout comme dans la cuisine Lepic de Jasper Morrison (cf. infra, fig. 2.6) que jʼai commentée dans le deuxième chapitre. Avant les Bouroullec, le designer Joe Colombo propose déjà pour Boffi un module à lʼapparence dépouillée (fig. 4.3 ; 1964) fig. 4.5 : Le module mini-kitchen de Joe Colombo pour Boffi, 1964. Source : Klat Magazine. mais qui intègre pourtant de multiples rangements permettant de dissimuler quelques génies de la vie domestique. Ces exemples mʼincitent à relever un fait qui paraîtra peut-être évident : entre les murs et lʼobjet existe une rupture dʼéchelle que reflète la frontière entre deux sous-disciplines du design que sont le design dʼespace et le design dʼobjet. De plus, il semble exister une tension pratique entre deux compréhensions déjà évoquées du terme «  cuisine  ». Quand il sʼagit de lʼespace domestique, il faut penser les murs, les corps qui les habitent, et, en particulier, celui de la ménagère. Quand il sʼagit de la pratique, lʼéchelle devient celle de la main, de ses gestes, et la boîte-cuisine se fait plutôt le réceptacle des «  bons génies de la vie domestique  » que sont les objets électroménagers : les différentes définitions de «  cuisine  » ont ainsi trait à lʼéchelle du regard porté sur elle. La distinction comporte aussi des soubassements économiques. Il sera en effet plus simple pour le grand public dʼacheter un équipement ménager dans une grande enseigne comme Darty ou Boulanger que dʼinvestir dans la réfection complète dʼun espace de vie, et la «  cuisine  » comme pratique est peut-être plus facile à considérer dès lors, que la «  cuisine  » comme lieu.
fig. 4.5 : Le module mini-kitchen de Joe Colombo pour Boffi, 1964. Source : Klat Magazine. mais qui intègre pourtant de multiples rangements permettant de dissimuler quelques génies de la vie domestique. Ces exemples mʼincitent à relever un fait qui paraîtra peut-être évident : entre les murs et lʼobjet existe une rupture dʼéchelle que reflète la frontière entre deux sous-disciplines du design que sont le design dʼespace et le design dʼobjet. De plus, il semble exister une tension pratique entre deux compréhensions déjà évoquées du terme «  cuisine  ». Quand il sʼagit de lʼespace domestique, il faut penser les murs, les corps qui les habitent, et, en particulier, celui de la ménagère. Quand il sʼagit de la pratique, lʼéchelle devient celle de la main, de ses gestes, et la boîte-cuisine se fait plutôt le réceptacle des «  bons génies de la vie domestique  » que sont les objets électroménagers : les différentes définitions de «  cuisine  » ont ainsi trait à lʼéchelle du regard porté sur elle. La distinction comporte aussi des soubassements économiques. Il sera en effet plus simple pour le grand public dʼacheter un équipement ménager dans une grande enseigne comme Darty ou Boulanger que dʼinvestir dans la réfection complète dʼun espace de vie, et la «  cuisine  » comme pratique est peut-être plus facile à considérer dès lors, que la «  cuisine  » comme lieu.
Dans son étude de lʼhistoire de la mécanisation, Siegfried Giedion a montré la complexité de cette catégorie des objets électroménagers, et les poussées techniques très diverses qui ont permis le développement de dispositifs tels que le four, lʼaspirateur ou la machine à laver. Très souvent, ces innovations se sont produites dans des contextes industriels ou du moins collectifs, avant de migrer vers les foyers individuels : cʼest le cas des machines à pétrir, ancêtres de nos robots ménagers, dʼabord utilisées pour les boulangeries municipales (Giedion 1948, 171–72 ; 581) ou de lʼaspirateur, qui a soufflé de lʼair avant de lʼaspirer, dans le but de retirer la poussière des moules dans lʼindustrie (Giedion 1948, 587). Par ailleurs, lʼétude de Giedion est plutôt concentrée sur ce que lʼon appelle aujourdʼhui le «  gros électroménager  » qui inclut les fours, les machines à laver, les aspirateurs, les sèche-linge ou encore les plaques de cuisson. Sʼintéresser à la diversité des échelles en cuisine implique non seulement de regarder le niveau de la pièce, puis le niveau des objets, mais aussi de distinguer, au sein de cette dernière catégorie, différents sous-niveaux. Le «  petit électroménager  » de la cuisine, dans lequel on trouvera, entre autres, les batteurs à œufs, les grille-pain, les yaourtières ou encore les mixeurs sont tout aussi importants. Ces petits appareils passent quelque peu au second plan chez Giedion, peut-être parce que son étude est déjà extraordinairement exhaustive. Il est vrai que lʼauteur sʼintéresse à des principes dʼinnovation technique, et la résistance électrique utilisée dans le four nʼest pas fondamentalement différente de celle du grill-pain, pas plus que la rotation motorisée dʼun mixeur ne diffère radicalement de celle du tambour dʼune machine à laver.
Cependant, il importe dans cette étude dʼinvestir le paysage complet des objets électrifiés en cuisine, car tous portent en eux une solution concrète dʼexternalisation du travail, et un imaginaire de lʼallègement de la charge du travail domestique. Aussi ces objets plus ou moins gros possèdent-ils une importance capitale dans lʼhistoire du design, quand bien même ils ne sont pas toujours nommés comme des productions de design. Lʼélectroménager reçoit en effet une attention assez limitée de la part des publications consacrées à la discipline. La revue française Intramuros consacre bien plus volontiers ses pages au mobilier et à lʼaménagement intérieur quʼà la dernière bouilloire ou autre robot multifonctions. En 2022, la revue propose tout de même un article consacré à lʼélectroménager, «  Couleurs en cuisine  ». Là , deux types dʼobjets reçoivent principalement son attention : les productions «  historiques  » des sociétés SEB et Moulinex, qui sont aujourdʼhui entrées dans les livres dʼhistoire du design, et les objets haut-de-gamme des marques Alessi ou SMEG, cette dernière proposant des habillages de série limitée en partenariat avec la marque de mode Dolce & Gabbana (fig. 4.4). fig. 4.4 : Bouilloire modèle « Dolce & Gabana », édition limitée, par SMEG. Illustration proposée dans « Colorama en cuisine  », article publié sur le Web en compléments de l’article « Couleurs en cuisine  » publié dans le numéro 211 de la revue, Intramuros, [en ligne], https:
fig. 4.4 : Bouilloire modèle « Dolce & Gabana », édition limitée, par SMEG. Illustration proposée dans « Colorama en cuisine  », article publié sur le Web en compléments de l’article « Couleurs en cuisine  » publié dans le numéro 211 de la revue, Intramuros, [en ligne], https:
Le fait de la complexité des objets techniques à lʼère du capitalisme industriel a été mis en textes et en images de manière emblématique par le designer Douglas Thwaites dans son projet expérimental The Toaster Project (2010, fig. 4.5). Un grille-pain peut en effet apparaître comme un dispositif très sommaire composé dʼun compartiment pour le pain, dʼune résistance, dʼun système de glissière reliant ces deux composants et dʼun minuteur. Toutefois, il nʼest pas certain que nous, usager·es, comprenions bien le fonctionnement de cet objet : à cet égard, il est, comme la «  Box  » Internet ou lʼassistant vocal une «  boîte noire  » (Bartholeyns & Charpy 2021, 10). Par ailleurs, sa durée de vie moyenne est de trois à cinq ans et en cas de panne, il est jeté (Supersolide 2020). Thwaites choisit cet objet de consommation courante afin de relever un défi apparemment simple pour un·e designer industriel·le : construire un exemplaire du dispositif de toutes pièces. Le designer documente le processus et les obstacles quʼil rencontre, à commencer par lʼindisponibilité de matériaux comme le mica, en raison de lʼarrêt des activités de minage en Grande-Bretagne684. Lʼinitiative du designer britannique met ainsi en évidence les réseaux complexes de co-dépendance industrielle qui permettent la disponibilité quotidienne dʼobjets et outils que nous tenons pour acquis.
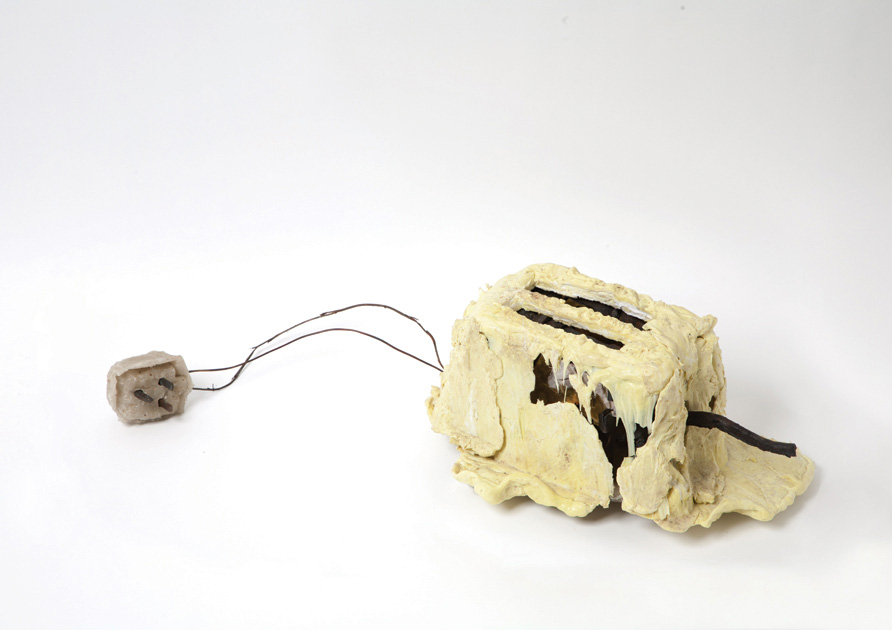
Ce faisant, il montre comment les imaginaires du progrès technologique, encore dominants en Occident, peuvent bien vite faire oublier que des dispositifs apparemment simples sont en réalité très complexes, et que lʼautomatisation, la délocalisation et, plus généralement, la production de masse peuvent occasionner une perte de savoir-faire, ou au moins leur atomisation en direction dʼune multiplicité dʼacteurs industriels685. Il en résulte que personne, à proprement parler, ne sait fabriquer de grille-pain ; et pourtant, la société industrielle en produit et en vend chaque jour. La soutenabilité et la durabilité dʼun tel système interrogent.
La cuisine est peuplée de dispositifs tout aussi complexes que le grille-pain. Ils ne sont ordinaires quʼen raison de leur omniprésence dans le quotidien ; en tant que productions de design, ils sont tout aussi sophistiqués que des objets perçus comme high-tech, comme les ordinateurs personnels ou les smartphones. Lʼanalyse des produits de haute technologie mériterait dʼailleurs dʼêtre déclinée au sujet des robots ménagers. Jʼai évoqué en introduction le travail cartographique de Vladan Joler et Kate Crawford, Anatomy of IA (2018, fig. 1.38). Dans cette carte exhaustive, lʼintelligence artificielle, soi-disant immatérielle et trop souvent perçue comme «  virtuelle  » est reliée à tous les réseaux de personnes et de richesses qui rendent son existence possible. Au sujet des hautes technologies, des années dʼexposition aux contenus sciencefictionnels nous ont appris à associer la figure du robot à celle de son créateur, soit le personnage trop souvent masculin de lʼinventeur génial, incarné dans notre monde contemporain par le métier dʼingénieur. Mais ce sont aussi des mineur·ses, des livreur·ses, des travailleureuses pauvres qui sont impliqué·es pour créer ces IA, soit pour trouver les métaux rares sans lesquels les objets techniques du numérique ne peuvent fonctionner, soit pour rendre ces objets disponibles, soit, encore, pour entraîner à peu de frais ces intelligences en triant des jeux de données. Derrière chaque objet, se cache un enchevêtrement de collaborations et de relais, entre mineur·ses, ouvrier·es et contremaîtres en Chine ou ailleurs, conducteurices dʼutilitaires de livraison, personnels sur les cargos dʼexportation, personnels de douane, vendeur·ses dans les magasins, etc. Et ma liste, elle-même, comporte probablement des manques ou des zones de labeur que je nʼai su identifier. Le grille-pain finalement produit par Douglas Thwaites est lʼenvers de cette cartographie intriquée dʼacteurs hétérogènes et dissociés. Sa coque dégoulinante est aux antipodes du rêve streamliné pérenne depuis Raymond Loewy, dans lequel la complexité mécanique de lʼobjet se cache derrière une apparence lisse et continue, qui peut aller jusquʼà lʼoccultation complète des logiques de fonctionnement dans une esthétique relevant de la «  boîte noire  »686 (Masure 2019). Elle montre toute lʼimpureté dʼun système : derrière le lisse, sont dissimulés le complexe, lʼabsurde, le déchet.
La forme finale de ce grille-pain nʼest pas une manière de louer la performance technique de lʼindustrie, mais plutôt une façon de rappeler la difficulté qui existe à produire un objet «  simple  ». Par ailleurs, le grille-pain de Douglas Thwaites, de son propre aveu, grille une tranche de pain unique avant de rendre lʼâme : un processus complexe de re-construction finit donc par produire un objet inutilisable. Dans le livre qui documente son processus, Thwaites défend alors lʼidée selon laquelle il importe de prendre soin de nos objets. Selon lui, tout artefact devrait être fourni avec deux modes dʼemploi : un premier, classique, qui indique comment sʼen servir, et un autre qui permet de démonter complètement lʼappareil et dʼen recycler les composants (2011, 177). À ce titre, le propos de D. Thwaites est en cohérence avec lʼesprit de son époque : le recyclage apparaît comme la solution maîtresse face à la surproduction. Lʼexpérimentation sur le grille-pain est aussi traversée par une éthique (et probablement une esthétique) DIY chère aux «  makers  »687 alors émergents, entre volonté dʼempouvoirer les consommateurices face à lʼobsolescence programmée et à la séduction des espaces de fabrication que sont les fablabs. Dans le contexte de mon étude, le grille-pain apparaît comme lʼincarnation tangible de la déraison de lʼindustrie contemporaine : obsolescence programmée, dépense énergétique excessive, production démesurée de déchets et absence dʼun lien significatif à lʼobjet sont autant de conséquences du capitalisme productiviste et de la délocalisation de la production qui le caractérise.
Jʼaborde donc le micro-paysage de la cuisine, soit la vue à hauteur dʼobjet, avec cette double leçon tirée de lʼexpérience de D. Thwaites. Tout dʼabord, il nʼexiste pas dʼobjet «  simple  ». Tout usage en apparence aisé (par exemple : ouvrir un robinet688) devrait être regardé dʼautant plus près quʼil semble facile, dans la mesure où il mobilise des chaînes complexes dʼespaces, de personnes et de ressources (dans mon exemple : les chaînes de fabrication des robinets, des canalisations, les centrales dʼépuration et leurs travailleureuses, les nappes phréatiques et leurs hôtes non-humains, etc.). De plus, la prolifération des petits génies de la vie domestique dans la seconde moitié du XXe siècle a été rendue possible par un ensemble de récits qui se sont fondés sur une compréhension de la technique comme inévitable moteur de progrès sociaux, parmi lesquels la libération féminine a été particulièrement mise en avant. Les technologies du numérique (notamment les intelligences artificielles et les techniques écraniques) sont aujourdʼhui mobilisées dans des discours très similaires. Il convient donc de déconstruire la prétendue rationalité intrinsèque des technologies (de lʼélectrification à la numérisation) en repérant les motifs constants qui sont convoqués pour asseoir leur inévitabilité. Par ailleurs, toute simplification autorisée par les technologies doit toujours être mise en friction avec les scénarios effectifs quʼelles impliquent, de la conception à la production, de la production à la distribution, de la distribution à lʼusage, de lʼusage à la dégradation. Les techniques ne sont pas rationnelles en soi et leur mise en Å“uvre dans de complexes chaînes industrielles indique même tout lʼinverse.
Dans le contexte de lʼusine, le robot remplace lʼouvrier·e. Depuis les luddites opposés à la spinning jenny (Sparke 2003, 31), il existe toute une tradition de lutte prolétaire visant à contester le remplacement des ouvrier·es à leur poste, quʼiels soient remplacé·es par des machines (mécanisation) ou, plus tard, par des travailleureuses du Sud (délocalisation). Le travail domestique est également concerné par cette double externalisation, à ceci près quʼelle semble moins immorale : dans la mesure où il nʼest pas rémunéré, le travail domestique nʼaurait-il pas vocation à être réalisé par une main-dʼœuvre rémunérée ou par un robot ? Le chapitre précédent a posé toutes les limites qui rendent lʼexternalisation vers des employé·es contestable. À présent, cʼest lʼexternalisation vers la machine et la manière dont le design y participe que je vais examiner. Mon objectif nʼest pas seulement de juger de la pertinence du robot ménager, mais de regarder comment la pénétration de la cuisine par des dispositifs mécaniques, électriques et numériques modifient cet espace, ses logiques et les usages qui la traversent.
Si le travail en usine est le faux jumeau du travail domestique, ce nʼest pas seulement le remplacement de la travailleuse en cuisine qui doit nous préoccuper, mais aussi, à la manière dʼun Charlot malmené par les rouages de la machine diabolique des Temps Modernes (1936), son aliénation. En effet, lʼindustrie électroménagère fait à ses clientes, après-guerre, en Europe et aux États-Unis, la promesse dʼune libération (telle lʼentreprise Moulinex qui promet dans ses réclames de «  libérer la femme  », fig. 4.6). fig. 4.6 : Publicité « Moulinex libère la femme » : une version couleur, et une destinée à la presse avec des modèles de robots, années 1960. Mais la ménagère, comme Charlot, pourrait bien à son tour être contaminée par les robots conçus pour lʼassister. Ce ne sont donc pas seulement des génies mécaniques de la vie en cuisine que nous allons ici rencontrer, mais aussi une possible mécanisation de la boniche, faite robote par son travail et son environnement -— et à quel prix ? Pour comprendre les tensions qui relient les dispositifs techniques à la travailleuse domestique, je mʼattacherai dʼabord à comprendre comment la technologie et ses usages sont genrés, et comment les sujets «  femmes  » ont été tenus à distance des objets techniques et, surtout, de leur conception.
fig. 4.6 : Publicité « Moulinex libère la femme » : une version couleur, et une destinée à la presse avec des modèles de robots, années 1960. Mais la ménagère, comme Charlot, pourrait bien à son tour être contaminée par les robots conçus pour lʼassister. Ce ne sont donc pas seulement des génies mécaniques de la vie en cuisine que nous allons ici rencontrer, mais aussi une possible mécanisation de la boniche, faite robote par son travail et son environnement -— et à quel prix ? Pour comprendre les tensions qui relient les dispositifs techniques à la travailleuse domestique, je mʼattacherai dʼabord à comprendre comment la technologie et ses usages sont genrés, et comment les sujets «  femmes  » ont été tenus à distance des objets techniques et, surtout, de leur conception.
Ensuite, je tâcherai de réinscrire nos actuels robots ménagers dans lʼhistoire des objets de consommation en cuisine, démocratisés et mythologisés par les Salons des arts ménagers qui sʼexposent en France dès 1923. Si ce Salon nʼexiste plus, il sʼinscrit néanmoins dans une histoire plus large des représentations des espaces domestiques vouées à engendrer des comportements de consommation. Publicités, vidéos de promotion, aménagement de «  cuisines du futur  » et autres modèles dʼexposition mʼintéresseront alors en tant quʼils sont les supports de récits au sujet de la vie domestique. Dans ces histoires, les femmes se voient attribuer une place, quand elles ne deviennent pas elles-mêmes un rouage de la machine-cuisine, un génie ménager au même rang quʼun mixeur, au service dʼune «  maison de demain  » dont les implications politiques et culturelles doivent nous interroger. Ayant observé comment le corps des femmes est à nouveau mobilisé comme une partie de lʼarchitecture, je mʼattacherai à comprendre, au-delà des promesses de libération des bateleurs, comment sʼorganisent les subjectivités des ménagères en cuisine. Quelles expériences proposent les plus ou moins petits objets de la vie en cuisine ? Quelles mises en Å“uvre de soi permettent-elles ? Je parlerai alors de vécus, mais aussi de rôles. Ainsi, en le répétant dans ces lignes, jʼœuvre à rendre acceptable ce mot de «  boniche  ». Cette femme-robote qui émerge dans les affiches du Salon des arts ménagers ou dans les fictions filmées (par exemple dans Blade Runner 2049 ou Umbrella Academy, fig. 4.7) offre-t-elle des espaces dʼagentivité ?

Jʼévoquerai comment dʼautres rôles peuvent être mobilisés : la fée du logis entrera ainsi en friction avec la sorcière derrière son chaudron, notamment en raison des relations potentiellement différentes quʼelles entretiennent à la beauté associée aux femmes et attendue dʼelles. Ces possibilités de vies fée, sorcière, boniche, mégère ou cordon-bleu sont un levier possible contre les violences sexistes. Cʼest là une autre «  responsabilité  » du design quʼil nous faudra examiner : non pas que la cuisine repensée puisse empêcher la violence, mais plutôt parce quʼil est impossible dʼoublier que tout objet, en tout temps et en tout lieux, charrie avec lui son devenir-arme. Cʼest aussi le pan optimiste sur lequel je conclurai cet essai : si les espaces savent être violents, nous pouvons sans doute nous outiller pour nous y défendre, voire repenser les espaces comme des sites dʼautodéfense, de préservation et de re-création.
En 1966, Claude Nougaro chante «  Les mains dʼune femme dans la farine  ». Dans cette chanson, il décrit en ces termes sa fascination nostalgico-érotique pour la présence féminine en cuisine :
Quand tu fais la tarte aux pommes, poupée, tu es divine
Rien nʼest plus beau que les mains dʼune femme dans la farine, oui
Allez roule-moi, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça mʼémeut
Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu (Nougaro 1966)
Les paroles ont ce mérite de rendre lisible la manière dont le corps féminin, dans la culture française (et peut-être plus largement occidentale) semble vissé à lʼespace de la cuisine : Anne-Martin Fugier, Catherine Clarisse et Mona Chollet font dʼailleurs toute référence à cette chanson dans leurs travaux (Martin-Fugier 2003[1979] ; Clarisse 2005, 215 ; Chollet 2015, 188). Les mains, comprises comme un siège de lʼintelligence (Focillon [1981[1934]), sont ici comme séparées de la personne à qui elles sont reliées. Nougaro chante bien ce travail en cuisine (il reconnaît même que «  cʼest pas de la tarte  »), mais les femmes en sont absentes : elles apparaissent comme une figure éternelle, hors du temps. Leurs mains agissent sans agir, figées quʼelles sont dans lʼacte de pétrissage ; les mains qui font sont celles du chanteur, qui affirme :
Rien nʼest meilleur que les mains dʼune femme dans la farine
Si ce nʼest mes propres mains posées sur ta poitrine
Et si une tarte aux pommes est bien évoquée, cʼest dʼabord pour émouvoir lʼhomme de lʼhistoire, qui dit préférer sa femme en cuisine plutôt que dans la chambre. Lʼaveu nʼest guère étonnant, et constitue une sorte de motif souterrain de la chanson populaire : parler des femmes, cʼest toujours évoquer de manière plus ou moins voilée leur disponibilité sexuelle, en même temps que leur attribuer des qualités associées à des rôles sociaux : par exemple, inoffensive comme une petite fille, fidèle comme une mère, chez Nougaro qui chante : «  Cʼest comme si tu étais ma mère en même temps que ma gamine  ». Dans tous les cas, la femme est en cuisine, nʼen sort pas et son rôle est défini par rapport à un homme à qui sont destinées tartes et caresses, dans un même geste laborieux, érotique et nourricier.
Il sʼagit bien sà »r dʼune chanson datée, dont on aura tôt fait de nommer le caractère passéiste. Catherine Clarisse, dans son étude Cuisines, recettes dʼarchitecture ne sʼen prive pas (2005, 215) quand elle nomme ironiquement lʼune des parties de son texte «  Ah ! Les mains dʼun homme dans la farine…  ». Elle ne cite pas Nougaro directement, et nʼen a nul besoin, tant la chanson est célèbre : mais il est clair dans cette évocation que le caractère sexiste de la ritournelle ne lui a pas échappé. Pour autant, le développement qui suit ce titre se borne à observer quʼ«  [h]eureusement, aujourdʼhui, de plus en plus dʼhommes font la cuisine avec plaisir  ». Cʼest en partie manquer le problème : car la figure puissante des «  mains dans la farine  » dépasse la seule question du partage des tâches. Elle pose la question des éléments qui sont associés au corps féminin, et la manière dont est représenté le travail spécifique en cuisine. Jʼaimerais donc proposer un autre regard sur cette chanson comme clé dʼentrée dans lʼunivers technique de la cuisine. Ce nʼest pas seulement lʼassociation de la femme à la préparation de sa tarte qui doit nous préoccuper, mais le caractère naturalisant, presque primitiviste et hors du temps de la représentation. Et si la critique peut sembler facile, il faudra nous demander comment ce motif presque pastoral des mains occupées à pétrir permet de tracer des lignes de partage pernicieuses dans lʼapproche de la cuisine. Catherine Clarisse ironise sur Nougaro, mais affirme quelques lignes plus tôt :
Après des heures de travail devant un écran dʼordinateur, couper des légumes frais, cultiver du basilic sur un rebord de fenêtre, pétrir à la main avec des enfants la pâte dʼun crumble peuvent procurer un délassement sensuel tout à fait complémentaire dʼoccupations «  virtuelles  » (2005, 215).
Si lʼaffirmation est intéressante et questionne la manière dont nos habitus contemporains au travail peuvent nous donner lʼimpression paradoxale dʼêtre «  déconnecté·es  », il y a quelque chose de frustrant à voir apparaître cette opposition somme toute assez binaire entre lʼespace «  virtuel  » (pourtant composé dʼobjets concrets, ou accessible grâce à eux) et ce motif pastoral de la «  vraie vie  » dont les composantes (pâte à crumble, enfant, rebord de fenêtre) ne sont pas anodines et dessinent, dʼune manière peu différente au fond de celle de Nougaro, lʼidéal dʼune vie domestique familiale plus authentique du fait de son lien aux plantes, à la famille reproductive, à la cuisine faite maison, etc.
Lʼassociation entre les femmes et leur foyer renforce et essentialise leur séparation dʼavec le champ des sciences et des techniques : on ne peut pas avoir les mains dans la farine et sur le clavier de lʼordinateur. En anglais, le terme même de «  housewife  » contient ce régime dʼassociations entre femme, foyer et vie maritale. Une association similaire affecte dʼailleurs le terme de «  husband  »â€¯: la particule hus correspond à une orthographe ancienne du mot maison. Ces deux termes, qui évoquent la vie maritale (surtout dans le cas de husband), connectent fortement les individus au foyer (Hayes 2010, 62) ainsi quʼà la terre agricole puisque «  to husband  », en anglais, renvoie au fait de labourer en vue de la récolte (Dworkin 2012, 184). Et si le terme «  housewife  » a pu désigner des hommes ou des femmes, il nʼen reste pas moins que lʼimagerie naturalisante de la cuisine nourricière est plus souvent liée aux femmes.
La cuisine est donc assignée aux femmes, et les femmes, nous lʼavons vu, sont fréquemment associées à la Nature, dont elles seraient plus proches par destin biologique. Forte de ces associations se dessine la figure dʼune femme au foyer incarnant métonymiquement la Mère Nature nourricière. Le choix de la farine nʼest dʼailleurs pas anodin dans la chanson de Nougaro : lʼimage sʼappuie sur un fond mythologique ancien, notamment sur la figure de Cérès, déesse à la fois de lʼagriculture, des moissons et de la reproduction. Si la cuisine est un espace technique (techniques du bâti, de lʼarchitecture, du mobilier), elle est souvent codée comme un espace naturel à cause de son association avec les femmes ; à moins que les femmes nʼy soient plus facilement assignées du fait des connotations nourricières primitives que porte la cuisine comme pratique. Quoi quʼil en soit, la dimension technique de la cuisine semble arriver après coup, comme la surcouche dʼun substrat originel. Par ailleurs, les usages du numérique sont facilement opposés (comme chez C. Clarisse) à des gestes manuels présentés comme plus directs et plus vrais. Il existe bien sà »r des textes et des pensées qui permettent de penser les techniques de manière plus subtile et moins binaires. Mais ces réflexions peuvent être prises au piège de la centralité du regard masculin : ainsi Gilbert Simondon pense de manière utile quʼil est «  sans fondement  » dʼopposer «  la culture et la technique  » (1958, 9). Et il prolonge cette illustration de lʼinutile binarité en refusant de renvoyer dos à dos «  lʼhomme et la machine  » (ibid.). Il est vrai quʼune telle opposition produit de fâcheux effets de bords, notamment celui de diaboliser une technique uniformément saisie comme «  déshumanisante  ». Mais lʼusage du neutre-masculin, et du mot «  homme  » pour dire «  humain  » creuse encore un peu plus le partage existant entre les technologies et les femmes. Nombreuses sont les formes prises par ce divorce, des films qui représentent systématiquement le génie créateur et sa créature-robote[zq] aux clichés populaires qui associent les femmes à une forme systématique dʼincompétence technique. Les femmes seraient ainsi dangereuses au volant, nulles en sciences ou en informatique, incapables de programmer un magnétoscope, etc.
Le cliché de lʼincompétence technique des femmes possède dès lors quelque chose de la prophétie autoréalisatrice. À force de considérer que les femmes ne sont pas «  bonnes  » avec les techniques ou quʼelles ne sʼy intéressent pas, on contribue à solidifier la domination masculine dans le champ professionnel des sciences et des techniques, en particulier dans le domaine du numérique. Au XXIe siècle, la parité homme-femme dans ce domaine nʼest pas réalisée : en 2017, les femmes occupent seulement 31% des postes dans lʼentreprise Google, et 20% des postes techniques dits vitaux (Chang 2018). Cette séparation, qui plus est, nʼa pas toujours été. Lʼexposition Computer Girls proposée à la Gaîté Lyrique en 2019 par les curatrices Inke Arns et Marie Lechner retrace la manière dont les femmes, dʼabord intégrées à lʼindustrie informatique pour un travail vu comme précis et répétitif, en ont été évincées dès que les grands enjeux politiques et économiques de cette discipline ont été compris. Des femmes ont pourtant constitué le gros de la main-dʼœuvre bon marché qui réalisait les calculs à lʼobservatoire dʼHarvard, ou ont programmé lʼEniac, le premier ordinateur électronique, en 1946 (Lechner 2023, 74–75). Par ailleurs, la dévalorisation des femmes et leur mise à distance de certains domaines estimés sont à double tranchant. Colette Guillaumin parle au sujet des «  […] techniques, engins et autres moteurs au sujet desquels la stupidité des femmes est bien connue  »â€¯:
Lʼunivers des femmes ce serait plutôt les vêtements, les pommes de terre, les parquets et autres vaisselles et dactylographie ; et les formes dʼagencement technique quʼimpliquent ces domaines sont ipso facto déclassées et renvoyées au monde du néant technologique, si ce nʼest de lʼinexistence pure et simple (1978, 8).
Autrement dit, les femmes sont séparées deux fois des technologies ; tout dʼabord, elles sont exclues dʼun champ technique désigné comme tel (le laboratoire scientifique, la programmation, lʼingénierie, etc.) ; ensuite, les savoir-faire qui leur sont associés sont déchus de leur statut de technique. On retrouve ici une logique que nous avons déjà vue à lʼœuvre dans le chapitre précédent, et que Sheryl Buckley situe à lʼorigine dʼune définition partielle du design.
Le champ des sciences et des techniques est ainsi éminemment genré : les hommes y sont numériquement plus représentés, et, comme dans bien des domaines, ils ont davantage la parole et sont en capacité de mobiliser un ensemble de savoirs qui assoit leur pouvoir, et inversement. Mais les femmes, Donna Haraway le rappelle, nʼexistent pas en dehors du champ des sciences. Leur exclusion sʼentend au niveau des espaces de pouvoir. En réalité, les femmes participent à la définition des sciences, soit parce quʼelles en sont lʼobjet, soit parce que leur exclusion est constitutive de la notion même de champ expérimental (Haraway 1997, 29). Aussi, pour comprendre ce que sous-tendent la mécanisation et la numérisation dʼun logis codé comme féminin, est-il indispensable de mieux comprendre les relations (souvent asymétriques et contrariées) entre femmes et technologies, et tout particulièrement les technologies du numérique. Jʼaborderai ainsi quelques cas de résistance féministe à lʼexclusion systématique des sujets «  femmes  » des champs des sciences et de la technique. Ces luttes entrent en friction avec un long héritage en faveur dʼune libération par les techniques. Angela Davis envisageait cette externalisation vers la machine dans ses écrits (2019[1981], 201). Lʼautrice et activiste Shulamith Firestone va jusquʼà imaginer des utérus artificiels qui libéreraient les femmes cisgenres du travail reproductif au foyer, acte gestatif compris (1970, 227–28). Comment les femmes résistent-elles à leur exclusion du champ technique, et avec quels enjeux pour leur travail assigné en cuisine ? Lʼévocation du cyberféminisme et de Barbie Informaticienne va me permettre de lʼappréhender ci-après.
Il existe aujourdʼhui de nombreuses manières pour les femmes de rejoindre un espace dit «  virtuel  » qui rejoue et parfois redouble les oppressions sexistes (et autres) qui traversent déjà les géographies tangibles. Sexisme dans le milieu du gaming, harcèlement en ligne ou cyberharcèlement, doxing689 de Youtubeuses sont autant de faits qui compliquent la vie des femmes avec les technologies du numérique, un champ vaste qui concerne aussi bien les usages ordinaires du Web, aujourdʼhui essentiels pour trouver un travail ou déclarer ses impôts, que des pratiques plus spécifiques (jeu vidéo, production de contenus, travail dʼinfluenceuse, etc.). Face à ces formes plus ou moins nouvelles du sexisme, des approches féministes ont proposé des moyens plastiques et techniques de critiquer la domination masculine dans le champ des technologies (notamment informatiques et numériques) et de proposer un regard alternatif sur le corps féminin, la sexualité et lʼautonomie par ou avec les technologies. Dans le manifeste cyberféministe publié dès 1997 par le collectif australien VNS, le positionnement est résolument antirationaliste et fait imaginer des continuités technocorporelles entre les individus femmes et le cyberespace (auquel on donne alors ce nom690), en affirmant par exemple que «  le clitoris est une ligne directe vers la matrice  »691 -— faisant écho aux visuels de lʼartiste Linda Dement qui propose des «  corps-paysages  » réinventés (fig. 4.8) dans son CD-ROM Cyberflesh girlmonster. Dans les visuels créés par le collectif VNS (fig. 4.8), on perçoit une vision alternative des technologies, à lʼopposé de la froideur technique qui marque la plupart des représentations filmiques alors dominantes. Le collectif théorise et assemble des fictions autour du «  slime  », une matière gluante, chaude et dysfonctionnelle, proche de lʼimpureté du cyborg harawayen théorisé quelques années plus tôt.

Selon Virginia Barratt, membre du collectif, la «  lignée féministe cyborg  » est un moyen de prolonger lʼesthétique et la politique punk alors sur le déclin. Elle résume ainsi lʼesprit de leur entreprise :
Le cyberféminisme était un moment catalyseur, un virus-esprit collectif qui a partout mobilisé des filles geeks et libéré le code techno-porno blasphématoire, de façon à rendre les machines humides, aptes à procurer du plaisir… alors que je vois le déclin de pussy riot vers des corps ‹ propres et appropriés ›, je sens la lignée féministe cyborg sʼétirer dans le temps et lʼespace (2015)692.
Ce sont toutefois des projets artistiques relativement peu connus, que lʼon dira peut-être «  de niche  ». Des initiatives comme lʼexposition Computer Girls permettent de leur redonner de la visibilité. Aujourdʼhui, cependant, lʼaccès des femmes aux technologies sʼentend plutôt comme une intégration dans lʼéconomie florissante de la «  Tech  ». Une telle approche implique un féminisme situationnel, stratégique, qui cherche davantage à briser le plafond de verre quʼà proposer une appropriation radicale des techniques du numérique.

En 2002, la marque de jouets Mattel lance un sondage pour connaître le prochain métier qui sera représenté dans sa ligne «  Barbie, I Can Be…  », une série de poupées Barbie orientées autour de la carrière des personnages (Stratigakos 2016, 40). Ces poupées se distinguent par leur métier et sont censées jouer le rôle de modèles pour les petites filles, pas seulement par leur apparence mais par la place quʼelles occupent dans la société, liée à leur aire de spécialisation. Lʼhistorienne de lʼarchitecture Despina Stratigakos raconte comment la Barbie Architecte nʼayant pas été pas retenue, elle a utilisé ce concept pour un travail mené avec ses étudiant·es à qui elle a demandé dʼélaborer leurs propres prototypes. En 2010, un nouveau vote est lancé par la marque et cʼest Barbie Informaticienne qui lʼemporte -— je le mentionne ici car Despina Stratigakos montre bien à quel point le fait dʼimaginer une femme architecte posait problème, au point que la représentation dʼune femme informaticienne a pu sembler plus réaliste.
Si D. Stratigakos finit par collaborer avec la marque Mattel pour réaliser cette poupée architecte, cʼest bien la Barbie Informaticienne qui mʼintéresse (fig. 4.10.a). fig. 4.10.a : Jouet Barbie informaticienne (Barbie Computer Engineer) produit par Mattel. A priori, elle est le signe dʼune volonté dʼintégration des femmes dans ces carrières. On peut en critiquer la dimension de feminist-washing mais il sʼagit bien de proposer aux petites filles, cibles commerciales de ces produits, dʼautres imaginaires que ceux de la cuisine, de la danse classique ou du poney. La poupée est équipée dʼobjets emblématiques de sa profession (ordinateur portable, aujourdʼhui un smartphone) ou stylisant celle-ci (un pull décoré dʼun imprimé alignant les chiffres «  zéro  » et «  un  »). À lʼépoque de sa commercialisation, le jouet était associé à dʼautres produits, tel un livre (Barbie: I Can Be A Computer Engineer) mettant en scène le personnage (fig. 4.10.b). Dans cette histoire, Barbie décide de programmer un jeu pour expliquer aux enfants comment les ordinateurs fonctionnent. Mais elle prend la décision mal inspirée de brancher sa clé USB sur lʼordinateur de son amie Skipper -— un virus infecte immédiatement la machine (fig. 4.10.c). Cette «  informaticienne  » explique plus tôt quʼelle ne sait pas vraiment coder et sʼoccupe «  seulement du design  »693.
fig. 4.10.a : Jouet Barbie informaticienne (Barbie Computer Engineer) produit par Mattel. A priori, elle est le signe dʼune volonté dʼintégration des femmes dans ces carrières. On peut en critiquer la dimension de feminist-washing mais il sʼagit bien de proposer aux petites filles, cibles commerciales de ces produits, dʼautres imaginaires que ceux de la cuisine, de la danse classique ou du poney. La poupée est équipée dʼobjets emblématiques de sa profession (ordinateur portable, aujourdʼhui un smartphone) ou stylisant celle-ci (un pull décoré dʼun imprimé alignant les chiffres «  zéro  » et «  un  »). À lʼépoque de sa commercialisation, le jouet était associé à dʼautres produits, tel un livre (Barbie: I Can Be A Computer Engineer) mettant en scène le personnage (fig. 4.10.b). Dans cette histoire, Barbie décide de programmer un jeu pour expliquer aux enfants comment les ordinateurs fonctionnent. Mais elle prend la décision mal inspirée de brancher sa clé USB sur lʼordinateur de son amie Skipper -— un virus infecte immédiatement la machine (fig. 4.10.c). Cette «  informaticienne  » explique plus tôt quʼelle ne sait pas vraiment coder et sʼoccupe «  seulement du design  »693.
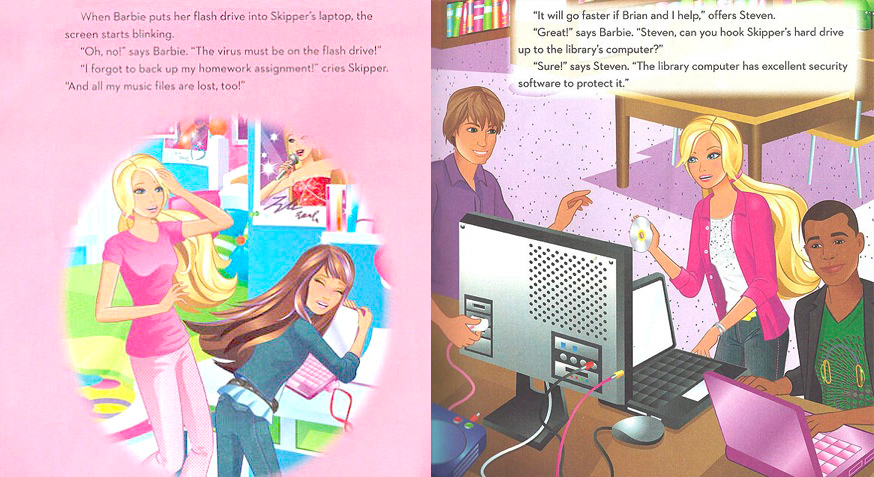
Enfin, elle doit solliciter lʼaide de deux hommes, Steven et Brian, pour réparer lʼordinateur de Skipper (fig. 4.10.c). À sa sortie en 2010, le livre fait logiquement lʼobjet dʼune controverse, puisquʼil reproduit des stéréotypes classiques au sujet des femmes et de leur implication dans le domaine de lʼinformatique. Même un personnage conçu comme informaticienne se retrouve dans le récit à avouer son incompétence et à dépendre de deux hommes pour parvenir à ses fins, comme sʼil existait une contradiction intrinsèque dans lʼassociation «  femmes  » et «  technique  ». fig. 4.10.c : Couverture du livret I Can Be a Computer Engineer publié en même temps que le jouet (2010). Suite à sa parution, le livre fait lʼobjet dʼune réappropriation féministe. Dans le projet Feminist Hacker Barbie, la consultante Kathleen Tuite propose à des informaticiennes de réécrire le récit sur la base des illustrations du livre (fig. 4.10.d). Ces nouvelles histoires créent deux déplacements féministes : le premier raconte autrement une histoire à lʼorigine sexiste et le second utilise lʼesprit du hacking694, pratique issue notamment des milieux de lʼinformatique, pour mener à bien ce projet de réécriture.
On voit ici à quel point la relation des femmes avec les techniques est conditionnelle : elle peut se faire si elle est juste question de design (la discipline leur étant soudainement ouverte, dès lors quʼelle représente le pendant décoratif dʼune activité technicienne) ou si des hommes dirigent lʼaction.
fig. 4.10.c : Couverture du livret I Can Be a Computer Engineer publié en même temps que le jouet (2010). Suite à sa parution, le livre fait lʼobjet dʼune réappropriation féministe. Dans le projet Feminist Hacker Barbie, la consultante Kathleen Tuite propose à des informaticiennes de réécrire le récit sur la base des illustrations du livre (fig. 4.10.d). Ces nouvelles histoires créent deux déplacements féministes : le premier raconte autrement une histoire à lʼorigine sexiste et le second utilise lʼesprit du hacking694, pratique issue notamment des milieux de lʼinformatique, pour mener à bien ce projet de réécriture.
On voit ici à quel point la relation des femmes avec les techniques est conditionnelle : elle peut se faire si elle est juste question de design (la discipline leur étant soudainement ouverte, dès lors quʼelle représente le pendant décoratif dʼune activité technicienne) ou si des hommes dirigent lʼaction.
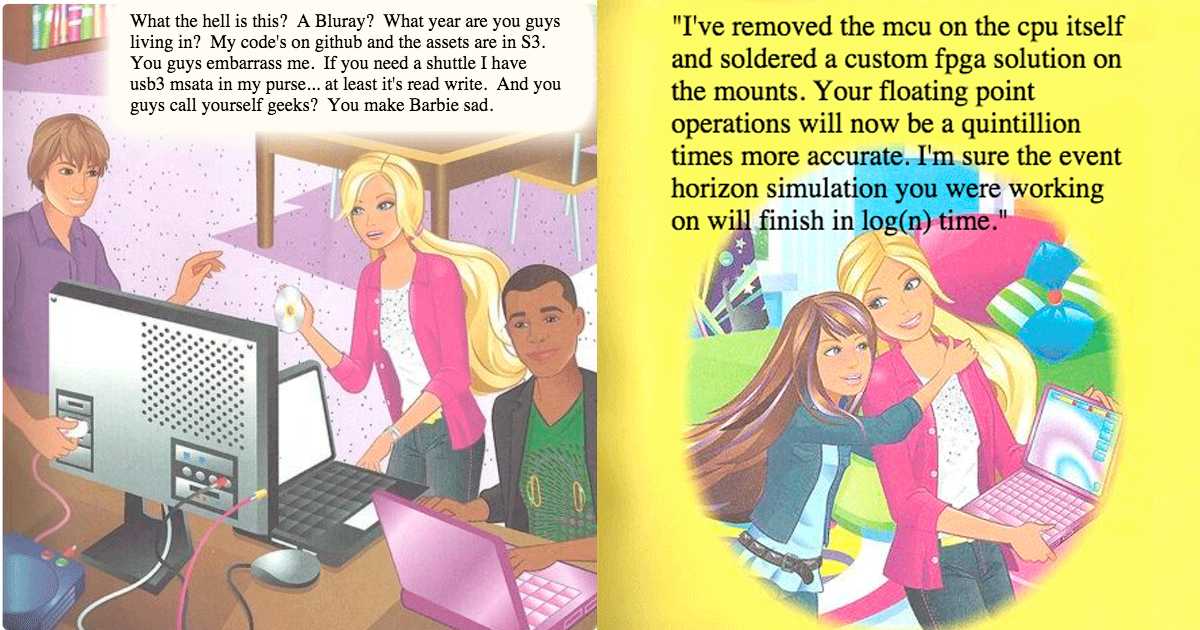
Nous serons amené·es à croiser ces dynamiques plus loin dans notre exploration : la présence de la technique en cuisine ne produit pas automatiquement une expertise féminine, voire, la technique est requalifiée pour devenir acceptable dans un espace codé comme féminin.
La mise en tension des possibles du cyberféminisme avec les formes plus convenues et limitatives de la rencontre femmes-technologies dans la culture populaire695 me permet de rappeler un point contextuel déterminant pour toute étude impliquant les femmes et les technologies : «  intégrer  » des femmes ne suffit pas, comme on lʼa dʼailleurs vu dans un autre contexte, au sujet de lʼarchitecture. Être présente nʼindique nullement que lʼon possède de lʼagentivité, ou que lʼon a droit à la parole. Et souvent, lorsque les femmes ont accès à ces lieux (de programmation, de conception, etc.), cet investissement se fait loin de lʼespace domestique, et semble relever dʼimaginaires qui lui sont étrangers, voire opposés. Pourtant, des propositions artistiques ont plus récemment tenté de visibiliser cette dimension technique de la cuisine, voire sa nature de laboratoire -— pas au service dʼune housewife qui voudrait satisfaire son époux, mais qui chercherait plutôt à sʼempouvoirer elle-même. Le projet OPEN SOURCE ESTROGEN (Å’STROGÈNES OPEN SOURCE) sʼinscrit dans cette approche (fig. 4.11.a). Son titre le lie directement aux enjeux politiques des pratiques de lʼinformatique. Depuis les années 1990, il existe en effet de nombreux groupes qui se réclament dʼun libre partage des codes sources des programmes pouvant être redistribués ou modifiés. Lʼinformaticien célèbre Richard Stallman a participé à diffuser ce terme et ce concept, en sʼopposant aux logiques propriétaires des brevets qui permettent à des acteurs privés de monétiser lʼaccès du public à un programme, un objet ou à un médicament.
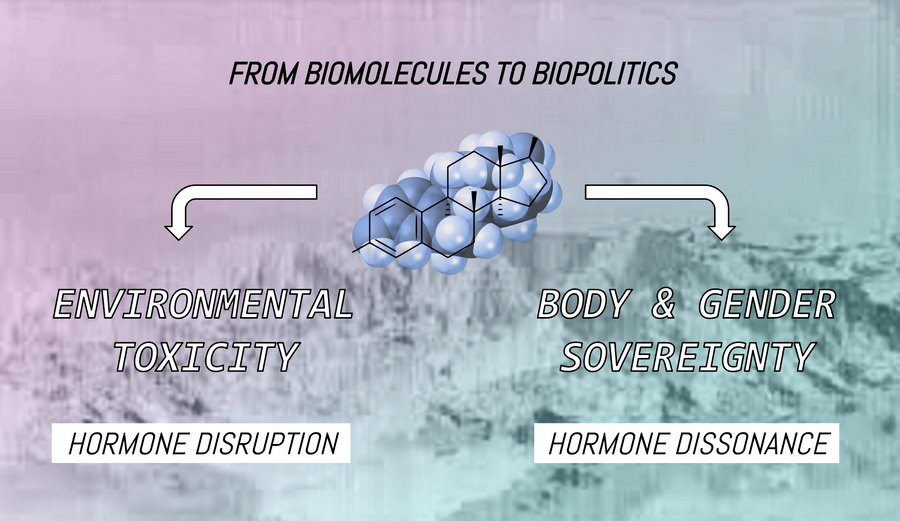
Le projet initié par lʼartiste Mary Maggic696 sʼinscrit dans cette approche politique, plus directement au sujet de la pharmacopée, et notamment lʼaccès aux thérapies hormonales pour les personnes trans. Sur son site Web, iel explique que sa proposition relève dʼune démarche de design spéculatif et de biohacking. Son approche fait écho à la pensée du cyborg proposée par Donna J. Haraway et ses prolongements dans le concept de xénoféminisme initié par le collectif Laboria Cuboniks : il sʼagit dʼinventer des corporéités étranges, queer, et impures qui brouillent les limites instituées par nos catégories de pensées (homme, femme, animal, etc.). Il est aussi question de penser un appareillage du corps qui ne serait pas uniquement dépendant des grandes industries ou réservé à certaines élites, comme cela est le plus souvent illustré dans les imaginaires transhumanistes.
Mary Maggic énonce ainsi la question à lʼorigine du projet Open Source Oestrogen : «  et sʼil était possible de fabriquer des Å“strogènes dans sa cuisine ?  »697. On observe ici quʼun déplacement a eu lieu : il ne sʼagit pas dʼintégrer les structures existantes du pouvoir capitaliste en formant une entreprise Å“uvrant dans le domaine des technologies (quoique cela puisse être intéressant) mais bien de déplacer la question technique vers un espace féminin dans une optique féministe.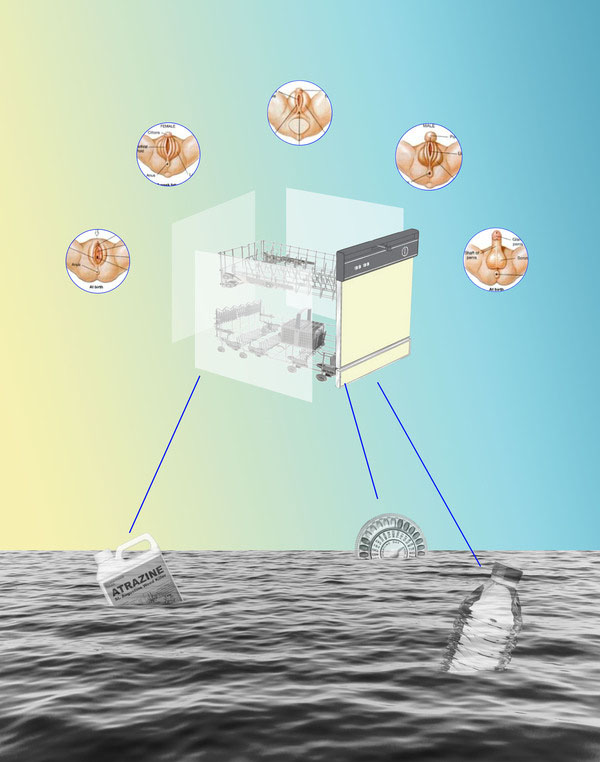 fig. 4.11.b : Visuel du projet de Mary Maggic. InspireÌ* par la notion de biopouvoir emprunteÌe aÌ€ Foucault, Maggic propose des pratiques reposant sur sa formation de chimiste, autant de formes de «  deÌsobeÌissance civile biotechnique  »698 (Tsang 2015). Iel affirme ainsi associer de manieÌ€re transdisciplinaire la pratique du biohacking et le design speÌculatif pour «  deÌmystifier lʼendocrinologie  » (Hay & Punjabi 2018). Parmi les dispositifs envisageÌs, on trouve des cultures de levures «  entraiÌ‚neÌes  » aÌ€ produire lʼhormone souhaiteÌe ou encore des poules vivant dans des environnements contamineÌs par celle-ci, et dont les Å“ufs sont en conseÌquence riches en Å“strogeÌ€nes. Ce dernier projet speÌculatif implique des enjeux meÌtaphoriques, puisque Mary Maggic identifie chez les poules et les femmes cisgenres un destin commun dʼ«  usine organique aÌ€ fabriquer des Å“ufs  » 699, qui rappelle les liens formulés par Donna Haraway entre sa propre prise dʼhormones et celle dont a besoin sa chienne (Haraway 2020[2016], 236–238). Lʼinitiative de lʼartiste nʼest pas isoleÌe, et iel connecte ainsi ses travaux au projet de Ryan Hammond, Open Source Gendercodes (2015), qui vise aÌ€ syntheÌtiser de la testosteÌrone aÌ€ partir de plants de tabac transgeÌniques (fig. 4.11.b). Le projet de M. Maggic, quant aÌ€ lui, repose sur une articulation entre la deÌmystification des protocoles scientifiques et la biopolitique des corps que lʼartiste localise aÌ€ la cuisine (2015). Ses projections impliquent en effet des gestes relevant du «  fait soi-meÌ‚me  » (ou DIY, Do It Yourself) qui forment un champ de pratiques scientifiques amateur : elles sont diffusées sur son site et partagées dans des fanzines (Estrozine, fig. 4.11.c & d).
fig. 4.11.b : Visuel du projet de Mary Maggic. InspireÌ* par la notion de biopouvoir emprunteÌe aÌ€ Foucault, Maggic propose des pratiques reposant sur sa formation de chimiste, autant de formes de «  deÌsobeÌissance civile biotechnique  »698 (Tsang 2015). Iel affirme ainsi associer de manieÌ€re transdisciplinaire la pratique du biohacking et le design speÌculatif pour «  deÌmystifier lʼendocrinologie  » (Hay & Punjabi 2018). Parmi les dispositifs envisageÌs, on trouve des cultures de levures «  entraiÌ‚neÌes  » aÌ€ produire lʼhormone souhaiteÌe ou encore des poules vivant dans des environnements contamineÌs par celle-ci, et dont les Å“ufs sont en conseÌquence riches en Å“strogeÌ€nes. Ce dernier projet speÌculatif implique des enjeux meÌtaphoriques, puisque Mary Maggic identifie chez les poules et les femmes cisgenres un destin commun dʼ«  usine organique aÌ€ fabriquer des Å“ufs  » 699, qui rappelle les liens formulés par Donna Haraway entre sa propre prise dʼhormones et celle dont a besoin sa chienne (Haraway 2020[2016], 236–238). Lʼinitiative de lʼartiste nʼest pas isoleÌe, et iel connecte ainsi ses travaux au projet de Ryan Hammond, Open Source Gendercodes (2015), qui vise aÌ€ syntheÌtiser de la testosteÌrone aÌ€ partir de plants de tabac transgeÌniques (fig. 4.11.b). Le projet de M. Maggic, quant aÌ€ lui, repose sur une articulation entre la deÌmystification des protocoles scientifiques et la biopolitique des corps que lʼartiste localise aÌ€ la cuisine (2015). Ses projections impliquent en effet des gestes relevant du «  fait soi-meÌ‚me  » (ou DIY, Do It Yourself) qui forment un champ de pratiques scientifiques amateur : elles sont diffusées sur son site et partagées dans des fanzines (Estrozine, fig. 4.11.c & d).
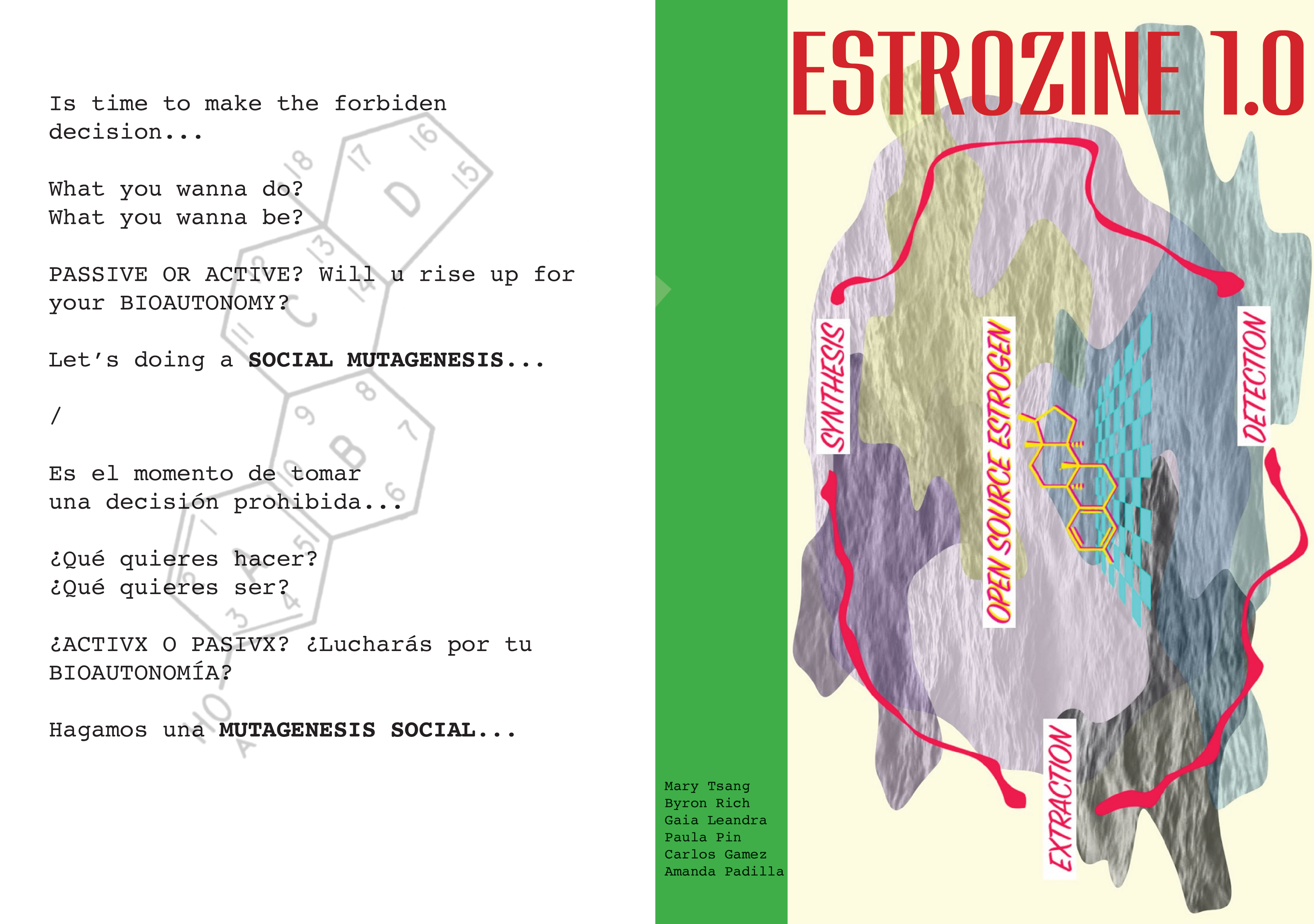
En investissant le domaine des technologies, les femmes et personnes sexisées resituent ce qui compte comme technologie700. Il ne sʼagit pas de sʼinscrire dans la logique réformiste qui veut que «  les femmes puissent aussi  », mais de déplacer les inscriptions et les langages patriarcaux des disciplines telles quʼelles sont. Ainsi, parler de technologie féministe ne reviendra pas seulement à parler de «  high-tech  » faites par des femmes mais aussi de low-tech mobilisées dans des buts politiques, apparaissant alors comme high-tech -— ce terme étant alors compris dans un sens différent. La mobilisation dʼune technologie au service de lʼempouvoirement féministe permet de matérialiser des buts politiques tout en requalifiant ladite technique. La binarité haut/bas (high/low), traversée par des connotations de classe mais aussi de genre devient le lieu dʼune mise en tension. Ainsi, le téléphone nʼest pas du tout une «  haute technologie  » dans les années 1970 -— lʼappareil fait partie du quotidien le plus banal. Pourtant, le collectif féministe Jane en fait un usage inattendu en diffusant dans des journaux underground une petite annonce incitant à «  appeler Jane  » en cas de grossesse non désirée. Ce réseau utilise ainsi le bouche à oreille ainsi que des technologies déjà éprouvées et facilement accessibles pour rendre lʼavortement, alors illégal aux États-Unis, accessible aux personnes qui le souhaitent. Au fil des opérations du groupe, il est établi quʼun homme médecin réalisant les avortements nʼest pas médicalement qualifié pour le faire, ce qui incite les femmes du collectif à apprendre à réaliser elles-mêmes lʼopération. Le collectif arrête ses activités avec la légalisation de lʼIVG ; pendant leurs quatre années dʼactivité, elles auront réalisé quelques 11 000 avortements.

On retrouve cette connexion entre technologies «  basses  » et autonomie reproductive ou, plus largement corporelle, dans de nombreuses actions contemporaines documentées en 2015 par la journaliste Rachel Wilson. Par exemple, le réseau hollandais Women on Web est organisé pour envoyer par courrier des médicaments abortifs (notamment le Misoprostol) aux femmes qui nʼy ont pas accès dans leur pays. Women on Waves est un autre réseau qui a mis au point le A-Portable, une unité dʼavortement mobile qui peut être chargée dans un camion ou un bateau posté dans les eaux internationales. Récemment, les personnes de ce collectif ont également organisé des envois de pilules abortives par drone (par exemple en Irlande du Nord ou en Pologne, fig. 4.12), ou encore par robot téléguidé au Mexique. fig. 4.12 : Photographie du «  drone de l’avortement  » (abortion drone) utilisé par le collectif Women on Waves en 2015 pour transmettre des pilules abortives à des femmes n’y ayant pas accès.
fig. 4.12 : Photographie du «  drone de l’avortement  » (abortion drone) utilisé par le collectif Women on Waves en 2015 pour transmettre des pilules abortives à des femmes n’y ayant pas accès.
Ces initiatives sont intéressantes parce quʼelles ne sont ni technophiles, ni technophobes : elles impliquent plutôt de mobiliser des technologies adéquates dans un contexte donné. Lʼidée du robot ne vaut pas pour lʼaspect innovant du dispositif, mais parce que le fait quʼil soit téléguidé à distance, depuis la Hollande, permet de contourner les lois en place (fig. 4.13). Ainsi, ces projets doivent toujours nous intéresser deux fois : dʼabord, en raison des politiques féministes quʼils permettent de mettre en Å“uvre, ensuite, pour les continuums technologiques quʼils dessinent. La technologie ne vaut pas ici pour elle-même, ou pour son aspect apparemment futuriste ou innovant : elle compte comme technique féministe reliée à des besoins individuels et collectifs clairs. fig. 4.13 : Photographie de rArbota, robot transmettant des kits d’avortement à des femmes n’ayant pas accès à l’IVG au Mexique. Parfois appelés Roe-bots par le collectif Women on Waves, ils peuvent être déployés dans des opérations de communication, comme ce fut le cas en 2024 aux États-Unis, sur le parvis de la Cour Suprême. Le design prospectif et lʼart permettent ainsi dʼimaginer des manières et des «  mondes à venir  » (Plana 2022) de mobiliser les technologies qui brouillent ces frontières entre high- et low-tech.
fig. 4.13 : Photographie de rArbota, robot transmettant des kits d’avortement à des femmes n’ayant pas accès à l’IVG au Mexique. Parfois appelés Roe-bots par le collectif Women on Waves, ils peuvent être déployés dans des opérations de communication, comme ce fut le cas en 2024 aux États-Unis, sur le parvis de la Cour Suprême. Le design prospectif et lʼart permettent ainsi dʼimaginer des manières et des «  mondes à venir  » (Plana 2022) de mobiliser les technologies qui brouillent ces frontières entre high- et low-tech.
Dans «  Housewives Making Drugs  » (fig. 4.14.a) est présenté un dispositif qui consiste aÌ€ reÌcupeÌrer de lʼurine et syntheÌtiser les Å“strogeÌ€nes quʼelle contient, en articulant un reÌcipient de reÌcupeÌration du liquide, du gel silicate et des filtres aÌ€ cigarette pour syntheÌtiser artisanalement lʼhormone (fig. 4.14.b). Cependant, le dispositif proposeÌ par Mary Maggic dans de multiples workshops, et dont Open Source Estrogen en 2015 nʼest que la premieÌ€re iteÌration, ne marche que de manieÌ€re expeÌrimentale.

La videÌo «  Housewives Making Drugs  » en projette pourtant un fonctionnement accessible en pratiquant une reÌfeÌrence fileÌe aux pratiques culinaires et aux eÌmissions télévisées de cuisine. Deux femmes trans, Jane Phoenix & Jane Renegade, preÌsentent ce faux show culinaire, tout autant inspiré par la preÌsentatrice de teÌleÌvision Martha Stewart (Tsang 2017, 36) que lʼartiste expeÌrimentale Martha Rosner. La représentation investit un registre camp (voir note XX dans le chap. III) : les deux femmes imitent en lʼexacerbant le steÌreÌotype de la housewife des anneÌes 1950, ainsi que la figure médiatique de la présentatrice télé au ton niais et premier degré. La videÌo joue sur cette tension entre ces différents rôles féminins stéréotypés et le propos, lui-meÌ‚me un meÌlange de pop science et de politique queer. Les deux femmes exposent leur dispositif, non sans mentionner, avec humour, la proximiteÌ de leur pratique avec la fabrique illicite de psychotropes (telle la MeÌthampheÌtamine ou meth). Ce rapprochement, faciliteÌ par la polyseÌmie du terme «  drug  » en anglais, souligne le double eÌcart permis par la localisation du projet en cuisine : cette pieÌ€ce de la maison, en eÌtant investie pour des activiteÌs apparemment diffeÌrentes de sa destination premieÌ€re, est en effet dissocieÌe de lʼimpeÌratif de reproduction imposeÌ aux femmes par le systeÌ€me heÌteÌronormatif et capitaliste. De surcroît, le deÌcalage de sens ne constitue pas cette cuisine en page blanche.
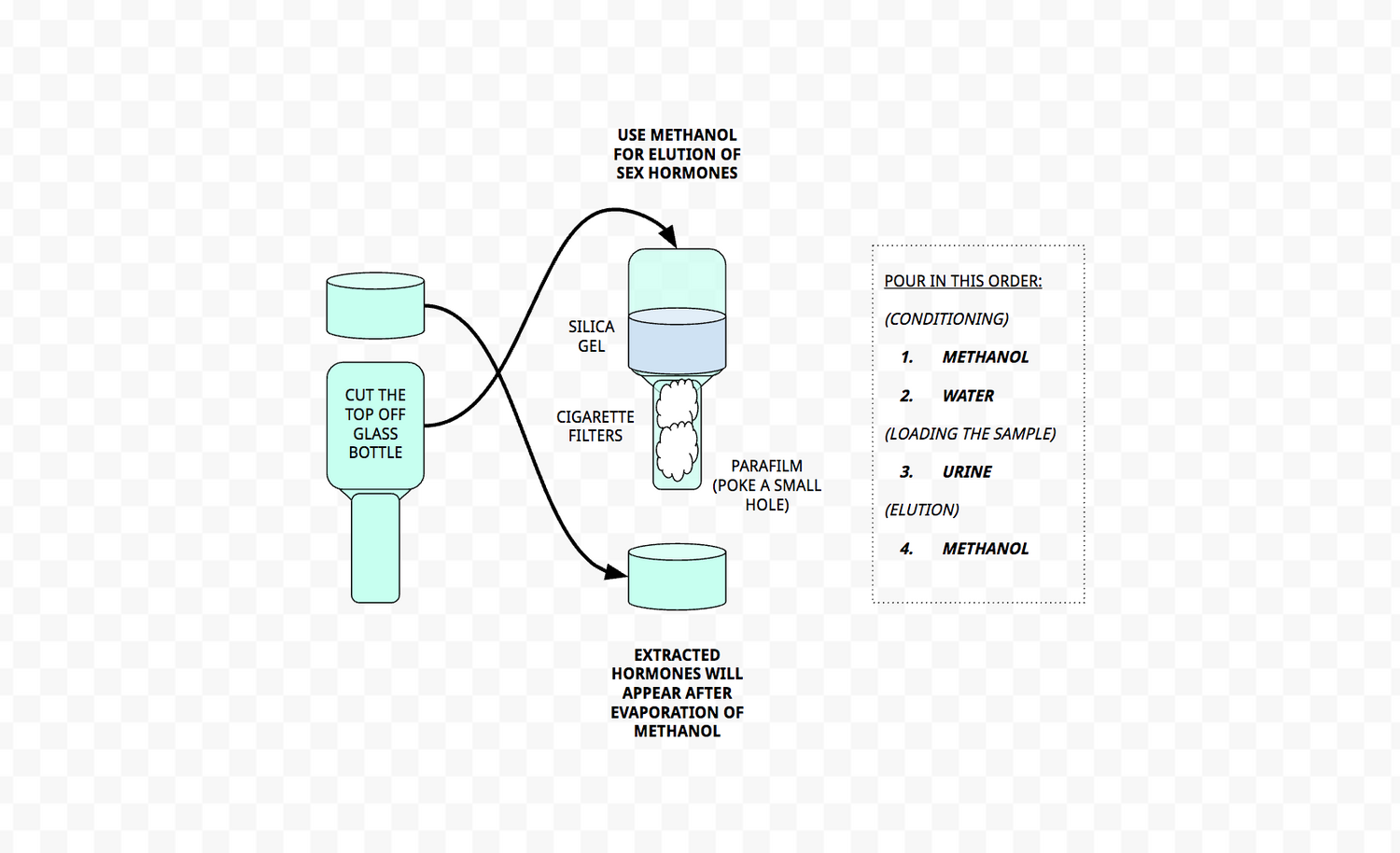
Elle reste riche de gestes, de savoirs, auxquels viennent sʼen ajouter dʼautres : ceux de lʼautonomie corporelle. La figure de la ménagère un peu idiote ou candide est mobilisée ici pour mieux montrer quʼil nʼexiste pas dʼopposition a priori entre les corvées de ménage et la révolution discrète et high-tech. Les femmes de «  Housewives Making Drugs  » vont ainsi au-delà de la seule dérision : elles ne se moquent pas des femmes au foyer, mais montrent à quel point ces dernières peuvent sʼinventer comme des chevaux de Troie.
Si le dispositif nʼest pas fonctionnel, il a susciteÌ une forte adheÌsion, aÌ€ tel point que saon creÌateurice a duÌ‚ repreÌciser les limites du systeÌ€me. Il est bel et bien possible de syntheÌtiser des hormones aÌ€ partir dʼurine (Haraway 2020[2016], 246–52), mais la pratique nʼest pas sans risque et produit des quantiteÌs limiteÌes qui peuvent eÌ‚tre insuffisantes dans le cadre dʼune transition hormonale. Le projet relève donc du design speÌculatif au sens le plus fort du terme, puisquʼil rend si tangible sa proposition quʼelle rencontre treÌ€s clairement les besoins des usager·es, au-delaÌ€ du pouvoir de seÌduction de propositions «  innovantes  » valoriseÌes par les discours meÌdiatiques qui entourent le design et les technologies. Si la forme du dispositif releÌ€ve dʼune forme de bricolage que certain·es trouveront en deçaÌ€ dʼun geste de designer, il faut appreÌcier ici la richesse visuelle mise en place et les perspectives quʼelle ouvre : entre les eÌmissions teÌleÌviseÌes culinaires Pop, le steÌreÌotype de la meÌnageÌ€re fifties, les codes visuels du cartoon et la palette coloreÌe fluo, la cuisine se reÌveÌ€le un veÌritable réservoir, capable de recevoir des formes multiples dʼeÌ‚tre entre ses murs, des plus normatives aux plus queer. Mary Maggic invente une image alternative de la science : une «  freak-kitchen-science  »701, selon ses propres mots, que je souhaiterais nommer comme science boniche. Affirmer que les femmes peuvent aussi faire de la science tend à fabriquer des imaginaires où elles rejoignent les hommes sur un terrain qui reste conçu comme le leur. Fabriquer des techniques en cuisine, cʼest rappeler que ce lieu nʼest pas intrinsèquement low-tech, ou que, sʼil lʼest, ce «  low  » ne doit pas sʼentendre de façon strictement hiérarchique et donc péjorative pour un ensemble de savoirs qui ne demandent quʼà être mobilisés et remis en circulation. En regardant «  Housewives Making Drugs  », on peut imaginer quʼune lecture féministe de la technique ouvre nécessairement sur des formes de trans-techs : des techniques qui accompagnent lʼautonomie corporelle (notamment trans) mais aussi fabriquent des continuums entre les «  high  » et «  low  » traditionnellement genrés des sciences et des techniques.
Lʼunivers de la cuisine est déjà technique : cette pièce du logis accueille des savoirs précis qui sont invisibles comme techniques uniquement parce quʼils ont été historiquement réalisés par des femmes. Dans ce contexte, la cuisine apparaît comme un espace biface, sinon un paradoxe architectural : il incarne pour les femmes le lieu des savoir-faire de peu, des expertises faibles (faire la vaisselle, ranger les courses, etc.), mais devient technique et scientifique lorsquʼil est investi par des hommes. La phase historique correspondant au développement de la science ménagère constitue un des moments de résolution de cette opposition, mais en créant aussi, comme nous lʼavons vu, son propre jeu de contradictions : les «  ménagères scientifiques  » nʼétaient souvent que des ménagères de surface et la rationalisation visée par leur science crée des scénarios parfois éloignés des réalités matérielles des femmes au foyer, qui «  signifient  » lʼexactitude et la maîtrise plus quʼils ne la mettent en Å“uvre.
Lʼexpression de «  cuisine-laboratoire  » peut ainsi amener à des décisions mal inspirées en termes de conception de lʼespace. Pour Jean-Luc Kaufmann, cet idéal a pu faire imaginer aux concepteurices dʼespaces des cuisines sans table, qui se sont soldées par un échec (2015[2005], 119). Scientifiser la cuisine nʼa pas pour effet automatique de rapprocher les femmes de la science, ou de crédibiliser leurs pratiques domestiques, loin sʼen faut. Il se peut que ce phénomène sʼexplique par la valeur prise par les termes «  science  » et «  technique  » ou «  technologie  » dans la discussion. Le fait que la binarité science/art recoupe le partage objectivité/subjectivité participe à faire oublier un fait important : la science et les technologies sont tout autant affaire dʼimaginaire que les arts. «  Scientifiser  » la cuisine ne revient donc pas seulement à lui apporter un ensemble de techniques ou de savoirs fixes, mais à situer en cuisine les valeurs et les objectifs traditionnellement confiés à la science. Cette observation importe pour les designers, car les sciences possèdent des esthétiques autant quʼun contenu épistémologique. Ainsi, il sera possible de proposer un comptoir immaculé, des fixations en métal ou dʼutiliser des contenants rappelant le nécessaire du chimiste : pour autant, il nʼest pas dit que cette cuisine soit plus rationnelle, cʼest-à -dire, quʼelle réponde correctement aux besoins des usager·es amené·es à investir cet espace. En outre, la rationalité scientifique de lʼingénierie a été opposée, historiquement, au décor féminin et superficiel.
Pourtant, les formes qui connotent la rationalité constituent elles aussi une forme de décor. Il en existe de nombreux exemples dans lʼhistoire du design, dont le plus emblématique est sans doute celui du style streamline dans les années 1925–1940 : ce dessin du fuselage des trains ou des avions, initialement pensé pour maximiser lʼaérodynamisme, devient un signifiant de vitesse, de modernité et de progrès (Giedion 1948, 607 ; Brunet & Geel 2023, 131–32). Ailleurs, lʼabsence apparente de décor nʼest ni un vide ni un silence visuel, et peut condenser une charge sémantique importante. Le blanc de la surface de la cuisine est ainsi traversé par son écho à la paillasse des laborantin·es, lʼidéal de la scientificité en blouse (telle celle arborée par Christine Frederick), la connotation hygiéniste du propre ou encore la supériorité morale de la féminité blanche immaculée. Aussi, dans les lignes qui suivent, vais-je investir science et techniques à travers de leurs imaginaires populaires, pour tâcher de saisir ce que les progrès techniques charrient dʼimages, de valeurs et dʼaspirations spécifiquement mobilisées en cuisine. Cette toile de fond me permettra ensuite de mieux contextualiser lʼarrivée des robots domestiques dans le quotidien, et la place quʼils occupent aujourdʼhui dans ces environnements. Je considérerai dʼabord la manière dont lʼélectrification et ses mythologies constituent le socle du rêve de la cuisine du futur. Puis, je décalerai mon propos pour envisager la manière dont cette futurité est projetée dans la nourriture et, par effet retour, sur les outils de sa préparation.
La technicisation de la cuisine va au-delà de lʼapplication dʼun principe à un espace : elle constitue une migration de logiques industrielles vers la sphère domestique. La cuisine et lʼespace domestique sont donc ouverts à dʼautres logiques et pratiques que les leurs ; selon Siegfried Giedion, ce passage pose un enjeu dʼéchelle (1948, 602 ; Hayden 1982, 23). Les dispositifs doivent, en quittant lʼusine, perdre en taille ou cacher leur apparence machinique considérée comme disruptive dans le cadre du logis. Celui-ci est bien sà »r affecté en profondeur par lʼarrivée de lʼélectricité et des dispositifs quʼelle nourrit ; mais, réciproquement, les objets techniques et leurs principes sont domestiqués par leur intégration au cadre de la vie familiale. Avant de regarder de plus près les robots électroménagers, il me faut revenir à lʼinnovation qui a permis toutes les autres : lʼélectrification. Lʼinvention de cette technologie est quant à elle liée à une «  découverte  » que je nomme comme telle entre guillemets, car la conscience de ce phénomène physique est très ancienne, et a été expliquée de multiples manières avant dʼêtre véritablement théorisée au-delà des manipulations empiriques. Lʼélectricité est identifiée comme source dʼénergie aux États-Unis dès les années 1860, et concurrence rapidement le gaz (disponible quant à lui depuis la moitié du XIXe siècle) à partir de 1870 (Sparke 1987, 37). Lʼélectricité convainc rapidement ses consommateurices potentiel·les, malgré un coà »t parfois prohibitif qui explique sans doute que sa domination ne soit pas immédiate ; pendant des années, charbon, gaz et électricité cohabitent. En effet, cette généralisation de lʼélectricité nécessite une normalisation des réseaux qui nʼa par exemple été effective en Grande-Bretagne quʼà partir des années 1920 (Sparke 1987, 38). Cette électricité mobilisée pour alimenter en énergie les logis au XIXe siècle, en commençant par les plus fortunés, implique de nouvelles perceptions, subjectivités et imaginaires. Sa nouveauté et son invisibilité participent à son identification comme phénomène magique, tantôt prodige sans source identifiée, tantôt puissance abstraite reliée à des forces telluriques ou divines, ou encore personnifiée comme «  fée  ». Mais lʼélectrification a beau être nouvelle, ses promesses puisent aussi dans un répertoire dʼimaginaires que le gaz a largement contribué à façonner et matérialiser.
La clarté effective proposée par le gaz dʼéclairage est traversée par un codage moral : la lueur, comme la blancheur (et son corollaire, la Blancheur), est associée à la pureté des sentiments ou à la justesse de la raison. À lʼopposé, lʼobscurité recouvre un territoire dʼactes immoraux, comprenant la duplicité, la tricherie ou encore lʼusage du faux. Les discours qui opposent la clairvoyance à lʼobscurantisme sont tributaires de ces représentations. Avant dʼalimenter les robots ménagers, lʼélectricité est donc mise à contribution dans un vaste projet moderne dʼéclairage du monde réel comme du monde des idées. Lʼimplantation du gaz dʼéclairage puis de lʼélectricité suit et inscrit un partage de classe : du côté des espaces privés, ce sont les foyers les plus bourgeois qui ont la capacité de sʼéquiper et de sʼilluminer, tandis que lʼespace public, sous lʼeffet de ces nouvelles lueurs, est segmenté en différents territoires. Ainsi, dans les commerces du XIXe siècle, les espaces de vente brillent de mille feux, tandis que les pièces logistiques sont maintenues dans une relative obscurité (Guien 2021, 68).
Cependant, cette électrification nʼest pas uniforme, et les écrits contemporains de lʼarrivée de lʼélectricité en témoignent. Les écrits de Marcel Proust sont particulièrement évocateurs en la matière, lorsquʼil nomme «  la […] sensation dʼétouffement que peut causer aujourdʼhui à des gens habitués à vingt ans dʼélectricité lʼodeur dʼune lampe qui charbonne ou dʼune veilleuse qui file  »702 (1992[1919], 265). Le chercheur en littérature Stéphane Chaudier nomme ainsi chez lʼécrivain cette récurrence de lʼélectricité comme métaphore du sentiment amoureux, mais relève aussi ses observations au sujet du partage de classe que cette technique matérialise (2007, 6 ; 10). Lʼélectricité est donc un opérateur social dans la mesure même où elle constitue une forme de merveilleux auquel seuls les plus fortuné·es ont accès. Les expositions universelles vont ainsi faire découvrir au grand public lʼélectricité avec cette double connotation : magie domptée et technologie maîtrisée, entre merveilleux et rationalisme.
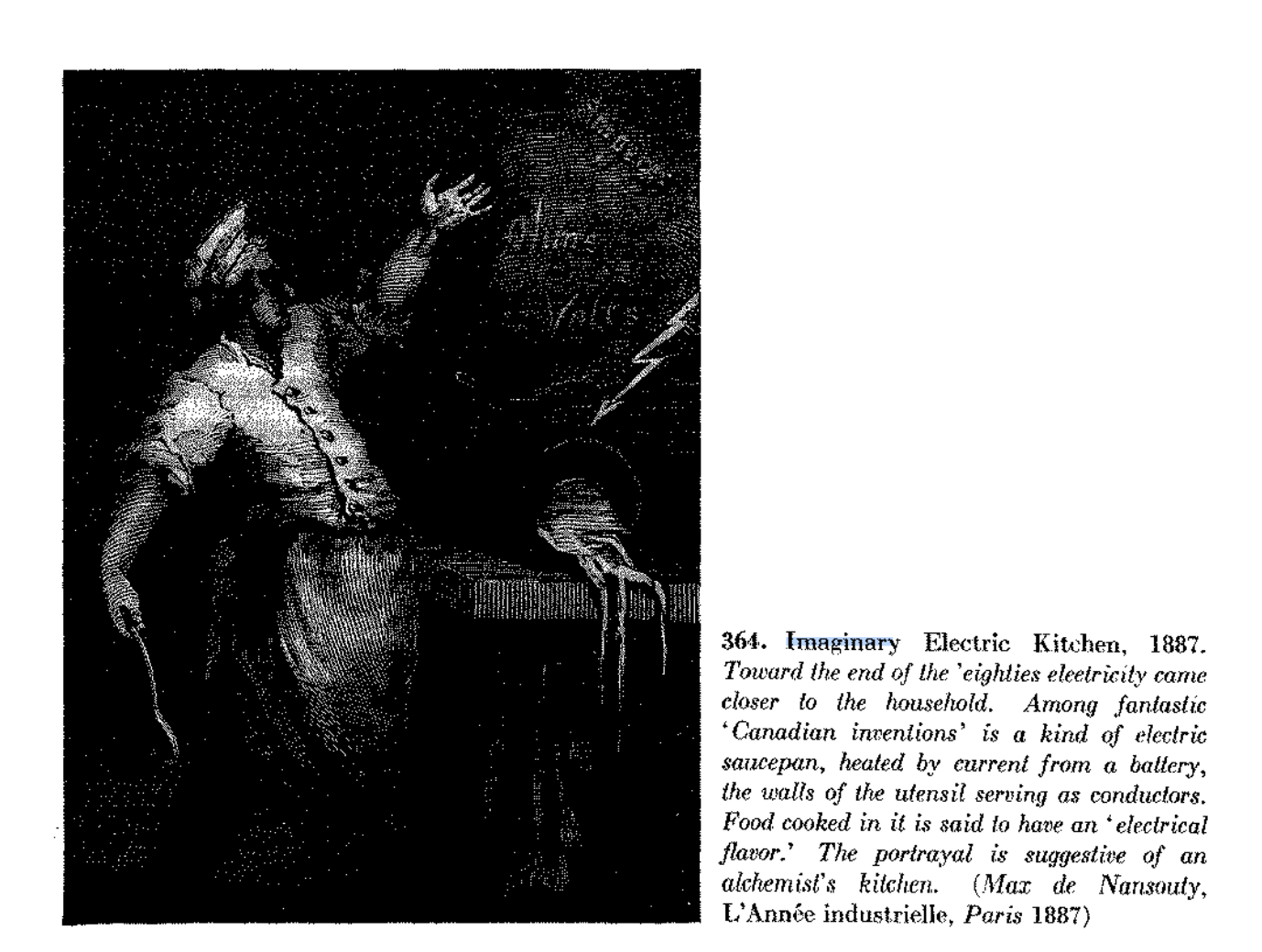
Cʼest dʼabord cet aspect magique qui prévaut dans les représentations de lʼélectrification domestique et tout particulièrement de lʼusage de lʼélectricité en cuisine à la fin du XIXe siècle (Giedion 1948, 607). Les images qui accompagnent cette mutation technique sont parlantes. Siegfried Giedion montre par exemple dans son célèbre ouvrage une illustration extraite de lʼouvrage LʼAnnée Industrielle (1887 ; fig. 4.15) du vulgarisateur scientifique et ingénieur Max de Nansouty (543). On y voit un cuisinier accueillir des éclairs en cuisine -— sans que leur qualité de menace ou de bénédiction soit bien claire. Aux États-Unis, William J. Hammer, assistant de Thomas Edison, produit pour le Nouvel An son Electrical Diabolerie, où sont proposés un «   toast éclectique  », une «  tarte de sorcier  », un «  gâteau télégraphe  » des «  cigares électriques  » et de la musique par «  lʼOrchestre électrique du professeur Méphistophélès  »703 (Wosk 2003, 71–72). Les réclames pour lʼélectricité relient aussi ce registre fantastique à un substrat religieux. Dix ans plus tard, aux États-Unis, une publicité pour le promoteur S. E. Gross associe la promesse de lʼhabitat individuel à cette clarté permise par les nouvelles technologies dʼalors (fig. 4.15).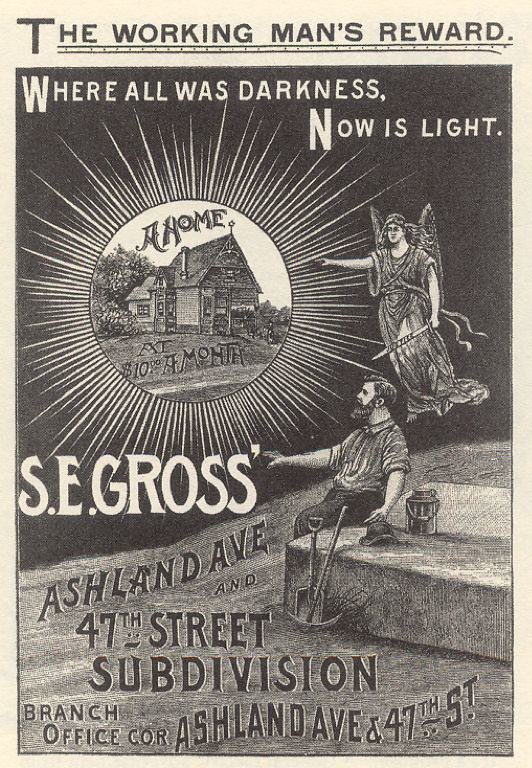 fig. 4.16 : Publicité S.E Gross , «  The Working Man’s Reward  » pour un nouveau quartier périphérique à la ville de Chicago, en 1898 ; la publicité est citée par Dolores Hayden dans Redesigning the American Dream (p. 39). Cette fois, ce nʼest plus une figure ambiguë de cuisinier faustien qui accueille la lumière, mais un ange divin. Le texte de lʼaffiche («  Where All Was Darkness, Now Is Light  ») est une évocation directe des textes bibliques704. Jʼai déjà évoqué la manière dont cette arrivée de lʼélectricité dans les foyers sʼaccompagne de questionnements, notamment sur le goà »t des aliments (cf. infra). Les discours publicitaires témoignent de cette hésitation face aux nouvelles technologies, dans la mesure même où ils tendent à rendre évident ou tout simplement bienvenu lʼusage de lʼélectricité. Dans une publication Hoover citée par Penny Sparke dans son étude des objets électroménagers, il est question de «  balayer à lʼélectricité  »705 (Sparke 1987, 29). Ici, lʼobjet électroménager pourtant nouveau quʼest lʼaspirateur disparaît de la représentation. Il devient un simple médiateur entre lʼusager·e et une force tellurique nouvellement domptée, plus motrice que le moteur lui-même : lʼélectricité. Certes, il se peut que toute nouvelle technologie existe dans un trou de langage provoqué par son apparition. En lʼabsence dʼhabitus constitués, le langage utilise dʼanciens référentiels pour désigner une action : on ne passe pas encore lʼaspirateur, on balaie. Lʼobjet domestique nʼest donc pas immédiatement investi par la magie prêtée à lʼélectricité ou au gaz : proto-génie domestique, il fonctionne dʼabord comme un intermédiaire bienvenu entre les usager·es et la mystérieuse électricité. Au XXe siècle, on trouve encore des traces de cette liaison à la fois paradoxale et fertile entre fantastique et science, ou entre horreur gothique et rationalité qui caractérise le XIXe siècle706. En 1932, la marque AEG sort un modèle dʼaspirateur nommé Vampyr (fig. 4.17.a ; Sparke 1987, 32) ; dans les années 1920, la marque Mors illustre encore le pouvoir de succion de son appareil par une personnification en génie qui «  boit la poussière  » (fig. 4.17.b).
fig. 4.16 : Publicité S.E Gross , «  The Working Man’s Reward  » pour un nouveau quartier périphérique à la ville de Chicago, en 1898 ; la publicité est citée par Dolores Hayden dans Redesigning the American Dream (p. 39). Cette fois, ce nʼest plus une figure ambiguë de cuisinier faustien qui accueille la lumière, mais un ange divin. Le texte de lʼaffiche («  Where All Was Darkness, Now Is Light  ») est une évocation directe des textes bibliques704. Jʼai déjà évoqué la manière dont cette arrivée de lʼélectricité dans les foyers sʼaccompagne de questionnements, notamment sur le goà »t des aliments (cf. infra). Les discours publicitaires témoignent de cette hésitation face aux nouvelles technologies, dans la mesure même où ils tendent à rendre évident ou tout simplement bienvenu lʼusage de lʼélectricité. Dans une publication Hoover citée par Penny Sparke dans son étude des objets électroménagers, il est question de «  balayer à lʼélectricité  »705 (Sparke 1987, 29). Ici, lʼobjet électroménager pourtant nouveau quʼest lʼaspirateur disparaît de la représentation. Il devient un simple médiateur entre lʼusager·e et une force tellurique nouvellement domptée, plus motrice que le moteur lui-même : lʼélectricité. Certes, il se peut que toute nouvelle technologie existe dans un trou de langage provoqué par son apparition. En lʼabsence dʼhabitus constitués, le langage utilise dʼanciens référentiels pour désigner une action : on ne passe pas encore lʼaspirateur, on balaie. Lʼobjet domestique nʼest donc pas immédiatement investi par la magie prêtée à lʼélectricité ou au gaz : proto-génie domestique, il fonctionne dʼabord comme un intermédiaire bienvenu entre les usager·es et la mystérieuse électricité. Au XXe siècle, on trouve encore des traces de cette liaison à la fois paradoxale et fertile entre fantastique et science, ou entre horreur gothique et rationalité qui caractérise le XIXe siècle706. En 1932, la marque AEG sort un modèle dʼaspirateur nommé Vampyr (fig. 4.17.a ; Sparke 1987, 32) ; dans les années 1920, la marque Mors illustre encore le pouvoir de succion de son appareil par une personnification en génie qui «  boit la poussière  » (fig. 4.17.b). fig. 4.17.a : Affiche pour l’aspirateur Vampyr AEG, années 1920s ; crédit : Deutsches Historisches Museum, Berlin.
fig. 4.17.a : Affiche pour l’aspirateur Vampyr AEG, années 1920s ; crédit : Deutsches Historisches Museum, Berlin.
Deux figures me semblent utiles pour penser la prolifération des appareils électroménagers et ses conséquences sur lʼexpérience de lʼespace domestique. La grille, comme motif spatial, permet de comprendre comment lʼappareil nʼest jamais une entité isolée : elle relie le domicile à une somme de réseaux dʼalimentation qui, comme lʼobservait Paulette Bernège, font vaciller la stricte division privé/public. La fée, le génie, la sorcière ou le lutin sont, quant à eux, autant dʼoccurrences dʼentités magiques et familières auxquelles les objets électrifiés de la cuisine vont se retrouver associés.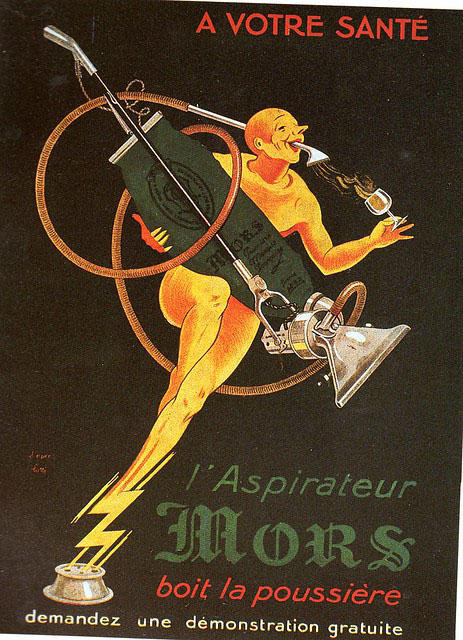 fig. 4.17.b : Publicité pour un aspirateur Mors, années 1930. La grille constitue lʼenvers moderne et scientifique des imaginaires de lʼélectricité, et nous permet de prendre la mesure de tout ce qui, dans une cuisine, se nourrit de cette source dʼénergie. On pensera bien sà »r à la lumière : lʼéclairage est le premier usage de lʼélectricité en cuisine, comme dans le reste du logis. Puis vient lʼélectrification dʼappareils qui remplacent lʼénergie cinétique de la main (robot, batteur à œufs, etc.), les appareils de cuisson divers (four, plaques chauffantes, et même les accessoires tels que la hotte aspirante) et de réfrigération ; enfin, de nos jours, lʼélectrification contribue aussi à alimenter les objets numériques plus ou moins dédiés à la cuisine : téléphone ou tablette sur laquelle consulter des recettes, enceinte connectée permettant de cuisiner en écoutant la radio, voire dispositif dit «  intelligent  » (frigo connecté). Stricto sensu, les objets relevant des technologies de lʼinformation et de la communication ne peuvent pas être considérés comme des produits électroménagers, que lʼon utilise lʼusage ou la commercialisation comme clé de classement. Industriellement, ces deux classes dʼobjets semblent mobiliser des savoir-faire différents, maîtrisés par des marques distinctes : SEB ne fait ainsi pas de radio et Motorola ne propose pas de robot de cuisine. Cette spécialisation des acteurs du marché est cependant de moins en moins prononcée, et on a vu ces dernières années des industriels plutôt associés aux objets multimedia (Philips, Samsung) investir le domaine de lʼélectroménager.
fig. 4.17.b : Publicité pour un aspirateur Mors, années 1930. La grille constitue lʼenvers moderne et scientifique des imaginaires de lʼélectricité, et nous permet de prendre la mesure de tout ce qui, dans une cuisine, se nourrit de cette source dʼénergie. On pensera bien sà »r à la lumière : lʼéclairage est le premier usage de lʼélectricité en cuisine, comme dans le reste du logis. Puis vient lʼélectrification dʼappareils qui remplacent lʼénergie cinétique de la main (robot, batteur à œufs, etc.), les appareils de cuisson divers (four, plaques chauffantes, et même les accessoires tels que la hotte aspirante) et de réfrigération ; enfin, de nos jours, lʼélectrification contribue aussi à alimenter les objets numériques plus ou moins dédiés à la cuisine : téléphone ou tablette sur laquelle consulter des recettes, enceinte connectée permettant de cuisiner en écoutant la radio, voire dispositif dit «  intelligent  » (frigo connecté). Stricto sensu, les objets relevant des technologies de lʼinformation et de la communication ne peuvent pas être considérés comme des produits électroménagers, que lʼon utilise lʼusage ou la commercialisation comme clé de classement. Industriellement, ces deux classes dʼobjets semblent mobiliser des savoir-faire différents, maîtrisés par des marques distinctes : SEB ne fait ainsi pas de radio et Motorola ne propose pas de robot de cuisine. Cette spécialisation des acteurs du marché est cependant de moins en moins prononcée, et on a vu ces dernières années des industriels plutôt associés aux objets multimedia (Philips, Samsung) investir le domaine de lʼélectroménager.

De plus, dans un domicile vanté comme «  connecté  », il importe de ne pas seulement analyser les objets qui sont présentés comme tels, mais toutes les formes de connexions déjà disponibles dans le foyer, spécifiquement en cuisine, et de voir ce quʼelles impliquent. Il convient même de ne pas rabattre «  connexion  » sur «  numérique  ». Lʼillustration scientifique proposée dans lʼouvrage The Quantified Home (2014) permet dʼobtenir une vision plus juste de lʼampleur de cette connexion et de ses ramifications historiques anciennes (fig. 4.18) : entre 2500 ans avant notre ère et 1700, seules quatre innovations relient potentiellement un logis à son extérieur dans lʼhémisphère nord : lʼévacuation de toilettes au Pakistan (2500 ans avant notre ère), lʼarrivée dʼeau potable chez les Minoens en Crète (1700 ans avant notre ère), lʼévacuation dʼeaux usées dans la Rome Antique (100 ans avant notre ère) et une arrivée dʼeau à Londres en Angleterre (1615). Le graphique rend ensuite lisible lʼaccélération technique qui se produit après 1700 : arrivée et évacuation dʼeau, distribution de gaz, raccordement à lʼélectricité domestique, puis au télégraphe, à la radio, à la télévision, etc. La grille correspond donc à une succession de réseaux auxquels le foyer est branché. Lʼobjet électroménager, quʼil soit «  connecté  » ou non, peut-être considéré comme une des terminaisons de cette gigantesque toile.
Dans les lignes qui suivent, je vais tout particulièrement mʼintéresser à cette dimension toujours connectée de lʼobjet électroménager. En effet, le pan rationnel, électrotechnique, illustré par son lien à la grille nʼest quʼune facette de ce raccordement. Jʼavance ici que le robot ménager est traversé par un imaginaire à la fois poétique et technique, ou même, poéticotechnique, et quʼil doit cette inscription (au moins double) à son lien concret autant que métaphorique à lʼélectricité. Aussi le robot ménager sera-t-il investi ci-après à la fois comme un ouvrage industriel de haute technicité (comme le rappelle Douglas Thwaites) et comme objet magique, voire personnage magique. Si lʼélectricité, capable de générer le chaud (pour cuire) comme le froid (pour conserver), est une sorte de bonne à tout faire en même temps quʼune fée, nous verrons quʼil existe une tension entre les objets et la ménagère à laquelle participent les figures magiques de la sorcière ou de la magicienne. La boniche est-elle la maîtresse démiurge de génies domestiques, ou est-elle elle-même la «  fée du logis  » qui anime ces engins ? Plus encore, le continuum féérique-technique matérialisé par lʼélectricité ne traverse-t-il pas aussi le corps de la housewife ? En dʼautres termes, est-il possible, dans un foyer électrifié, connecté, relié à la grille, dʼêtre fée sans devenir robote ? Je répondrai à cette question plus avant, car, pour lʼheure, il me faut investir la manière dont ce rêve moderne de la maison électro-connectée est lié à un autre imaginaire futuriste : celui de la nourriture du futur. Le futurisme qui traverse le foyer et donc la cuisine a-t-il vocation à redéfinir les pratiques alimentaires ? Quel mobilier et aménagements la pensée du «  manger demain  » sous-tend-elle ?
Parmi les tropes récurrents des récits de science-fiction ou dʼanticipation, on rencontre souvent, entre les moyens de déplacements révolutionnaires (voiture qui vole, téléportation, vaisseau spatial, etc.) et les augmentations corporelles inédites (implants et autre prothèses bioniques) un futur de la nourriture matérialisé par la pilule nutritive. Cette image condense tout un horizon dʼattente vis-à -vis des ressources alimentaires. Si la nourriture est vue comme devant en premier lieu garantir notre subsistance, ses représentations futuristes (les plus stéréotypées, jʼen conviens) en font facilement une pure source dʼénergie condensée dans un produit aux allures de médicament. Cette rationalité est parfois poussée à lʼextrême, comme dans lʼemblématique Soylent Green (1973) où la ration calorique, sans saveur, fait regretter aux personnages le temps du steak, avant quʼils ne découvrent la véritable nature de ce produit composé de cadavres humains. La suffragette étasunienne Mary E. Lease voyait dans la pilule-repas un moyen de libérer les femmes et les animaux (Belasco 2006, 27), mais il semble quʼaujourdʼhui ce type nourriture relève plutôt dʼun imaginaire repoussoir. Par ailleurs, les imaginaires dystopiques dominent la science-fiction, et cela lui est dʼailleurs souvent reproché. Dans ce contexte, la «  nourriture du futur  » ne fait pas exception. Le récit postapocalyptique pose la question fort actuelle de la survie, et de lʼaccès à la nourriture dans un monde où les chaînes dʼapprovisionnement capitalistes nʼexistent plus. Le film de zombies, forme dystopique par excellence, investit fréquemment ce thème de la quête de nourriture et le redouble en opposant la quête légitime des humains pour se nourrir, et celle, obscène, des morts-vivants qui sont soumis à leurs pulsions anthropophages. Par ailleurs, des fictions moins crépusculaires comme Wall-e (2008; fig. 4.19) fig. 4.19 : La surconsommation associée à la grosseur dans Wall-e (2008). illustrent le danger du gavage plutôt que celui de la pénurie, en montrant des humains vissés à leurs sièges spatiaux, gavés dʼimages et de nourriture grasse et sucrée -— dans des représentations grossophobes qui associent grosseur et laisser-aller (cf. infra.). Ce type de récit prolonge dʼune certaine manière la représentation anxiogène de la machine à manger (fig. 4.20)
fig. 4.19 : La surconsommation associée à la grosseur dans Wall-e (2008). illustrent le danger du gavage plutôt que celui de la pénurie, en montrant des humains vissés à leurs sièges spatiaux, gavés dʼimages et de nourriture grasse et sucrée -— dans des représentations grossophobes qui associent grosseur et laisser-aller (cf. infra.). Ce type de récit prolonge dʼune certaine manière la représentation anxiogène de la machine à manger (fig. 4.20)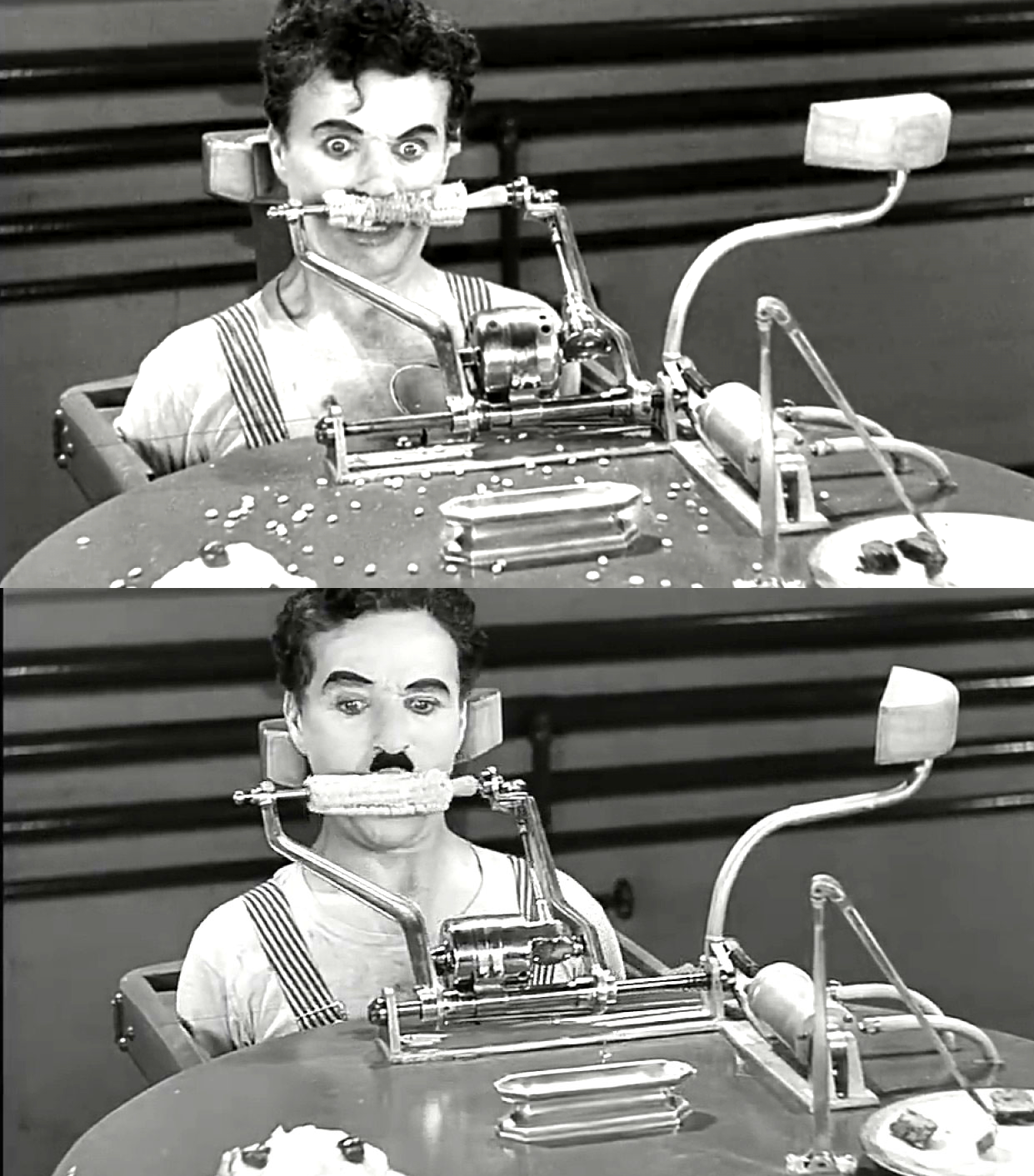 fig. 4.20 : L’échec de la machine à manger dans Modern Times (1936) de Charlie Chaplin : celle-ci n’est pas là pour économiser les efforts de la ménagère mais pour maximiser le temps travaillé de l’ouvrier. présente dans les Temps Modernes de Charlie Chaplin (1936) : la production est débordée par sa rationalisation pour contaminer la consommation. Dans cette économie, le corps humain lui-même devient une machine à manger. Cette image constitue en somme le pendant domestique du corps-rouage rendu iconique par le même film de Chaplin.
fig. 4.20 : L’échec de la machine à manger dans Modern Times (1936) de Charlie Chaplin : celle-ci n’est pas là pour économiser les efforts de la ménagère mais pour maximiser le temps travaillé de l’ouvrier. présente dans les Temps Modernes de Charlie Chaplin (1936) : la production est débordée par sa rationalisation pour contaminer la consommation. Dans cette économie, le corps humain lui-même devient une machine à manger. Cette image constitue en somme le pendant domestique du corps-rouage rendu iconique par le même film de Chaplin.
Penser les pratiques alimentaires à venir implique au moins trois axes de réflexion. Il faut en effet imaginer comment les matières premières seront cultivées/élevées et distribuées (agriculture, élevage, transformation), puis penser la préparation à domicile (le champ de la cuisine, au centre de mes préoccupations) et enfin la forme des repas et de leur prise (cultures alimentaires, commensalité). Les imaginaires du futur, quand ils ne sont pas catastrophistes, sont saturés par le solutionnisme technologique censé soutenir une forme de «  rationalité  ». Est vu comme rationnel ce qui prend moins de temps et dʼeffort et, dès lors, cette conception étroite participe dʼune «  panne des imaginaires  » (Nova 2014 ; Masure 2016, 2017) qui concerne aussi les scénarios prospectifs liés à la nourriture et au «  manger  ». Les formes futures de la nourriture sont ainsi souvent piégées dans des représentations types, comme la pilule concentrée ou la nourriture instantanée. Le fait que le récit soit chargé dʼironie ne diminue pas le pouvoir de fascination de ces représentations.

Dans Retour vers le futur II (1989), on voit une minuscule pizza, grosse comme une pièce de monnaie (fig. 4.20) être réhydratée en quelques secondes dans un avatar de micro-ondes. La nourriture du futur se présente presque toujours à lʼexcès (Belasco 2006, 154) : soit lʼexcès dans le manque lié à la pénurie, ou lʼexcès dʼabondance, souvent lié au «  mini  ». Plus petite, plus condensée, plus énergétique, plus rapide à préparer : cette nourriture du futur crée en miroir lʼidée dʼune nourriture du présent aberrante. Lʼanthropologue Kelly Alexander souligne bien lʼécart qui marque nos imaginaires futurs de lʼalimentation lorsquʼelle écrit que «  les nourritures que nous fétichisons dans le présent -— lʼartisanal, le local, les petites quantités -—ne sont jamais celles que nous semblons associer avec la perspective alléchante du ‹ futur ›  »707 (2022). Il existe en effet un écart entre certains discours écologistes qui appellent (avec de nombreux biais et angles morts) à un retour aux sources et aux savoir-faire ancestraux, et lʼesthétique futuriste de la pilule-repas. Avec lʼarrivée sur le marché et le succès des repas liquides destinés à la perte de poids et à la prise de muscle708, on peut dʼailleurs arguer que cette qualité prospective est toute relative. Que cherche-t-on à rationaliser, quand on rationalise la nourriture ? Sa production, ou sa consommation ? (Alexander 2022). Kelly Alexander pointe ainsi la manière dont les représentations fictionnelles du futur comme la série animée Les Jetsons (1962–63) imagine une nourriture futuriste identique à celle du présent dans lequel la série est diffusée. Cette famille du futur dépeinte par le dessin animé Hannah Barbera mange en effet Å“ufs et bacon comme le foyer nucléaire étasunien type dʼaprès-guerre (Alexander 2022)  — mais cʼest la préparation des repas qui est décalée par lʼanticipation space age du récit. En dʼautres termes, la nourriture du futur nʼest pas une affaire de nourrissement mais de préparation culinaire ; elle a plus à voir avec la cuisine comme lieu de fabrication des repas, quʼavec la question alimentaire à proprement parler.
Mécanisation de la nourriture et mécanisation de sa préparation sont pourtant liées et cʼest peut-être un lien que le fantasme ou la peur dʼune «  nourriture électrifiée  » matérialise en partie. Siegfried Giedion lui-même lʼobserve, faisant alors écho à la machine de Charlie Chaplin, lorsquʼil écrit que «  la mécanisation de la cuisine [kitchen] coïncide avec la mécanisation de la nutrition  »709. Il affirme en effet que «  tandis que la cuisine se mécanise plus fortement, plus la demande pour des mets transformés ou préparés augmente  »710 (Giedion 1948, 42). Une telle affirmation résonne singulièrement dans le contexte qui est le nôtre, en 2024, en Occident et plus particulièrement en France où les termes «  préparés  » et «  transformés  » sont négativement connotés, souvent intégrés à la notion moralement chargée de «  malbouffe  ». Dans de nombreux discours, lʼaccès à une nourriture de qualité nʼest pas considéré comme un droit élémentaire souvent bafoué, mais comme une responsabilité individuelle quʼil convient dʼendosser à chaque repas. On retrouve ici les catégories de haute et basse technologies évoquées précédemment, associées à des valeurs plus ou moins positives.
Une nourriture très transformée sera jugée malsaine, tandis que dʼautres produits rentreront en grâce dès lors quʼils seront perçus comme étant plus «  naturels  » -— ce terme étant dʼailleurs souvent interchangeable avec lʼadjectif «  sain  ». Les objets électroménagers sʼarticulent de manière problématique à cette séparation entre naturel et artificiel. Sʼils sont évidemment «  industriels  », cʼest-à -dire des produits de lʼindustrie, ils peuvent aussi, selon les cas, apparaître comme des équipements permettant de renouer avec des savoir-faire perdus ou traditionnels (yaourtière, machine à pain, etc.). Ce mot dʼindustriel est dʼailleurs très ambivalent quand il sʼagit des questions de cuisine : à lui seul, il est souvent mobilisé pour désigner une denrée alimentaire de mauvaise qualité nutritionnelle. Si queeriser revient à troubler les catégories normatives, une queerisation de la cuisine suppose donc de dépasser la partition entre nourriture industrielle malsaine et produit bio sain. Cela nʼinvite aucunement, par ailleurs, à nier lʼimplication de lʼindustrie alimentaire dans lʼécocide en cours, mais plutôt de regarder lʼalimentation du futur comme un ensemble de possibles qui sont dʼautant plus foisonnants quʼils sont à la fois low- et high–tech. Les catégories associées aux techniques se troublent dʼautant mieux quʼelles sont historicisées. Ainsi, la boîte de conserve peut apparaître comme un objet évident, à la manière du grille-pain que nous avons croisé plus tôt. Pourtant, en suivant Giedion, cette boîte apparaît comme un creuset rassemblant des savoir-faire poussés, à tel point quʼelle lui fait dire que «  lʼère de la mécanisation totale est identique à celle du temps de la boîte de conserve  »711. Penser la nourriture du futur et la cuisine capable de lʼaccueillir mériterait dès lors dʼadopter cette double approche dans la lecture : ce qui est high-tech à une époque peut apparaître low-tech à la suivante ; les technologies apparemment low-tech méritent dʼêtre revisitées, comprises comme les accomplissements industriels quʼelles sont. Aussi des approches plus hybrides refusant de séparer les technologies selon la ligne de partage bas/haut doivent-elles nous intéresser, en particulier en cuisine.
Les travaux du Center for Genomic Gastronomy (Centre pour la Gastronomie Génomique) sont un exemple dʼun regard volontairement impur porté sur les futurs, les technologies et les questions alimentaires. Ce think tank dirigé depuis 2010 par des artistes se donne pour objectif «  dʼexaminer les biotechnologies et la biodiversité des systèmes alimentaires humains  »712. Plutôt que de penser «  la  » nourriture du futur, il sʼagit pour elleux de «  cartographier les controverses alimentaires  », «  prototyper des futurs culinaires alternatifs  » et «  imaginer un système nourricier plus juste, beau et biologiquement diversifié  »713. Un de leurs projets est matérialisé par un glossaire critique714 rassemblant des notions stimulantes en vue de réaliser ces missions. Certains concepts décrivent justement des objectifs, et substituent dʼautres valeurs à l’efficacité et au gain de temps habituels. La «  biodiversité dans la cuisine  »715 décale les imaginaires individualistes du zéro déchet, point de contact rebattu entre cuisine et écologie, pour projeter une forme dʼabondance dʼorganismes vivants en cuisine. Un tel objectif rompt dʼailleurs avec lʼhygiénisme légué par le XIXe siècle pour imaginer, plutôt que des plans de travail aseptisés, une prolifération bactérienne en cuisine716 proche des «  parentèles  » inattendues souhaitées par Donna Haraway (2020[2016], 225–28). La dimension de collection apportée par le glossaire permet de faire proliférer les directions possibles prises par les imaginaires des cuisines du futur. Certaines notions relient ainsi les pratiques alimentaires au foyer à des pratiques rituelles plutôt quʼà des enjeux de biodiversité, comme ces «  cuisines intentionnelles  »717 qui désignent «  les rituels et pratiques et manières de faire-manger [foodways] […] qui servent dʼalternative aux cuisines normatives dans leur époque et leur localité  »718. Cette dimension de contre-scénario est en effet palpable dans le projet qui évoque le «  backronyme  »719 O.F.F.I.C.E pour Other Food Futures (Including Cuisine and Ecology), soit dʼAutres Futurs Alimentaires (Cuisine et Écologies Incluses). Lʼexpression entend servir de rappel permettant de «  prioriser le goà »t et le lieu quand il est question de prototyper des futurs alimentaires désirables, en évitant la vénération inutile de la technologie, du profit et de la pensée linéaire  »720.
Le glossaire fait plus généralement la part belle à lʼimpureté, à lʼhybridité et à lʼéchec. En cela, il sʼinscrit dans la lignée du projet philosophique de Donna Haraway qui nous invite à «  vivre avec le trouble  » (2020[2016]). Cela implique dʼintégrer lʼéchec dans le processus de conception, comme avec les «  Utopies alimentaires ratées  », des «  projets historiques pour améliorer le système alimentaire humain et qui nʼont pas rempli leur promesse initiale ou qui ont été interrompus  »721, comme la nourriture en pilule, la spiruline ou les plats à base de champignons. Il peut aussi sʼagir de penser des formulations hybrides, par exemple biotech, dans lʼesprit du natureculture cher à Donna Haraway, comme ce «  Cyber Agricole  », un «  agroécosystème spéculatif qui emploie des technologies bio-numériques émergentes afin de créer un système alimentaire régénératif  »722. La dernière entrée du glossaire constitue une synthèse de lʼidée la plus forte du projet, qui rejoint la nécessité, selon moi, dʼabattre la barrière entre des technologies de différentes natures, comme la frontière entre technologie et nature dʼailleurs. «  Nous avons toujours été des BioHackers  »723 est une incitation à regarder toute technologie comme hi-tech. Une telle perspective interdit dʼidéaliser un passé plus authentique au motif quʼil serait plus proche de la Nature. Renoncer à la dualité ancien-vertueux/nouveau-décadent (et à son pendant apparemment opposé et en fait équivalent ancien-obsolète/nouveau-bénéfique) revient aussi à créer une autre relation au temps. Plutôt que dʼimaginer un avant et un après strictement opposables et hiérarchisables, dʼune manière ou dʼune autre selon que lʼon est nostalgique ou moderniste, il sʼagit dʼinvestir le continuum dʼune «  intelligence collective  » différemment incarnée selon des époques qui ne sʼempilent pas en suivant la flèche du temps linéaire, occidental, mais se contaminent et sʼinforment mutuellement.
Aussi est-ce avec cette prudence que jʼaborde la promesse traditionnelle de libération faite aux femmes, et incarnée dans le champ économique par les appareils électroménagers. Je semble ici avoir fait un sort à lʼidée dʼune technologie qui sera intrinsèquement libératrice -— mais faut-il pour autant jeter le grille-pain avec lʼeau de vaisselle, a fortiori en tant que designers capables de repenser ces objets ? La cuisine peuplée de robots serviles aux ordres dʼune ménagère en chef a pu constituer lʼimage dʼun futur désirable à une ou plusieurs époques données, et ce sont justement ces «  futurs du passé  » que je vais investir pour déterminer si nos imaginaires des temps à venir se sont renouvelés et selon quelles modalités ils lʼont fait. Il importe aussi de saisir quelles idées, potentialités et savoir-faire ont été oubliés et comment ils peuvent éventuellement être réactivés. De même que lʼélectricité nʼa pas supplanté la flamme dans la cuisine, le numérique ou la domotique complexifient des systèmes existants quʼils ne requalifient quʼen partie.
Dans les imaginaires collectifs, il est fréquent de voir associés prolifération des appareils ménagers et espace domestique dʼaprès-guerre. La multiplication de ces engins est en effet liée à lʼessor industriel qui marque les années 1950. En 1956, la chanson «  La complainte du progrès  » de Boris Vian illustre parfaitement cette ivresse de la consommation et la multiplication des gadgets qui affecte le foyer. Cependant, pour comprendre comment ces outils divers et plus ou moins indispensables ont intégré la «  boîte  » domestique (Hayden 1982, 23) et affecté les ménagères, il est nécessaire dʼobserver une histoire plus ancienne, qui commence avant le XXe et même avant le XIXe siècle. Les objets mécaniques qui émergent au XVIIIe siècle ne possèdent bien sà »r ni la fonctionnalité ni la diffusion des dispositifs industriels qui leur succéderont. Toutefois, ces protogénies domestiques manifestent peut-être plus clairement que leurs successeurs les intentions qui ont présidé à leur invention. Siegfried Giedion évoque ainsi un «  Washerwomanʼs assistant  » (aussi appelé «  Housewife economist  »), sorte de première machine à laver (1948, 560–61; fig. 4.22) dont le nom manifeste lʼintention de son inventeur, visiblement soucieux de proposer en lieu et place dʼune servant·e humaine un avatar mécanique, tout en considérant bien ce labeur comme un travail de femme. Cependant, il semblerait que ces premières machines aient plutôt été utiles dans des contextes collectifs, ou que leur fonctionnalité effective ait été très limitée (Giedion 1948, 560). Il peut du reste être ambigu de parler de «  machines à laver  », et cela explique sans doute le choix de Siegfried Giedion qui catégorise plus volontiers son étude à partir de typologies fonctionnelles, pour parler de la mécanisation de la lessive, du repassage, etc.
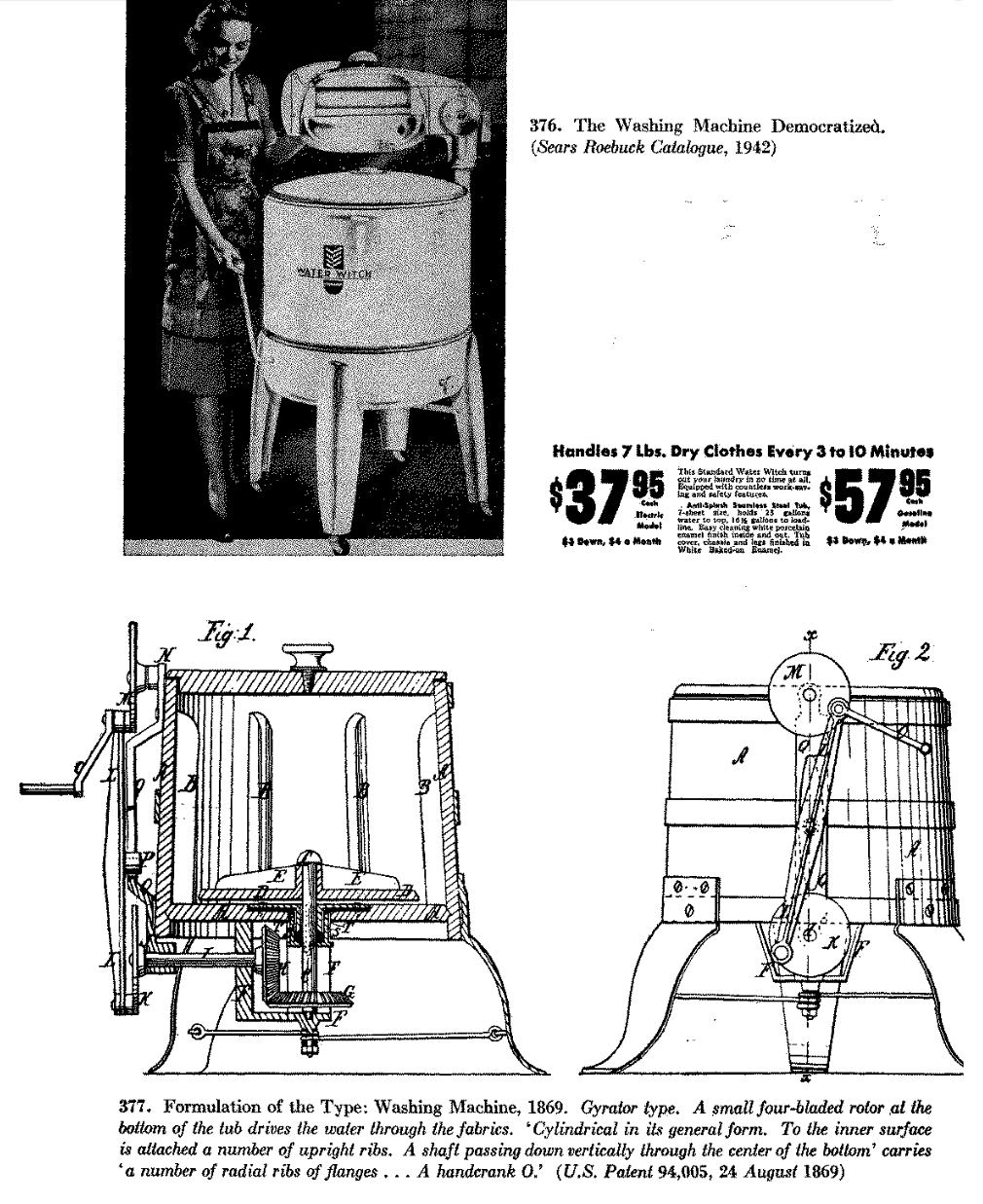
Cette approche produit des coupes intéressantes et montre la manière dont les machines que nous connaissons et qui nous semblent évidentes sont en fait traversées dʼune riche histoire de protoformes marquées dʼerrances techniques, de choix industriels et peut-être de hasards de conception. Les machines sont donc variées et proposent, dans leurs formes primitives, des réponses différentes à des questions qui peuvent paraître simples : comment laver le linge724 ? Comment le repasser ? Comment cuire des aliments ?
Ainsi, les premiers tambours rotatifs destinés au lavage nettoient des pommes de terre ou appareillent le blanchissage des textiles dans lʼindustrie plutôt que dʼoutiller la lessive domestique (Giedion 1948, 564). Il est probable que les réponses techniques sont variées car le geste lui-même qui consiste à laver le linge (pour ne prendre que ce seul et emblématique exemple) est très complexe. Il existe en effet une «  diversité extrême des techniques du lavage du linge  » (Denèfle 1995, 5). Lorsque lʼethnologue Sylvette Denèfle sʼintéresse à la technique préindustrielle la plus commune de lavage du linge, ce sont de multiples étapes qui sont évoquées : savonner, faire tremper, drainer et utiliser la cendre, faire la «  buée  » (verser plusieurs fois de lʼeau bouillante sur le linge), faire bouillir le linge, laver et rincer (1995, 17). Mécaniser une tâche aussi complexe (et éprouvante physiquement, comme le rappelle Sylvette Denèfle) implique des choix techniques au niveau de la conversion du geste. Faut-il agiter le linge, ou reproduire le geste de battement ? (Denèfle 1995, 22) Dans un second temps, la mécanisation et le développement de standards industriels normalisent la tâche, en font «  une tâche nouvelle et complètement uniformisée  » (Denèfle 1995, 25). Si on suit lʼexemple de la lessive, il apparaît que la mécanisation fait plus que de reproduire ou même convertir un geste manuel, humain en un geste mécanique puis électromécanique : avec lʼobjet électroménager, la tâche est requalifiée. La liste des étapes distinctes de lavage qui caractérisent la tâche de la lessive avant sa mécanisation est éloquente : plus quʼune conversion, cʼest bien à un effacement que conduit la migration du geste vers la machine.
Les premiers aspirateurs apparaissent en 1859, les lave-vaisselle en 1865 et le «  prototype moderne de la machine à laver  » en 1869 (Giedion 1948, 553) : toutes ces inventions prédatent de quelques années celle du moteur électrique et sa démocratisation. Il ne sʼagit pas ici de mener une enquête visant à fixer une origine ou la préséance dʼun phénomène sur lʼautre. La révolution industrielle se compose dʼinventions multiples, et il peut parfois être difficile dʼaffirmer que le désir de rationalisation explique lʼinnovation, ou lʼinverse. Je souhaite toutefois observer que lʼenvie de déléguer ces tâches semble être une constante historique : la tâche est ainsi reportée sur les corps des travailleur·ses domestiques ou sur des machines quʼon imagine très tôt autonomes. Cependant, le processus de conversion technique du geste, marqueur de la première salve dʼinnovation électroménagère, nʼest quʼun aspect de lʼhistoire du robot domestique. Sans vouloir trop séparer la fonction de la forme (une analyse rigoureuse en design me lʼinterdit), il faut bien observer que lʼinvention de processus mécaniques est aussi significative que lʼenfermement de ces rouages dans une surface lisse. Ce choix de conception est caractéristique des années 1930 et correspond aux apports du mouvement streamline. Si on relie très souvent ce courant à un goà »t moderniste pour des courbes aérodynamiques qui suggèrent vitesse et progrès, il ne faut pas oublier que ce moment dans lʼhistoire du design correspond aussi à la diffusion dʼun modèle de lʼobjet domestique qui offre une surface lisse, agréable, et garde ses encombrants mécanismes à lʼabri de la vue des usager·es. Ce deuxième temps de la mécanisation, qui cache paradoxalement ce que lʼobjet possède de mécanique est profondément genré : si on masque les rouages des robots, cʼest peut-être parce que les commerciaux et industriels opèrent sur la base de la croyance qui veut que les femmes soient plus facilement convaincues par une belle forme que par un mécanisme ingénieux (Giedion 1948, 608). Ces objets, avant de libérer les femmes (si tant est quʼils le fassent), sont dʼabord les héritiers dʼun stéréotype prépondérant dans lʼhistoire du design, déjà évoqué plusieurs fois dans ces pages, qui veut que les hommes soient proches de la structure, du fonctionnement, de lʼessence des choses tandis que les femmes seraient «  naturellement  » inclinées à apprécier décor, futilités et surfaces.
Un deuxième fait historique contrarie lʼargumentaire (certes peu convaincant) de la «  libération  » des femmes par la mécanisation. À lʼorigine, lʼobjectif consistant à soulager les femmes de leur travail domestique est sans doute second par rapport à la nécessité de régler le «  problème domestique  » («  servant problem  ») qui émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle (Sparke 1987, 9). Ici, le robot ménager nʼest pas différent de son pendant à lʼusine, dans la mesure où il remplace dʼabord un corps subalterne avant dʼoutiller la maîtresse de maison. La housewife est le produit de la séparation entre maison et usine (Davis 2019[1981], 206) : sa présence au foyer permet au mari de négocier sa force de travail sur une place de marché, mais elle est aussi, sur le plan de lʼimage, le signe de sa réussite professionnelle (Singly 2007, 73). Dans ce contexte, lʼappareil électroménager prétend remplacer les employé·es domestiques et sert aussi, en préservant lʼépouse du ménage bourgeois, à bénéficier au mari : sa fonction seconde consiste en quelque sorte à assurer la paix des ménages. Les hommes théoriciens qui mentionnent le travail domestique sont souvent prompts à retenir le motif de la libération ou comme Siegfried Giedion, ne questionnent pas cette idée outre mesure, y compris dans des publications récentes qui se piquent dʼinventer des futurs utopiques (Bregman 2017[2016], 188).
Toutefois, dans dʼautres textes, y compris écrits par des hommes, une idée un peu différente apparaît : le robot domestique ne supplée pas seulement la main des femmes ; plus encore, il garantit la bonne humeur de son usagère, et donc, in extenso, le bien-être de son mari. Marshall McLuhan nomme ainsi clairement lʼappareil électroménager comme le moyen pour les femmes de ne pas détester leur mari (2011[1951], 44). Betty Friedan lʼobservait : les femmes, en étant cantonnées à lʼespace domestique, ne sont pas tant les contremaîtres dʼune batterie de robots que des consommatrices en chef (1979[1963], 202). On oublie donc souvent de dire que les hommes sont tout autant ciblés par des campagnes de publicité qui ne vantent plus le gain de temps en cuisine, mais le supplément de bonheur quʼune épouse apaisée peut apporter. Certaines réclames semblent même tenir un propos féministe, en proposant aux hommes, dans une curieuse inversion, dʼimaginer le calvaire de la femme au foyer. Siegfried Giedion évoque ainsi la réclame de la Westinghouse Company et son slogan «  Mettez un four dans votre bureau  »725 (comprenons : si vous lʼosez, messieurs !) (1948, 572 ; fig. 4.23). Cʼest effectivement un effet positif de ce motif pourtant encombrant de la «  libération  »â€¯: il a le mérite, a minima, de reconnaître une forme de pénibilité à ce travail, voire de considérer ce dernier comme un travail. Néanmoins, cette forme dʼempathie, destinée de toute manière à convaincre les clients potentiels, nʼa rien de révolutionnaire : il nʼest à aucun moment question de partager le travail, et cette prise en compte du labeur féminin nʼest pas désintéressée (puisque la publicité indique que lʼépouse sera probablement «  reconnaissante  »726). Quant à la simulation qui permet à lʼemployé dʼimaginer le calvaire de sa femme qui repasse, elle se compose dʼun foyer alimenté par un servant noir -— un rappel du pouvoir masculin blanc peut-être rendu nécessaire par cette inhabituelle projection dans la vie des moins privilégiées que lui.
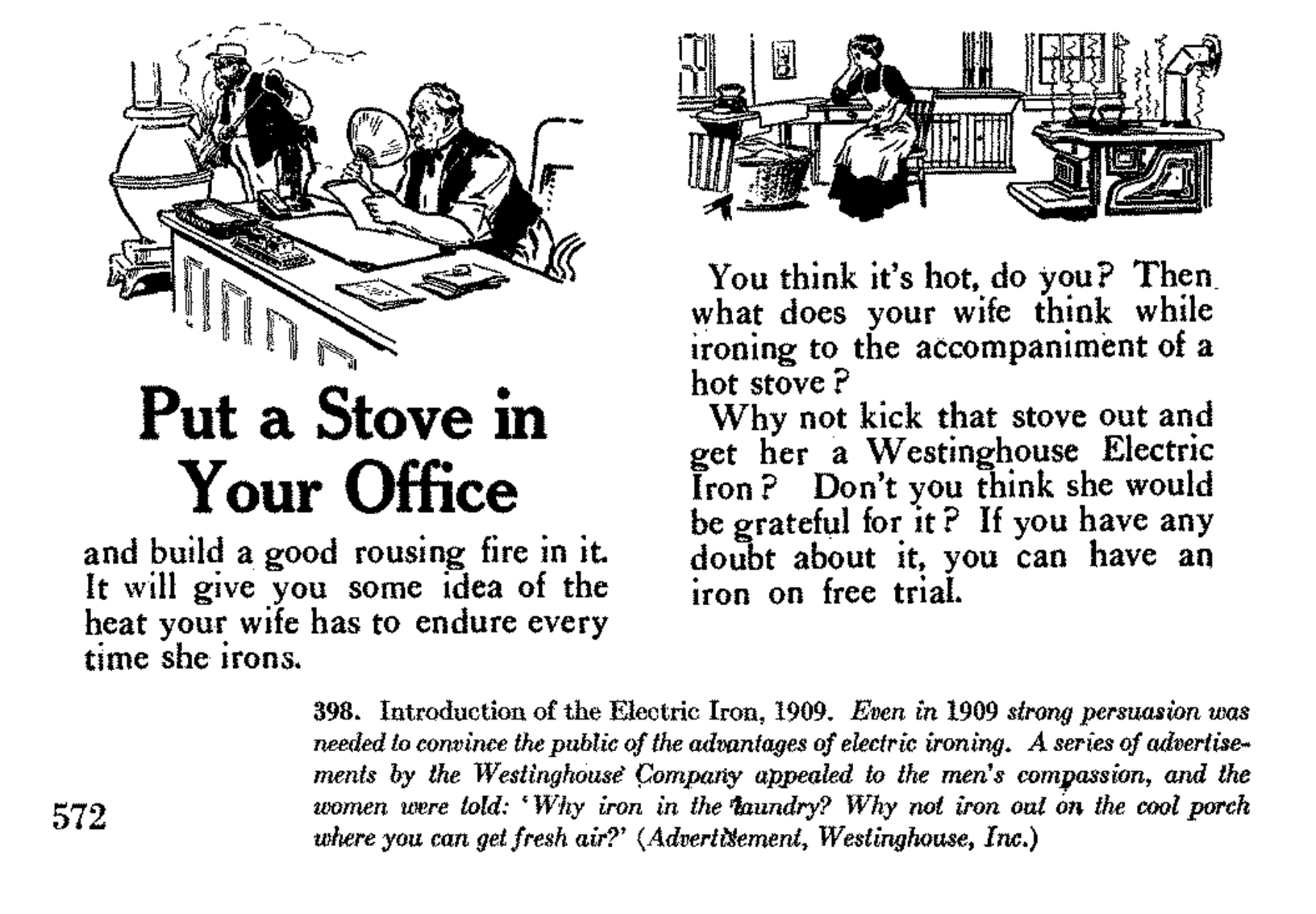
Le travail domestique peut donc être reconnu comme pénible et ce constat nʼouvre pas sur une redistribution, mais sur une dilution du problème dans lʼacte de consommation, comme le regrette dʼailleurs Dolores Hayden à la fin de son analyse sur la révolution domestique manquée (1982, 301). Si lʼon oublie un instant les problématiques de surproduction et les enjeux éthiques de la participation active au capitalisme, la question suivante, finalement assez simple, sʼimpose : si Moulinex libère la femme, de quoi, au fond la libère-t-il ? La réponse à cette question est-elle la même pour tous les objets électroménagers, ou est-il nécessaire de la soumettre aux catégories de tâches rendues dispensables par tel ou tel objet ? Revenons par exemple à la machine à laver, et au problème de la lessive quʼelle est censée résoudre. Sylvette Denèfle offre une réponse catégorique à cette question lorsquʼelle écrit :
Si le lave-linge modifie le travail de la lessive, ce qui est incontestable dans la mise en œuvre et dans lʼeffort physique nécessaire à cette tâche, il ne réduit pas le temps de travail (1995, 100).
Plus loin, elle écrit même pour balayer tout malentendu que «  la machine à laver automatique ne libère pas les femmes  » (117). Certes, la machine à laver diminue de beaucoup la pénibilité de cette tâche. Le trempage, le battage, lʼétape de la cendre ont disparu : tous ces gestes, très physiques, sont pris en charge par le mouvement rotatif plus ou moins rapide du tambour. Toutefois, si faire la lessive prend moins de temps, il apparaît que certaines étapes du processus sont absolument incompressibles : penser à laver le linge, le centraliser auprès des membres du foyer, le trier (séparer les couleurs du blanc, le linge délicat), charger la machine et choisir le programme adapté en fonction de son emploi du temps, vider la machine et étendre le linge, le faire sécher (sur un étendoir ou dans une autre machine), vérifier quʼil est sec pour le plier (éventuellement le repasser) et le ranger. On le voit, la chaîne dʼactions est encore longue et mobilise peut-être moins de savoir-faire, mais elle ne les rend pas dispensables pour autant. Un robot supplée donc la ménagère, mais la tâche condensée ne disparaît pas. Plutôt, elle est requalifiée et mobilise dʼautres compétences : il est différent dʼaller au lavoir et de battre le linge des heures durant, et de penser à programmer sa machine afin que le linge mouillé ne sʼéternise pas dans le tambour.
Reste à sʼentendre sur ce changement de nature du travail domestique : pour Angela Davis, «  malgré la prolifération de gadgets pour la maison, le travail domestique nʼa pas été affecté qualitativement par les avancées technologiques du capitalisme industriel  »727 (2019[1981], 206). Jʼaurais tendance à être en désaccord avec cette affirmation en investissant le «  qualitativement  » de la phrase du point de vue du design. Si, par la «  qualité  » de la tâche, on pense à la nature des gestes, au déroulé des actions et à la nature des compétences (intellectuelles, cognitives, de planification, de classification, etc.), il me semble important de faire une distinction. Mais si, comme A. Davis, on adopte un regard macro-centré sur la question du temps, il est clair que les appareils ménagers produisent un gain tout relatif et que, qualitativement, «  le travail domestique occupe encore des milliers dʼheures de lʼannée de la femme au foyer moyenne  »728. En effet, la machine à laver fait économiser des efforts physiques, et sans doute du temps, tout comme le hachoir électrique est moins fatiguant que son ancêtre manuel et comme un batteur à œufs motorisé permet de monter plus rapidement une chantilly quʼun dispositif à manivelle, mais le grille-pain est-il véritablement plus rapide que le four, ou quʼun dispositif chauffé sur le feu ? La cafetière électrique fait-elle gagner du temps, par rapport à un percolateur chauffé sur le gaz ? Et à partir de combien de minutes le gain peut-il être considéré comme valant la dépense énergétique occasionnée par la production dʼun nouvel objet ?
En lisant les historien·nes qui ont retracé les développements des objets électroménagers, on trouve dʼautres nécessités à leur présence dans nos logis. La plus évidente est bien sà »r celle imposée par le capitalisme marchand : vendre en masse des appareils à lʼutilité diverse a fait la fortune des entrepreneurs concernés, mais a également été souhaité par les producteurs dʼélectricité. En augmentant lʼusage de cette source dʼénergie, son coà »t pouvait baisser et son usage se démocratiser (Sparke 1987, 25). Il semble plutôt évident, habituellement, quʼil y ait eu des appareils domestiques parce quʼil y a eu de lʼélectricité -— mais lʼinverse est sans doute tout aussi vrai. Plus que faire économiser (des gestes), on a donc souhaité faire dépenser davantage (de lʼélectricité, et tout simplement, de lʼargent). Et le «  gain  » de lʼappareil ne se situe pas toujours dans la poignée de minutes économisée par la ménagère. Penny Sparke, lorsquʼelle raconte la manière dont les cuisines se sont ouvertes après-guerre aux États-Unis, mentionne les scénarios dʼusage esquissés par les auteurs Henry Wright et George Nelson dans leur ouvrage Tomorrowʼs House (1945). Lʼouverture ne relie pas seulement des espaces et les corps qui sʼy trouvent : elle donne accès aux robots traditionnellement relégués à la cuisine. Ainsi, le grille-pain se retrouve «  à proximité de la table, ce qui permet au maître de maison dʼavoir quelque chose à faire en attendant son Å“uf  »729 (Sparke 1987, 21). La tâche domestique nʼest pas tant compressée que requalifiée : facilitée, elle devient le moyen dʼoccuper le mari. Selon que lʼon vend des appareils ou que lʼon imagine la maison rêvée, le temps est élastique : tantôt il est nécessaire de le compresser, tantôt il est perçu comme excédentaire, devant être immédiatement comblé sous peine dʼennui730.
Revenons à la machine à laver : jʼévoquais la question du temps gagné, et jʼai montré que lʼéconomie de temps nʼest pas une constante du report de la tâche sur un robot. Le temps change de qualité plutôt quʼil nʼest véritablement économisé. En suivant S. Denèfle, ce temps «  libéré  » est une maigre compensation, car le problème fondamental nʼest pas résolu. En effet, la machine à laver «  ne libère pas de la responsabilité sociale du propre  » (1995, 118). On retrouve ici la mécanique imparfaite propre à lʼexternalisation : la housewife peut recourir à du personnel de ménage, mais cʼest encore elle qui doit gérer lʼemployé·e (son emploi du temps, son accueil, son salaire). La tâche reportée sur le robot suit la même dynamique : cʼest un travail délégué qui reste le sien. Il est entendu quʼelle a la responsabilité du robot et du travail soi-disant minime quʼil occasionne ; si le robot dysfonctionne, si les conditions changent (panne du matériel, vacances…) la tâche initialement reportée peut facilement revenir à lʼépouse. Aussi les tâches nʼévoluent-elles pas de manière linéaire : en particulier, le temps qui leur est consacré nʼest pas voué à rétrécir. Par exemple, la crise climatique et les discours écologistes qui lui sont liés ont suscité une prise de conscience au niveau des polluants produits par la grande consommation. Là où «  faire sa lessive  » dans les années 1980 ou 1990 consistait à associer une machine à laver et un produit nettoyant, le choix de ce dernier est aujourdʼhui une question écologique qui sʼajoute à tout le travail cognitif (relevant de la charge mentale) déjà nécessité par la lessive.
La tâche semble se simplifier, quelques économies de temps sont réalisées, mais, ce faisant, le travail mute et se requalifie. Lʼénergie dépensée à battre ses Å“ufs à la force du poignet est économisée, mais au prix dʼune dépense en électricité, dʼun peu de vaisselle et de rangement supplémentaire. Le gain, lorsquʼil est effectif, peut aussi être couplé à une perte réelle provoquée par les objets électroménagers. Il est ainsi fréquent de lire, sous la plume de différent·es auteurices, que la tâche déléguée entraîne une perte dʼexpertise chez la ménagère. Le batteur à œufs en est justement un exemple limpide : on économise de la force, mais on perd aussi le «  tour de main  » qui peut sʼavérer utile dans dʼautres situations. Sans idéaliser un «  avant  » où les femmes auraient maîtrisé davantage de ces savoirs, on peut remarquer que le travail domestique a largement évolué de la période préindustrielle à la nôtre. Acheter les produits nécessaires à la survie du foyer est bien un travail, mais cette tâche a remplacé des pratiques de production dont lʼobjectif était non seulement la consommation au sein du foyer mais aussi la vente sur une place de marché (Schwartz Cohan 1989, 99–100). Qualitativement, lʼexpérience de battre un Å“uf et dʼacheter un gâteau tout prêt ne sont simplement pas les mêmes -— même sʼil faut se garder de juger trop vite quelle expérience est la plus agréable, à supposer que lʼon puisse émettre ce type de jugement généraliste.
Faire des bougies, carder la laine ou battre le beurre en baratte sont autant de savoir-faire qui semblent perdus, et dont la pratique éventuelle au XXIe siècle a radicalement changé de sens : on se piquera de les réactiver dans un esprit de loisir, par curiosité, nostalgie, ou parfois dans une quête dʼauthenticité, mais, dans tous les cas, ces tâches ne seront absolument pas nécessaires à la survie du foyer. Dans certains cas, cette perte de gestes tenus en haute estime (peut-être parce que les commentateurices qui les louent nʼont pas à les réaliser) est associée à une masculinisation des espaces. Dès les années 1970, Luce Giard écrit quʼavec les appareils électroménagers, les relations domestiques changent :
[…] la mécanique masculine, son organisation technique, ses machines et sa logique sont entrées dans la cuisine des femmes, sans vraiment leur permettre dʼadapter ces engins à leurs séculaires techniques du corps, en leur imposant dʼautorité une nouvelle manière de manipuler les ingrédients, de rapport aux choses, et aussi dʼautres modes de raisonnement (1979, 153).
La reconnaissance dʼun savoir féminin est effectuée au prix dʼune naturalisation des gestes. On peut sʼentendre sur le fait quʼil existe des gestes «  de femmes  » en cuisine. Pour ma part, je désigne ces pratiques comme féminines parce quʼelles ont été historiquement réalisées par des femmes. Mais désigner la pratique culinaire ou ménagère comme féminine pour lʼopposer au domaine masculin des machines me semble relever dʼun motif sexiste différentialiste dommageable. Il est sexiste au premier sens du terme, puisquʼil suppose des natures radicalement différentes et opposées en fonction de la sexuation des individus. Il est aussi sexiste à un autre niveau, puisquʼil sʼappuie sur un présupposé selon lequel les logiques des technologies sont étrangères aux femmes -— dès lors cantonnées à la Nature, à la Terre, avec toutes les conséquences nuisibles que lʼon peut imaginer sur lʼagentivité politique des sujets femmes. Le genrage des objets qui composent nos environnements comporte en plusieurs niveaux, à commencer par celui, premier, qui distingue des objets «  pour hommes  » et «  pour femmes  ». Cʼest souvent cette distinction de destination qui vient à lʼesprit quand on évoque la discipline du design en relation avec les questions de genre. Jʼobserve par exemple que les étudiant·es parlent volontiers du codage rose/bleu particulièrement lisible dans les jouets pour enfants, et qui se prolonge souvent dans les choix chromatiques des objets pour adultes. Les objets sont en réalité genrés bien au-delà de leur apparence première, ou dʼun code couleur qui pourrait aisément être changé ou détourné. Cʼest ce que permet de saisir lʼétude dʼEllen van Oost (2004) au sujet des rasoirs électriques. La théoricienne mobilise le concept de «  script dʼobjet  » (Akrich 2006[1992]) pour faire lʼhypothèse que les artefacts seraient porteurs de «  scripts de genre  ». Pour la sociologue des techniques Madeleine Akrich, le «  script  » constitue une «  (pré)vision du monde  » «  inscrit[e]  » dans les choix de conception de lʼobjet (2006[1992], §9). Le script de genre, quant à lui, fonctionne aussi bien au niveau sémiotique (les signes présentés par lʼobjet) quʼau niveau de sa fonctionnalité propre (van Oost 2004, 195). Ellen van Oost explique que le rasoir électrique, mis sur le marché dans les années 1920, est dʼabord destiné aux hommes mais que les femmes sont pensées comme des usagères possibles (2004, 200). À mesure que la mode permet ou impose que de plus grandes parties du corps féminin puissent être dénudées, le rasoir devient un accessoire indispensable, et doit être adapté pour certains usages spécifiques aux femmes (le rasage des aisselles) (van Oost 2004, 200). La création de rasoirs pour femmes va être symptomatique de ce genrage double des objets. Chez Philips, dans les années 1980, le développement du Ladyshave (fig. 4.25) repose sur lʼintégration dʼune supposée incompétence féminine : là où le modèle masculin Philishave est démontable, et présente dʼailleurs de manière claire les parties qui le composent, le rasoir pour femmes présente une coque muette qui brouille la structure de lʼobjet (van Oost 2004, 206). Cette dimension technique du produit -— réelle, car le rasoir électrique a connu de multiples innovations pour devenir ce quʼil est aujourdʼhui -—est masquée une seconde fois, au niveau «  symbolique  » (van Oost 2004, 206).

Ce cas nʼest pas isolé, et peut même être compris comme un exemple clé au sujet des objets électroménagers. La chercheuse Julie Wosk écrit ainsi :
Lʼ‹ esthétique épurée › en design de produit a dissimulé les mécanismes qui, à une époque antérieure, fournissaient aux femmes des connaissances techniques et une indication sur le fonctionnement réel des appareils. Comme lʼa suggéré Thomas Hine, alors quʼauparavant, les femmes pouvaient être considérées comme des ingénieures ménagères, dans les années 1950 et 1960, avec les boutons-poussoirs électriques, on leur a assuré que la seule véritable connaissance dont elles avaient besoin était de savoir comment allumer les machines (ainsi que leurs maris)731. (2003, 230)
On retrouve ici un tournant de lʼhistoire du design convoqué ici plusieurs fois : la phase décisive du streamline, souvent associée a posteriori à la célèbre phrase de Raymond Loewy selon laquelle «  la laideur se vend mal  » (1953). Cependant, un passage par les études de genre appliquées au design (les travaux dʼEllen van Oost, notamment) interdit de ramener le sens de cette esthétique au seul vÅ“u moderniste, ou encore aux nécessités du marché et des politiques commerciales. Le style streamline doit aussi être compris au prisme de ses effets politiques, dont celui, lui-même dissimulé, qui participe à consolider lʼidée dʼune incapacité féminine face aux objets. On voit du reste que la forme de lʼobjet est un script autant quʼun commentaire : lʼobjet ne dit rien de son intérieur, comme, après lui, les «  boîtes noires  » vendues par la Silicon Valley (Masure 2019) mais, comme il ne saurait être ouvert, démonté ou réparé, il produit par une curieuse prophétie autoréalisatrice lʼincompétence des femmes que sa conception présupposait.
En nommant la déspécialisation suscitée par lʼélectroménager, il importe toutefois de ne pas reproduire le motif dʼune machine intruse qui polluerait de ses rouages masculins la pureté de lʼespace féminin de la «  cuisine  ». Il convient, pour comprendre la plasticité de la tâche, en particulier lorsquʼelle est mécanisée, de la connecter à son résultat. Si les génies de la vie domestique ne font pas gagner autant de temps que les publicités le racontent, cʼest peut-être parce que la tâche mécanisée offre un résultat différent, et avec lui, un ensemble dʼattentes supérieures qui contribuent à façonner des exigences plus fortes au sujet du travail domestique. Ruth Schwartz Cohan montre ainsi la mécanique piégeuse de la mécanisation, au sujet du batteur à œufs que nous évoquions précédemment :
Le batteur à œufs, inventé et commercialisé au milieu du siècle, aurait pu alléger quelque peu le poids de ce travail ; mais malheureusement, la popularité du batteur sʼest accompagnée de celle du angel food cake732 dans lesquels les œufs sont le seul levain, et où les jaunes et les blancs sont battus séparément, ce qui double le travail733. (1989, 53)
Cʼest un point fréquemment mobilisé par les féministes au sujet de la libération par lʼélectroménager : lʼappareil ne fait pas seulement plus vite, il fait aussi mieux734. On a donc tôt fait de sʼhabituer à un sol aspiré plutôt que balayé, ou encore à la finesse dʼune soupe mixée électro-mécaniquement plutôt que passée à la main. Tandis que lʼon perd le temps aussitôt récupéré, dʼautres facettes du travail ainsi requalifié peuvent disparaître. La machine à laver est ici lʼexemple canonique : ce qui est gagné en huile de coude est perdu en termes de contact humain. En effet, les femmes économisent leurs forces en quittant les lavoirs, mais elles perdent aussi un espace de socialité féminine, une non-mixité de fait qui offre des possibilités de soutien moral, de solidarité, en bref, de sororité735 (Pruvost 2021, 152). Lʼidée que cette socialité domestique est remplacée par les contacts humains au travail peut être également remise en question. Il nʼest dʼailleurs pas sà »r que les appareils domestiques servent directement à libérer des femmes qui peuvent ensuite proposer ce temps disponible sur le marché du travail salarié, même si cette idée est assez répandue dans les années 1980, aux États-Unis notamment (Schwartz Cowan 1989, 208). Jʼen arrive de la sorte à la dernière question me permettant de douter dʼune libération féminine par lʼélectroménager : qui, au juste, est libéré par ce transfert ? Les consommatrices dʼélectroménager et les femmes nouvellement embauchées au XXe siècle (surtout dans sa seconde moitié) sont-elles bien les mêmes ? À qui profite la machine à laver ?
Pour lʼhistorienne Ruth Schwartz Cowan, lʼévidence empirique contredit ce motif qui relie externalisation sur les robots et pénétration du marché du travail salarié par les femmes. Selon elle, les femmes au foyer ont intégré le salariat bien avant que les appareils ne se démocratisent (1989, 208). Non seulement il nʼy a pas de corrélation, après-guerre, entre lʼemploi dʼune femme et un salaire marital permettant lʼachat dʼobjets électriques, mais elle est négative : une femme a dʼautant plus de chances de devoir chercher un emploi que le revenu de son mari est limité, et donc insuffisant pour consommer ces produits. Plutôt que dʼimaginer une femme rendue soudainement disponible par le travail autonome de la machine à laver, les recherches de Ruth Schwartz Cowan mettent en évidence la manière dont les femmes vont gagner ce complément de revenu pour sʼéquiper. Dolores Hayden souscrit à cette analyse quʼelle relie à son étude de la période antérieure (le XIXe siècle) : pour elle, les femmes des classes inférieures ont un accès inégal à ces objets longtemps après leur démocratisation (1982, 12). Toute approche par le design de cette question doit ainsi prendre la mesure de la manière dont la position sociale du foyer est clé lorsquʼil sʼagit dʼexternalisation du travail, et pas uniquement quand il sʼagit dʼembaucher de la main dʼœuvre. Le motif de la «  société de consommation  », souvent relié aux années 1950, peut faire oublier que toutes et tous nʼavaient pas accès à ces biens, ou alors pas au même degré, pas aux mêmes gammes de produits, et pas dans la même temporalité. Le logis, abordé en termes de classe, est le lieu de fortes asymétries, comme le rappelle Ruth Schwartz Cowan :
En 1940, alors que la Grande Dépression touchait à sa fin et que lʼéconomie se tournait vers la production de guerre, un·e Américain·e sur trois transportait encore de lʼeau dans des seaux et deux Américain·es sur trois ne bénéficiaient pas du confort du chauffage central736 (Schwartz Cowan 1989, 195).
Son observation fait écho au diagnostic antérieur de Jules-Louis Breton, créateur du concours dʼappareils ménagers qui donnera naissance au Salon des arts ménagers en France. En 1923, il défend lʼurgence à moderniser le logis dans les campagnes. Si son discours est traversé par une position technophile que nous retrouverons ci-après, son regard permet de prendre la mesure des écarts qui traversent les sociétés occidentales dʼalors. On peut douter du fait que lʼélectroménager soit le remède ; il nʼen reste pas moins que sa description est évocatrice :
Lʼeau est loin, il faut la puiser dans un puits à coup de seaux ou manÅ“uvrer les leviers dʼune pompe, transporter des cruches à bout de bras en sʼessoufflant et sʼarrosant les pieds. Le bois est ailleurs. Les mains sʼabîment dans le transport, vous avez un mal inouï à allumer le feu et à lʼentretenir, vous vous grillez le visage lorsque vous voulez griller tout autre chose […] comme la moitié de la population française vit à la campagne, cʼest la moitié des femmes de notre pays qui use en vain ses forces et gaspille son temps en des travaux de servantes du Moyen Âge (sic) (Bouillon 2022 136–137).
Pour Breton, cette condition est avant tout rurale, mais, en suivant les travaux des historiennes étasuniennes, on peut aussi la relier à des formes de précarité. Il est aisé de retenir des années 1930 les premières publicités pour lʼélectroménager, ou encore lʼimage dʼune Christine Frederick souriante, sans parler de la housewife en tablier qui sature les publicités étasuniennes des années 1950 et dʼoublier ainsi que, pour beaucoup, le raccordement à lʼeau courante, la présence dʼune baignoire dans le domicile ou encore la possession dʼappareils culinaires étaient une aspiration plus quʼune réalité. Enfin, ce nʼest pas parce que lʼélectroménager arrive dans le foyer quʼil libère nécessairement la housewife. Cʼest peut-être lʼobservation la plus cruelle de toutes, que lʼon croise chez Ruth Schwartz Cohan : les tâches qui disparaissent par le jeu de lʼélectro-mécanisation sont souvent celles des hommes, ou celles pour lesquelles hommes et enfants étaient jusque-là mis à contribution (1989, 200–01). Ainsi le vide-ordures rend plus facile une tâche plutôt codée comme masculine ; quant au lave-vaisselle, il peut pousser les membres de la famille qui aidaient au débarrassage à considérer que leur aide nʼest plus nécessaire.
Les objets en cuisine sont divers, et participent de trois paradigmes techniques qui ne sont pas mutuellement exclusifs. En effet, je peux, pour faire ma purée, utiliser un presse-purée, un moulin à légumes ou encore un mixeur électrique (fig. 4.24). Le premier est simplement manuel ; le second est mécanique, cʼest-à -dire quʼil convertit un geste manuel pour en maximiser lʼefficacité. Enfin, le mixeur emploie le même principe rotatif que le moulin à légumes, mais il en augmente encore la puissance en alimentant un bloc moteur en électricité, dès lors en charge du mouvement rotatif.

Une quatrième typologie pourrait même être ajoutée aujourdʼhui, celle de la convergence des fonctions dans le tout-en-un. Le Cookeo de Moulinex, le Cook Expert de Magimix ou bien sà »r le Thermomix de Vorwerk (fig 4.26), fig. 4.26 : Robot Thermomix TM-6 de Vorwerk, site de la marque, 2024. premier du genre, combinent un mixeur, un cuit-vapeur, une balance de cuisine et un batteur à œufs (entre autres). Si ce type dʼobjets existe depuis les années 1960, ils se sont démocratisés dans les années 2000 et marquent peut-être un changement de paradigme : les années 1950–60 proposaient plus volontiers une diversification des appareils, au point dʼencombrer la cuisine et de contredire les discours dʼefficacité activés par ces produits (Sparke 1987, 23). Jʼinvestirai plus loin cette tension entre lʼobjet malin, capable en se multipliant de saturer lʼespace (un petit peuple de la cuisine), et les objets rassemblés jusquʼà former non plus un objet, mais presque un élément de mobilier.
fig. 4.26 : Robot Thermomix TM-6 de Vorwerk, site de la marque, 2024. premier du genre, combinent un mixeur, un cuit-vapeur, une balance de cuisine et un batteur à œufs (entre autres). Si ce type dʼobjets existe depuis les années 1960, ils se sont démocratisés dans les années 2000 et marquent peut-être un changement de paradigme : les années 1950–60 proposaient plus volontiers une diversification des appareils, au point dʼencombrer la cuisine et de contredire les discours dʼefficacité activés par ces produits (Sparke 1987, 23). Jʼinvestirai plus loin cette tension entre lʼobjet malin, capable en se multipliant de saturer lʼespace (un petit peuple de la cuisine), et les objets rassemblés jusquʼà former non plus un objet, mais presque un élément de mobilier.
Les femmes sont souvent considérées comme incompétentes techniquement parlant, et les ingénieures et scientifiques femmes se battent encore, de nos jours, pour exister socialement et faire reconnaître leurs compétences. Alors que «  femme  » et «  technique  » sont encore construits de manière routinière comme deux termes antagonistes, il est aussi question dʼune «  libération  » aux termes flous qui répondrait, sinon aux discriminations subies par les femmes dans les carrières scientifiques, du moins au schéma inégalitaire qui leur impose par défaut les travaux domestiques. Lʼexternalisation sur les appareils robotiques constitue une alternative à lʼexternalisation sur le personnel salarié, dont on a vu quʼelle ne peut être considérée comme un système pérenne. Une première esquisse des innovations sur le terrain de lʼélectroménager mʼa permis dʼen relier les promesses à celles, primitives, de lʼélectrification. De cette électricité, les génies domestiques prolongent lʼimaginaire technomagique : lʼobjet électroménager fonctionne parce que sa puissance sʼexplique (rationalité) en même temps quʼelle est incommensurable (magie de la science). Il entend faire gagner du temps, mais ce temps gagné nʼest pas toujours celui des femmes, ou alors, cʼest pour quʼelles sʼinvestissent dans de nouvelles tâches, qui sont associées à de plus ou moins nouvelles injonctions. Le terrain de la cuisine, ponctué dʼobjets électrifiés, voit ceux-ci traversés dʼécarts ; écart entre la réclame qui se fait le relais de la libération, et la réalité du terrain que les designers doivent à plus forte raison documenter (Nova 2021) ; écart, aussi, entre la cuisine telle quʼelle est, et le laboratoire queer quʼelle peut devenir dans les représentations dʼart et de design prospectif ; écart, enfin, entre les femmes et ces objets conçus pour elles, mais trop rarement, dans les imaginaires collectifs, par elles. Parti·es de la promesse publicitaire liée à ces objets, nous devons nous engager plus clairement dans la question de leur fonctionnalité. Oublions un instant le gain de temps, et investissons peut-être la raison première pour laquelle ces objets séduisent : au-delà de leur efficacité, ils donnent le «  sentiment grisant de la modernité  » (Leymonerie 2012, 54). Mais selon quel projet ? À la fois banaux et futuristes, ces objets méritent quʼon leur consacre à présent un inventaire critique.
Dans le contexte dʼune crise climatique généralisée, liée notamment à la surproduction et à son corollaire quʼest la prolifération des déchets électroniques, il est difficile dʼinvestir lʼobjet électroménager avec enthousiasme. Cʼest pourtant le pari quʼa relevé un étudiant du master DTCT, Aurélien Pons737, en positionnant son travail de mémoire-projet comme une réponse conjointe à la surproduction et aux besoins en cuisine. Sa proposition (fig. 4.27) peut faire écho au Thermomix, puisquʼelle relève dʼune condensation de fonctions. Le mixeur devient un accessoire à fixer sur un bloc moteur qui peut aussi alimenter une perceuse738. Si lʼancrage du projet ne se situe pas dans les études de genre, lʼapproche matérialise un continuum de fonctionnalités qui relie des objets traditionnellement marqués par des «  scripts dʼobjets  » fortement genrés. Esthétiquement, lʼhéritage est celui de la gute Form à la Braun : lignes orthogonales, absence de décor ostentatoire et contraste de matériaux (mats et unis) pour rendre lisibles les parties de lʼobjet font partie de lʼéconomie visuelle de la proposition. Le choix sʼentend car il mobilise dans ses intentions quelque chose de la promesse initiale de la gute Form : lisibilité, mais aussi durabilité grâce à des esthétiques qui visent une forme dʼintemporalité, et donc de permanence dans les usages. Avec le standard aux formes simples est également nourri le rêve moderne (dans son pendant social du moins) dʼun accès universel et équitable aux technologies.

Le projet dʼAurélien Pons a plusieurs mérites, et celui, surtout, dʼéchapper aux sirènes du refus de la production qui compose une partie des propositions en design contemporain. Prêcher la récupération comme solution unique, cʼest faire preuve de naïveté : les producteurs dʼobjets de mauvaise qualité nʼont aucun intérêt à arrêter leur production, et renoncer à faire, cʼest leur abandonner des pans entiers de lʼindustrie et donc de la vie. De plus, les objets sʼusent, y compris les plus durables : ce sont donc des modalités de production soutenables quʼil faut envisager. Étant entendu que le fait même de la production nʼest pas remis en cause, on peut bien sà »r en interroger lʼéchelle, les modalités et les effets délétères. Dans cet inventaire des solutions électroménagères, je propose comme toujours de considérer lʼobjet dans un complexe spatial qui le relie à dʼautres objets. En dʼautres termes, le moulin à café et lʼaspirateur font dispositif : ils créent des usages, des scénarios et des possibles de vie (ou au contraire, ils en suppriment). Et si la main humaine est encore nécessaire, a minima, pour appuyer sur le bouton du Thermomix, il est bon de se rappeler que les objets ne sont pas entièrement qualifiés par nos manipulations. Comme le pose Ruth Schwartz Cowan, «  [l]es outils ne sont pas des instruments passifs, confinés à lʼexécution de nos ordres, mais ils ont une vie propre  »739 (1987, 9). Ignorer ce fait, cʼest sʼexposer à ce quʼils «  nous commandent, plutôt que lʼinverse  »740 (10).
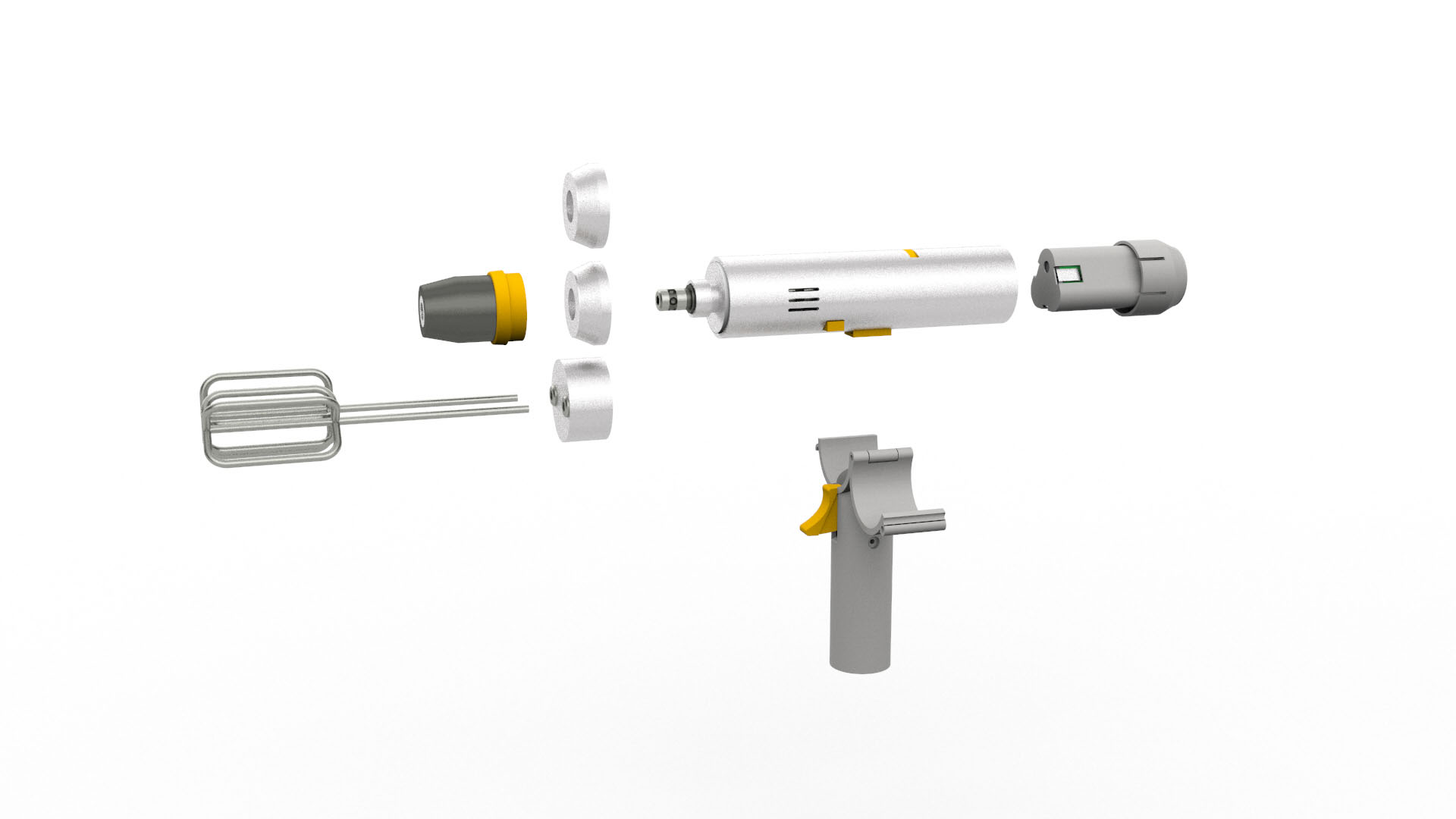
Lʼhistoire de la cuisine est profondément marquée par celle de lʼélectroménager. Mais le formuler ainsi solidifie une séparation entre le lieu-cuisine et ses accessoires électrifiés, facilitée par la rupture dʼéchelle entre lʼhabitat et les objets. En réalité, comme nous le rappelle Claire Leymonerie, «  [l]a promotion des appareils ménagers va de pair avec celle de la cuisine comme pièce essentielle au sein de lʼhabitation  » (2005). Ces objets, tout de même coà »teux, donnent envie de démonstrations à vue, plutôt que de suivre «  le modèle de lʼappartement bourgeois parisien, qui relègue la cuisine à lʼarrière de lʼhabitation, desservie par un escalier de service, donnant sur une cour de service et communiquant par un couloir avec la salle à manger où la famille prend ses repas  » (Leymonerie 2005, §16). Les objets que nous allons observer constituent potentiellement des variantes électrifiées dʼobjets activables à la main. La miniaturisation, par ailleurs, est un phénomène aussi important que lʼélectrification. Nous avons vu avec Dolores Hayden comment la domesticité avait manqué son virage collectif dans les années 1850 (cf. infra., chap. II). Lʼurbaniste observe que cette individualisation de la cuisine va produire directement un rétrécissement des dispositifs : moins lʼobjet est collectivisé, plus il devient petit pour sʼinsérer dans un espace déjà bien saturé. La machine à laver familiale sera donc plus petite quʼun dispositif pensé pour un immeuble entier741. Et à mesure que les objets rétrécissent pour entrer dans une cuisine (certes moins exiguë si elle est ouverte), ils nécessitent des adaptations correspondantes, à commencer par lʼenrichissement des points de raccordement au réseau électrique (les prises) (Harris 2013, 209 ; Bartholeyns & Charpy 2021, 103). Ainsi, cuisine et objets électroménagers se complètent et se déterminent mutuellement, au point quʼil nʼest pas possible de parler de ces objets sans les penser conjointement avec les murs, les sols et les placards qui composent la cuisine, lesquels ne sont pas un réceptacle passif de produits.
Les placards, parlons-en : pensés pour rassembler les outils des usager·es en cuisine, ils sont débordés par les outils électroménagers, a fortiori ceux qui sont accusés de ne pas servir. Dans un contexte contemporain avide de désencombrement à la Marie Kondo («  declutter  », cf. infra. XX), on semble plus enclin à se libérer dʼun imposant appareil quʼà attendre une quelconque libération de celui-ci. Cette sensation dʼêtre envahi par les appareils nʼest pas récente : Siegfried Giedion lʼévoque déjà dans sa somme, même si lʼimage quʼil convoque semble davantage moquer la femme au sein de la cuisine, transformée en chef militaire des opérations (1948 fig. 508 p. 480) quʼun véritable bric-à -brac dont les industriels seraient responsables. Le terme choisi par Giedion est celui de «  gadget  »â€¯: en design, ce mot, appliqué à un objet, vaut quasiment pour marque dʼinfamie. Deux acceptions du gadget, qui sont en réalité convergentes, sont importantes à signaler. Un objet peut être considéré comme «  gadget  » parce que ses fonctions sont très limitées. Utile une fois lʼan, son existence semble absurde tant la dépense énergétique de sa conception et de sa production ont des effets comparativement modestes. On peut ainsi penser à un coupe-avocat (fig 4.28.a) fig. 4.28 : Quelques exemples d’une possible gadgetisation :
a. Un couteau à avocat de la marque Joseph Joseph. ou à un couteau à pamplemousse, qui gagnent en efficacité en sʼadaptant à leur destination exacte, mais pour un usage plus exceptionnel que régulier742. Du côté des objets électrifiés, on pensera ainsi à la machine à barbapapa, la machine à pop-corn, la machine à barres de céréales, la machine à raclette, à fondue, ou encore à la fontaine à chocolat qui sont autant dʼopportunités, pour les designers, de sʼinterroger sur ce que le mot «  fonction  » veut dire.
fig. 4.28 : Quelques exemples d’une possible gadgetisation :
a. Un couteau à avocat de la marque Joseph Joseph. ou à un couteau à pamplemousse, qui gagnent en efficacité en sʼadaptant à leur destination exacte, mais pour un usage plus exceptionnel que régulier742. Du côté des objets électrifiés, on pensera ainsi à la machine à barbapapa, la machine à pop-corn, la machine à barres de céréales, la machine à raclette, à fondue, ou encore à la fontaine à chocolat qui sont autant dʼopportunités, pour les designers, de sʼinterroger sur ce que le mot «  fonction  » veut dire.
Proche de cette hyper-spécialisation, un deuxième tort peut distinguer le gadget -— tort généralement consécutif à la compensation du premier. Puisque tel ou tel dispositif nʼest pas assez utile, on peut se retrouver à condenser ces fonctions annexes en un seul objet. On peut même chercher à faire tout réaliser à un seul artefact, ce qui, dans lʼenseignement du design, est incarné par le couteau suisse multifonction (fig. 4.28.b), fig. 4.28 : Quelques exemples d’une possible gadgetisation :
b. Un couteau suisse multifonction de la marque Victorinox. qui sert dʼavertissement aux étudiant·es trop ambitieux·ses dans la mesure où il permet dʼexpliquer facilement quʼun objet qui fait tout ne fait en général rien correctement. Ces objets ne sont pas anodins parce quʼils convoquent un imaginaire tout autre que celui de la femme jetant son tablier : au contraire, ils supposent une ménagère suréquipée, devenue multitâches par la grâce de son équipement, à la manière dʼun Batman sortant des gadgets de sa ceinture pour sauver la veuve et lʼorphelin. La comparaison avec le registre super-héroïque nʼest pas fortuite : on demande aux femmes comme aux objets dʼêtre multifonctions. Comme le robot doit mixer, râper, pétrir sans relâche, les femmes doivent combiner vie professionnelle, vie de famille, vie personnelle et communication sur les réseaux. Ce premier rapprochement me permet dʼannoncer une hypothèse à laquelle je vais donner corps ci-après : les femmes sont moins dans la cuisine quʼen elle, au point que lʼespace domestique et lʼêtre-boniche relèvent dʼune existence voire, dʼune chair, partagée.
fig. 4.28 : Quelques exemples d’une possible gadgetisation :
b. Un couteau suisse multifonction de la marque Victorinox. qui sert dʼavertissement aux étudiant·es trop ambitieux·ses dans la mesure où il permet dʼexpliquer facilement quʼun objet qui fait tout ne fait en général rien correctement. Ces objets ne sont pas anodins parce quʼils convoquent un imaginaire tout autre que celui de la femme jetant son tablier : au contraire, ils supposent une ménagère suréquipée, devenue multitâches par la grâce de son équipement, à la manière dʼun Batman sortant des gadgets de sa ceinture pour sauver la veuve et lʼorphelin. La comparaison avec le registre super-héroïque nʼest pas fortuite : on demande aux femmes comme aux objets dʼêtre multifonctions. Comme le robot doit mixer, râper, pétrir sans relâche, les femmes doivent combiner vie professionnelle, vie de famille, vie personnelle et communication sur les réseaux. Ce premier rapprochement me permet dʼannoncer une hypothèse à laquelle je vais donner corps ci-après : les femmes sont moins dans la cuisine quʼen elle, au point que lʼespace domestique et lʼêtre-boniche relèvent dʼune existence voire, dʼune chair, partagée.
Avant de rencontrer quelques objets électroménagers, il convient de rappeler la nécessité dʼune relation critique à la notion dʼinnovation, cette fois dans le contexte de la cuisine. Parler dʼobjets en cuisine invite nécessairement le ballet des génies domestiques électrifiés ; le terme de «  génie  », encore une fois proche du registre magique, confère aussi une forme dʼexception à ces objets pourtant nombreux. Toutefois, il est tout aussi important de sʼintéresser aux projets pertinents en dehors de cette catégorie. Les objets non électrifiés peuvent sembler avoir déjà atteint leur degré maximal de perfectionnement, et pourtant, il existe toujours des angles pour réinvestir ces objets : soit pour trouver une forme encore plus adéquate, soit pour que le geste devienne disponible au plus grand nombre. Le chercheur en communication Sun-Ha Hong pose effectivement cette question : «  à quoi bon changer les technologies si on ne change pas les rapports sociaux ?  »743 (2021). Pour lui, les imaginaires du futur «  promettent la différence, mais ne font que reproduire le même  »744. fig. 4.29 : Objets issus de la gamme Good Grips, marque OXO, d’après les recherches de Sam et Betsey Farber. La critique sʼentend et peut dʼailleurs sʼinverser : des projets qui proposent en apparence des solutions classiques peuvent être particulièrement innovants. Les chercheuses Sarah Hendren, aux USA, et Manon Ménard, en France, évoquent respectivement cette question dans leurs travaux. S. Hendren présente la collection Good Grips de la marque OXO, soit un ensemble dʼustensiles de cuisine (fig. 4.29) dont les manches et autres prises combinent résistance et souplesse.
fig. 4.29 : Objets issus de la gamme Good Grips, marque OXO, d’après les recherches de Sam et Betsey Farber. La critique sʼentend et peut dʼailleurs sʼinverser : des projets qui proposent en apparence des solutions classiques peuvent être particulièrement innovants. Les chercheuses Sarah Hendren, aux USA, et Manon Ménard, en France, évoquent respectivement cette question dans leurs travaux. S. Hendren présente la collection Good Grips de la marque OXO, soit un ensemble dʼustensiles de cuisine (fig. 4.29) dont les manches et autres prises combinent résistance et souplesse.
La chercheuse fait la généalogie de cette solution technique aujourdʼhui classique en remontant aux origines de sa conception par le couple Sam et Betsey Farber. Ladite Betsey Farber observe quʼelle a des difficultés à travailler avec un épluche-légumes classique à cause de son arthrose. Le couple, à partir de cette expérience en cuisine, opère un nombre de choix spécifiques :
Les ailettes sur les côtés [de lʼobjet] indiquent élégamment lʼendroit où placer le pouce pour optimiser la mécanique dʼutilisation, formant un repère visuel pour une manipulation intuitive. Lorsque vous tenez lʼéplucheur contre une carotte, il vous encourage à appliquer juste assez de pression pour attraper un ruban de la peau du légume sans couper trop profondément, et sans glisser inconsidérément, ce qui ferait voler la carotte et lʼéplucheur dʼentre vos mains. La prise en main, la friction, lʼeffet de levier et la force — toutes ces considérations doivent être réunies au cœur dʼun faisceau rapide de préoccupations (Hendren 2020)745.
Il y a bien quelque chose de nouveau dans cet objet : un système qui mettait en difficulté des usager·es leur permet avec succès de sʼengager dans une tâche. Le terme de «  good grips  » est du reste intéressant. On pourrait trouver anecdotique le fait de pouvoir éplucher une carotte : ce serait une erreur.

Ce genre de petits gestes nécessite une prise en main dʼoutil qui peut être difficile, et cette prise (grip) est aussi reliée symboliquement et cognitivement, à la prise que lʼon a ou non sur le monde. Les designers Maria Benktzon & Sven-Eric Juhlin (Ergonomi Design Gruppen) sʼinscrivent dans une démarche voisine avec leur set de vaisselle destiné aux utilisateurices handicapées (fig. 4.30). Manon Ménard décrit ce projet en convoquant les travaux de la chercheuse Maria Göransdotter, pour qui la démarche est exemplaire dans la mesure où elle convoque de manière collaborative les usager·es. Sur la notice du Musée Cooper Hewitt qui documente le projet, lʼhistorienne Susan Teichman mobilise elle aussi cette notion de «  prise  », qui justifie de nombreux choix de dessin et donc de conception industrielle comme les circonférences plus amples des éléments (par exemple la tige dʼun verre à pied) ou le poids du manche du couteau. On lʼaura compris, innover nʼest pas nécessairement synonyme dʼélectrifier. Une telle approche permet dʼobserver les produits électroménagers les plus récents avec un regard critique, et de les relier à leurs protoformes pour mieux les questionner.
Quʼest-ce quʼun objet électroménager ? Une réponse généraliste consisterait à dire quʼil est un objet technique, dont la forme est pensée pour réaliser une typologie de fonction (mixer, râper, cuire…) et pour sʼintégrer au mieux dans le paysage du foyer. On peut étendre cette définition pour mieux appréhender ce que lʼobjet fait à la cuisine, et réciproquement. Lʼobjet électroménager nʼest donc pas seulement un objet technique ; il est un assemblage complexe, qui condense des usages anciens, ses protoformes, des aboutissements techniques, une histoire industrielle au sens large (lʼensemble des techniques qui rendent son existence possible), son histoire industrielle au sens restreint (son trajet individuel dʼobjet, de lʼextraction des matériaux à la saisie par les usager·es) et tous les imaginaires quʼil condense et prolonge. Je propose ici de regarder un objet qui est asymétrique par rapport à la catégorie «  électroménager  », et pour cause : au cours de son existence, il a été davantage dépendant de la flamme que de son raccordement au réseau électrique. Cʼest précisément cette relative hybridité qui va ici permettre un regard sur les fonctions, plutôt que sur une catégorie transversale dʼélectroménager, qui occasionne des généralisations conséquentes.
La cocotte, parfois appelée cocotte-minute, est intéressante précisément parce que ses fonctions ne sʼélectrifient que sur le tard. Ma méthodologie de design mʼimpose de toujours relier les objets à deux typologies plutôt quʼà la plus immédiatement évidente. Ainsi, une chaise pourra être rangée dans cette catégorie, «  chaise  »â€¯: ce faisant, elle sera comparée à tout objet associant une assise, quatre pieds et un dossier et correspondant à la hauteur attendue. Mais il peut être plus pertinent de classer la chaise dans la sur-catégorie plus vaste des «  objets permettant de sʼasseoir  »746. En suivant cette logique, la cocotte sera placée à la fois aux côtés des marmites et casseroles qui lui ressemblent, mais aussi dans la catégorie parente des «  objets permettant de cuire la nourriture et dʼassembler des plats chauds  » (dans laquelle on trouvera alors le réchaud du camping ou les tandoors indiens).
En 1953, la marque SEB747 sort un nouveau produit : la cocotte-minute (fig. 4.31.a). fig. 4.31.a : a : La cocotte SEB originale (source : Le Monde). Ce produit prédate de trois ans les premiers produits électroménagers de la marque, selon son site commercial. La cocotte fait lʼobjet dʼun brevet déposé par les frères Lescure qui se voient refuser la présentation de leur produit au Salon des arts ménagers. Cet objet sʼinscrit dans la typologie ancienne de la marmite. Si sa forme peut paraître relativement inchangée au fil des siècles, les différentes sources de chaleur (feu, flamme au gaz, électricité, induction) lui ont imposé dʼimportantes modifications en termes de revêtement.
fig. 4.31.a : a : La cocotte SEB originale (source : Le Monde). Ce produit prédate de trois ans les premiers produits électroménagers de la marque, selon son site commercial. La cocotte fait lʼobjet dʼun brevet déposé par les frères Lescure qui se voient refuser la présentation de leur produit au Salon des arts ménagers. Cet objet sʼinscrit dans la typologie ancienne de la marmite. Si sa forme peut paraître relativement inchangée au fil des siècles, les différentes sources de chaleur (feu, flamme au gaz, électricité, induction) lui ont imposé dʼimportantes modifications en termes de revêtement.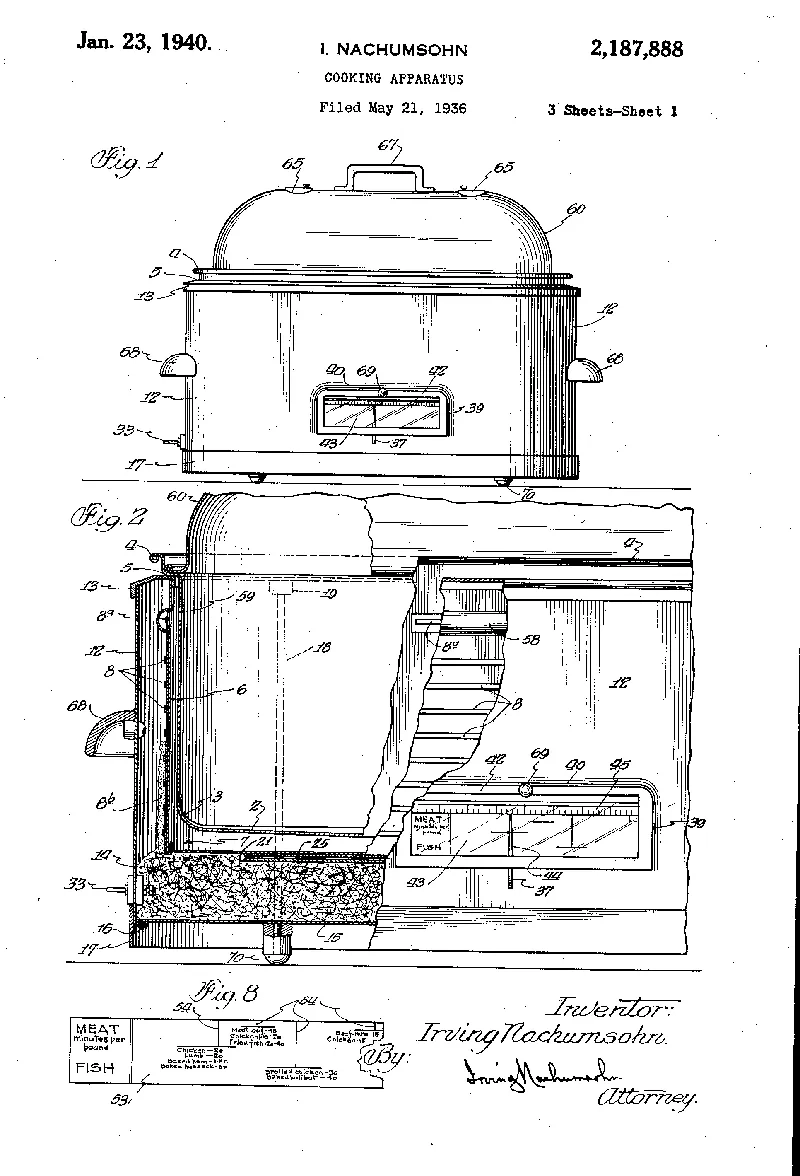 fig. 4.31.b : b : Brevet pour le crock-pot en 1940 (source : Smithsonian Museum). La cocotte-minute met en évidence le fait que viser le gain de temps nʼimplique pas nécessairement de recourir à lʼélectrification. La cuisson, avec cet objet, repose sur la mise sous pression du contenu de la cocotte. Lʼair chaud ainsi contenu permet de cuire plus rapidement les aliments : il sʼéchappe en partie par lʼentremise dʼune soupape. Lʼensemble de la cocotte, à lʼorigine en aluminium laminé embouti (Watin-Augouard 2003, 44), est aujourdʼhui fabriqué en acier inoxydable. Par le passé, dʼautres méthodes ont été mobilisées pour conserver une chaleur trop volatile. La marmite norvégienne en est un exemple : chauffée sur le feu, elle est ensuite placée dans un contenant (par exemple en tissu) qui va limiter la perte de chaleur, permettant le maintien dʼune cuisson lente, à lʼéchelle de la journée. Cette approche se retrouve dans la mijoteuse (dite slow cooker en anglais, ou crock-pot), dont le brevet est déposé aux États-Unis en 1940 (fig. 4.31.b). En réalité, cocotte-minute et crock-pot relèvent de deux approches opposées : lʼune fait vite, lʼautre permet à la housewife de démarrer le repas du soir le matin, et de le laisser mijoter la journée pendant quʼelle est au travail. Mais il est possible que malgré des fonctions divergentes, elles remplissent un objectif commun de gain de temps et quʼelles recouvrent le même registre dʼévocations, celle dʼun contenant «  symbolis[ant] parfaitement la chaleur rayonnante du foyer réuni [qui] sʼattache irrésistiblement à lʼimage de la mère nourricière  » (Kaufmann 2015[2005], 171). Dans une note au sujet de cet objet emblématique, le sociologue Jean-Claude Kaufmann affirme que le terme dʼautocuiseur, proposé par «  les ingénieurs  », nʼa jamais pris car «  ‹ cocotte › exprimait mieux lʼidée de la tendresse familiale mitonnée par la cuisine spécialement par la mère  » (ibid.) : on retrouve pourtant ce terme sur les fiches-produits des nouvelles variantes de «  cocottes  » aujourdʼhui en vente. Quant au mot de «  cocotte  » lui-même, il est devenu un terme générique qui, on lʼa vu, recouvre des gestes et usages divers.
fig. 4.31.b : b : Brevet pour le crock-pot en 1940 (source : Smithsonian Museum). La cocotte-minute met en évidence le fait que viser le gain de temps nʼimplique pas nécessairement de recourir à lʼélectrification. La cuisson, avec cet objet, repose sur la mise sous pression du contenu de la cocotte. Lʼair chaud ainsi contenu permet de cuire plus rapidement les aliments : il sʼéchappe en partie par lʼentremise dʼune soupape. Lʼensemble de la cocotte, à lʼorigine en aluminium laminé embouti (Watin-Augouard 2003, 44), est aujourdʼhui fabriqué en acier inoxydable. Par le passé, dʼautres méthodes ont été mobilisées pour conserver une chaleur trop volatile. La marmite norvégienne en est un exemple : chauffée sur le feu, elle est ensuite placée dans un contenant (par exemple en tissu) qui va limiter la perte de chaleur, permettant le maintien dʼune cuisson lente, à lʼéchelle de la journée. Cette approche se retrouve dans la mijoteuse (dite slow cooker en anglais, ou crock-pot), dont le brevet est déposé aux États-Unis en 1940 (fig. 4.31.b). En réalité, cocotte-minute et crock-pot relèvent de deux approches opposées : lʼune fait vite, lʼautre permet à la housewife de démarrer le repas du soir le matin, et de le laisser mijoter la journée pendant quʼelle est au travail. Mais il est possible que malgré des fonctions divergentes, elles remplissent un objectif commun de gain de temps et quʼelles recouvrent le même registre dʼévocations, celle dʼun contenant «  symbolis[ant] parfaitement la chaleur rayonnante du foyer réuni [qui] sʼattache irrésistiblement à lʼimage de la mère nourricière  » (Kaufmann 2015[2005], 171). Dans une note au sujet de cet objet emblématique, le sociologue Jean-Claude Kaufmann affirme que le terme dʼautocuiseur, proposé par «  les ingénieurs  », nʼa jamais pris car «  ‹ cocotte › exprimait mieux lʼidée de la tendresse familiale mitonnée par la cuisine spécialement par la mère  » (ibid.) : on retrouve pourtant ce terme sur les fiches-produits des nouvelles variantes de «  cocottes  » aujourdʼhui en vente. Quant au mot de «  cocotte  » lui-même, il est devenu un terme générique qui, on lʼa vu, recouvre des gestes et usages divers.
Le modèle SEB traditionnel est toujours disponible, mais il en existe aussi une version modernisée, la Clipso, qui remplace lʼétrier par une système de fermeture en plastique manipulable dʼune seule main (fig. 4.32.a). fig. 4.32.a : La Clipso de SEB. Là encore, le gain de temps est accompli sans que lʼobjet soit séparé de la flamme. La modernité est parfois plus affaire de ligne que de changement de paradigme technique : la marque Le Creuset propose depuis 1925 une marmite émaillée (fig. 4.32.c) qui est désormais un «  classique  » de la marque déclinée en une variété de couleurs et dʼéditions spéciales. En 1958, cette cocotte est redessinée au sein de la CEI (Compagnie dʼEsthétique Industrielle) par Raymond Loewy (Leymonerie 2016, 141), designer français expatrié aux États-Unis et dont la pratique est souvent associée au streamline et au titre de sa biographie, selon lequel «  la laideur se vend mal  ». La Coquelle (fig. 4.33) est décrite aujourdʼhui sur le site de la marque Le Creuset en ces termes : «  Des lignes fuselées pour lʼère de lʼaviation à réaction  ». Pourtant, on ne peut pas dire que les lignes de cette cocotte soient aérodynamiques : apparemment, le choix de Loewy consiste plutôt à inverser les attentes vis-à -vis dʼune cocotte, dont la forme archétypale est celle dʼune marmite ronde pour proposer un volume plus rectangulaire et anguleux (Leymonerie 2016, 141). Ce faisant, il projette la marmite dʼantan dans des imaginaires modernistes, comme il lʼa dʼailleurs fait dans dʼautres propositions.
fig. 4.32.a : La Clipso de SEB. Là encore, le gain de temps est accompli sans que lʼobjet soit séparé de la flamme. La modernité est parfois plus affaire de ligne que de changement de paradigme technique : la marque Le Creuset propose depuis 1925 une marmite émaillée (fig. 4.32.c) qui est désormais un «  classique  » de la marque déclinée en une variété de couleurs et dʼéditions spéciales. En 1958, cette cocotte est redessinée au sein de la CEI (Compagnie dʼEsthétique Industrielle) par Raymond Loewy (Leymonerie 2016, 141), designer français expatrié aux États-Unis et dont la pratique est souvent associée au streamline et au titre de sa biographie, selon lequel «  la laideur se vend mal  ». La Coquelle (fig. 4.33) est décrite aujourdʼhui sur le site de la marque Le Creuset en ces termes : «  Des lignes fuselées pour lʼère de lʼaviation à réaction  ». Pourtant, on ne peut pas dire que les lignes de cette cocotte soient aérodynamiques : apparemment, le choix de Loewy consiste plutôt à inverser les attentes vis-à -vis dʼune cocotte, dont la forme archétypale est celle dʼune marmite ronde pour proposer un volume plus rectangulaire et anguleux (Leymonerie 2016, 141). Ce faisant, il projette la marmite dʼantan dans des imaginaires modernistes, comme il lʼa dʼailleurs fait dans dʼautres propositions.

Les discours des marques au sujet de ces objets emblématiques, et relativement permanents dans les cuisines, mobilisent des formes de nostalgie en même temps quʼils revendiquent lʼaspect «  classique  » de certaines esthétiques : en dʼautres termes, ces communications sont paradoxales. fig. 4.32.b : La marmite émaillée Le Creuset, depuis 1925. On ravive un ancien qui se targuait à son époque de modernité ; on innove parfois en gardant les signifiants fondamentaux associés à la fonction. Dans certains cas, la forme proposée inverse les attentes, comme chez Loewy : la cocotte ou marmite Cubica, dessinée pour Alessi par Aldo Rossi en 1991, tire ses formes cubiques (fig. 4.32.d) de la pratique dʼarchitecte de son créateur qui sʼétait déjà livré par le passé à ce type de transferts.
fig. 4.32.b : La marmite émaillée Le Creuset, depuis 1925. On ravive un ancien qui se targuait à son époque de modernité ; on innove parfois en gardant les signifiants fondamentaux associés à la fonction. Dans certains cas, la forme proposée inverse les attentes, comme chez Loewy : la cocotte ou marmite Cubica, dessinée pour Alessi par Aldo Rossi en 1991, tire ses formes cubiques (fig. 4.32.d) de la pratique dʼarchitecte de son créateur qui sʼétait déjà livré par le passé à ce type de transferts. fig. 4.32.c : Cubica, dessinée pour Alessi par Aldo Rossi en 1991. Lʼobjet existe donc entre deux échelles : celle, macro, des bâtiments qui lʼinspirent, et celle, plus abstraite, du pictogramme qui peut résumer et simplifier les formes à lʼextrême. Ce faisant, la cocotte est comme arrachée au réseau des images traditionnelles qui lui sont associées -— à commencer peut-être par ses dimensions nourricières, et donc féminines. Cette tension entre le rond et lʼanguleux traverse lʼhistoire de lʼélectroménager et, par extension, celle de la cocotte : ces registres formels sous-tendent plus quʼun seul caprice du goà »t. Ils sont le résultat de modes souvent durables qui ont caractérisé le marché de lʼobjet ménager (électrique ou non) pendant de nombreuses années. Ainsi, la rondeur des produits a été déterminée par la diffusion du matériau plastique, dont sʼemparent certaines productions devenues depuis emblématiques, comme cʼest le cas pour SEB. Savinel & Rozé vont ainsi proposer ce «  style bien identifiable  » (Leymonerie 2016, 209) dʼobjets à la coque lisse et aux angles rondelets, distingués par des couleurs vives et qui «  évoquent autant une collection de jouets quʼun catalogue dʼappareils ménagers  » (ibid.).
fig. 4.32.c : Cubica, dessinée pour Alessi par Aldo Rossi en 1991. Lʼobjet existe donc entre deux échelles : celle, macro, des bâtiments qui lʼinspirent, et celle, plus abstraite, du pictogramme qui peut résumer et simplifier les formes à lʼextrême. Ce faisant, la cocotte est comme arrachée au réseau des images traditionnelles qui lui sont associées -— à commencer peut-être par ses dimensions nourricières, et donc féminines. Cette tension entre le rond et lʼanguleux traverse lʼhistoire de lʼélectroménager et, par extension, celle de la cocotte : ces registres formels sous-tendent plus quʼun seul caprice du goà »t. Ils sont le résultat de modes souvent durables qui ont caractérisé le marché de lʼobjet ménager (électrique ou non) pendant de nombreuses années. Ainsi, la rondeur des produits a été déterminée par la diffusion du matériau plastique, dont sʼemparent certaines productions devenues depuis emblématiques, comme cʼest le cas pour SEB. Savinel & Rozé vont ainsi proposer ce «  style bien identifiable  » (Leymonerie 2016, 209) dʼobjets à la coque lisse et aux angles rondelets, distingués par des couleurs vives et qui «  évoquent autant une collection de jouets quʼun catalogue dʼappareils ménagers  » (ibid.).
Chez Moulinex, en revanche, on fait tardivement appel à des designers, et les dessinateurs industriels questionnent peu les process existants, dont lʼemboutissement qui produit des «  produits aux surprenantes formes facettées, faits dʼune architecture complexe de pans coupés assemblés par des arêtes vives  » (Leymonerie 2016, 197). Lʼhistorienne Claire Leymonerie, dans sa somme consacrée à lʼhistoire du design industriel en France de 1945 à 1980, évoque les débats et textes produits après-guerre autour des formes des objets du quotidien. Elle évoque notamment le groupe Formes Utiles, et son porte-parole André Hermant qui parle de la simplification du dessin des objets industriels comme dʼun «  retour à lʼœuf  » (2016, 42). Selon C. Leymonerie, cette approche évoque les observations du philosophe des techniques Gilbert Simondon au sujet dʼun «  processus de synthèse  » qui rassemble les «  ensembles fonctionnels  » des objets en un «  système cohérent et unifié  » (2016, 42).
Ces quelques exemples mʼont permis dʼévoquer une somme de processus hétérogènes à lʼœuvre dans la conception de lʼobjet électroménager, qui ne sont pas nécessairement concurrents. De nombreuses binarités traversent lʼobjet : passé/futur, rond/anguleux, simple/complexe. Les nécessités du marché imposent dʼailleurs un renouvellement des propositions qui font de ces catégories moins des partis à adopter que les pôles dʼune oscillation permanente entretenant lʼillusion de nouveauté. Aujourdʼhui, deux directions émergent, et elles sont donc plus complémentaires que véritablement opposées. Dʼune part, cʼest la permanence de lʼancien, le «  classique  » qui prévaut. Dans un contexte de conscience écologique accrue, le recours à lʼindémodable est un argument commercial de poids, qui allie greenwashing et désir de consommation locale (made in France associé aux marques historiques) et durable.

Cʼest ce qui permet à SEB de continuer à vendre sa cocotte de 1958 sous une forme très similaire à lʼoriginale, sous le nom de «  Autocuiseur authentique  » ou à Le Creuset de dire que ses cocottes «  sont le produit de près dʼun siècle de raffinement  » et que «  transmises de générations en générations, elles se bonifient avec lʼâge  »748. Une image présente sur le site de la marque place dʼailleurs côte à côte une réclame ancienne de la marque et une photographie contemporaine : sur les deux, une ménagère cuisine avec sa cocotte (fig. 4.34). La continuité nʼest pas seulement celle de la forme de lʼobjet, mais bien des usages quʼil génère : ici, les femmes sont en cuisine comme leurs grand-mères.
Ailleurs, la fonction de cuisson est réinventée, notamment par la fusion avec dʼautres fonctionnalités et lʼassociation à un pavé numérique permettant la programmation. Cette numérisation de lʼespace domestique, en particulier celui de la cuisine, pose de multiples questions que je ne résoudrai pas dans ces pages. Mais lʼobservation des formes des «  tout-en-un  » comme le Thermomix révèle deux directions de dessin -— il sʼagit en somme dʼoublier un instant lʼaspect numérique de ces objets, pourtant au centre de leur promotion, pour sʼintéresser à la manière dont cette numérisation influence, ou non, la forme générale de lʼobjet. fig. 4.32.d : Multicuiseur 43 de Moulinex. Dans les combinés récents que jʼai pu observer, deux registres formels se détachent : celui de lʼobjet high-tech «  boîte noire  », qui revendique cet aspect, et une forme plus hybride qui tâche de rappeler son ancien référent. Dans le Multicuiseur 43 de Moulinex ou le Speedi de Ninja (fig. 4.32.d & e), la forme de la marmite est oblitérée, pour proposer un objet muet, aux fonctions peu évidentes.
fig. 4.32.d : Multicuiseur 43 de Moulinex. Dans les combinés récents que jʼai pu observer, deux registres formels se détachent : celui de lʼobjet high-tech «  boîte noire  », qui revendique cet aspect, et une forme plus hybride qui tâche de rappeler son ancien référent. Dans le Multicuiseur 43 de Moulinex ou le Speedi de Ninja (fig. 4.32.d & e), la forme de la marmite est oblitérée, pour proposer un objet muet, aux fonctions peu évidentes. fig. 4.32.e : Speedi de Ninja. Dans certains cas, cet aspect oblige les marques à proposer sur les supports promotionnels des vues en coupe de leurs objets, afin dʼexpliciter ce qui sʼy passe. Un autre choix consiste à séparer visuellement le pan numérique de lʼobjet du réceptacle à nourriture en tant que tel, comme dans le ClickChef de Moulinex (fig. 4.32.g), à nouveau, ou le Cooking Robot de Xiaomi (fig. 4.32.h). Dans ce dernier cas, lʼécran numérique tactile concurrence en taille la «  marmite  » réduite à un bol qui ressemble plus, visuellement, à celui dʼun blender. La forme la plus fréquente est celle du Thermomix de Vorwerk, qui a fait école (fig. 4.26) : un socle numérique est associé à un bol dont la forme maintient le référent visuel «  marmite  ». Seul Moulinex propose une véritable synthèse sans que la protoforme de la cocotte disparaisse derrière la boîte noire dans le Cookeo (fig. 4.32.i), dont les poignées fournissent certes une prise pour ouvrir le couvercle de lʼappareil, mais permettent aussi de donner à lʼobjet un profil qui connote la cuisine, plutôt quʼune haute technologie indéterminée.
fig. 4.32.e : Speedi de Ninja. Dans certains cas, cet aspect oblige les marques à proposer sur les supports promotionnels des vues en coupe de leurs objets, afin dʼexpliciter ce qui sʼy passe. Un autre choix consiste à séparer visuellement le pan numérique de lʼobjet du réceptacle à nourriture en tant que tel, comme dans le ClickChef de Moulinex (fig. 4.32.g), à nouveau, ou le Cooking Robot de Xiaomi (fig. 4.32.h). Dans ce dernier cas, lʼécran numérique tactile concurrence en taille la «  marmite  » réduite à un bol qui ressemble plus, visuellement, à celui dʼun blender. La forme la plus fréquente est celle du Thermomix de Vorwerk, qui a fait école (fig. 4.26) : un socle numérique est associé à un bol dont la forme maintient le référent visuel «  marmite  ». Seul Moulinex propose une véritable synthèse sans que la protoforme de la cocotte disparaisse derrière la boîte noire dans le Cookeo (fig. 4.32.i), dont les poignées fournissent certes une prise pour ouvrir le couvercle de lʼappareil, mais permettent aussi de donner à lʼobjet un profil qui connote la cuisine, plutôt quʼune haute technologie indéterminée. fig. 4.32.f : ClickChef de Moulinex.
fig. 4.32.f : ClickChef de Moulinex.
Le principe qui veut que lʼon fasse les meilleures soupes dans les vieux pots semble donc encore à lʼœuvre dans ces propositions de design, tendues entre la promesse (ancienne) dʼun remplacement du travail humain par le robot et lʼidée dʼune permanence ou dʼune tradition en cuisine. fig. 4.32.g : Cooking Robot de Xiaomi. Les objets numériques ou connectés incarnent la promesse dʼun tout-en-un, mais la vieille casserole, vue comme «  authentique  » fait aussi partie du paysage des cuisines actuelles. Cʼest aussi que certaines formes sont indéboulonnables : un combiné de téléphone filaire continue de fournir la base iconique de tout pictogramme servant à évoquer les appels vocaux. Plutôt que dʼopposer ces deux tendances, jʼaurais au contraire tendance à les relier : cʼest parce que nos marmites sont de plus en plus connectées que nous désirons plus fort les modèles dʼantan.
fig. 4.32.g : Cooking Robot de Xiaomi. Les objets numériques ou connectés incarnent la promesse dʼun tout-en-un, mais la vieille casserole, vue comme «  authentique  » fait aussi partie du paysage des cuisines actuelles. Cʼest aussi que certaines formes sont indéboulonnables : un combiné de téléphone filaire continue de fournir la base iconique de tout pictogramme servant à évoquer les appels vocaux. Plutôt que dʼopposer ces deux tendances, jʼaurais au contraire tendance à les relier : cʼest parce que nos marmites sont de plus en plus connectées que nous désirons plus fort les modèles dʼantan.
Ces objets numériques représentent aussi un saut paradigmatique : là où le moulin à purée ou le robot proposaient de suppléer la main, ces objets font imaginer un relais mental. Lʼélectroménager propose de plus en plus, en sus des fonctions courantes, des livres de recettes programmées et intégrées à lʼobjet. En plus de convoquer un imaginaire «  clac des doigts  » que jʼai déjà évoqué, ces objets déplacent la question du faire vers celle du savoir-faire. Cʼest dʼailleurs un élément de discours mobilisé par les marques. Sur son site Web, la marque SEB retrace la succession dʼinnovations qui ont fait son histoire.

En 2010, elle dit avoir créé «  la 1ère yaourtière qui sait [mon italique] préparer des yaourts, des faisselles, ainsi que des desserts gourmands  ». Une telle affirmation est étonnante, quand on connaît le principe technique dʼune yaourtière : en effet, cet objet nécessite seulement, pour fonctionner, un support hermétique et lʼintégration dʼune résistance maintenant une température constante pendant les heures de fermentation du yaourt. Que fait de plus ce pavé numérique intégré à lʼobjet ? Sʼil sʼagit dʼintégrer un minuteur, pourquoi ne pas utiliser ceux à présent embarqués sur nos smartphones ? Pourquoi lʼobjet doit-il prendre en charge cette fonction pour lui-même ? Je lis ici deux angles morts dans la conception de lʼélectroménager. Pour toutes leurs promesses futuristes, ils sont encore conçus de manière très «  rétro  », dans la mesure où lʼobjet est une entité isolée, autosuffisante. Ces produits gagneraient en effet à être pensés dans un paysage dʼobjets plus complet, qui ne soit pas seulement un univers de marque. De plus, il est important, en tant que designer (et sans doute en tant quʼusager·e et consommateurice), de repérer les situations où le discours sur la technologie lʼemporte sur la proposition technique réelle.
Le studio Super Solide propose quelque chose de cet ordre dans son exposition Utopie Domestique749 (fig. 4.35.b). Celle-ci, documentée dans un catalogue auto-édité, propose de penser de manière macro un «  habitat idéal  » (2023, 5). Parmi les trois zones le composant, la cuisine rassemble des objets créés par le studio et dʼautres créés par des designers qui ne lui appartiennent pas. Il y a déjà dans cette approche quelque chose dʼintéressant : les designers peuvent composer des paysages avec les créations dʼautrui, ou sʼinsérer intelligemment dans le déjà -là . Et, plutôt que de créer une énième marmite, le studio Super Solide propose une cloche de cuisson (fig. 4.35.a) en liège qui permet dʼutiliser la cocotte de notre choix comme une marmite norvégienne.

Jʼentends bien que proposer de designer des compléments dʼobjets plutôt que dʼen fabriquer de nouveaux ne soit pas dʼune immense originalité : pour autant, le projet de Super Solide propose un objet singulier, évocateur dʼune forme primitive quʼil ne convoque pas pour contrebalancer sa numérisation, mais bien dans le but dʼappareiller une situation dʼusage existante. Cʼest ce type dʼinterstices quʼil me semble important de mobiliser. Cette question du signe «  marmite  » et de sa mobilité dans des objets très différents dʼelle renvoie au sujet plus vaste du codage et du langage des objets. Je vais à présent examiner dans quelle mesure ces codes préparent ou solidifient des usages genrés.
Il peut sembler difficile de proposer des scénarios alternatifs en cuisine précisément parce que ses objets sont soumis à un faisceau de contraintes très fortes. La distribution massive de produits standardisés aussi complexes ne facilite pas les écarts, et rend sans doute les professionnels du secteur réticents à lʼidée de proposer des formes divergentes. Le design critique possède ici la faculté dʼinterroger ces formes évidentes prises par les objets ménagers et de proposer dʼautres manières dʼinvestir leurs esthétiques. Trois chercheuses en design suédoises, Karin Ehrnberger, Minna Räsänen et Sara Ilstedt ont développé en 2012 un projet permettant dʼanalyser la matérialisation des normes de genre dans les objets. La démarche associe étude de cas et positionnement relevant du «  design critique  »750 -— selon la définition initiale quʼen donnent les designers Fiona Raby et Anthony Dunne, celle dʼun design qui «  utilise des hypothèses de conception spéculative pour remettre en question les suppositions étroites, les idées préconçues et les états de fait relatifs au rôle que jouent les produits dans la vie quotidienne  »751 (Dunne & Raby 2014, 34). Le projet sʼancre dans lʼanalyse du «  langage du produit  »752 (Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012, 87) appliquée à deux objets : un mixeur et une perceuse (fig. 4.36.a). Les codes visuels et les choix de matériaux associés aux deux objets sont décortiqués et reliés à des attentes genrées.

La perceuse apparaît lourde, et son aspect technique est mis en relief par des choix formels. Si le moteur rotatif de la perceuse nécessite bien des aérations, elles sont grosses et ostentatoires, et connotent une forte dépense dʼénergie. Les boutons, orange, contrastent avec le corps vert-kaki de lʼappareil : jʼajouterais pour ma part que ces choix colorés sʼassocient plus volontiers à des univers masculins, non seulement du bricolage, mais aussi de lʼarmée. La taille des boutons participe aussi de lʼeffet général, qui est celui dʼun objet tourné vers sa fonction (percer des trous). À lʼopposé, le mixeur, qui repose pourtant sur le même principe technique du moteur rotatif, et qui est tout aussi dangereux, semble voiler ses logiques de fonctionnement. Le corps de lʼappareil se présente dʼun seul bloc : il est évocateur en cela du Ladyshave croisé plus tôt. Là où les vis de la perceuse sont visibles, et racontent le démontage en même temps quʼelles le rendent possible, le mixeur est une masse dʼun seul tenant. Sa couleur blanche contraste peu avec des boutons bleus qui ne rompent pas le profil de lʼobjet, et sont absorbés au contraire par ses courbes. Le cÅ“ur fonctionnel de lʼobjet -— les lames -—doit certes être recouvert pour éviter les projections et les coupures, mais ici, lʼaccessoire en plastique est dessiné et moulé pour suggérer une sorte de jupon qui semble effectuer un léger mouvement de rotation. Souplesse, mouvement courbe, légèreté et évocation de la danse sont autant de signes visuels qui participent à coder lʼobjet comme féminin.
Une fois ces codes énoncés, les chercheuses et designers décident de les travailler par un choix simple : lʼinversion. Elles produisent ainsi deux objets qui sont destinés à être exposés plutôt quʼutilisés dans le quotidien. Ces artefacts sont des opérateurs conversationnels et des outils dʼanalyse avant dʼêtre des objets fonctionnels au quotidien. Le premier, Mega Hurricane, est un mixeur dont les codes semblent plutôt relever dʼun registre masculin (fig. 4.36.b). La «  jupe  » voilant les lames cède la place à une couverture métallique qui suggère la puissance de lʼengin. Un écran LCD affiche par des chiffres la puissance mobilisée, ce qui suggère également un objet qui déploie des forces importantes et présente des données chiffrées pour permettre le contrôle. Ses larges boutons rendent également lʼobjet plus immédiatement lisible au niveau des interactions attendues.


À lʼinverse, la perceuse Dolphia (fig. 4.36.c) voit ses différentes parties fonctionnelles absorbées par lʼunité de la coque. Des manipulations sont possibles, mais elles sont indiquées de manière discrète. La production des deux objets nʼest quʼune étape du projet : ils sont ensuite exposés lors de lʼexposition Abnormal aÌ€ Stockholm en 2007 puis dans diverses expositions internationales. La réception des objets par les visiteureuses des expositions est alors observée et analysée par les chercheuses (Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012, 94–95). Les réactions face aux deux propositions sont très différentes. La réception de la perceuse Dolphia est hétérogène, et implique de classer les réactions selon quatre niveaux. Souvent, lʼobjet en changeant de codes de genre devient non identifiable : les visiteureuses échouent à lire la fonction de lʼobjet, la confondant parfois avec celle dʼun sèche-cheveux. À un second niveau, les visiteureuses identifient avec succès une perceuse, mais supposent quʼelle fonctionne mal ou possède de faibles performances. Dans un autre cas, Dolphia est perçue comme efficace, mais destinée aux femmes. Enfin, dans de plus rares cas, lʼobjet est accueilli et reconnu positivement.
Mega Hurricane, en revanche, ne suit pas une grille de réception aussi fragmentée (Ehrnberger, Räsänen & Ilstedt 2012, 95). Le mixeur masculinisé est reconnaissable et suscite une forte adhésion, à tel point que les visiteureuses le touchent malgré les interdictions formulées. Lʼexpérimentation est révélatrice à deux titres au moins. Tout dʼabord, elle montre quʼil est possible de séparer la forme de la fonction de manière expérimentale, et que beaucoup de formes qui nous semblent fonctionnellement motivées relèvent en fait dʼun codage de lʼobjet auquel les normes de genre participent pleinement. Deuxièmement, le projet repose sur ces normes en tant quʼelles suivent un codage oppositionnel binaire. Pour autant, lʼinversion ne produit pas des écarts équivalents, et révèle au contraire que lʼobjet perçu comme féminin se masculinise aisément, tandis que la féminisation dʼun dispositif masculin produit de la confusion et du rejet. Ces réactions peuvent être rapprochées dʼautres inversions sans rapport dʼéquivalence : il est plus aisé pour une femme de porter un pantalon que pour un homme de porter une jupe ; et si la masculinisation des femmes peut être sanctionnée, la féminisation des hommes (ou des personnes perçues comme telles) produit fréquemment des formes de violence sans égales. Enfin, et cʼest peut-être le plus grand intérêt de ce projet, Mega Hurricane et Dolphia mettent en évidence la redondance formelle et stylistique qui marquent nos objets. Lʼécart produit touche aux normes, mais aussi à la question concomitante de nos attentes et de nos habitudes dès lors quʼil est question dʼobjets du quotidien. Il est aussi significatif de rappeler les domaines de référence choisis pour souligner lʼopposition-inversion.
Cuisine féminine et bricolage masculin sont souvent montrés comme étant complémentaires, pour mieux illustrer lʼimage idéalisée dʼune domesticité où chacun·e contribue selon des compétences pensées comme étant intrinsèquement liées aux hommes et aux femmes, comme le montre par exemple une publicité Steel Works datant de 1961 (fig. 4.37). Cette image me paraît intéressante à plus dʼun titre, et je la mobilise souvent en cours pour montrer la manière dont le genre (comme système) sʼorganise autour des genres (comme identités), pensés comme exclusifs, radicalement différents et donc ultimement compatibles. Dans cette double page publiée dans une revue, le visuel fait la promotion de lʼacier en ces termes : «  Voici lʼacier qui aime travailler… Voici lʼépouse qui aime cuisiner… Voici le mari qui aime la femme qui aime cuisiner… Voici lʼacier qui aime travailler pour eux deux  »753. Cette rhétorique ne relie pas seulement homme et femme dans le couple hétérosexuel : elle leur associe une technologie ici métonymiquement incarnée par le matériau acier qui forme la glu de leur relation. Lʼacier, souvent représenté comme un élément structurel (poutres, IPN) est ici projeté dans la sphère domestique nécessairement coupée en deux : Madame est présentée frontalement, entourée de ses casseroles, tandis que Monsieur est accompagné dʼoutils de jardin, notamment sa tondeuse. Le mur derrière eux est habillé dʼun treillis dʼacier, mais la couleur diffère pour mieux séparer et opposer leurs espaces. Chacun·e, disposé·e parmi ses accessoires, apparaît comme une poupée : le mari et la femme sont le produit de consommation final de cette écologie visuelle.

Pour une fois, ce nʼest pas la femme qui est montrée comme oisive, mais plutôt le mari : lui ne cuisine pas, il se contente dʼaimer la femme qui cuisine. Ce type dʼimages est à double tranchant, comme souvent dans la production publicitaire : en opposant, il prépare aussi lʼinversion. La ligne entre les deux boîtes genrées, aussi fine soit-elle, compose un entre-deux qui peut inviter à la traversée754.
Lʼinversion nʼinvite pas forcément au trouble : elle ne brouille pas les catégories et se contente de placer une situation par-dessus tête. Cʼest un éventuel reproche que lʼon peut formuler à lʼadresse du projet de Karin Ehrnberger, Minna Räsänen et Sara Ilstedt : les rôles sont échangés et, ce faisant, révèlent lʼarbitraire et peut-être lʼabsurde de leur codage mais sans pourtant faire émerger de troisième (ou quatrième, ou cinquième…) voie. Il existe aussi dans ces inversions une dimension comique : les chercheuses montrent du reste que la féminisation de la Dolphia lui vaut de ne plus être prise au sérieux en tant que perceuse. Ce travail de design évoque ainsi dʼautres propositions, tel ce sketch de lʼémission Saturday Night Live qui propose une parodie de publicité pour les produits GE Big Boy (2018) (fig. 4.38). Dans cette courte vidéo humoristique, lʼacteur Jason Momoa utilise des produits électroménagers conçus pour les hommes et dont les caractéristiques masculines ont été exagérées.

Ce faisant, le clip met en relief la fragilité dʼhommes qui se tiendraient à distance du ménage afin de préserver leur virilité, en imaginant un monde où ce travail ne serait plus invisible, mais où il serait héroïsé, car masculin.

La porte de la machine à laver pèse soixante-dix livres et la machine à laver mesure six pieds (soit 1 mètre 80) et, par conséquent, «  elle [lʼépouse, ndla] a peut-être grimpé lʼéchelle sociale mais elle aura littéralement besoin dʼune échelle pour accéder à la machine à laver  »755. Passer lʼaspirateur est également requalifié en pratique masculine, en fusionnant sa fonction avec les principes dʼun tracteur-tondeuse. Enfin, une éponge détachante est fixée à un objet ressemblant à un marteau-piqueur. Tous les objets utilisent le codage de lʼunivers du bricolage, en particulier la bichromie jaune-noir qui évoque les objets de chantier (notamment ceux de la marque Caterpillar). Le sketch exagère des traits observables dans des campagnes publicitaires très sérieuses qui sur-codent la masculinité lorsquʼelles sʼemploient à vendre à un public masculin des objets ou produits habituellement associés aux femmes (yaourt, lingettes). Détail significatif, tous les objets Big Boy ont une note environnementale de F- car ils utilisent de lʼessence : on voit même J. Momoa remplir le réservoir de sa machine à laver avec un jerrycan. La parodie met en évidence le lien entre écologie et care. Et comme le care est féminin, lʼaffirmation virile passe logiquement par une posture anti-écologique756.
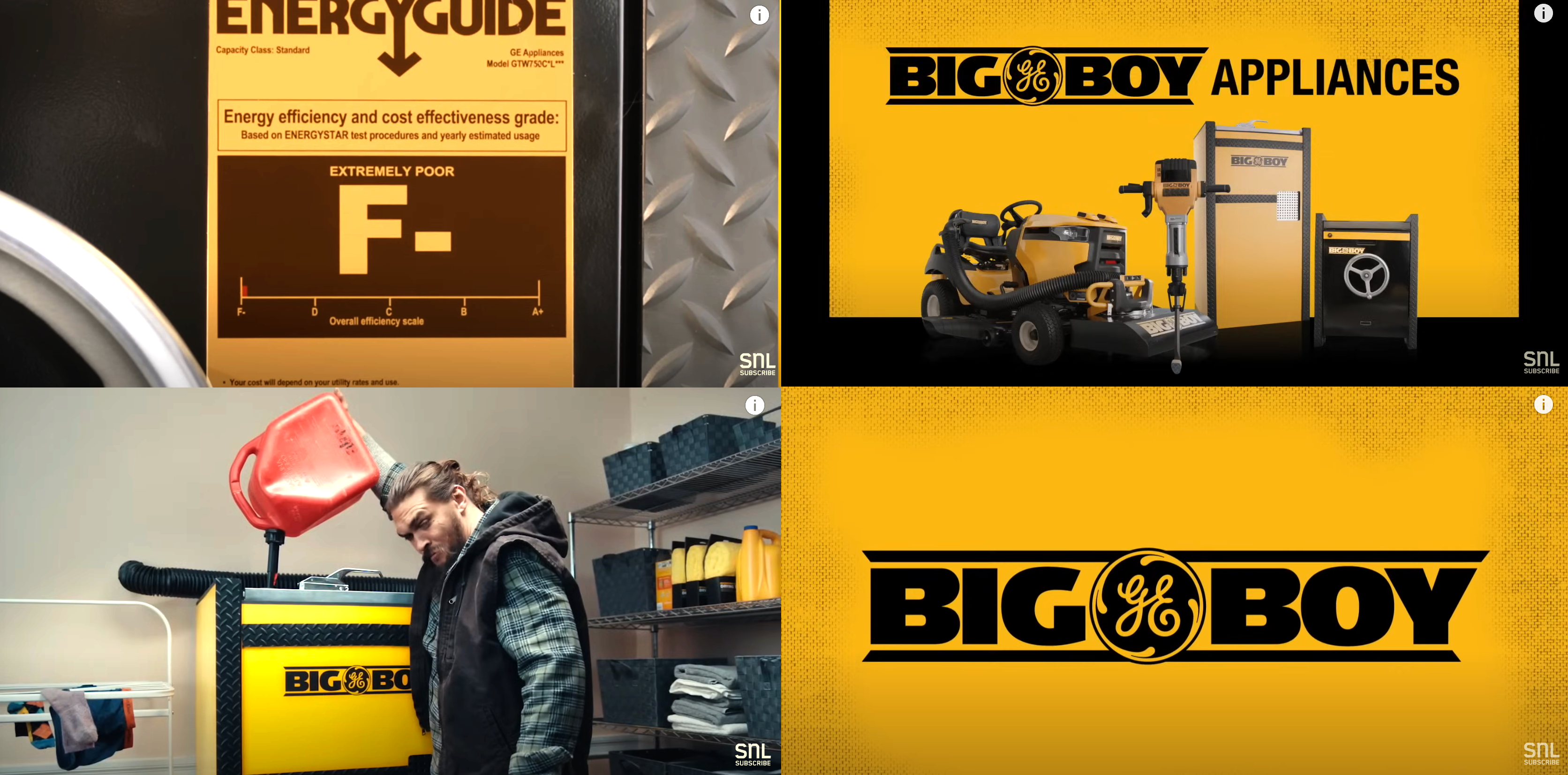
Enfin, la fin de la fausse publicité inverse le trope de la housewife qui sʼadresse sur un ton de connivence aux consommatrices. Lʼacteur suggère ainsi aux téléspectateurs : «  Sois un homme en cette période de Noë l et demande à ta femme de tʼacheter les équipements GE Big Boy  »757. Lʼinterprétation du clip impose la prudence : elle peut sembler progressiste, dans la mesure où elle tourne en dérision le besoin de validation de leur virilité des hommes cisgenres hétérosexuels ; mais elle présente aussi une impasse. Les formes prises par les objets sont si absurdes quʼon peut en déduire quʼil nʼexiste pas de levier de design qui puisse inciter les hommes à faire les tâches ménagères.
Dans des champs très différents, le projet Dolphia/Mega Hurricane et le sketch de SNL peuvent solidifier la binarité quʼelles critiquent. Toutefois, ils ont aussi le mérite de déplacer la traditionnelle opposition travail domestique/travail en entreprise, ou sphère publique/sphère privée. Si cette dernière opposition sʼentend (avec les complexités que nous avons précédemment évoquées), elle doit aussi être associée à la seconde binarité qui partage le logis, entre travail domestique féminin (de la cuisine à la lessive) et travail domestique masculin (poubelles, bricolage, entretien de la maison). Le champ du bricolage doit particulièrement nous intéresser parce quʼil a régulièrement été mobilisé dans lʼhistoire du design comme une forme vernaculaire pouvant informer la pratique professionnelle des designers. La valorisation du bricolage et, à travers lui, dʼune figure du «  bricoleur  » à même dʼinformer positivement la pratique du design, peuvent participer tour à tour dʼune fascination nostalgique (Marion 2016, 132), dʼune méthode mobilisée pour ses ressources créatives758 (porosité à lʼaccident), ou encore dʼune économie visuelle utilisant la séduction des formes759 associées au DIY ou au fait-main. Il est significatif que la discipline du design cherche à résoudre ses contradictions ou enrichir ses pratiques en regardant du côté de pratiques liminaires ou hybrides qui ne relèvent pas premièrement de son champ. Toutefois, il est tout aussi intéressant de constater la masculinité de cette figure du bricoleur, quʼil soit du dimanche ou non. Même son versant raté ou destructeur, le «  carambouilleur  » que le chercheur en design Gregory Marion décèle chez Charlot (2016, 133–35) apparaît par défaut comme un homme. Ainsi, les inversions de genre qui se produisent si facilement, en design ou en comédie, entre lʼespace de la cuisine et celui du garage du bricoleur, ne sont pas seulement intéressantes pour les formes étonnantes quʼelles produisent, mais aussi en ce quʼelles font émerger le creux immense, laissé dans lʼhistoire du design, par le surinvestissement du bricoleur et le délaissement concomitant de la boniche. Approchée de cette manière, la revalorisation de la housewife nʼapparaît pas seulement comme une nécessaire cause féministe, mais comme une lacune épistémologique à combler, au cÅ“ur de la discipline du design. Mais de quoi cette figure pourrait-elle être le nom, si le bricoleur a déjà condensé nostalgie et formes du faire ? Je mʼattacherai plus loin à déployer ces possibles rôles, mais il me faut tout dʼabord considérer la manière dont les appareils ménagers ont empouvoiré ou désempouvoiré la ménagère, et comment ces promesses de libération se sont cristallisées.
Jʼai évoqué plus tôt la nécessité pour le design de penser des paysages dʼobjets -— une vieille idée, que lʼon trouve déjà , entre autres, chez les radicaux Italiens dans la synthèse de leur travail rendue visible dans lʼexposition The New Domestic Landscape (1972). La pensée systémique de lʼhabitat me semble manquer aux objets, et pourtant : lʼélectroménager a bien existé dans de vastes paysages avant dʼêtre disséminé dans les intérieurs. Les objets de la cuisine, électrifiés ou non, ont dà » être popularisés avant dʼêtre vendus en masse, et les foires et autres lieux dʼexposition ont joué un rôle clé à cet égard, bien avant la période après-guerre que lʼon associe traditionnellement à la grande consommation. Le Salon des arts ménagers, qui ouvre pour la première fois ses portes en France en 1923, pense en effet «  le cadre de vie dans sa globalité  » (Bula 2022, 29). Interrompu pendant la guerre, il se tiendra jusquʼen 1983 (36) après sʼêtre déplacé dans différents lieux, dont le Grand Palais à Paris à partir de 1926 où il sʼétend sur 35 000 m2 (Bouillon & Bula 2022, 11; Furlough 1993, 503 ; fig. 4.39). Le salon va permettre, durant ses quelques soixante années dʼexistence, dʼexposer de nouveaux produits sur des stands de fabricants ou dans des expositions thématiques. Par exemple, un espace est dédié en 1954 à lʼexposition «  Si vous étiez des enfants  », assemblée par Pierre Faucheux et Paul Faucher, le créateur des albums du Père Castor (Bouillon & Bula 2022, 12–13) : elle présente des meubles agrandis pour faire vivre aux spectateurices adultes les difficultés des enfants à agir avec ces dispositifs qui nʼont pas été prévus pour elleux. Le Salon des arts ménagers est en effet «  une grande fête populaire  » «  visité[e] en famille  » (Bouillon & Bula 2022, 11), en même temps quʼun événement commercial, dans lequel on peut tester, regarder des démonstrations, acheter, et même croiser des stars venues sʼexposer dans le cadre de leur promotion -— mais cela nʼempêche pas ses organisateurs de donner à leur événement dʼautres fonctions, comme celle de lʼéducation populaire (Bula 2022, 120). Il sʼagit de viser le «  progrès social  » (Bouillon & Bula 25–27), en connexion avec des objectifs natalistes après-guerre (12) et les grands projets urbanistes dʼalors.

Si, au début du XXe siècle, ces grandes expositions sont perçues comme de gigantesques fêtes à lʼaméricaine, elles sont adoptées plus tard par les Français·es. La foire nʼest donc pas une typologie nationale dʼévénement, mais elle servira, par exemple dans le cas du Salon, à diffuser une forme de bon goà »t et de savoir-vivre à la française (Furlough 1993, 495). Les foires, et le Salon qui en est un exemple, sont des jumelles des expositions universelles : elles font aussi la promotion dʼune modernité accomplie par la technologie, mais elles rattachent cette promesse à un acte dʼachat. Il serait alors tentant de considérer le Salon comme une performance bourgeoise à destination de cette classe et ce fut dʼailleurs un des reproches qui lui furent adressés par la gauche française (Bouillon & Bula 28). Cependant, dans ses objectifs, le Salon affiche dʼautres ambitions, dont celle de faire de lʼart ménager un «  facteur dʼunification sociale  » (29). Si les objets proposés peuvent sʼinscrire dans un processus de distinction de classe, la démocratisation de ces produits fait partie de lʼéthos affiché de lʼévénement. En outre, dʼautres enjeux politiques traversent le Salon. Il est lʼoccasion pour certaines personnalités dʼasseoir leur expertise : Paulette Bernège est ainsi membre du comité dʼorganisation du Salon et éditrice de la revue LʼArt Ménager liée à son succès (Furlough 1993, ; Cardoso 2018, 100). En concordance avec cette défense dʼune science ménagère, sont organisés les concours «  Meilleure ménagère  » et «  Fée du logis  ». Lʼexpertise domestique nʼest pas le seul sujet mobilisé : en 1934–36760, la journaliste et activiste Louise Weiss propose une performance avec son groupe de suffragettes, la Femme Nouvelle. Ensemble, les femmes du groupe cuisinent pour des journalistes invités à cette occasion (Bouillon 2022, 152), sur une table habillée dʼune affiche sur laquelle il est écrit «  La Française doit voter  ». Le 8 mars 1975, une action du MLF consistera à occuper le Salon, en protestant contre les «  gadgets ménagers  », rejetés en faveur dʼéquipements collectifs (154–55). Les problématiques de genre sont donc au cÅ“ur du Salon, parce quʼil cible explicitement les femmes, quʼelles soient des ménagères accomplies ou des employées cherchant à gagner du temps dans le soin accordé à leur maison. De ce fait, le Salon offre, à défaut dʼun véritable espace critique, un lieu de mobilisation des signes de lʼoppression des femmes. Jʼy reviendrai ci-après, lorsque jʼévoquerai la «  Marie mécanique  » qui constitue la base de la communication du Salon, ainsi que son détournement par des groupes féministes des années 1970.
Le Salon participe à démocratiser les objets électroménagers et autres accessoires ; plus que dʼen faire la promotion individuelle, il les inscrit dans des espaces de référence, et permet de projeter, au-delà des usages, un style de vie moderne facilité par lʼélectrification et lʼappareillage. Mais ce «  modernisme  » nʼest pas aussi univoque que lʼon pourrait le croire. Le Salon, à cet égard, est un lieu de contradictions et de tensions, et pas seulement parce que ses images souvent passéistes font réagir les suffragettes puis les féministes du MLF. Au niveau des formes et de la production industrielle aussi, les paradoxes sont légion. La sociologue Odile Henry résume ainsi :
La participation active de la Ligue de lʼorganisation meÌnageÌ€re au Salon des arts meÌnagers tend aÌ€ marquer cette institution du coÌ‚teÌ des patrons ‹ modernistes ›. Mais cette attirance pour la ‹ moderniteÌ › est aussitoÌ‚t contrebalanceÌe par les prises de positions ‹ passeÌistes › de la fondatrice de la Ligue [Paulette Bernège] qui, aÌ€ partir des anneÌes 1930, consacre un certain nombre dʼarticles aÌ€ la ceÌleÌbration du mode de vie paysan et aÌ€ la deÌploration de son affaiblissement. Dʼautre part, si P. BerneÌ€ge prend le parti de la meÌcanisation des taÌ‚ches domestiques, elle justifie ce point de vue par le fait que la femme moderne doit deÌsormais se passer de personnel de maison et ‹ tout faire par elle-meÌ‚me ›, rejoignant alors la vision des partisans de lʼauto-production (2003, 133).
Cʼest donc une modernité négociée qui émerge au Salon : on se modernise pour garder un rôle ancien, voire développer ce dernier. Par ailleurs, si les organisateurs de lʼévénement et les commentateurices des médias mobilisent le Salon comme emblème national, il est aussi le lieu de transmission dʼun style de vie bourgeois à lʼaméricaine (Furlough 1993, 505 ; 509). En France, après-guerre, on repousse volontiers avec force cette américanisation perçue des mÅ“urs mais, dans les faits, les objets et les usages qui les accompagnent sont intégrés à la vie quotidienne. Le Salon fait donc la promotion des dernières innovations ménagères, offre des stands à des marques comme Frigidaire, Singer ou Kelvinator (504) mais se tourne aussi vers un passé national, notamment avec lʼexposition «  lʼart ancien dans la vie moderne  » (Bula 2022, 30) qui présente des objets domestiques du passé en lien avec le musée des Arts et Traditions Populaires et un syndicat de négociants (ibid.). Ce regard vers les traditions est connecté à des entreprises contemporaines qui sʼattachent, quant à elles, à comprendre et à projeter les implications de la production industrielle de masse. Cʼest le cas de Formes Utiles, qui possédera pendant 30 ans son exposition au Salon (Leymonerie 2016, 27). Son porte-parole André Hermant sʼinscrit bien dans ce rejet du modèle étasunien : il nʼadhère que partiellement à lʼindustrialisation de la production (32), déteste Raymond Loewy (40) et juge sévèrement lʼapparition des plastiques, auxquels il préfère le «  quatuor ciment, verre, métal, électricité  » (39).
Poser la question de la modernité du Salon, et de son influence sur notre conception des intérieurs dʼaujourdʼhui, revient donc à rencontrer un paysage complexe et contradictoire. Ce sont en fait plusieurs modernités qui se concurrencent et sʼentrechoquent dans lʼespace du Salon, et sans doute dans les cuisines qui accueillent les achats réalisés sur les stands. Il existe dʼabord la modernité de la forme, et avec elle, la modernité du récit quʼelle sous-tend. Mais dans ce récit, combien de paradoxes ? Ellen Furlough résume bien le piège de la modernisation du logis, lorsquʼelle écrit au sujet des femmes que «  les agents de leur ‹ libération › étaient domestiques  »761. Lʼespace de la cuisine, conçu comme une forme hors du temps, à la fois en raison de sa quotidienneté et de son lien à lʼauthenticité, est aussi relié à la forme moderne du temps occidental progressiste, soit la flèche tendue vers un avenir (meilleur sʼentend). Le Salon incarne à plus dʼun titre ce rêve de totalité : cʼest le désir dʼun objet pour chaque besoin, ce sont des milliers de mètres carrés couverts dʼidées et de solutions, et ce sont enfin des temporalités contradictoires et complémentaires, celle du primitif et du futuriste, qui sont rassemblées en son sein. Catherine Geel et Claire Brunet semblent nommer cet aspect en le reliant à la discipline du design, lorsquʼelles écrivent que «  le rapport du design à la modernité, régulièrement caricaturé, cache en fait souvent le rapport de la discipline à sa propre modernité  » (2022, 197). On pourrait retourner cette affirmation : à chaque fois quʼil est question de ligne, de matériaux, de lʼéthos du carter et de son absence, il est en réalité question de futur, des futurs, et ce qui peut sʼimaginer en termes de styles de vie. Cʼest là une question qui est déterminante pour les femmes, car ces objets, en même temps quʼils sʼorganisent pour accompagner le geste ou faire gagner du temps, assignent une place à la ménagère. Je vais montrer ce quʼil advient de ce rôle, voire de cette figure, dans quelques cuisines «  du futur  » qui ont traversé lʼhistoire du design.
En 1899 paraît une collection dʼimages, En lʼan 2000, dessinées par Jean-Marc Côté pour lʼExposition Universelle (fig. 4.40 ; Hong 2021). Ces images offrent des aperçus de la vie quotidienne cent ans après leur fabrication, telle que leur auteur se la représente : les agriculteurs dirigent leurs champs depuis un poste de contrôle, les architectes donnent eux aussi leurs ordres depuis une cabine téléguidée, et le fait même de donner du grain aux poules implique une machine. Ces cartes ne seront pas produites pour lʼexposition faute de budget762, mais elles nous intéressent parce quʼelles impliquent que tous les métiers sont redéfinis par la machine, selon des modalités qui relèvent de lʼexternalisation.
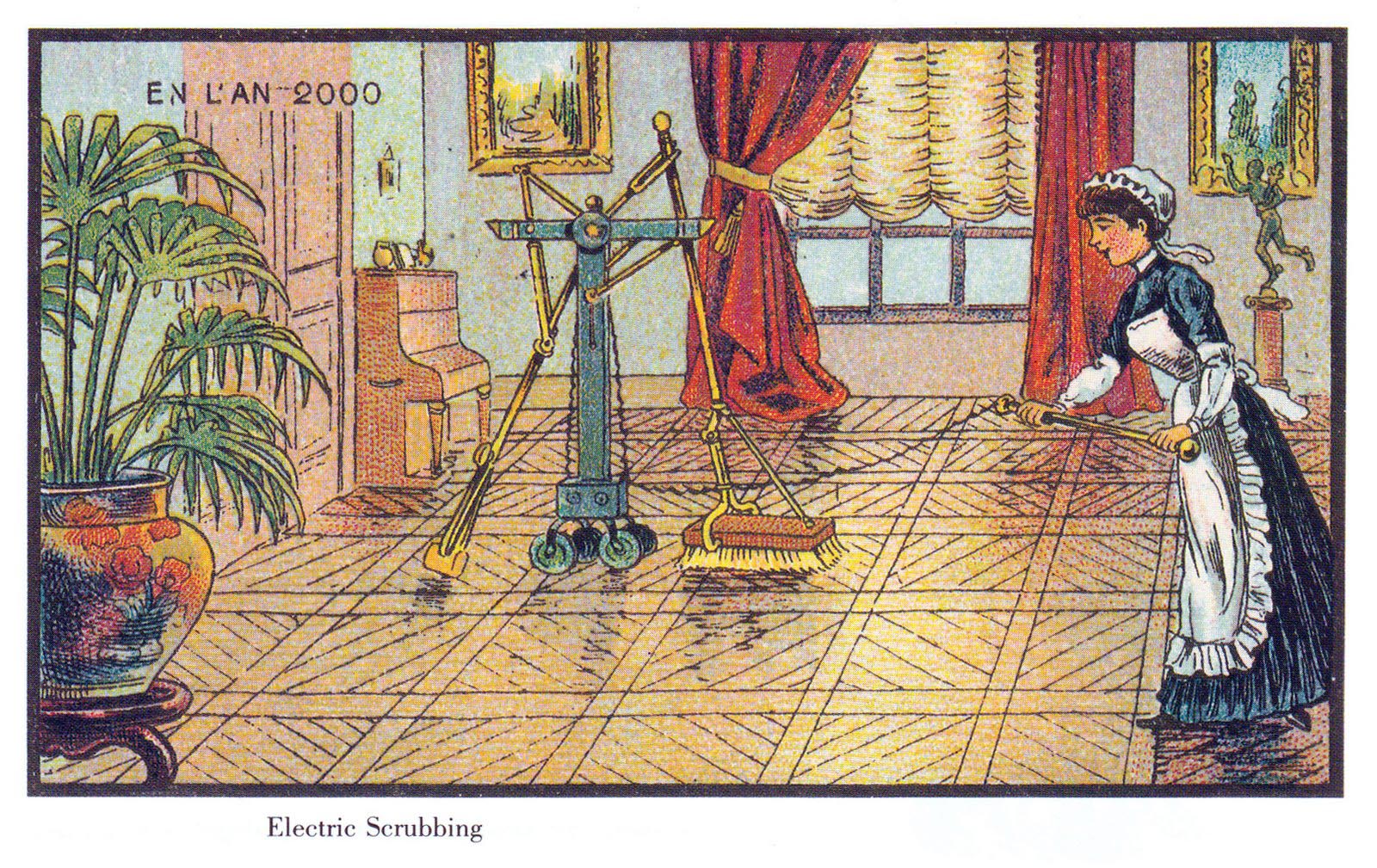
Les cartes qui concernent notre sujet sont saturées dʼimplicites que nous avons déjà croisés : une machine sʼoccupe du travail ménager, mais elle est encore supervisée par une servante en livrée (fig. 4.40) ; la cuisine devient un laboratoire et, ce faisant, devient peuplée dʼhommes en toques ; enfin, le dîner ressemble bien à un moment festif de 1900, si ce nʼest que la légende de lʼimage mentionne «  un dîner chimique  ». Mon écrit se donne pour tâche dʼexaminer les possibles de la cuisine grâce à une boîte à outils transféministe : il cherche donc à projeter des futurs souhaitables ou envisageables pour cet espace et ses usages. À ce titre, il est utile de regarder ces «  futurs du passé  », pour deux raisons au moins. Premièrement, lʼimage passée du futur, peut-être précisément parce quʼelle est touchante de naïveté ou complètement risible, a le pouvoir de révéler ce que nos images actuelles du futur ont de déjà obsolète. Deuxièmement, il apparaît aussi, à lʼétude, que rien nʼest plus intemporel que les imaginaires de demain tant certaines images sont tenaces : je pense par exemple à la fameuse «  voiture volante  » ou à lʼécran transparent qui continuent dʼapparaître régulièrement dans les récits de science-fiction quand bien même elles sont promises depuis cent ans, sans avoir jamais trouvé dʼactualité, et sans peut-être avoir de raison dʼêtre autre que leur pouvoir de séduction et leur persistante répétition.
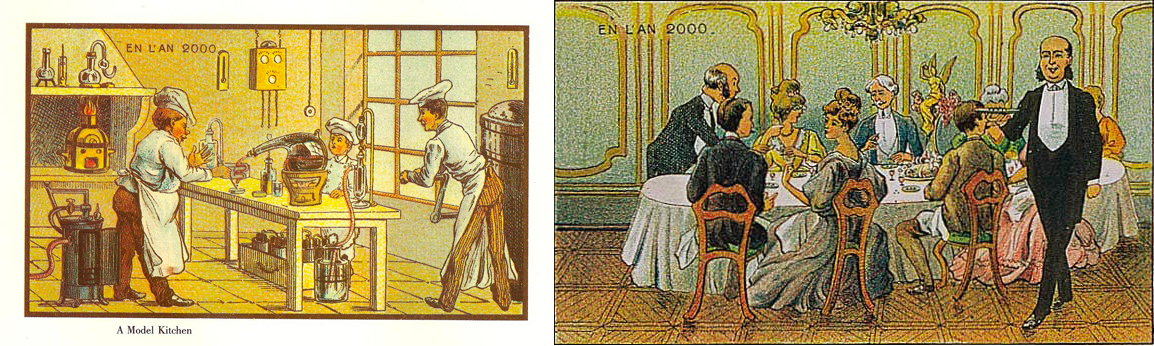
Le futur, «  lubie du présent  » (Bublex & During 2014, 11), peut-il être autre chose quʼun argument de vente ? Déjà , dans les médias qui commentent le Salon des arts ménagers, émerge quelque chose dʼune conscience de la volatilité de ces promesses ; on lit ainsi dans Le Maine Libre en 1950 : «  Vous envierez le robot […] et repartirez avec le moutardier  » (Bouillon 2022, 93). Pour autant, on nʼa pas cessé au XXe siècle de présentiser le futur, par lʼentremise de lʼarchitecture et du design. Lʼexposition -— dont le Salon est une occurrence commerciale -— et la maison modèle sont deux moyens de faire habiter au public des usages possibles. Il sʼagit dʼune typologie de lieu ambiguë  : ni complètement publique, puisquʼelle reproduit lʼespace privé, ni privée dans la mesure où elle est ouverte au public763. Avant que la maison ne soit simulée pour présenter des produits disponibles à lʼachat, comme cʼest le cas aujourdʼhui dans les enseignes IKEA, il a donc existé de multiples avatars de ces maisons du futur. En 1907, Georgia Knap propose dans sa villa Feria Electra à Troyes (puis dans deux appartements parisiens) un espace raccordé au maximum dʼappareils électriques, contrôlables par la voix (Boeglin 2022, §17). fig. 4.40.a : Quelques maisons du futur (du passé) : 1933, House of Tomorrow par George Peck, [en ligne], http:
fig. 4.40.a : Quelques maisons du futur (du passé) : 1933, House of Tomorrow par George Peck, [en ligne], http:

Enfin, ce panorama incomplet, étant données les limites de ce chapitre, doit pourtant faire la place au Futurama de Norman Bel Geddes764, présenté à la foire de New York en 1939 (Midal 2009, 74–75, fig. 4.40.c). fig. 4.40.c : Quelques maisons du futur (du passé) :
c. 1939, Futurama de Norman Bel Geddes. La maison électrique reste une typologie récurrente de ces expositions : en 1955, une installation portant ce nom est parrainée par les revues Paris Match et Marie-Claire (Cocault 2022, 116 ; Chauvin & Gencey 2013). Paris Match tient auparavant des chroniques régulières sur le Salon, et notamment ses «  cuisines merveilleuses  » où pose lʼactrice Geneviève Page.
fig. 4.40.c : Quelques maisons du futur (du passé) :
c. 1939, Futurama de Norman Bel Geddes. La maison électrique reste une typologie récurrente de ces expositions : en 1955, une installation portant ce nom est parrainée par les revues Paris Match et Marie-Claire (Cocault 2022, 116 ; Chauvin & Gencey 2013). Paris Match tient auparavant des chroniques régulières sur le Salon, et notamment ses «  cuisines merveilleuses  » où pose lʼactrice Geneviève Page.

Lʼêtre en cuisine est construit par les objets mais aussi par leur mise en scène dans des appartements témoins aux objectifs divers. Pour Geneviève Bell & Joseph «  Jofish  » Kaye, ces maisons sont des «  vision houses  »â€¯: habitées par des acteurices (parfois professionnel·les, comme je le mentionne ci-dessus), elles sont autant des objets de design que des formes spectaculaires (2002, 56). Cette destinée de la maison témoin comme espace de divertissement est sans doute la plus lisible dans la House of the Future, proposée par Monsanto en partenariat avec le MIT et exposée à Disneyland en 1957 (Ward Jandl 1991, 206 ; (fig. 4.40.d & e). Ici encore, on voit à quel point les imaginaires du futur ne sont pas seulement techniques, mais toujours techniques en même temps que merveilleux. La rationalité de la proposition est étroitement tressée avec la magie, le goà »t de lʼirréel et dʼun espace idéal, utopique, accessible sans lʼêtre. Il faut que la cuisine de rêve puisse être touchée du doigt, mais quʼelle soit suffisamment différente de ce que connaît le grand public.

Ainsi, certaines solutions offertes par ces maisons reposent plus sur un goà »t de lʼécart que sur un véritable questionnement des usages. Dans une des vidéos promotionnelles qui explorent le lieu se déploie cette association entre curiosités et formes familières. Le film commence par une incitation à rêver : «  imaginez comme il serait merveilleux de vivre dans une maison comme celle-là … essayez seulement dʼimaginer…  »765.
La housewife, dont lʼhabillement est typique du style des années 1950 (robe ample cintrée à la taille, mise en plis) nous guide dans sa cuisine tandis quʼun homme, en voix over, commente les innovations de demain : lave-vaisselle à «  ondes infrason  »766 ou encore espaces de stockage montés sur vérins, qui sortent des placards avec une lenteur qui contredit à la fois le bon sens et les projets de rationalisation domestique du siècle précédent. Dʼailleurs, on ne parle plus de réfrigérateurs ou de congélateurs mais de trois «  zones froides  »767 ; la dernière est dédiée à la «  nourriture irradiée  »768, ce qui à lʼâge de lʼAtome, avant Tchernobyl, était probablement engageant. Il sʼagit ici de signifier le futur à partir de sa différence : en revanche, la famille nucléaire ne change pas. Selon lʼaxiome propre aux classes dominantes, «  il faut que tout change pour rien ne change  »769. On redistribue donc avec plaisir le frigidaire, le four ou la lumière, tant que la cellule familiale et ses dynamiques sont inchangées ; parfois, il suffit de changer de nom pour donner lʼillusion du nouveau.
Jʼai évoqué plus tôt la manière dont la cuisine est aujourdʼhui une «  cuisine médiatique  » (cf. infra., p. XX) avec lʼavènement des YouTubeur·ses et autres influenceur·ses : on voit ici que ce modèle est en réalité ancien. Ces appartements et maisons témoins qui se multiplient au cours du XXe siècle, en invitant à faire imaginer le futur, créent des formes dʼhabituation à des usages à venir, en même temps quʼelles projettent des habitus contemporains associés à des normes de genre, classe et race. Elles procèdent à cette mise en spectacle par le design, et par lʼassociation du design à des formes audiovisuelles. La pièce à vivre est un espace de référence, mais aussi, au niveau macro pour un effet immersif, la maison ou même la ville (quoiqu’en modèle réduit, dans le Futurama de Norman Bel Geddes). Il est donc intéressant de regarder comment deux contenus audiovisuels, tournés dans le même espace témoin, peuvent générer des récits relativement différents.
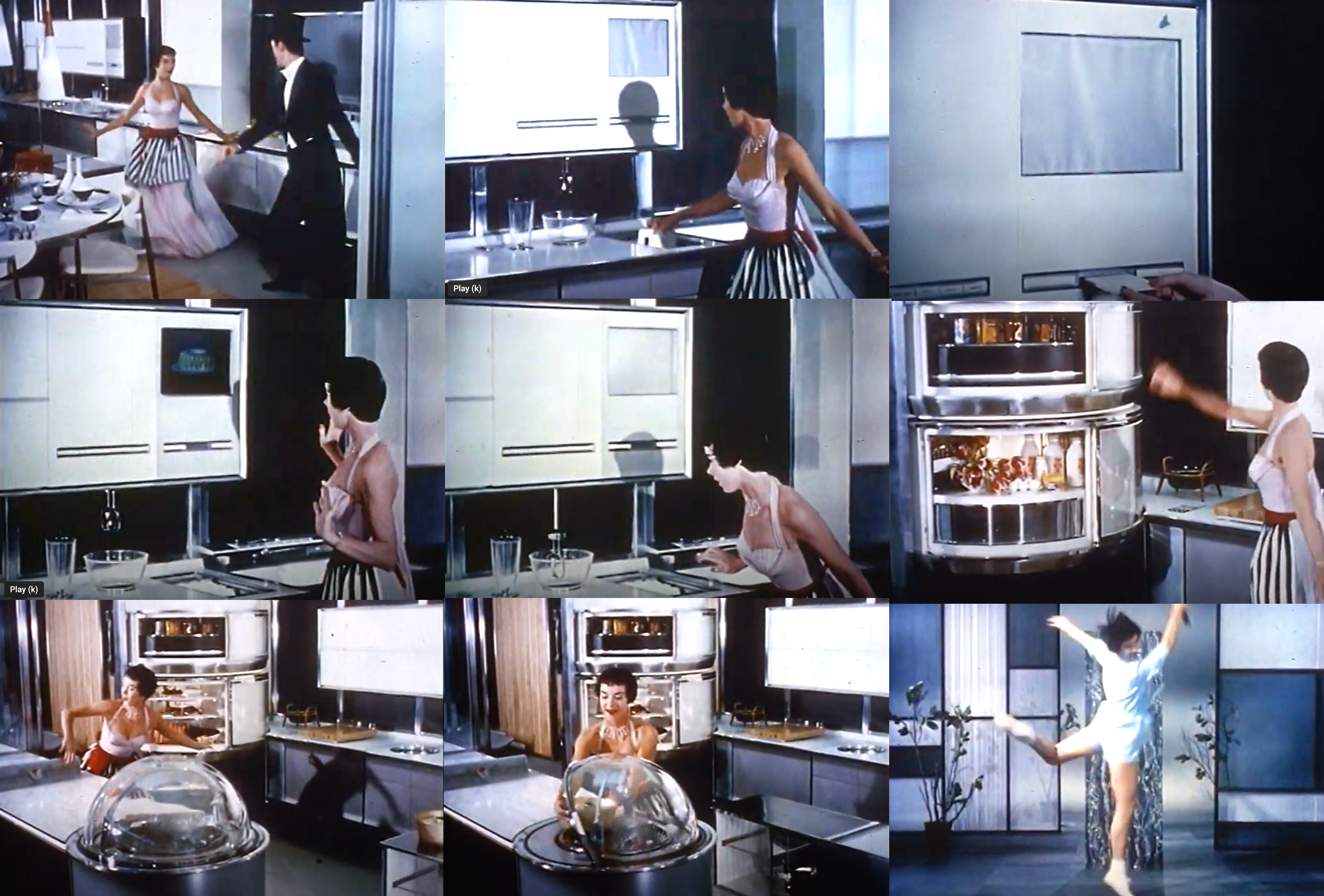
«  Design for Dreaming  » est une vidéo promotionnelle de 1956 financée par la General Motors, qui utilise les codes de la comédie musicale. Dans celle-ci, on voit une femme, au lit, être interpellée (en rêve ?) par un «  prince charmant  », plutôt habillé comme Fantômas (fig. 4.42.a), qui lui propose de lʼemmener «  dans le lieu où demain rencontre aujourdʼhui  »770. Elle quitte en un clin dʼœil son pyjama771 pour adopter une tenue de soirée et découvrir une sorte de showroom où sont présentées les voitures de la General Motors. Submergée dʼémotion, elle sʼévanouit, ce qui fait dire à un homme de lʼassemblée : «  Hey, ma chère, on voit votre tablier !  »772. Un autre (le prince charmant ?), plus pragmatique, sʼexclame : «  on ferait mieux de lʼemmener dans sa cuisine, et vite !  »773. Le rêve de promotion sociale, évoquant de manière très claire le conte de Cendrillon, sʼouvre donc sur un autre espace fantasmatique. Dans la cuisine, on retrouve lʼascenseur comme signifiant incertain du futur quand les fouets dʼun batteur à œufs descendent dʼun placard. Aussi le réfrigérateur devient-il un carrousel transparent, et on peut accéder à des recettes sur un écran en insérant dans une fente des cartes perforées. Une marmite (à la forme traditionnelle) arrive sur un trolley mu par une force inconnue.Tous les ingrédients sont ensuite placés dans un four dont le fonctionnement reste mystérieux, et pour cause : il est situé à lʼintérieur dʼun dôme transparent. Pendant que sa préparation cuit, la ménagère passe hors champ, et en disparaissant derrière une large sculpture à la César, change rapidement dʼaccoutrement, pour adopter une tenue de golfeuse, de tenniswoman ou encore un maillot de bain. Alors quʼelle change magiquement de vêtements, la jeune femme chante : «  tic, tac, tic, tac, je mʼamuse vingt-quatre heures sur vingt-quatre  »774. Quand finalement le minuteur sonne, un gâteau apparaît spontanément sous le dôme et les bougies dʼanniversaire sʼallument toutes seules. La vidéo se termine avec de nouvelles visions automobiles, sur «  lʼautoroute du futur  » (qui semble, de manière presciente, tourner en rond) et le chant de la ménagère qui invoque les temps à venir («  Demain… Demain…  »775). Il est vrai que, plus tôt, elle déclarait que «  certains disent que le futur est étrange, mais jʼai le sentiment que certaines choses ne changeront pas  »776. Demain est encore une fois chanté pour mieux assurer le sentiment de permanence.
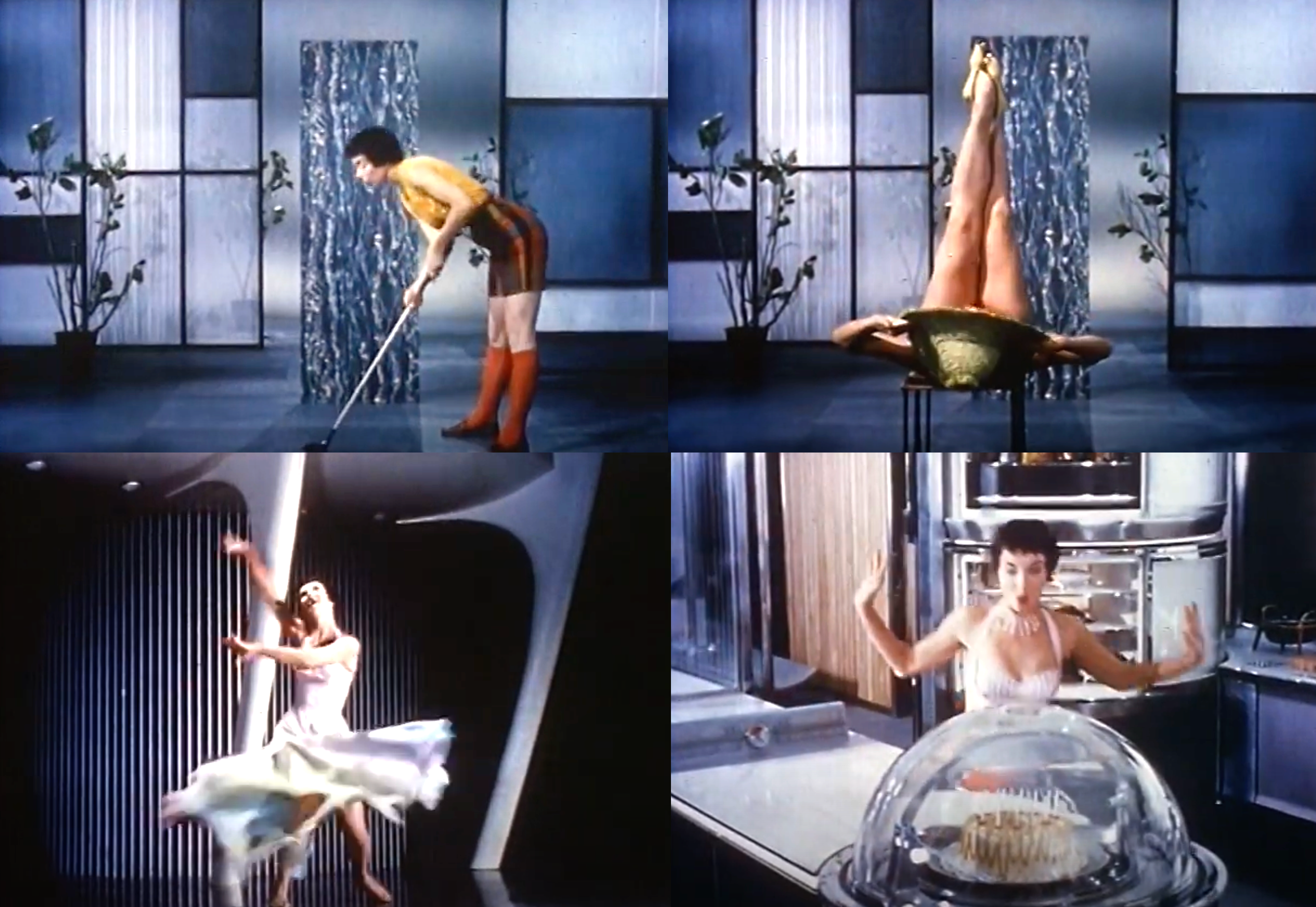
La cuisine que lʼon découvre dans «  Design for Dreaming  » a été investie de multiples manières. En France, elle est étiquetée comme «  cuisine de lʼan 2000  », «  cuisine atomique  » ou encore «  cuisine ultra-sonique  » (Bouillon 2022, 103) et elle est présentée en 1957 au Salon des arts ménagers (fig. 4.42.c). Les Actualités Françaises, alors diffusées en amorce des programmes au cinéma, montrent cette cuisine avec une approche beaucoup plus pragmatique. Pourtant, ce sont les mêmes accessoires qui sont exposés, mais avec de gros plans plus appuyés, et sans tout le support narratif et musical de «  Design for Dreaming  ». Seulement, les batteurs à œufs sur vérins ou encore le dôme transparent font partie dʼun bloc qui est associé dans ce cas à une autre unité. Ressemblante à un bureau, elle apparaît comme une sorte de station de contrôle à partir de laquelle la ménagère peut «  transmettre sa commande par téléscripteur  ». Il est prédit que «  le boucher vous fera lui-même ses présentations  » par retransmission télévisée. Les images sont bien étasuniennes, comme le révèlent les quelques éléments écrits qui apparaissent à lʼécran, ainsi que le doublage de la housewife par la voix over, masculine. Lʼapproche est ici résolument illusionniste : on suit une femme dans la préparation de son dîner. Mais le commentaire prend tout de même en charge la dimension fantasmatique de ce qui est présenté, dès ces premiers mots : «  Faisons un rêve  » «  qui sera la réalité de demain  ».
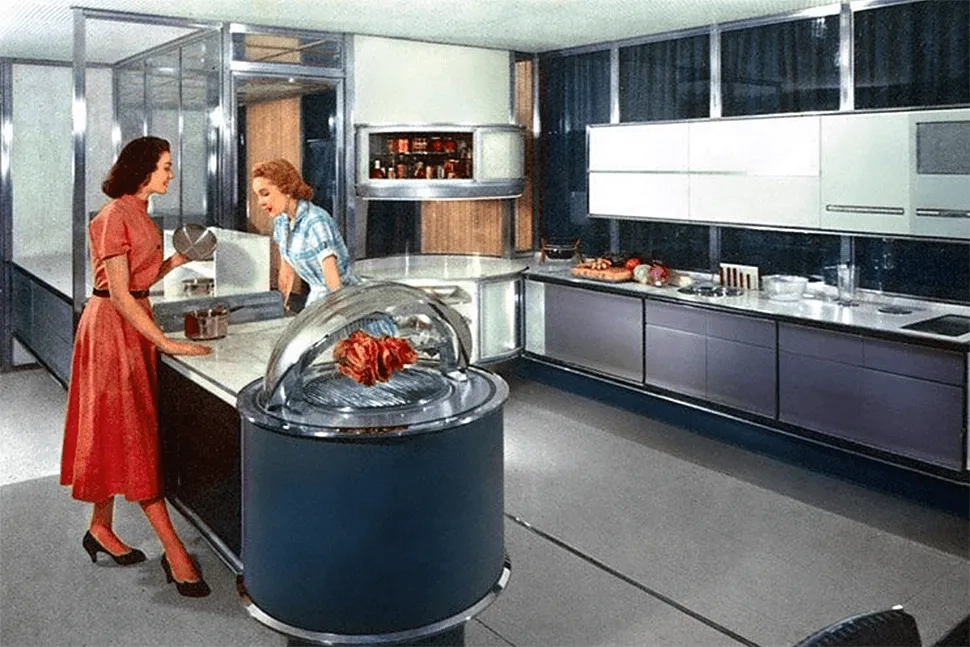
Lʼaspect scientifique est aussi convoqué quand surgit le mot de «  laboratoire  »â€¯; ailleurs, la relation dialectique entre tradition et modernité nʼest nulle part plus lisible que dans la présentation des plaques de cuisson, «  en marbre dʼItalie  », mais fonctionnant par induction. Dans ce contenu audiovisuel, il est question dʼ«  audaces  » qui sont plus ou moins réalistes : le distributeur de glaçons permet de faire imaginer une distribution de boissons chaudes et froides «  par pipeline  » et la farine, quant à elle, tombe dʼun réservoir invisible à lʼécran. Le poulet sera cuit dans le dôme transparent, de manière plus lisible que le gâteau de «  Design for Dreaming  »â€¯; il est indiqué que la cuisson sʼeffectue «  aux infrarouges  ». Enfin, le commentateur nous promet quʼil sera inutile de porter le poulet jusquʼà la table des convives, puisquʼun trolley sʼen chargera. Ici, on rencontre un biais de design typique des représentations futuristes : pour obtenir lʼimage séduisante dʼun poulet qui se sert tout seul à la table, il faut imaginer creuser un sillon dans le sol, auquel serait arrimée de manière permanente une lourde console… Autant dʼefforts pour économiser le port dʼune charge légère sur deux mètres à peine. Il sʼagit bien ici dʼune différence qui signifie le futur, plus quʼelle ne le projette, au sens fort que la discipline du design donne à ce mot.
Tout ceci nʼempêche nullement la vidéo dʼêtre conclue par une réponse à son éventuel potentiel anxiogène, lorsquʼelle évoque ces «  dispositifs modernes où le robot a pris la place de lʼhomme777  ». Le danger est aussitôt désamorcé, car «  [l]e robot ne sait pas encore découper le poulet  », comme le montre lʼimage correspondante. Lʼobservation est significative : à aucun moment ces robots ne remplacent «  lʼhomme  ». Éventuellement, ils suppléent lʼépouse dans des tâches qui sont toujours vues comme les siennes et pourtant, le doute est bien présent, même sʼil constitue une note humoristique. Celle-ci touche à une angoisse de genre dont les ramifications sont multiples. Pour les hommes, lʼimage de la femme couplée à la machine constitue un réservoir dʼanxiété, et incarne potentiellement la peur dʼêtre remplacé. On verra plus loin que dʼautres représentations de «  femmes robotiques  » tâchent justement dʼutiliser cette augmentation du corps féminin comme une réduction de ses possibilités dʼagentivité. Enfin, si de nombreux gadgets ne sont pas (ou pas encore) devenus une réalité, on peut observer quʼun paradigme majeur est ici esquissé : celui dʼune cuisine bureau, où il est possible de télétravailler. Le clip envisage un télétravail domestique (parler au boucher) mais ne prend pas la mesure de ce que le rapprochement cuisine-bureau laisse augurer : non pas un homme remplacé par les robots, mais plutôt une femme multitâches, capable de cumuler travail salarié et travail domestique.
Ce type de vidéos, quʼelles investissent le registre du merveilleux («  Design for Dreaming  ») ou quʼelles reposent plutôt sur une forme moderniste de rêve technologique, dessinent des formes de continuité dʼun objet à lʼautre, dʼun geste à lʼautre. Les actrices qui sʼy illustrent se meuvent dans ces décors en dansant778, ce qui contribue au récit de facilité que visent ces contenus : même si le corps dansé peut être vu comme étant au travail, la danse est ici mobilisée pour suggérer lʼaisance et la légèreté. Lʼidée que tous les objets vont ensemble, et se connectent les uns aux autres avec facilité, peut aussi sʼinscrire dans les choix de design. Ainsi, plusieurs cuisines produisent visuellement et matériellement cette continuité grâce à une conception monomatériau. Cʼest le cas de la Day After Tomorrow Kitchen (1944–45) designée par H. Creston Dohner, qui repose sur une fabrication intégrale en verre (par la marque Libbey-Owens-Ford ; fig. 4.43) ou encore de la célèbre House of the Future (fig. 4.40.e) conçue par lʼentreprise Monsanto, et qui sera exposée à Disneyland comme je lʼévoquais plus tôt.

Elle est revendiquée comme une création toute en plastique, et la cuisine nʼéchappe pas à cette «  tupperisation  »779 générale (A. Clarke 2001). Cʼest encore une vidéo qui nous permet dʼavoir une meilleure vision dʼensemble de la proposition de lʼentreprise Monsanto. Dans «  House of the Future  », ce ne sont pas seulement des spéculations sur le lave-vaisselle à ultrasons ou les «  zones froides  » qui nous sont proposées, mais un rêve monomatériau. Tout ici est en plastique, de la vaisselle au mobilier, des murs au sol en vinyle. Ce «  rêve  » fait bien sà »r le jeu de fabricants qui souhaitent imposer leur produit (verre, plastique, et plus tard Corian, céramique ou cuir végan) comme la solution à tous les problèmes dʼhabitat. Leur objectif marketing rejoint dʼailleurs lʼobjectif de nombreux designers qui souhaitent autant que possible, dans la première moitié du XXe siècle, réunir tous les éléments de la cuisine de manière continue à la manière dʼun George Nelson et de sa «  kitchen work unit  » (Giedion 1948, 615), ou de la Day After Tomorrow Kitchen dans laquelle le gaufrier fusionne avec le plan de travail (fig. 4.43). On trouve encore des échos de ce rêve de fusion totale dans la cuisine monobloc Z. Island de Zaha Hadid (2006, fig. 4.44.a) ou la cuisine Alno780 (1971 et 1975, fig. 4.44.b). fig. 4.44.a : Cuisine de Zaha Hadid, Z. Island, 2006. Ces cuisines projettent finalement à grande échelle le rêve du tout-en-un incarné par certains appareils électroménagers : une coque unie et lisse, et toutes les fonctions possibles sous le capot. Le plastique se prête très bien à de telles propositions, tout comme le formica, à la fois «  cuirasse et parure  »781. On verra plus loin quʼà ce jeu de la fusion, les corps des femmes ne sont pas les derniers concernés.
fig. 4.44.a : Cuisine de Zaha Hadid, Z. Island, 2006. Ces cuisines projettent finalement à grande échelle le rêve du tout-en-un incarné par certains appareils électroménagers : une coque unie et lisse, et toutes les fonctions possibles sous le capot. Le plastique se prête très bien à de telles propositions, tout comme le formica, à la fois «  cuirasse et parure  »781. On verra plus loin quʼà ce jeu de la fusion, les corps des femmes ne sont pas les derniers concernés.
La vidéo qui présente la maison du futur de Monsanto peut nous sembler aujourdʼhui risible, tant elle cherche à provoquer lʼémerveillement devant le «  tout-plastique  ». fig. 4.44.b : Cuisine sphérique éditée par la marque Sheer, 2005. De nos jours, un tel projet évoque plutôt des objets de piètre qualité et des fonds marins ravagés par les déchets quʼune véritable utopie. Pourtant, de nombreuses vidéos promotionnelles prolongent aujourdʼhui encore ces imaginaires du matériau-solution qui vient habiller la maison, et en particulier la cuisine. Si lʼesprit du bloc a en partie été abandonné, on retrouve dans «  A Day Made of Glass  » (2011) un futur lisse et sans aspérités à tous les égards, que ce soit celui des usages ou des surfaces782. La promesse de fluidité est dʼailleurs contenue dans lʼaspect lisse du matériau verre vendu par la firme Corning. La vidéo multiplie les situations quotidiennes (fig. 4.45.b) pour faire la démonstration de la versatilité des usages de son matériau, mais, en y regardant de plus près, il apparaît quʼun seul usage domine : celui de lʼécran.
fig. 4.44.b : Cuisine sphérique éditée par la marque Sheer, 2005. De nos jours, un tel projet évoque plutôt des objets de piètre qualité et des fonds marins ravagés par les déchets quʼune véritable utopie. Pourtant, de nombreuses vidéos promotionnelles prolongent aujourdʼhui encore ces imaginaires du matériau-solution qui vient habiller la maison, et en particulier la cuisine. Si lʼesprit du bloc a en partie été abandonné, on retrouve dans «  A Day Made of Glass  » (2011) un futur lisse et sans aspérités à tous les égards, que ce soit celui des usages ou des surfaces782. La promesse de fluidité est dʼailleurs contenue dans lʼaspect lisse du matériau verre vendu par la firme Corning. La vidéo multiplie les situations quotidiennes (fig. 4.45.b) pour faire la démonstration de la versatilité des usages de son matériau, mais, en y regardant de plus près, il apparaît quʼun seul usage domine : celui de lʼécran.

Celui-ci est ubiquitaire (Citton 2023) et fait une apparition singulière en cuisine. En effet, la table de cuisson ne comporte plus aucune aspérité. Elle permet tout autant de faire chauffer une casserole, de régler la température de ce «  feu  » et de regarder les informations.

Il est frappant de constater à quel point cet imaginaire du plan de travail-écran est constant. Il est préparé par la «  cuisine du futur  », lorsquʼon voit la ménagère toucher du bout du doigt la surface à induction qui ne la brà »le pas (fig. 4.46). Elle se retrouve dans cette vidéo de 2011, mais aussi dans la IKEA Concept Kitchen 2025 proposée en 2015 par la marque.

Là , la table devient une surface vivante prenant en charge toutes les fonctions : elle détecte les ingrédients, effectue leur pesée et propose des recettes pour les associer ; elle tient le café au chaud ; elle recharge le smartphone ; elle chauffe les poêles et les casseroles. Elle donne même des indications précises sur la manière de couper un brocoli (fig. 4.47.a & b).

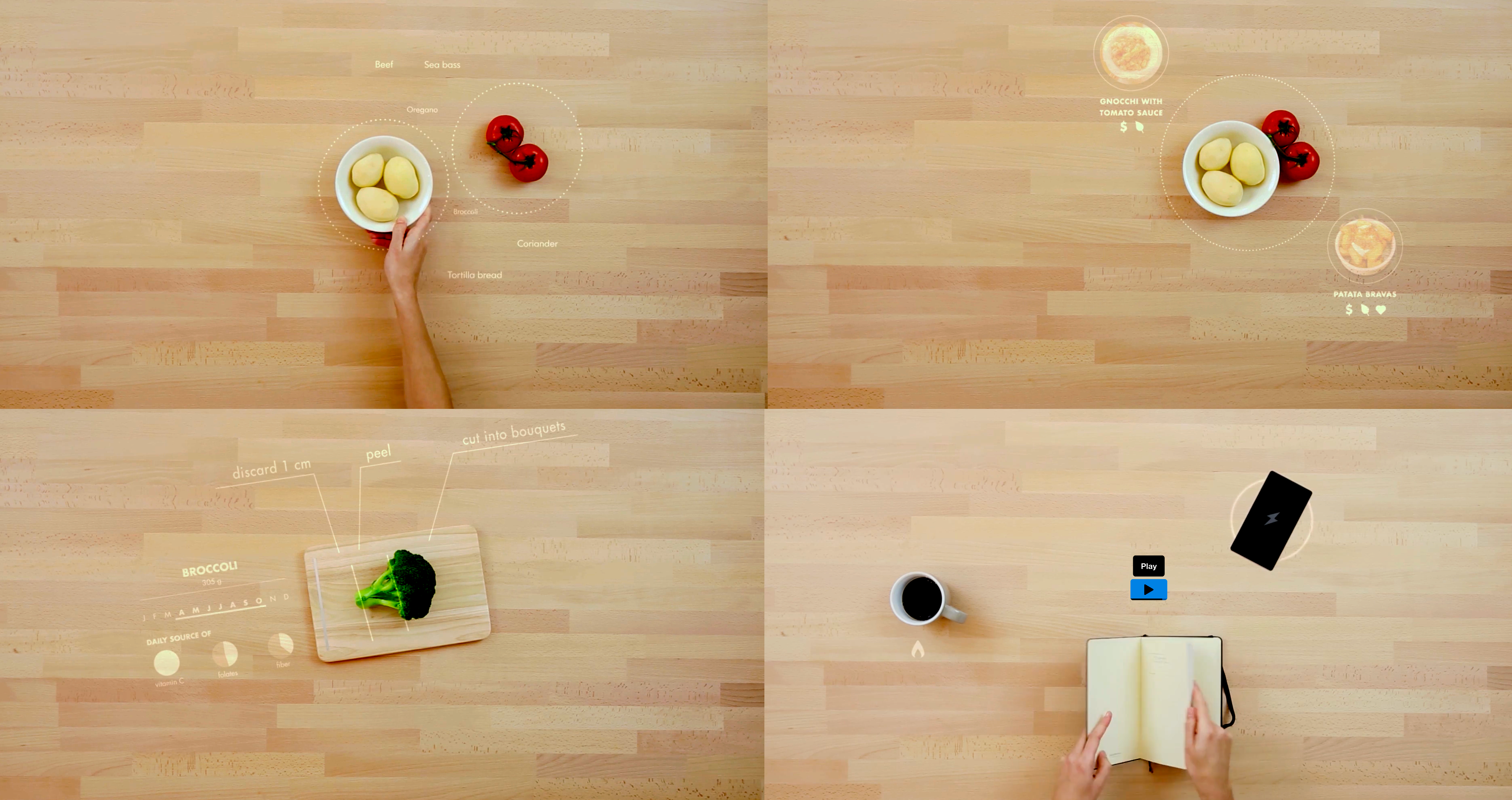
Par ailleurs, cette cuisine proposée il y a dix ans environ par IKEA imagine de nouveau des fonctions magiques : dans un buffet de cuisine, des cavités sont proposées pour le recyclage. Une machine mystérieuse, de petite taille, se tient derrière un panneau blanc (fig. 4.47.d). Puis, à droite du panneau, un espace à vue montre les matériaux recyclés, proprement emballés dans de petits sachets. Par quelle opération magique un dispositif plus petit quʼune machine à laver parvient-il à réaliser ce que nos centrales de tri peinent à accomplir ? On ne le sait pas : mais on retrouve ici le principe de la surface muette qui permet de faire «  tenir  » ensemble deux aspects non compatibles de la réalité. Cette cuisine, par ailleurs, relève davantage du squelette habillé dʼaccessoires que de lʼunité monobloc muette ; en dʼautres termes, elle est plus proche de la cuisine désintégrée des frères Bouroullec que de la cuisine Z. Island de Zaha Hadid. On pourrait donc les croire éloignées, mais il nʼen est rien : elles sont associées par le rêve futuriste de la fluidité, rêve parfois accompli (quand ceci est à lʼavantage des industriels) par lʼunité de matériau, mais plus encore par les surfaces lisses que ce choix permet. Cet aspect soyeux, sans grain («  flawless  »), rapproche la surface de travail de lʼécran avant même que celui-ci ne soit partout présent. Pour autant, dans les représentations contemporaines, lʼécran nʼest plus corrélé à une station de travail externe, mais gagne tous les objets de la cuisine. Cʼest donc sur ce devenir-écran de la cuisine que je vais à présent mʼattarder.


Lʼécran omniprésent dans les représentations des cuisines du futur est peut-être la partie visible dʼun phénomène plus large : la numérisation de lʼespace domestique, notamment à travers ce que lʼon appelle la smart house. Un tel dispositif repose sur lʼinterconnexion des génies domestiques que nous évoquons dans ce chapitre et dans le chapitre II. Cʼest en effet une possible alternative au rêve du tout-en-un : plutôt que dʼimaginer un seul objet qui prend en charge différentes fonctions, on peut concevoir un principe transversal qui relie les objets, les fait communiquer entre eux… Mais à quelle fin ? Dans les années 1990, la démocratisation de la connexion au Web laisse imaginer une numérisation de lʼespace domestique de manière plus concrète et réalisable que dans des projections antérieures, telle la visioconférence avec le boucher dans la cuisine Frigidaire de 1957. La cuisine rêvée par lʼexposition La casa prossima futura (1999 ; cf. infra), matérialise les paradoxes qui traversent la connexion possible ou réelle de la cuisine. Il sʼagit également dʼune cuisine imaginée par une marque, Philips, et documentée dans un catalogue introduit par le designer et architecte Stefano Marzano. La temporalité contradictoire est un aspect revendiqué du projet, puisque lʼouvrage sʼouvre sur cet incipit (répété p. 15) : «  [l]a maison du futur ressemblera plus à la maison du passé quʼà celle du présent  »783. Ce propos est ambivalent : dʼun côté, il nous libère des «  futurs futuristes  », cʼest-à -dire des injonctions à créer des images qui signifient leur propre futurité, plus quʼelles ne se livrent à un effort prospectif. De lʼautre, cette phrase fantasme une «  maison du passé  » unique et souhaitable dont les caractéristiques ne sont pas claires. Si revenir au passé peut sembler être lʼenvers de la projection vers le futur, il nʼen est rien. Les deux attitudes sont en effet très proches, et peuvent provoquer un même effet : lʼoblitération du temps présent et de ses contradictions. Pour S. Marzano, la question du présent ne disparaît pas complètement, puisquʼelle est reliée à un optimisme qui sert de toile de fond à une domesticité future qui est dʼabord pensée en termes de produits, par les entreprises qui les fabriquent (1999,18). Le texte oppose boîtes noires ou grises de la technologie à une possible débauche stylistique : ce sont les deux extrémités du spectre en termes dʼesthétiques, qui doivent habiller des objets vus comme des «  majordomes, cuisiniers, assistant·es, collègues -— et même des animaux de compagnie  »784. Si S. Marzano reconnaît que la promesse de la smart house, plutôt ancienne, ne sʼest pas réalisée, cʼest pour mieux affirmer que ce modèle est en train, à son époque, de devenir possible.

Ce propos incarne les contradictions des images de la domesticité imaginées lors de lʼexposition. On y retrouve lʼesthétique «  global village  » alors en vogue : elle combine des signes prélevés dans des cultures ancestrales très diverses, en revendiquant un effet bric-à -brac, brocante ou «  retour de vacances  »785. Au niveau des objets de la casa prossima, deux choix matérialisent cette dialectique primitif-connecté : dʼun côté, les écrans sont omniprésents, mais, de lʼautre, ils sont quasiment tous fabriqués en entier ou pour partie en terracotta786, ou dans des plastiques mats qui évoquent des objets antiques (fig. 4.48.a).

Cet aspect est revendiqué puisque de nombreux objets sont présentés comme des baguettes magiques ou totem, dans un esprit qui évoque le travail antérieur (au début des années 1980) du groupe de designers italiens Memphis. La partie «  cuisine  » de lʼouvrage sʼouvre sur un écran qui permet de regarder des vidéos de cuisine ou de se distraire en faisant la vaisselle -— on voit bien aujourdʼhui que lʼidée dʼun écran spécialisé a quasiment disparu, et que ce sont smartphones et tablettes qui remplissent cette fonction. fig. 4.48.c : Objets transparents de la Casa Prossima (1999), exposition et catalogue de la marque Philips. Dʼautres objets prennent en charge des fonctions qui sont devenues des applications, comme «  lʼanalyseur de nourriture  » ou le «  moniteur de santé  »787. On rencontre également lʼidée dʼoutils sans fil, rechargeables par contact ; grille-pain et bouilloire deviennent transparents, mais révèlent plus leur contenu que leur fonctionnement (fig. 4.48.c). Un objet, le «  micro-climats  », permet dʼadapter la température et lʼhumidité à lʼaliment contenu : il est le seul objet qui paraisse véritablement étonnant pour qui consulte ce livre aujourdʼhui. Si la salle à manger inclut un «  outil de cuisine en groupe  »788, la section «  Cuisine  » quant à elle est close par un «  tablier intelligent  »789 dont lʼapparence est très classique : il est dit que ce «  tablier lavable  », qui permet de diriger des dispositifs par lʼintermédiaire de la voix, peut aussi être utilisé pour «  demander de lʼaide auprès de la famille ou leur dire que le déjeuner est prêt  »790 (fig. 4.48.d). Dans cette écologie domestique où les objets sont à la fois des majordomes et des ami·es, il semblerait que læ travailleur·se isolé·e, seul·e dans sa cuisine, nʼait pas disparu. Pourtant, lʼintroduction écrite par la manager de Philips, Josephine Green mentionne bien le fait que «  les mères (sic), travaillant aujourdʼhui loin du foyer, ne sont plus disponibles pour remplir le rôle traditionnel de prise de soin [carer]  »791 (Marzano 1999, 4). Ce fait posé, rien nʼest mentionné dans lʼouvrage sur une éventuelle restructuration de la famille ou une réorganisation des rôles : la maison connectée est un hybride entre le primitif et le high-tech, mais ne renouvelle pas, au fond, les imaginaires, en particulier ceux du petit peuple des objets électroménagers : ils sont pensés pour «  nous  » remplacer, et la nature exacte des tâches suppléées est souvent floue.
fig. 4.48.c : Objets transparents de la Casa Prossima (1999), exposition et catalogue de la marque Philips. Dʼautres objets prennent en charge des fonctions qui sont devenues des applications, comme «  lʼanalyseur de nourriture  » ou le «  moniteur de santé  »787. On rencontre également lʼidée dʼoutils sans fil, rechargeables par contact ; grille-pain et bouilloire deviennent transparents, mais révèlent plus leur contenu que leur fonctionnement (fig. 4.48.c). Un objet, le «  micro-climats  », permet dʼadapter la température et lʼhumidité à lʼaliment contenu : il est le seul objet qui paraisse véritablement étonnant pour qui consulte ce livre aujourdʼhui. Si la salle à manger inclut un «  outil de cuisine en groupe  »788, la section «  Cuisine  » quant à elle est close par un «  tablier intelligent  »789 dont lʼapparence est très classique : il est dit que ce «  tablier lavable  », qui permet de diriger des dispositifs par lʼintermédiaire de la voix, peut aussi être utilisé pour «  demander de lʼaide auprès de la famille ou leur dire que le déjeuner est prêt  »790 (fig. 4.48.d). Dans cette écologie domestique où les objets sont à la fois des majordomes et des ami·es, il semblerait que læ travailleur·se isolé·e, seul·e dans sa cuisine, nʼait pas disparu. Pourtant, lʼintroduction écrite par la manager de Philips, Josephine Green mentionne bien le fait que «  les mères (sic), travaillant aujourdʼhui loin du foyer, ne sont plus disponibles pour remplir le rôle traditionnel de prise de soin [carer]  »791 (Marzano 1999, 4). Ce fait posé, rien nʼest mentionné dans lʼouvrage sur une éventuelle restructuration de la famille ou une réorganisation des rôles : la maison connectée est un hybride entre le primitif et le high-tech, mais ne renouvelle pas, au fond, les imaginaires, en particulier ceux du petit peuple des objets électroménagers : ils sont pensés pour «  nous  » remplacer, et la nature exacte des tâches suppléées est souvent floue. fig. 4.48.d : Le tablier de la Casa Prossima (1999), exposition et catalogue de la marque Philips. Lʼécran est aussi omniprésent, sans quʼon sache dans quels scénarios il sʼinscrit : par ailleurs, le désir de transparence reste avant tout affaire dʼapparences, et le fonctionnement des objets connectés reste particulièrement opaque. Il est possible que lʼécran, au-delà dʼincarner un rêve de connexion totale, soit aussi une énième occurrence de ce goà »t du lisse qui relie la cuisine Monsanto, la casa prossima et la cuisine IKEA 2025 : comme si le rôle du design, à lʼendroit des cuisines, était dʼen supprimer les aspérités.
fig. 4.48.d : Le tablier de la Casa Prossima (1999), exposition et catalogue de la marque Philips. Lʼécran est aussi omniprésent, sans quʼon sache dans quels scénarios il sʼinscrit : par ailleurs, le désir de transparence reste avant tout affaire dʼapparences, et le fonctionnement des objets connectés reste particulièrement opaque. Il est possible que lʼécran, au-delà dʼincarner un rêve de connexion totale, soit aussi une énième occurrence de ce goà »t du lisse qui relie la cuisine Monsanto, la casa prossima et la cuisine IKEA 2025 : comme si le rôle du design, à lʼendroit des cuisines, était dʼen supprimer les aspérités.
Un dernier mot sʼimpose au sujet de la maison et donc de la cuisine connectée. En lʼabsence de scénarios détaillés explicitant les raisons de cette connexion, il apparaît que les technologies du numérique peuvent, plutôt que dʼamorcer des usages libératoires, prolonger les violences systémiques, et même appareiller des situations existantes de violences domestiques. Tout comme la technologie est traditionnellement associée aux hommes, la smart home et ses technologies sont pensées comme des dispositifs destinés aux hommes, quand bien même il sʼagit du contexte domestique. Pour les anthropologues australien·nes Sarah Pink,Yolande Strengers, Rex Martin et Kari Dahlgren, «  ‹ lʼhomme intéressé par les technologies › est positionné implicitement comme le consommateur cible des smart objects  »792 (2023). Dans leur travail de terrain, les chercheur·ses ont mis en évidence la manière dont les hommes sʼapproprient plus volontiers ces technologies, tandis que les femmes (dans des couples hétérosexuels) apparaissent plutôt comme des «  gardiennes  » de ce qui peut entrer ou non dans lʼespace domestique (Pink, Strengers, et. al. 2023). La présence dʼun·e assistant·e vocal·e, sʼil peut libérer la ménagère, peut aussi rejouer le drame de lʼexternalisation sur un·e tiers pauvre et racisé·e (Pink, Strengers, et. al. 2023). La cuisine est particulièrement poreuse à de tels usages, puisque la manipulation de nourriture, qui peut sʼavérer salissante, invite aisément à penser des usages automatisés par le biais de la voix (Ammari 2019), comme le tablier de la casa prossima lʼanticipe dʼailleurs. En outre, le modèle de servitude qui traverse les usages associés aux assistant·es vocaux et autres IA est redoublé par celui de la surveillance. Giuliana Bruno affirme que «  si on les interrogeait, les maisons raconteraient des histoires dʼamour et de violence  »793 (2002, 103). Il est possible que cette suggestion poétique prenne une forme de réalité tangible avec les objets domestiques connectés. Mais la surveillance permise par la domotique est-elle réellement à lʼavantage des housewives ?
Un épisode de la série Mr. Robot (2016) fait plutôt imaginer le contraire. On y voit une femme, dans sa luxueuse demeure, assister au dérèglement de tous les appareils qui composent son logis qui a, en réalité, été hacké (fig. 4.47). Lʼalarme commence par lui résister, la télévision sʼallume et sʼéteint toute seule. Ce sont ensuite des morceaux de musique qui sont joués à un très haut volume, et lʼeau de sa douche lʼébouillante. Dans son salon, elle est finalement accueillie par une température glaciale, des lumières qui clignotent et lʼalarme qui hurle de manière insoutenable. Au téléphone avec lʼassistance technique, elle répond à cellui qui cherche à lʼaider quʼelle ne peut rien débrancher : tout a été installé dans les murs quand elle a commandé le «  smart house package  ». Ce cauchemar en smart house, sʼil peut sembler excessif, rend visible un ensemble de gestes et de possibilités qui ont été documentés. Je remarque dʼailleurs que sa mise en récit dans une forme audiovisuelle rend visible à quel point cette maison dérégulée terrorise sa locataire à la manière dʼune maison hantée. Ainsi, même dans leur versant négatif, les technologies domestiques ne perdent pas leur lien à la magie.
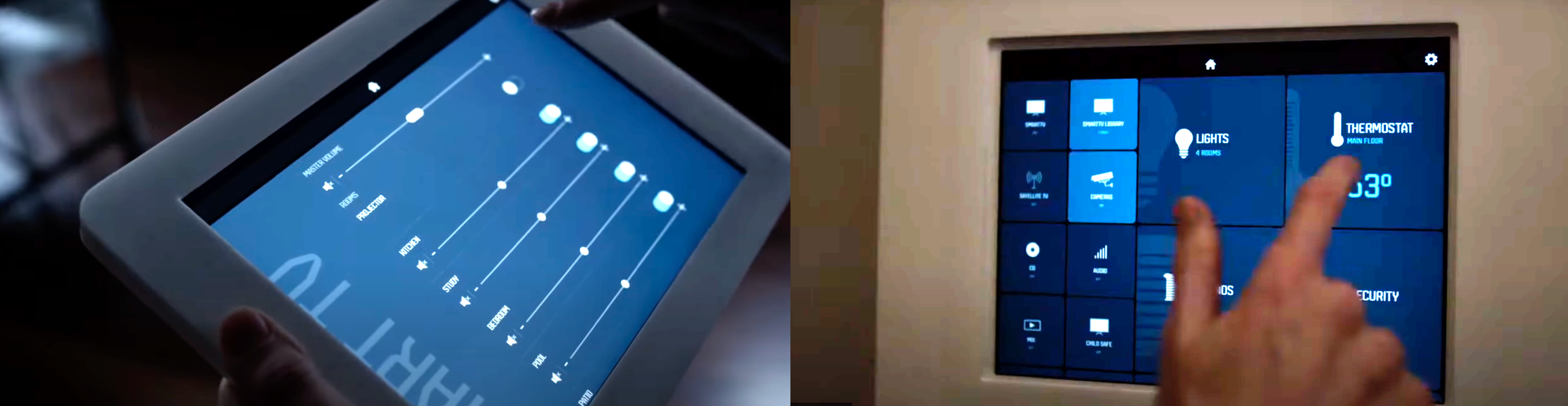
En 2018, la journaliste Nelly Bowles documente pour le New York Times la manière dont les thermostats, portes à codes et autres objets connectés deviennent des outils concrets dʼexercice de la contrainte dans les situations de violence domestique. Selon N. Bowles, ils sont «  des moyens de harcèlement, de surveillance, de vengeance et de contrôle  »794. Elle cite ainsi des cas où la maison ne fait pas que limiter les mouvements ou les usages de sa locataire. Lorsquʼune serrure connectée voit son code changer toutes les semaines par exemple, lʼimpact va au-delà de lʼaccès au domicile (aussi crucial ce sujet soit-il) et jette la personne harcelée dans une situation de «  gaslighting  », où elle doute de ses perceptions et de sa santé mentale. Ces objets constituent un changement de paradigme dans la mesure où ils distribuent la violence domestique dans des domaines qui jusque-là pouvaient lui échapper. Aussi, ils rendent la séparation du·de la conjoint·e plus difficile : les mesures dʼéloignement que peuvent mettre en place les victimes, éventuellement garanties par lʼappareil judiciaire, sont rendues caduques par la potentielle ubiquité de certains dispositifs (trackers, manipulation dʼobjets à distance, etc.). Nelly Bowles rappelle que les objets connectés sont souvent pris en charge par une personne dans le couple, et cette personne, nous lʼavons vu, est le plus souvent un homme. Dans un contexte où 72% des victimes de violences conjugales795 sont des femmes, ce fait est à souligner796. Tout questionnement au sujet des objets électroménagers implique aujourdʼhui leur «  connexion  » plus ou moins large : ainsi, la dimension des violences domestiques numériques est également à prendre en compte.
Le terme de «  violence  » peut également sʼentendre dans différentes acceptions. Jʼai parlé précédemment des «  violences domestiques  » au sens le plus couramment admis du terme : celles des violences psychiques ou physiques qui ont lieu dans la vie dʼun couple, souvent dans leur logis, et qui peuvent frapper dʼautres membres de la cellule familiale. Toutefois, on peut aussi travailler sur la base dʼune définition plus ouverte, non pas pour dissoudre le sens de «  violences domestiques  », mais pour comprendre de manière macro toutes les formes de violence reliées à la domesticité. À cet égard, lʼassociation des femmes au labeur en cuisine, ainsi que les inégalités de partage des tâches, peuvent sʼentendre comme des violences en domesticité. La frontière entre violences domestiques et violences en domesticité nʼest pas nécessairement très marquée. Comme souvent, dans les cas de violence, des formes de continuum lient les actes les plus ténus aux formes les plus graves dʼagression. Ces liens sont aussi, depuis le mouvement #metoo, lʼobjet de discussions : on le voit apparaître dans la proposition de la députée EELV Sandrine Rousseau, qui proposait lors dʼune interview en 2022 de créer un «  délit de non-partage des tâches domestiques  » (Hennequin 2022). Si la proposition tient sans doute plus dʼune volonté de relancer les débats sur un sujet donné que dʼune véritable intention législative, elle attire lʼattention dans la mesure où elle situe les inégalités de partage des tâches comme une forme de violence en la jugeant répréhensible par la loi, dans la lignée de ces mères étasuniennes qui sʼétaient réunies en 2022 pour faire entendre un «  cri primal  »797 lié à leur épuisement (Darnault 2022). Dans ce contexte, les applications de partage de tâches peuvent apparaître comme une solution adéquate, et même comme une forme de prévention des violences si lʼon admet que lʼinégalité du partage du travail domestique appartient à cette catégorie.
Lʼoffre actuelle dʼapplications est cependant encore assez hétérogène. Les recherches rapides que jʼai pu effectuer798 mʼont plutôt mené vers des applications de gestion du temps ou des tâches génériques, pensées pour le travail salarié ou en freelance. Lorsque les applications sont pensées spécifiquement pour la gestion du logis, les positionnements sont également très variés. Par exemple, pour le Planificateur de tâches ménagères, lʼenjeu est plutôt de gérer lʼaspect cyclique des tâches, afin de ne pas délaisser certains items : lʼapplication se présente donc comme un décompte de durées jusquʼau moment où la corvée doit être réalisée (fig. 4.50.a). Dʼautres applications comme Maple sʼoffrent comme des tableaux de bord multitâches permettant de combiner listes à cocher, listes de courses, classeur de recettes, etc. Il est probable que ces applications soient souvent délaissées au profit dʼapplications généralistes comme Notion ou Evernote qui proposent des fonctionnalités plus souples en fonction des besoins de chacun·e -— le Web regorge de tutoriels pour construire son propre tableau de bord de ménage en utilisant ces applications. Dʼautres sont plus ciblées, comme la défunte Pistache qui visait à «  gamifier  » les tâches dévolues aux enfants en leur faisant gagner des points au fil de leurs accomplissements. Enfin, comme je lʼavais mentionné précédemment au sujet des applications de livraison de nourriture, les communications en ligne de ces services font partie de lʼoffre et doivent être analysées en parallèle des services eux-mêmes. Les discours associés aux applications sont variables et nomment plus ou moins les enjeux féministes qui sont liés à leur proposition. Par exemple, lʼapplication Maydée (à lʼhomonymie troublante, dans un contexte familial !), affiche clairement ses objectifs, parmi lesquels «  faire progresser lʼégalité entre les femmes et les hommes en sensibilisant à lʼimpact de lʼinégale répartition des tâches domestiques  » et même «  aider les femmes et les hommes à sʼaffranchir des rôles genrés qui leur sont encore aujourdʼhui très souvent attribués  ». La «  quantification et la valorisation du travail domestique  » sont également affirmées comme des enjeux dʼimportance. Soutenue par la Région ÃŽle-de-France et le Secrétariat dʼÉtat chargé de lʼÉgalité entre les Femmes et les Hommes et des Luttes contre les Discriminations, cette application affiche également le label «  Sexisme ! Pas notre Genre  ». Dʼautres positionnements sont plus ambigus : Tipstuff mobilise la notion de «  charge mentale  » pensée par Monique Haicault (1984), mais en reproduisant des schémas de partage très classiques. Lʼapplication propose en effet une organisation collective à lʼéchelle de la famille. fig. 4.50.b : Écran promotionnel sur le site de l’application Tip Stuff. Toutefois, son image dʼaccueil (une femme qui pilote lʼapplication depuis son smartphone, un homme lointain, flou, en arrière-plan ; fig. 4.50.b) ainsi que les textes explicatifs laissent imaginer une situation inchangée : «  Il ne manquera plus jamais de céréales  » (fig. 4.50.c), nous promet le rédactionnel, nous identifiant automatiquement à une destinataire féminine sʼoccupant de son ado, de son mari, ou dʼun mélange incertain entre les deux. Cette adresse flottante est même clarifiée, un scroll plus loin, lorsquʼon lit : «  Cʼest ça une famille moderne : gérer ensemble et se répartir les travaux du quotidien. En trois clics dans TipStuff, déléguez des tâches à votre ado ou votre conjoint, et suivez lʼavancement  »799. Il est donc clair que cʼest encore aux femmes (ménagère ou non) de devenir les managers en chef de cette organisation «  collective  ». La récompense est claire : être «  moderne  », comme lʼont promis bien avant les applications les robots Moulinex et consors.
fig. 4.50.b : Écran promotionnel sur le site de l’application Tip Stuff. Toutefois, son image dʼaccueil (une femme qui pilote lʼapplication depuis son smartphone, un homme lointain, flou, en arrière-plan ; fig. 4.50.b) ainsi que les textes explicatifs laissent imaginer une situation inchangée : «  Il ne manquera plus jamais de céréales  » (fig. 4.50.c), nous promet le rédactionnel, nous identifiant automatiquement à une destinataire féminine sʼoccupant de son ado, de son mari, ou dʼun mélange incertain entre les deux. Cette adresse flottante est même clarifiée, un scroll plus loin, lorsquʼon lit : «  Cʼest ça une famille moderne : gérer ensemble et se répartir les travaux du quotidien. En trois clics dans TipStuff, déléguez des tâches à votre ado ou votre conjoint, et suivez lʼavancement  »799. Il est donc clair que cʼest encore aux femmes (ménagère ou non) de devenir les managers en chef de cette organisation «  collective  ». La récompense est claire : être «  moderne  », comme lʼont promis bien avant les applications les robots Moulinex et consors.
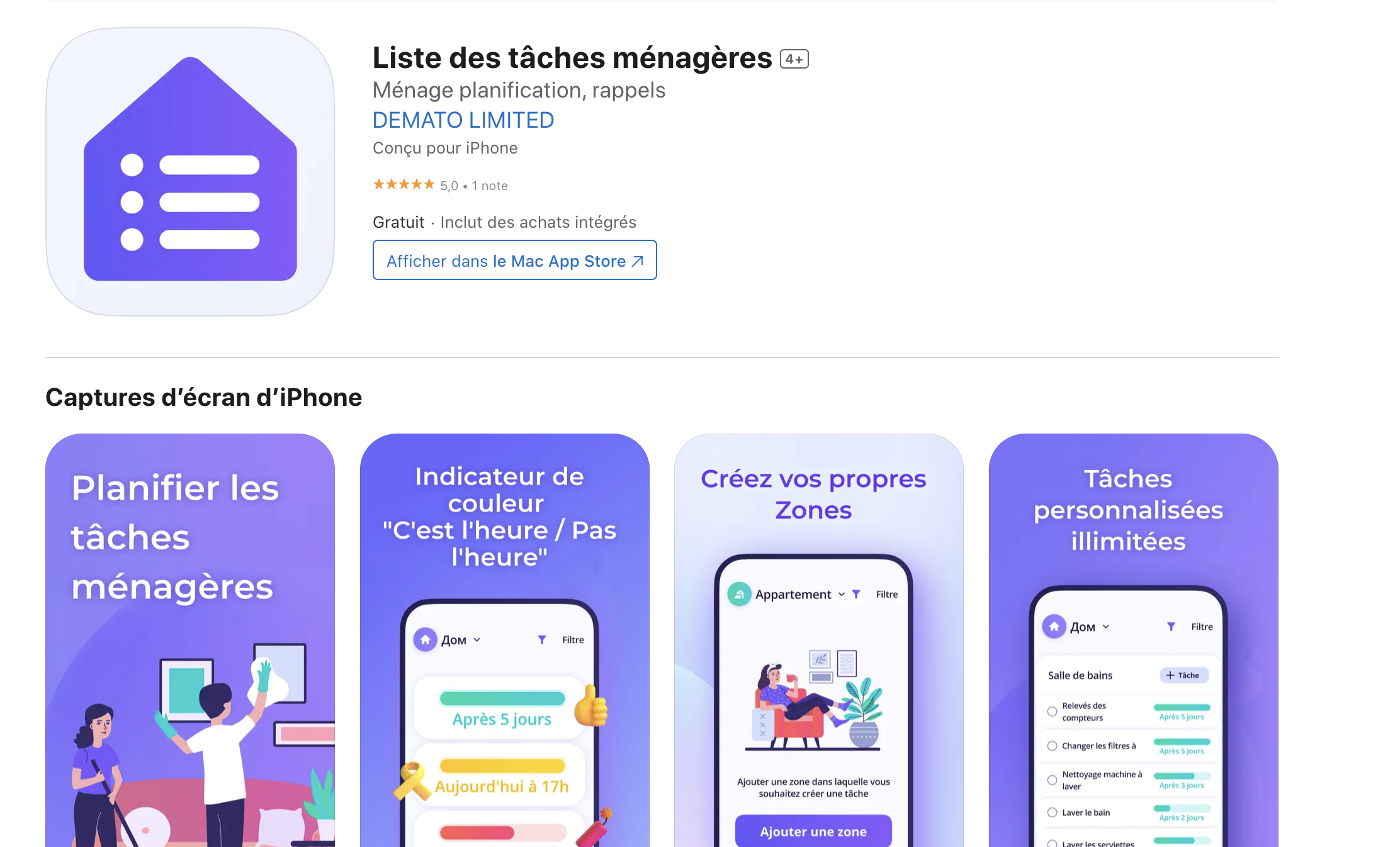
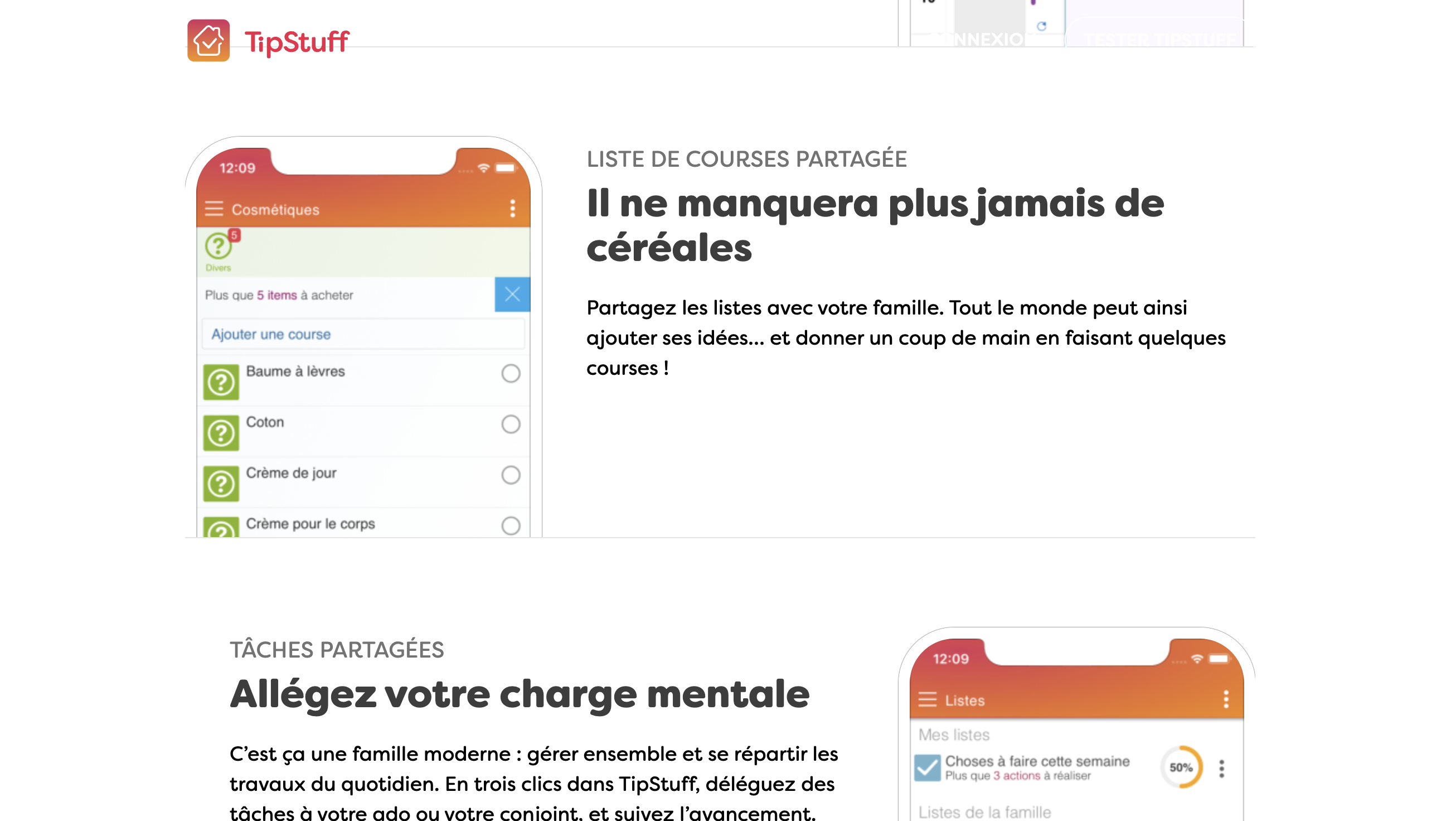
Il apparaît ainsi que la promesse des applications, comme celle de lʼélectroménager avant elles, est largement surestimée. La journaliste Tanya Basu, dans la MIT Technological Review (2022), explique ainsi que ces applications nʼallègent pas la charge de travail domestique dévolue aux femmes, mais «  pourraient même bien avoir lʼeffet contraire  »800. Au lieu dʼêtre libérées par lʼapplication, des usager·es interrogées par la journaliste affirment quʼelles ont vu une nouvelle tâche apparaître : gérer lʼapplication mobile. Cette dynamique nʼest pas étonnante, si on se rappelle la démonstration du chapitre précédent. Même lorsquʼil est externalisé, par exemple en employant du personnel de ménage, le travail domestique est vu comme un travail de femme -— du moins dans les couples hétérosexuels. Les statistiques dʼutilisation relatives à ces applications, comme Cozi aux États-Unis, confirment cette répartition inégalitaire : 86% de ses usagers sont des usagères (Basu 2022). Il faut bien sà »r questionner les scénarios qui président à la conception de ces applications. Lorsquʼun·e usager·e unique doit piloter les autres membres de la famille, les femmes se retrouvent facilement à endosser ce rôle : lʼapplication prolonge la dynamique existante qui relie une femme cheffe des travaux et son mari gentil exécutant (Basu 2022). En revanche, les applications qui «  gamifient  » les tâches en proposant, par exemple, un système de points rencontrent un plus franc succès (Basu 2022). Je suis pour ma part assez sceptique vis-à -vis de telles approches, puisquʼelles consolident lʼidée selon laquelle ce travail est pénible, et quʼil ne peut être effectué quʼen échange dʼune contrepartie, ne serait-ce que des points virtuels. Elle donne aussi lʼidée que certains membres de la famille doivent trouver ces tâches ludiques, ou agréables, pour accepter de les faire. Que se passe-t-il si lʼincitation disparaît ? Il est probable que dans ce cas, le mode «  par défaut  » de la mère gestionnaire et exécutante revient en force. Ces applications témoignent enfin de la démocratisation du terme théorique de «  charge mentale  » pensé par Monique Haicault. En France, la bande dessinée de la dessinatrice Emma, «  Fallait demander  » (fig. 4.49), qui a connu un grand succès à sa publication sur les réseaux sociaux en 2017, a participé de cette intégration aux discours communs.
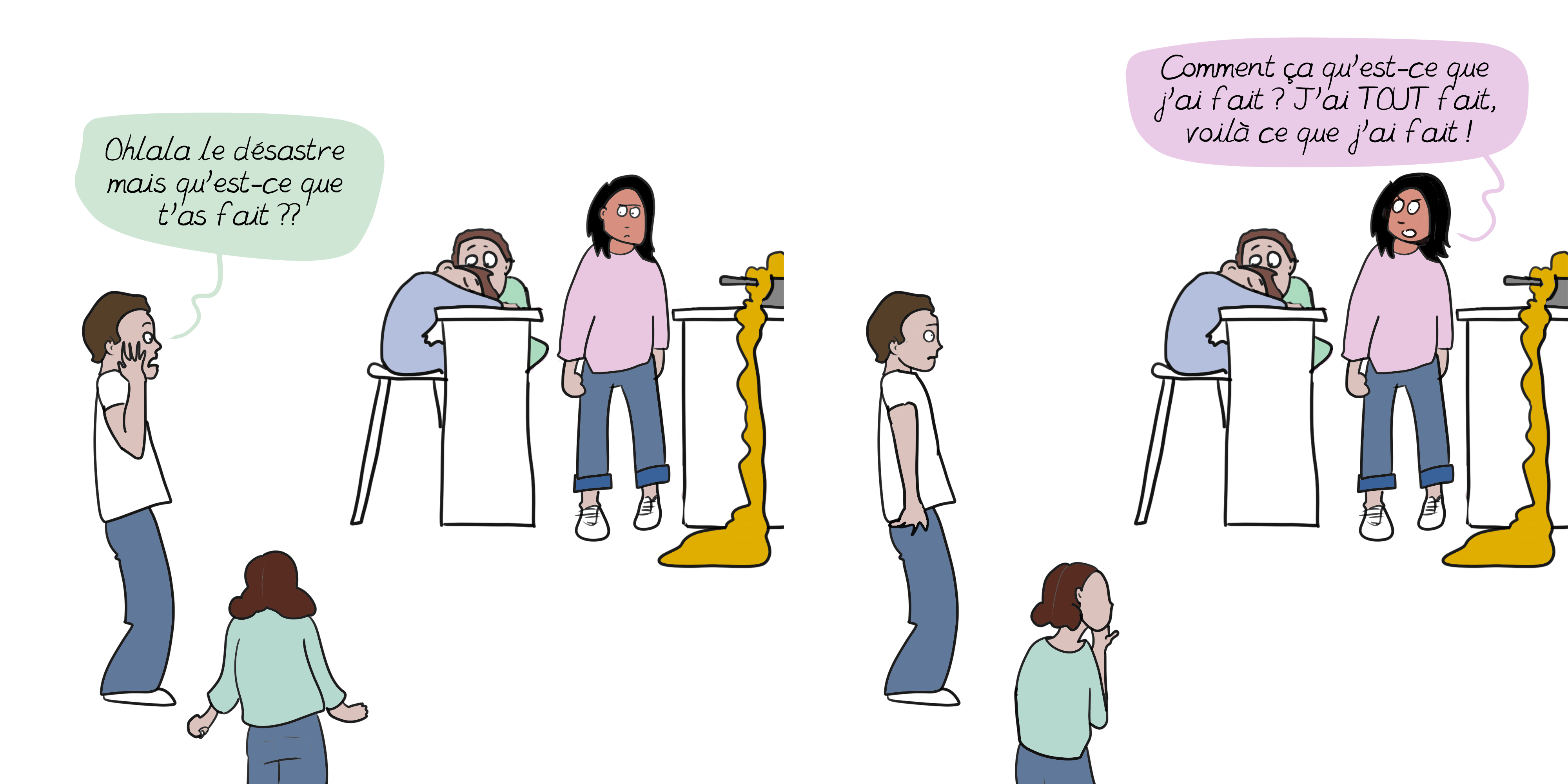
Si on peut se féliciter quʼun terme théorique issu de la recherche universitaire ait migré et permis à de nombreuses femmes (et travailleureuses précaires) de nommer des situations dʼexploitation, il me semble aussi que cette adoption sʼest réalisée au prix dʼune perte du sens initial de lʼexpression801. Par «  charge mentale  », Monique Haicault entend :
«  [ce qui est]fait […] de ces perpétuels ajustements, de la viscosité du temps qui nʼest que rarement rythme et beaucoup plus souvent immanence, où se perd le corps, où se tue la tête, à calculer lʼincalculable, à rattraper sur du temps et avec du temps, le temps perdu à faire, à gérer  » (1984, 275).
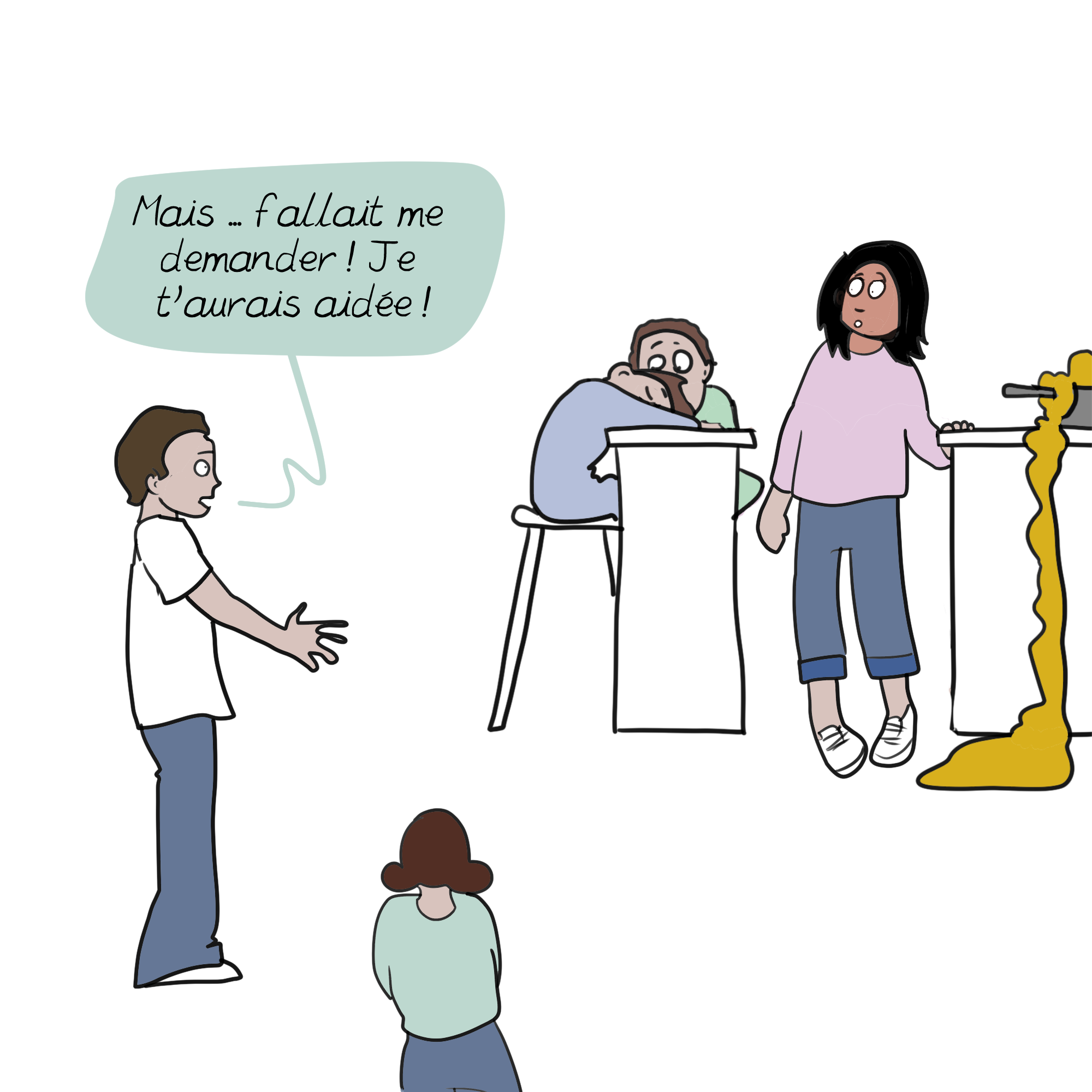
Penser à lʼapplication, la télécharger, la paramétrer, et sans doute perdre du temps précieux dʼattention captée par tout autre chose sur le téléphone, font partie de ces heures perdues. Parier quʼune application peut résoudre cette question, cʼest aussi ignorer les motivations des partis impliqués. Pour les hommes, il nʼest pas intéressant que ce travail devienne partagé -— à moins que celui-ci soit gamifié (hypothèse basse) ou repensé (hypothèse haute, du côté du design). Il faut également avoir en tête le «  trouble dans le genre  », et dans lʼidentité des membres dʼune famille structurée autour dʼun couple hétérosexuel que peut occasionner une telle redistribution (Singly 2007, 25–26). Ainsi, il me semble que ces applications, si elles ne sont pas articulées à une pensée alternative des espaces, auront des difficultés à remplir leurs objectifs. Du reste, il ne peut ainsi y avoir dʼalternative dans le partage quʼen se saisissant de la tâche : sans quoi, cette «  alternative  » ne sera quʼitérative, comme le disait Foucault au sujet des prisons (1993[1976], 21).
Les femmes ne naissent pas femmes, mais le deviennent (de Beauvoir, 1949) ; elles le deviennent sans doute par une suite de positionnements spatiaux, dont celui qui les attache au foyer. Cet attachement est dʼautant plus facile que le corps féminin (au sens de la sexuation «  femme  » ou comme montré plus tôt «  femelle  ») est perçu comme foyer. Jʼai précédemment évoqué la manière dont les théories médicales du XVIIIe siècle constituent le corps féminin comme habitacle, voire comme espace vaste disponible chez Martin Frobenius Ledermuller (1719–1769) pour qui «  le petit animalcule [le spermatozoïde] se développe dans la mère comme la graine dans le champ  » (Tuana 1989, 167 ; cf. infra). Cette métaphore spatiale, en dépit de la vastitude suggérée, possède plutôt des connotations négatives. Si être lʼespace (lʼincarner, symboliquement) est une conséquence paradoxale de ne pas avoir dʼespace à soi, mon analyse ne devrait-elle pas se saisir différemment de lʼespace cuisine ? Jusquʼà présent, jʼai investi cette pièce de la maison comme un élément séparé des corps féminins. Autrement dit, jʼai suivi une approche classique du design, qui sépare les espaces disponibles des corps qui les habitent -— les usager·es. Je souhaite à présent modifier mon approche : que serait une analyse de design qui se saisirait du corps féminin comme objet ? Il ne sʼagit pas ici dʼobjectifier les corps féminins, mais plutôt de reconnaître que le sexisme, en objectifiant certains corps, nous permet aussi, dès lors, de regarder ces corps avec les outils analytiques que nous appliquons dʼordinaire aux objets. Et plus encore que dʼanalyser le corps féminin en tant quʼobjet, il sʼagit peut-être de reconnaître comment, dans lʼhistoire du design et notamment dans celle de lʼélectroménager, le corps des femmes possède un statut ambigu.
Mais de quel objet parle-t-on ? Les femmes sont-elles comparables à des robots mixeurs, des servantes mécaniques, des placards entiers ? Pour explorer cette question, il me faut mieux décrire cette relation à lʼespace, et au pouvoir qui sʼy rattache. De nombreuses Å“uvres permettent de mettre cette puissance en lumière. Dans le documentaire Lʼhistoire oubliée des femmes au foyer (2021), la réalisatrice Michelle Dominici assemble images dʼarchives et témoignages dʼune dizaine de femmes (françaises, allemandes et anglaises) qui se sont mariées entre 1945 et 1970, découverts par le biais de leurs journaux intimes. À lʼorigine de sa démarche se trouvent les mots de sa propre mère, dont les mémoires sʼarrêtent en 1960, date de son mariage, car selon elle : «  après, ce nʼest plus intéressant  ». Lʼensemble du film file ce motif en creux : cʼest la disparition des sujets intéressants, mais aussi des espoirs et dʼelles-mêmes que ces femmes racontent. M. Dominici décrit le mariage dʼalors comme une «  annexion  »â€¯: lʼépouse doit demander lʼautorisation de son mari pour travailler et le suivre géographiquement selon les aléas de sa carrière professionnelle, sans pouvoir gérer son compte en banque. Lʼapproche comme la tonalité du documentaire font écho aux travaux de Christine Detrez et Karine Bastide (2020). Dans Nos mères, Huguette, Christiane et tant dʼautres, une histoire de lʼémancipation féminine, elles se penchent sur leurs archives familiales et notamment les correspondances de leurs mères respectives pour raconter les espoirs, luttes et déceptions des femmes de cette génération802. Huguette, mère de Karine Bastide, entretient une correspondance avec Simone de Beauvoir dans laquelle elle décrit en ces termes son mariage : «  une espèce de cube noir, dense, aux angles nets, aux arêtes glaciales  » (Detrez & Bastide 2020, 275). Si cette boîte noire au volume coupant semble hostile à tout habitat humain, il semble pourtant que les femmes, symboliquement, soient partie prenante de cette géométrie. De même, le langage commun est plein de ces associations entre le corps des femmes, leur maison et leur destinée commune de reproduction. Pensons par exemple à lʼexpression, en anglais «  to have a bun in the oven  », que lʼon traduit généralement par «  avoir un polichinelle dans le tiroir  ». En anglais, lʼacte de gestation est décrit comme une cuisson, comme opération culinaire et domestique intégrée au corps féminin. fig. 4.52 : Les Cariatides qui soutiennent le temple de l’Erechtéion à Athènes, commentées par Martine Delvaux dans Les filles en série (2013). Cʼest une expression qui condense à la fois le pouvoir du corps perçu comme féminin (compris comme matrice, capable de génération803) et son enchaînement à cette destination. Il en va de même avec ce terme de «  cuisinière  » qui désigne aussi bien un élément du mobilier que son usagère (Kaufmann 2015[2005], 113). On retrouve cette ambivalence dans dʼautres mises en scène du corps des femmes. La chercheuse en littérature Martine Delvaux commente en ce sens une photographie des Cariatides qui soutiennent le temple de lʼErechtéion à Athènes (fig. 4.52) : ces femmes de pierre, fonctionnant comme piliers, sont «  fondatrices  », «  essentielles en tant que matière  » mais aussi «  enfermées  » (Delvaux 2013, 20).
fig. 4.52 : Les Cariatides qui soutiennent le temple de l’Erechtéion à Athènes, commentées par Martine Delvaux dans Les filles en série (2013). Cʼest une expression qui condense à la fois le pouvoir du corps perçu comme féminin (compris comme matrice, capable de génération803) et son enchaînement à cette destination. Il en va de même avec ce terme de «  cuisinière  » qui désigne aussi bien un élément du mobilier que son usagère (Kaufmann 2015[2005], 113). On retrouve cette ambivalence dans dʼautres mises en scène du corps des femmes. La chercheuse en littérature Martine Delvaux commente en ce sens une photographie des Cariatides qui soutiennent le temple de lʼErechtéion à Athènes (fig. 4.52) : ces femmes de pierre, fonctionnant comme piliers, sont «  fondatrices  », «  essentielles en tant que matière  » mais aussi «  enfermées  » (Delvaux 2013, 20).
De nombreuses œuvres artistiques comme des témoignages épars portent la marque de cette condition spatiale spécifique à la domesticité féminine. Cette spatialité devient alors aussi un lieu potentiel dʼempouvoirement. Si la cuisine tient les femmes, et si elle les tient spatialement, alors elle peut aussi être mobilisée à rebours, être détournée, envahie et habitée autrement. fig. 4.53.b : Œuvres de Valie Export :
Die Geburtenmadonna, 1976. Plusieurs Å“uvres constituent à cet égard une constellation de rébellions architecturales. Elles peuvent amorcer des formes de résistance en nommant lʼenchâssement, en le rendant palpable, par exemple dans le film Craigʼs Wife, réalisé par la cinéaste lesbienne Dorothy Arzner (1936) et commenté par Giuliana Bruno (2002, 88–91) qui observe que son personnage «  voyage domestiquement  »804 (90).
fig. 4.53.b : Œuvres de Valie Export :
Die Geburtenmadonna, 1976. Plusieurs Å“uvres constituent à cet égard une constellation de rébellions architecturales. Elles peuvent amorcer des formes de résistance en nommant lʼenchâssement, en le rendant palpable, par exemple dans le film Craigʼs Wife, réalisé par la cinéaste lesbienne Dorothy Arzner (1936) et commenté par Giuliana Bruno (2002, 88–91) qui observe que son personnage «  voyage domestiquement  »804 (90).
 fig. 4.54.b : Sandy Orgel, Womanhouse: Linen Closet, 1972. Ce film qui se termine sur une note mélancolique, avec son personnage seul, devenue elle-même la maison plutôt que son habitante résonne avec dʼautres représentations : cʼest lʼartiste Valie Export qui, dans ses performances, devient un fragment de lʼespace urbain (fig. 4.53.a), ou fusionne dans ses collages avec des pièces dʼélectroménager (fig. 4.53.b). Cʼest encore ce corps de femme enchassé dans une armoire, dans lʼinstallation Linen Closet de Sandy Orgel et montrée dans la Womanhouse (1972 ; fig. 4.52.a), non loin du Kitchen Apron de Christine Jürgensen (1975 ; fig. 4.52.b). Là , corps féminin, tablier et gazinière fusionnent en une figure à la fois monstrueuse et familière805.
fig. 4.54.b : Sandy Orgel, Womanhouse: Linen Closet, 1972. Ce film qui se termine sur une note mélancolique, avec son personnage seul, devenue elle-même la maison plutôt que son habitante résonne avec dʼautres représentations : cʼest lʼartiste Valie Export qui, dans ses performances, devient un fragment de lʼespace urbain (fig. 4.53.a), ou fusionne dans ses collages avec des pièces dʼélectroménager (fig. 4.53.b). Cʼest encore ce corps de femme enchassé dans une armoire, dans lʼinstallation Linen Closet de Sandy Orgel et montrée dans la Womanhouse (1972 ; fig. 4.52.a), non loin du Kitchen Apron de Christine Jürgensen (1975 ; fig. 4.52.b). Là , corps féminin, tablier et gazinière fusionnent en une figure à la fois monstrueuse et familière805.


Ces images possèdent leur envers : dans de nombreuses communications promotionnelles, le corps féminin est mis en scène comme un morceau dʼarchitecture. Ce devenir-brique du corps des femmes est le plus lisible dans les discours promotionnels relatifs aux standards de taille. Cʼest un des paradoxes de lʼhéritage Beecher-Frederick-Bernège : adapter la cuisine à ses occupantes implique de façonner une boîte aux dimensions exactement pensées pour mieux les contenir et les enfermer. En 1953, la revue Popular Science propose un visuel frappant intitulé «  Une nouvelle cuisine construite pour convenir [fit] à votre femme  »806 (fig. 4.55) qui décrit la Cornell Kitchen proposée par lʼuniversité du même nom (Archer 2019). Les connotations du terme «  fit  » sont difficiles à restituer en français, tant le terme condense de significations relatives à la taille (hauteur), à la ligne (fitness), au confort et à lʼadaptation. On pourrait dire : «  une cuisine à la taille de votre femme  », ce qui résonne étonnamment avec la représentation de lʼépouse en question, qui apparaît comme une petite figurine enchâssée dans un modèle ancien de pied à coulisse.
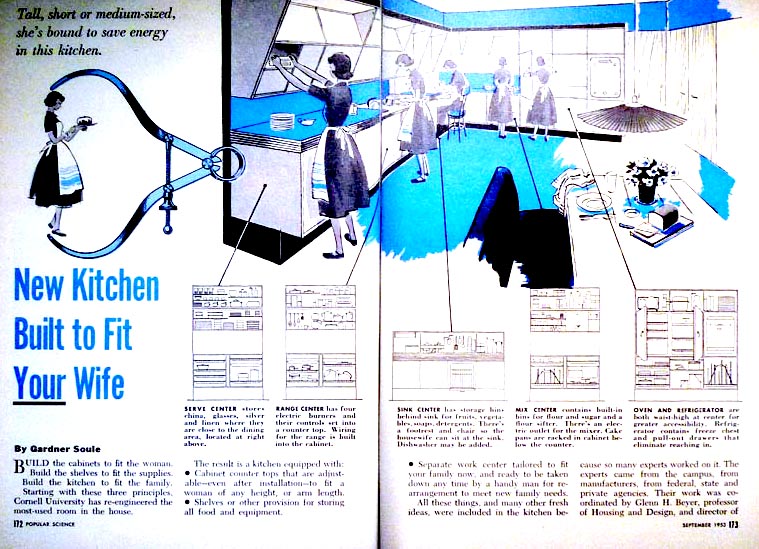
Un texte en chapeau complète le visuel : «  elle est certaine dʼéconomiser de lʼénergie dans cette cuisine  »807 -— on retrouve ici la promesse dʼefficacité et de productivité liée au choix des standards adaptés. En anglais, cette certitude sʼexprime avec lʼexpression «  sheʼs bound  », qui peut aussi se traduire par «  elle est attachée  ». Sur la partie droite du visuel, la cuisine est habitée par la figurine en mouvement, multipliée pour suggérer des temporalités différentes. Là encore, un double sens se glisse dans lʼimage comme plus tôt dans le texte. Plutôt que de suggérer une équipée de femmes collaborant dans le travail domestique, ce visuel éclaire dʼun jour nouveau la figure de la Cariatide : non pas un groupe de femmes soutenant collectivement le bâti, mais plusieurs variantes de la même femme, épuisée, jamais tranquille.
Ce type dʼimages matérialise les craintes des féministes de seconde vague vis-à -vis de lʼarchitecture : pour elles, les projets de Lilian Gilbreth étaient «  des tentatives claires de garder les femmes à la maison, de les enfermer littéralement dans les placards et les appareils ménagers  »808 (Penner 2021–22, 34). Ce que pointe cette citation, cʼest la dimension corporelle de lʼassignation en cuisine. Il ne sʼagit pas seulement dʼun fait social observable (les femmes sont en cuisine), ou dʼun enchaînement symbolique : quelque chose de lʼinjonction domestique passe par le corps, et par son association concrète au mobilier. La logique voudrait ainsi que les standards soient déclinés à partir des corps ; mais il apparaît que ces standards modélisent aussi à rebours les corps quʼils sont censés représenter (Arndt 2015). Cʼest peut-être plus sensible dans le prêt-à -porter : une fois des mesures prises et diffusées, des tailles jouent le rôle de repère. Si lʼon a du mal à sʼhabiller au-delà du 46, on peut en déduire que le corps nʼest pas censé faire cette taille. Un évier trop haut communiquera ainsi lʼinadéquation du corps usager, plutôt que la sienne. Cʼest dʼailleurs une des critiques qui peut être adressée de manière générale à lʼergonomie. Pour la chercheuse Jehanne Dautrey, ce terme connotant le confort et lʼadaptation au corps correspond en fait à une standardisation de lʼusage «  dans laquelle le corps est un organisme dressé  » (2014, 355). Sarah Hendren formule un reproche similaire dans son ouvrage lié au design et aux questions de handicap, en observant que ce que lʼon appelle ergonomie est le plus souvent fondé sur lʼobservation dʼ«  hommes blancs entre dix-huit et vingt-cinq ans  »809 (2020, 72). De cette critique découle une possibilité de solution évidente : ouvrir le spectre des usager·es possibles à une plus grande variété de corps. Mais cette «  inclusivité  », qui nʼest jamais évidente à accomplir, court le risque dʼenfermer celle pour qui la cuisine est modélisée. Les femmes nʼauraient-elles le choix quʼentre une cuisine parfaitement à leur mesure, jouant le rôle de cage dorée, ou un impossible volume conçu pour dʼautres ? Un concept me semble à même dʼêtre utile pour les projets de design en cuisine souhaitant dépasser cette impasse, entre proposition coercitive et solution inadaptée. Il sʼagit de positionner la démarche de design dʼespace dans la «  logique prosthétique de lʼarchitecture  » dans la mesure où la prothèse incarne le moment où «  la technologie devient une partie de la biologie  »810 (Wigley 2010, 53). Des parties de lʼespace peuvent ainsi être investies comme des fragments politiques qui offrent des espaces de projet, ou dʼœuvres dʼart qui peuvent ouvrir sur des projets.

Julia Taramarcaz évoque ainsi le travail des étudiantes Marcia Domenjoz, Manuela Stojkovic et Emilie Suchet qui proposent dans leur Å“uvre Chantier (2021) des briques textiles qui décalent le symbolisme classique de la pierre et son association au domaine de lʼarchitecture (Taramarcaz 2023, 140 ; fig. 4.56). Pour elles, le mur évoque le rôle de «  pilier  » des mères dans leur foyer, et la charge mentale qui est la leur -— en investissant le premier élément qui absorbe des charges dans le bâti, le mur (ibid.). Reste à savoir ce quʼune telle approche pourrait matérialiser dans le champ du design. Je reviens donc à ma discipline qui, vu ces expérimentations, semblera peut-être offrir un champ de contraintes trop fort pour nous permettre de véritablement penser une agentivité des femmes en cuisine. À moins que leur offrir une ouverture puisse être pris très littéralement, et que le mur des charges sʼaccommode dʼune fenêtre.
Dans le documentaire La domination masculine (2009), le réalisateur Patric Jean évoque les stéréotypes de genre qui sont transmis dès lʼenfance, à travers de jouets et de livres. Dans ce dernier cas, est montré à la caméra un ensemble dʼimages (extraites dʼouvrages non datés) qui entretiennent une curieuse ressemblance et forment un trope : celui de la petite fille à la fenêtre. La voix over présente cette analyse : la fenêtre étant associée au rêve, cela transcrit la position des personnages féminins face à leur futur. Ainsi les filles «  nʼont pas dʼambition : elles ont des rêves  ». La fenêtre constitue donc une ouverture au sens ambigu : si elle a le pouvoir dʼouvrir la cage domestique, cʼest pour mieux donner lʼillusion dʼun ailleurs que lʼoccupante de ces lieux est vouée à contempler sans pouvoir y accéder. Ce trope de la fille -— ou de la femme -— à la fenêtre est ancien, et on le rencontre déjà chez Virginia Woolf comme ce point de tension entre un extérieur inaccessible et une domesticité subie.
Elle écrit dans Trois Guinées :
Nous qui avons si longtemps regardé ces spectacles pompeux dans les livres ; ou qui avons observé, cachées derrière les rideaux dʼune fenêtre, les hommes cultivés quitter leur maison vers neuf heures et demie pour aller au bureau et retourner à la maison vers six heures et demie revenant dʼun bureau, nous pouvons nous aussi, quitter la maison, monter ces marches, entrer et sortir par ces portes, porter des perruques et des robes, gagner de lʼargent, rendre la justice… (1977[1938])811
La figure apparaît quelques quarante années plus tard sous la plume de Betty Friedan. La journaliste décrit cette femme «  qui ne contredit jamais son époux  » et «  passe de longues heures à regarder par la fenêtre la neige, la pluie, la percée graduelle des premiers crocus  »812 (1979[1963], 56) et que lʼon croise dans les pages du Ladiesʼ Home Journal en 1959. Il est dʼailleurs intéressant que ce motif soit convoqué de manière transversale, autant par des contenus conservateurs que par les féministes qui utilisent son caractère emblématique pour asseoir leur critique. La porte se substitue parfois à la fenêtre. Pour Shannon Hayes, la «  femme au foyer habillée avec soin sur les marches de sa maison de banlieue, embrassant son mari, emmenant ses enfants à lʼécole dans son break, puis rentrant à la maison pour repasser ses draps et cirer son parquet  »813 est une image puissante dans les imaginaires après-guerre étasuniens (2010, 28). Comme la fenêtre, ce perron est ambivalent. Il est dʼailleurs puissamment matérialisé au cinéma par John Ford dans The Searchers (1956), qui filme la silhouette de lʼépouse à contre-jour, faisant dʼelle une forme statuesque, tout aussi obscurcie que les murs du foyer. Le perron ou la fenêtre, dans les récits, nʼoccultent pas : ils font exister, quoiquʼen creux, ce confort de la vie domestique que le héros pourra regagner lorsquʼil aura suivi son parcours transformateur. La fenêtre nʼest donc réellement pas une issue, mais plutôt lʼouverture cruelle par laquelle les femmes voient un monde auquel elles nʼont pas accès.
Du point de vue du design, et de lʼarchitecture, quel sens donner aux ouvertures de la cuisine une fois ce paradoxe nommé ? Jʼai montré précédemment comment la cuisine naît de séparations fonctionnelles qui se solidifient aux débuts de lʼère industrielle. Des fonctions qui jusquʼalors étaient réunies dans une pièce unique (dormir, cuisiner, se laver) sont associées à un espace clos par des murs. Des couloirs et ouvertures sont chargés dʼarticuler les fonctions entre elles, avec des difficultés auxquelles les architectes ne cessent de faire face dès quʼil sʼagit de penser lʼhabiter. Les ouvertures, je lʼai signalé, nʼexistent pas seulement pour que la ménagère participe à la vie de famille en réalisant son travail, mais servent aussi à la circulation de lʼair et à lʼévacuation de la vapeur et des mauvaises odeurs. Toutefois, il serait injuste dʼaffirmer que les architectes -— majoritairement des hommes -— nʼont pas eu conscience de cet enfermement potentiel des femmes dans la cuisine. La presse sʼempare même très rapidement de la question, comme le relève Siegfried Giedion dans un article du New York Times de 1945 où la journaliste Mary Roche affirme que «  cʼest lʼisolement qui fait du mal  »814 (Giedion 1948, 621). La disparition du modèle bourgeois recourant systématiquement aux domestiques en faveur dʼune structure où la housewife est chargée de lʼessentiel des tâches explique en partie ce revirement, que Giedion situe vers les années 1930. La cuisine sʼouvre en même temps que le living-room, et ces deux pièces deviennent contiguë s. Cette ouverture rompt sans doute lʼisolement, mais elle permet aussi aux femmes dʼassurer une forme de double service, comme le note lʼhistorien qui ne voit cependant pas de problème lorsquʼil écrit quʼ«  une femme au foyer peut surveiller ses enfants et distraire les invité·es sans quitter son travail  »815 (1948, 625).
En termes dʼaménagement, Giedion crédite Frank Lloyd Wright pour son ouverture radicale de la cuisine, tout en longueur, sur la pièce de vie dans la Malcolm Willey House (1934) puis dans la Affleck House (1940). Ces choix, plutôt radicaux pour leur époque, infusent les plans dʼarchitectes à venir et signalent un changement de paradigme important : cuisiner ne doit plus nécessairement être fait «  derrière des portes fermées  » 816 (Giedion 1948, 624). Toujours selon Giedion, la demande des femmes au foyer va aussi dans le sens de lʼouverture, mais pas du mur qui sépare la cuisine de la salle à manger. Dans les années 1940, elles veulent ainsi une «  baie vitrée  »817 au-dessus de lʼévier, si lʼon en croit les sondages cités par lʼauteur (Giedion 1948, 617). Fait intéressant, la deuxième innovation attendue consiste en un miroir intégré à la cuisine : faut-il y voir un désir de se retrouver, ou une forme de contrôle de lʼapparence si bien intégré quʼil dépasse lʼespace de la salle de bains qui lui est traditionnellement dévolu ?
Lʼouverture pratiquée dans la cuisine dans les années 1930–40 est finalement contestée non par principe, mais en raison dʼinnovations tout autres qui lui font concurrence. La disparition du garde-manger (pantry) entraîne probablement une agréable économie de pas : elle est permise par le développement de la cuisine équipée et de ses placards, dispositif dont la matrice était le plan proposé par Catharine Beecher en 1842. Le problème de lʼenfermement de la housewife et de lʼéconomie de ses mouvements requièrent des solutions concurrentes : placards et fenêtres se disputent ainsi lʼespace mural disponible. George Nelson en prend acte dans son ouvrage Tomorrowʼs House en 1945 lorsquʼil écrit sobrement au sujet de la cuisine équipée que «  [m]alheureusement, les fenêtres en souffrent  »818 (Nelson & Wright 1945, 73). Il applique donc à sa proposition de cuisine (renommée «  work center  ») un principe mobilisé ailleurs dans le logis, celui du «  mur rangement  » («  storage wall  ») : lorsque la fonction placard est localisée sur un seul mur, dʼautres murs sont libérés et peuvent accueillir de larges baies vitrées. De telles possibilités sʼentendent bien sà »r dans le cas de propositions qui ne sont pas soumises à des contraintes budgétaires, ou pour des recommandations générales liées à la construction de nouveaux logis. Voilà sans doute un endroit où, en tant que designer, il convient rester modeste, et Dolores Hayden peut nous y aider lorsquʼelle nous rappelle que «  [d]ʼun point de vue féministe, la principale réussite de la plupart des expériences communautaires a été de mettre fin à lʼisolement de la femme au foyer  »819 (1982, 39). Ce nʼest pas tant le réaménagement qui libère, que lʼassociation de la conception à un programme social qui repense la place du travail domestique.
Pour finir cette partie initialement amorcée du côté des objets électroménagers, je souhaite décaler le sens pris par le terme «  ouverture  ». La fenêtre ouverte est une image possible de la liberté, en tant quʼelle est associée à la rêverie -— à condition que les individus (par exemple, les femmes) ne soient pas cantonnés à imaginer une vie autre, accoudés à son rebord. Lʼouverture, quʼelle soit une fenêtre ou une percée dans le mur, au-dessus dʼun bar, donne de la visibilité : ce regard qui imagine peut alors aussi surveiller. La fenêtre, en fabriquant la figure genrée de la rêveuse (plutôt que de la flâneuse), rend également possible le rôle de vigie. Sans aller trop vite vers le motif familier du panoptique cher à Foucault, il est vrai que cette figure de la femme à la fenêtre est aussi ambivalente pour cette raison : son regard est bien-veillant… Autant dire quʼil veille et potentiellement sur-veille comme on le voit dans des images très récentes, telle cette publicité pour le Family Hubâ„¢ commentée dans le chapitre II (cf. infra.). Quel rapport, cependant, avec lʼélectroménager ? Si on oublie un instant la dimension électrique de ces objets, on peut les observer de manière transversale en tant que prothèses. Mur, fenêtre, robot mixeur appareillent différemment les corps, et le corps féminin au premier chef.
Cet inventaire reste cependant incomplet sʼil nʼinclut pas lʼappareillage chimique de la housewife. Après-guerre, le foyer étasunien est réinventé par les industriels, notamment les fabricants de matériaux qui mettent à profit les innovations pensées pour lʼeffort de guerre -— ainsi, les plastiques transparents comme le Lucite ou le Plexiglas qui ont servi à équiper les tourelles de tir et les cockpits migrent vers la cuisine (Wosk 2003, 161). Lʼindustrie pharmaceutique nʼest pas en reste : Dexedrine et Méthédrine sont des médicaments aux effets euphorisants qui sont prescrits aux femmes étasuniennes au foyer après avoir été distribués aux soldats sur le front en Europe (Preciado 2011, 158). Paul Preciado observe dans Testo Junkie (2008) la manière dont les produits pharmaceutiques, notamment les hormones, relèvent dʼune «  infiltration progressive des techniques de contrôle social propres au système disciplinaire à lʼintérieur du corps individuel  » (163). Il analyse en ce sens la prise contraceptive dʼhormones, comparant le cercle calendaire qui structure lʼabsorption quotidienne de pilules au Panopticon de Bentham (164). Plus loin dans son texte, il évoque des substances comme le Prozac ou la Ritaline, qui produisent «  un laboratoire étatique miniaturisé installé dans le corps de chaque consommatrice  » (166). En 1978, le Valium et le Librium sont prescrits aux femmes 47 millions de fois aux États-Unis (Hayden 1982, 26). Tandis que lʼusage de ces médicaments, de la classe des benzodiazépines et aux vertus calmantes se répand, les amphétamines aux effets stimulants sont encore prescrites dans le cadre de régimes amincissants (Lyons 2009, 76).
Il est donc significatif que de nombreuses publicités pour ces produits, après-guerre et au-delà (aux États-Unis, où elles sont autorisées) établissent un lien direct entre molécules et travail domestique. Nervine nous promet de nous «  sentir calme  » (fig. 4.55.a)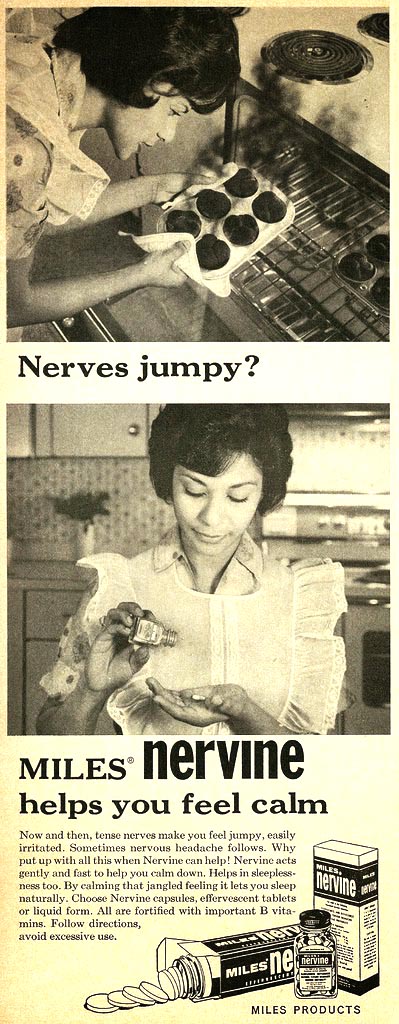 fig. 4.55.a : Publicité pour Nervine. plutôt que «  nerveuse  »820, tandis quʼune réclame Mornidine présente une housewife joyeuse accompagnée de la mention «  à présent, elle peut de nouveau préparer le petit-déjeuner  »821 (fig. 4.55.b). Ces supports de communication, comme les réclames pour lʼélectroménager, doivent reconnaître une forme de pénibilité du travail domestique pour soutenir leur discours promotionnel. Mais ce qui pourrait être une forme de conscience féministe (ce travail est pénible) est soluble dans une consommation capitaliste, plus précisément pharmacologique. Les objets de la domesticité sont bien visibles dans ces images, surtout dans les communications pour la Ritaline : dans lʼune dʼelles, une femme démissionnaire est assise sur son aspirateur, accompagnée dʼun texte qui promet la fin de «  la fatigue chronique et de lʼapathie  »822 (fig. 4.55.c).
fig. 4.55.a : Publicité pour Nervine. plutôt que «  nerveuse  »820, tandis quʼune réclame Mornidine présente une housewife joyeuse accompagnée de la mention «  à présent, elle peut de nouveau préparer le petit-déjeuner  »821 (fig. 4.55.b). Ces supports de communication, comme les réclames pour lʼélectroménager, doivent reconnaître une forme de pénibilité du travail domestique pour soutenir leur discours promotionnel. Mais ce qui pourrait être une forme de conscience féministe (ce travail est pénible) est soluble dans une consommation capitaliste, plus précisément pharmacologique. Les objets de la domesticité sont bien visibles dans ces images, surtout dans les communications pour la Ritaline : dans lʼune dʼelles, une femme démissionnaire est assise sur son aspirateur, accompagnée dʼun texte qui promet la fin de «  la fatigue chronique et de lʼapathie  »822 (fig. 4.55.c).


Cʼest peut-être à eux autant quʼaux médecins que lʼon sʼadresse, à lʼexemple de Serax, qui présente une femme derrière une série de manches à balai figurant des barreaux. Le slogan est formel : «  vous ne pouvez pas la libérer. Mais vous pouvez lʼaider à se sentir moins anxieuse  »823 (fig. 4.55.e). fig. 4.5.f : Publicité pour Mellaril. La promesse de Mellaril tient à mots à peine couverts dans une paix des ménages facilitée par la molécule, qui «  apaise les relations interpersonnelles  »824 (fig. 4.55.f). Tandis quʼaprès-guerre les psychotropes sont souvent associés à la révolution sexuelle et au bouillonnement artistique hippie, sur fond dʼouverture des «  portes de la perception  », les amphétamines (que lʼon nomme parfois «  speed  »), avant de devenir lʼemblème de la culture club, sont la prothèse chimique des femmes au foyer. Ces molécules ne sont pas une porte, pas plus quʼune fenêtre ou une ouverture sur un ailleurs : elles rétablissent plutôt ce qui est compris comme un fonctionnement normal de la femme hétérosexuelle au foyer.
fig. 4.5.f : Publicité pour Mellaril. La promesse de Mellaril tient à mots à peine couverts dans une paix des ménages facilitée par la molécule, qui «  apaise les relations interpersonnelles  »824 (fig. 4.55.f). Tandis quʼaprès-guerre les psychotropes sont souvent associés à la révolution sexuelle et au bouillonnement artistique hippie, sur fond dʼouverture des «  portes de la perception  », les amphétamines (que lʼon nomme parfois «  speed  »), avant de devenir lʼemblème de la culture club, sont la prothèse chimique des femmes au foyer. Ces molécules ne sont pas une porte, pas plus quʼune fenêtre ou une ouverture sur un ailleurs : elles rétablissent plutôt ce qui est compris comme un fonctionnement normal de la femme hétérosexuelle au foyer.
Paul B. Preciado écrit :
Le corps des femmes, y compris celles qui apparaissent comme normales, les féminines, les hétérosexuelles ni frigides ni hystériques, ni putes ni nymphomanes, les bonnes mères potentielles, est de toute façon objet de surveillance et de régulation. Par définition, le corps féminin nʼest jamais complètement normal hors des techniques qui font de lui un corps social hétérosexuel docile, dont la reproduction est sous contrôle  » (2008, 182).

Jʼajouterais à sa suite que ces techniques, qui participent de processus biopolitiques et prosthétiques spécifiques, participent à traiter les ménagères comme des machines. Dysfonctionnelles, quand elles dépriment ou cèdent à lʼanxiété, elles doivent être réparées au moyen dʼun outil chimique. Il est ensuite facile dʼimaginer que la molécule fait partie intégrante de son fonctionnement par défaut : la fenêtre chimique mute alors en vigie interne. La ménagère nʼest hackée que pour mieux respecter son programme ; son algorithme est celui de lʼantidépresseur, du stimulant ou de lʼanxiolytique. Cʼest lʼhorizon de ce dernier chapitre : après avoir fait un inventaire du petit peuple électroménager de la cuisine, je vais me risquer à examiner son membre central, la boniche, en tant quʼelle est un item mécanique parmi les autres. Plutôt que femme-mur, cette femme-mixeur possède peut-être, espérons-le, quelques ressources pour échapper aux injonctions, au cœur de son programme ou au-delà .
«  Moulinex libère la femme  »â€¯: parti·es de la méthode ancienne qui consiste à faire faire son travail à dʼautres, nous en en sommes venu·es à son pendant : sʼil nʼest pas éthique dʼexternaliser le travail sur des êtres humains, peut-être que le monde domestique peut devenir robotique. Ce rêve est double, et reprend le partage public/privé précédemment investi : à lʼusine, le robot remplace lʼouvrier. Nʼest-il pas logique que dans lʼautre usine du capitalisme, la cuisine, on remplace la ménagère par une roboniche ? Ce terme nʼest pas un simple mot-valise : ici, je le convoquerai pour désigner un ensemble de représentations qui allient la ménagère à son pendant mécanique. Les images qui relèvent de cette ménagère pourront aussi bien représenter une femme au foyer mécanisée (cʼest le pendant «  Moulinex  » de cette affaire, précédemment investi) quʼun robot pensé pour suppléer les femmes dans tous leurs travaux. En somme, le concept de roboniche permet de réunir les robots féminisés et les femmes robotisés pour mieux mʼinterroger : au-delà de la libération promise, que fait la technologie domestique aux femmes ? Une fois domestiquées, quelle cuisine fabriquent les technologies, notamment numériques, avec quelles implications pour les subjectivités des personnes qui sʼy frottent ? Et surtout, quelle place possède la roboniche, et donc le robot, dans ces imaginaires ?
Le terme «  robot  » possède des connotations plutôt négatives, du côté du travail forcé, lorsquʼil apparaît dans une pièce de théâtre de Karel ÄŒapek, R. U. R. (Rossumʼs Universal Robot). Robota est formé sur la base de «  rob  » , une racine slave qui signifie «  esclave  ». Il sʼagit dʼune étymologie très connue, par laquelle sont en général introduites la plupart des études (universitaires ou non) sur le sujet. Ce rappel fréquent peut faire oublier trois faits notoires : premièrement, le robot, avant dʼêtre une créature de cinéma ou de littérature, vient du théâtre ; deuxièmement, lʼétymologie fait apparaître la proximité du mot «  robot  » avec robota825, qui évoque la servitude, rob signifie serviteur ou serf ; enfin, le féminin roba peut vouloir dire bonne mais aussi prostituée dans les langues slaves (Komlosy, 42). Le terme «  robot  » charrie aujourdʼhui un ensemble dʼimages qui le situent dʼabord du côté de la technologie, de son métal et des rouages. Ses connotations négatives au sujet du travail ou des actions quotidiennes sont inscrites dans le langage : se comporter ou faire les choses «  comme un robot  » est rarement employé avec une connotation positive dans les discours quotidiens. Si lʼusine comme la maison sont traversées par ce motif du robot qui remplace le corps humain (soi-disant libéré pour un temps de loisirs), force est de constater que lʼusine sʼest davantage robotisée que le logis. Sans trop en chercher les causes, on peut observer simplement que le travail domestique, non rémunéré, ne repose pas sur un capital qui permettrait dʼinvestir dans une aide robotisée. La valeur produite, quoique réelle, est absorbée par le marché sans être monétisée : il nʼest par conséquent pas utile de procéder à une robotisation de masse comme cela a été le cas dans lʼindustrie. On est donc loin de la représentation comique dʼun Woody Allen dans Sleeper (1973), qui nous montre un futur où une armée de robots employée par lʼentreprise Domesticon vient sʼoccuper du logis. Dès lors, de quelle robotisation parle-t-on exactement ?
Dans lʼindustrie, des processus entiers sont confiés aux «  mains  » des machines qui construisent des biens de consommation complexes comme les voitures ou les grille-pains dont je parlais plus tôt. Comme le remarque lʼhistorien Aaron Benanav, les machines restent toutefois «  comiquement incapables dʼouvrir les portes ou, hélas, de plier le linge  »826 (2020, 1). À notre époque, le mot «  robot  » condense également un ensemble de fonctionnalités très hétérogènes. Certains robots dans lʼindustrie exécutent des tâches mécaniques qui les définissent comme des automates : cʼest le cas par exemple de robots capables de soulever des colis et de les déplacer. Dans le contexte du développement des technologies numériques, le terme de «  robot  » désigne cette suppléance mécanique aussi bien que sa combinaison avec des éléments logiciels, algorithmiques (scanner les colis pour gérer le stock, par exemple). Cʼest une dualité que jʼai déjà rencontrée dans ces pages, et qui explique les limites de lʼexternalisation robotique : même si nous avions un robot qui plie le linge, saurait-iel quand le faire ? Saurait-iel ensuite le ranger ? La part de la charge mentale, saisie par certaines applications et potentiellement relégable à des intelligences artificielles, est non négligeable lorsquʼon parle de robot et de robotisation. fig. 4.56 : L’électrobonne, exposée au Salon des Arts Ménagers en 1933. En dépit de ces limites, le début du XXe siècle a fait miroiter ce rêve aux consommateurices. En 1933, le Salon des Arts Ménagers expose lʼÉlectrobonne, «  [u]ne servante électrique à 20 centimes de lʼheure  », qui condense les fonctions dʼ «  aspirateur, sèche-cheveux, cireuse, vaporisateur, désinfecteur  » (Bouillon 2022, 96 ; fig. 4.56). Le propos promotionnel est très clair quant à ce que la technologie supplée : cʼest bien le travail de la servante qui est remplacée, en même temps que lʼobjet incarne pour les classes bourgeoises (ou les classes aspirant à ce mode de vie) la certitude de continuer à être servies. Dire que le robot est une «  servante  » revient à faire imaginer chez lui une grande autonomie, qui permet à lʼusager de muter en simple donneur dʼordres. Les scénarios projetés par les entreprises de la Silicon Valley participent de ce rêve. Prononcer «  Dis, Siri  », cʼest faire croire que tout est à portée de voix. Mais pour lʼheure, «  dis, Siri, plie le linge  » relève encore du scénario de science-fiction… À moins que la «  Siri  » en question ne redevienne une travailleuse pauvre.
fig. 4.56 : L’électrobonne, exposée au Salon des Arts Ménagers en 1933. En dépit de ces limites, le début du XXe siècle a fait miroiter ce rêve aux consommateurices. En 1933, le Salon des Arts Ménagers expose lʼÉlectrobonne, «  [u]ne servante électrique à 20 centimes de lʼheure  », qui condense les fonctions dʼ «  aspirateur, sèche-cheveux, cireuse, vaporisateur, désinfecteur  » (Bouillon 2022, 96 ; fig. 4.56). Le propos promotionnel est très clair quant à ce que la technologie supplée : cʼest bien le travail de la servante qui est remplacée, en même temps que lʼobjet incarne pour les classes bourgeoises (ou les classes aspirant à ce mode de vie) la certitude de continuer à être servies. Dire que le robot est une «  servante  » revient à faire imaginer chez lui une grande autonomie, qui permet à lʼusager de muter en simple donneur dʼordres. Les scénarios projetés par les entreprises de la Silicon Valley participent de ce rêve. Prononcer «  Dis, Siri  », cʼest faire croire que tout est à portée de voix. Mais pour lʼheure, «  dis, Siri, plie le linge  » relève encore du scénario de science-fiction… À moins que la «  Siri  » en question ne redevienne une travailleuse pauvre.
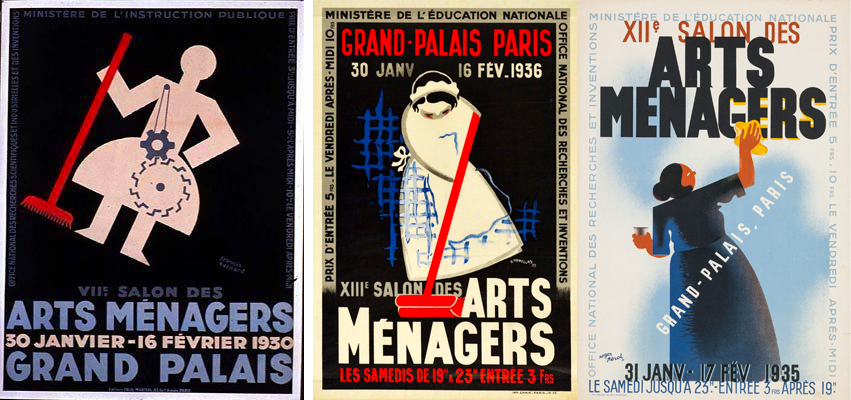
La communication générale du Salon des arts ménagers est traversée de manière célèbre par cette question de lʼexternalisation mécanique, sinon robotique : mais les signes que les supports visuels mettent en place sont justement plus ambigus en termes dʼidentification que le discours associé à lʼÉlectrobonne. Dès 1923, un personnage incarne le Salon sur les affiches et sur le site de lʼexposition : la «  Marie mécanique  » (fig. 4.57). Créée par lʼillustrateur français Francis Bernard, la figure apparaît de manière régulière sur divers supports de communication, y compris des timbres ou une figure métallique géante présentée à lʼentrée du Salon (Berry 2017, 9 ; 17). Parfois, et même dès les années 1930, elle laisse place à une femme «  de chair et dʼos  » (par exemple en 1935, 1936, fig. 4.57.a & b). Ces cas sont rares : la silhouette schématique de la Marie mécanique, à défaut dʼêtre véritablement un logo, constitue un signe puissant, immédiatement reconnaissable. Son degré dʼiconicité est en effet très faible : sur lʼaffiche du Salon de 1930 (fig. 4.57.c), la tête de Marie est formée dʼun simple cercle, tandis que ses jambes se résument à des rectangles, et sa jupe, à un demi-cercle. Le personnage possède une esthétique naïve, en même temps quʼune radicalité propre au style Art Déco dʼalors. Cette silhouette basique est le plus souvent complétée dʼun balai, tandis que la forme essentielle du corps de Marie permet des jeux de vide/plein efficaces sur lʼaffiche, accentuant son impact visuel et sa lisibilité.
Lorsque Marie sʼévide, à la manière dʼun pochoir, cʼest pour mieux révéler son intérieur : des rouages simples évoquant sa nature mécanique -— dʼoù elle tire son nom.
Mais quʼincarne cette roboniche nommée Marie ? Pour lʼhistorienne de lʼart Francesca Berry, le signe est dʼautant plus fonctionnel quʼil est équivoque, notamment en termes de classe (Berry 2017, 17). Selon elle, le nom de Marie est en lui-même significatif, car associé «  à une identité commune, une appellation adaptée au titre professionnel de bonne à tout faire  »827 (Berry 2017, 17). Mais Marie nʼest pas pour autant strictement une bonne :
«  [elle] peut tout autant évoquer une nouvelle figure de femme moyenne, apparemment socialement indifférenciée sur le plan social de ‹ ménagère › ou ‹ housewife › à laquelle toutes les femmes, quʼelles appartiennent à la classe ouvrière ou à la bourgeoisie, [sont] désormais censées aspirer  »828 (Berry 2017, 17–18).
En même temps, cette communication destinée à la bourgeoisie reste ouverte en termes dʼinterprétation, «  pour un public bourgeois qui avait peut-être conservé la volonté et la capacité dʼemployer une femme de ménage, mais qui pouvait aussi envisager de compléter ce travail par des appareils coà »teux  »829. Housewife ou servante, le signe synthétique ne tranche pas et désigne les deux, réunies par leur possible externalisation vers un troisième terme : la robote. Cette robote, bien sà »r utopique en termes dʼactualisation technique, est, en termes commerciaux, un signe pointant vers le Salon comme lieu de toutes les innovations techniques. Il porte également en lui une forme dʼinquiétude : la possible contamination de la ménagère par son arsenal ménager, qui devient dès lors un robot multifonction parmi les autres. La publicité est hantée par cette possibilité au XXe siècle, comme le montre Ellen Lupton qui reprend à son compte lʼexpression «  fiancée mécanique  », empruntée à Marshall McLuhan (Lupton 1993, 10).
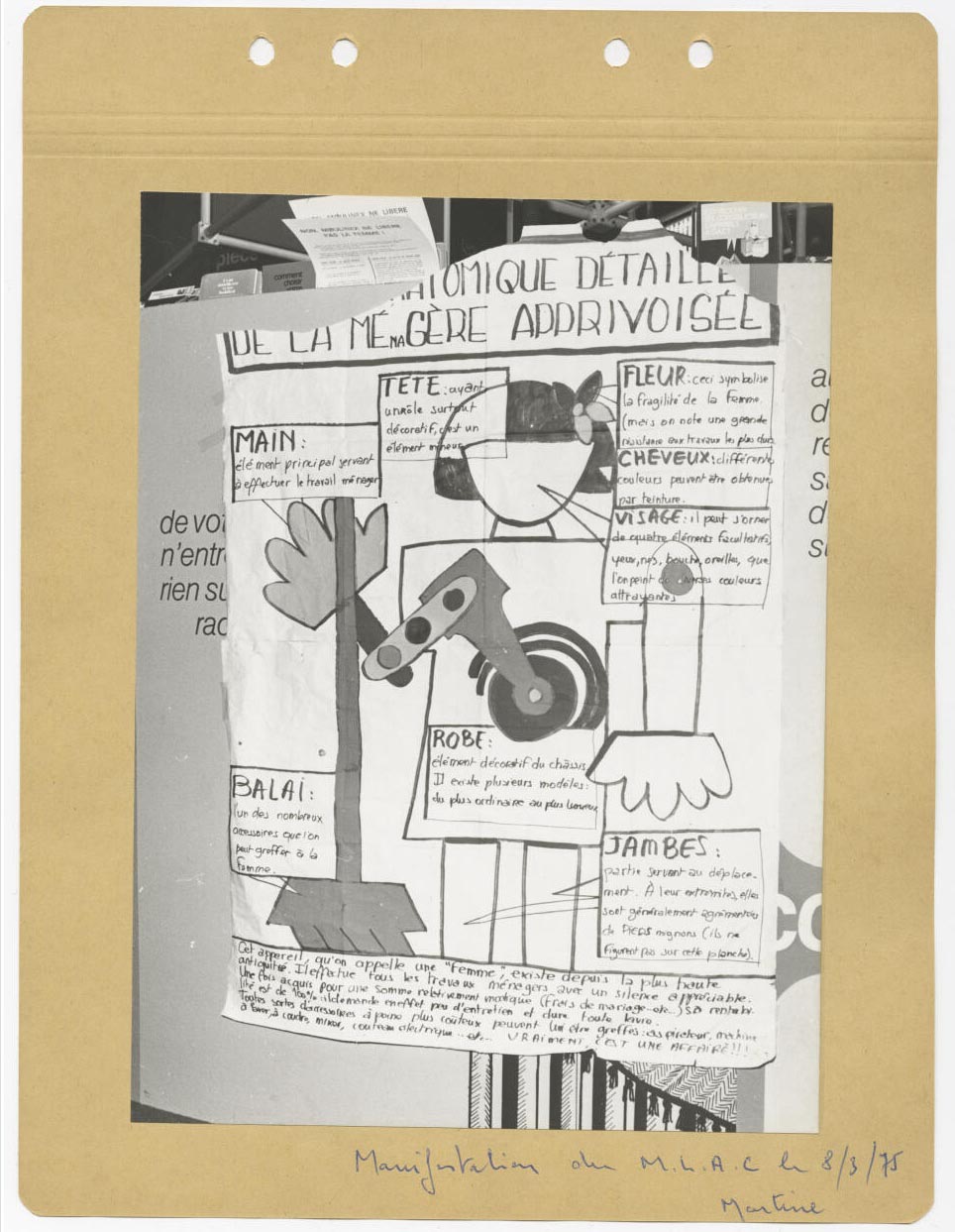
Dans les images quʼelle collecte, elle pointe cette continuité entre le corps féminin et lʼélectricité, que ce soit dans une réclame qui invite les hommes à acheter une montre pour «  électrifier [leur] femme  »830 ou dans un autre support qui compare le visage dʼune femme à un écran de télévision (Lupton 1993, 12). En France, on retrouve cette proximité corps féminin-corps robotique. Chez Moulinex, dans les années 1960, les robots sʼappellent Marie, Jeannette, Charlotte (Leymonerie 212) : si la boniche se robotise, les robots, eux, sʼhumanisent en se féminisant. Les féministes du MLF en sʼy trompent pas, quand elles manifestent le 8 mars 1975 (cf. infra.) au Salon des arts ménagers : leur communication repose notamment sur un détournement de la Marie Mécanique, tant cette figure est dense en assignations de genre et fausses promesses de libération (fig. 4.58). Le signe étant sommaire, sa reproduction et son détournement par les féministes sont dʼautant plus simples. Ainsi, le poster sarcastique indique à la manière dʼun schéma technique les parties de cette femme -— ici comprise comme lʼépouse enchaînée aux travaux domestiques. Il est écrit que la tête «  a surtout un rôle décoratif  » et que la main «  sert à effectuer le travail ménager  ». Le balai, quant à lui, est un accessoire que lʼon peut «  greffer  » au corps de la femme. Une légende complète le tout :
Cet appareil, quʼon appelle une «  femme  » existe depuis la plus haute antiquité. Il effectue tous les travaux ménagers avec un silence appréciable. Une fois acquis pour une somme relativement modique (frais de mariage… etc…) sa rentabilité est de 100 %. Il demande en effet peu dʼentretien et dure toute la vie.
Les féministes pointent lʼenvers de lʼimage de lʼÉlectrobonne : loin dʼêtre libérée par ses appareils, ou par une boniche qui les concentrerait tous, les femmes dʼalors (et sans doute dʼaujourdʼhui) sont plutôt rattrapées par la mécanisation qui les affecte corporellement, plutôt quʼelle nʼest un domaine où elles pourraient sʼempouvoirer, en devenant bricoleuses ou ingénieures. La tâche, en se robotisant, ne se déféminise pas : la promesse dʼune Marie mécanique produit même une nouvelle forme dʼaliénation pour les femmes. Néanmoins, lʼincarnation dʼune promesse de libération en une figure identifiable rend le détournement facile et efficace. Les féministes du MLF font parler autrement la Marie Mécanique, comme plus tard Jane Renegade et Jane Phoenix sʼhabillent en housewives des années 50 pour faire imaginer un biohacking transféministe.
La «  MÉnaGÈRE apprivoisée  », caricature de la Marie mécanique possède un pensant filmique sur lequel il est utile de sʼarrêter. En 1975, Brian Forbes réalise un film adapté du roman Stepford Wives dʼIra Levin831 (1972). Il y raconte lʼhistoire de Joanna, une photographe new-yorkaise qui quitte la ville avec son mari et ses deux enfants pour sʼinstaller dans la bourgade champêtre de Stepford. Cette femme codée comme «  moderne  » -— elle travaille comme photographe, porte un pantalon, semble avoir une relation plutôt horizontale avec son mari -— découvre un environnement que le féminisme de la seconde vague ne semble pas avoir atteint. Les femmes y sont habillées comme dans les années 1950, et se comportent comme de parfaites épouses : elles sont soumises, connaissent leur place et, lorsquʼelles se retrouvent entre elles, aucun grief ne fait surface. Elles discutent plutôt de lʼélaboration des menus et décorations de Noë l. Les hommes, quant à eux, semblent très satisfaits de cet état des choses, et se retrouvent eux aussi en non-mixité, dans un club qui leur est réservé. Joanna se lie très vite avec Bobbie qui partage ses idéaux féministes et méprise la soumission des femmes de Stepford à leurs maris. Mais Bobbie finit par devenir aussi soumise que les autres, ce qui pousse Joanna à chercher plus loin une explication. Elle découvre alors que les femmes de Stepford sont des clones robotiques fabriqués par un des hommes de la communauté. Les épouses sont remplacées une à une par ces versions soumises dʼelles-mêmes et Joanna ne fera pas exception. Le film se termine sur lʼimage de son visage robotique, les yeux sans pupilles, vidés de leur subjectivité (fig. 4.59.a).
 fig. 4.59.a : Photogrammes extraits du film Stepford Wives (1972) :
a. Johanna finit robotisée. Le film a également fait lʼobjet dʼun remake en 2004, qui joue avec habileté sur la connaissance du public du premier opus. Si les trois premiers quarts du film respectent globalement le récit original, un plot twist final nous laisse découvrir que ce nʼest pas un homme qui a tout manigancé, puisquʼil est lui-même un robot. Cʼest en fait son épouse (interprétée par Glenn Close), une tradwife conservatrice, qui a fabriqué ce cauchemar masculiniste. Quelques années avant #Metoo, le film investit de manière critique lʼa priori qui verrait dans les femmes les alliées naturelles du féminisme. Un tel propos rappelle celui de Andrea Dworkin dans lʼouvrage Les femmes de droite (2012[1983]). Disparu dans la traduction française, son sous-titre évoquait lʼintention, pour la théoricienne, de questionner «  la politique des femmes domestiquées  »â€¯: Stepford Wives, dans ses deux versions, montre quant à lui que les femmes sont domestiquées (contrôlées) à mesure quʼelles acceptent la domesticité.
fig. 4.59.a : Photogrammes extraits du film Stepford Wives (1972) :
a. Johanna finit robotisée. Le film a également fait lʼobjet dʼun remake en 2004, qui joue avec habileté sur la connaissance du public du premier opus. Si les trois premiers quarts du film respectent globalement le récit original, un plot twist final nous laisse découvrir que ce nʼest pas un homme qui a tout manigancé, puisquʼil est lui-même un robot. Cʼest en fait son épouse (interprétée par Glenn Close), une tradwife conservatrice, qui a fabriqué ce cauchemar masculiniste. Quelques années avant #Metoo, le film investit de manière critique lʼa priori qui verrait dans les femmes les alliées naturelles du féminisme. Un tel propos rappelle celui de Andrea Dworkin dans lʼouvrage Les femmes de droite (2012[1983]). Disparu dans la traduction française, son sous-titre évoquait lʼintention, pour la théoricienne, de questionner «  la politique des femmes domestiquées  »â€¯: Stepford Wives, dans ses deux versions, montre quant à lui que les femmes sont domestiquées (contrôlées) à mesure quʼelles acceptent la domesticité.
Une scène est particulièrement instructive du point de vue du design. Joanna a saisi que quelque chose se trame à Stepford, et elle se confie à sa thérapeute en ville, lui disant que très bientôt «  il y aura quelquʼun avec mon nom, qui cuisinera et fera le ménage comme pas possible, mais elle ne sera pas photographe et elle ne sera pas moi… Elle sera comme un robot à Disneyland  »832. Alors quʼelle prépare sa fuite, elle se rend chez son amie Bonnie. Cette dernière a montré plus tôt des signes de «  stepfordisation  » et cette nouvelle visite confirme les craintes de Joanna. Tandis quʼelle exprime son angoisse au sujet de sa situation, Bonnie reste de marbre et focalisée sur lʼaccueil de son hôte, à qui elle veut absolument faire du café. Exaspérée, Joanna finit par poignarder Bonnie. Celle-ci ne saigne pas, pas plus quʼelle ne semble souffrir ou même être troublée. Elle se contente de gronder Joanna, répétant en boucle «  pourquoi faire une chose pareille ?  »833 (fig. 4.59.b). Tandis quʼelle est insensible à la détresse de son amie, Bonnie continue dʼaccomplir les gestes nécessaires à la confection du café promis. Toutefois, le coup de couteau semble avoir affecté ses capacités puisque la housewife répète ses gestes de manière de plus en plus mécanique, tandis que la bande-son (probablement une boucle en 8-bits) évoque lʼimaginaire de la machine, et confirme ce dont Joanna avait lʼintuition : Bonnie a été remplacée par son double robotique, obéissant et servile.

Le film fonctionne sur une peur féminine, sinon féministe : celle de voir son corps annexé, et de «  disparaître  » derrière le rôle attendu par la société. La disparition des femmes, et leur remplacement par une robote peuvent aussi être lus comme une forme dramatisée de la réalité des féminicides et des violences conjugales, déjà dénoncée par les féministes dʼalors. La dimension sciencefictionnelle du film, tardivement révélée, tient à cette figure du robot qui nʼest pas perçu comme une prouesse technique. Lʼaspect «  robotique  » des épouses repose en effet entièrement sur le jeu dʼactrice. Cette codification discrète participe de lʼambivalence de la figure du robot dans ce film : elle sert autant comme horizon horrifique, en montrant que le substitut mécanique nʼest pas nécessairement synonyme de libération. En ce sens, le film nous invite à regarder les objets mécaniques comme prolongeant le rêve de la housewife des années 1950, plutôt que son dépassement. Mais le robot, appréhendé moins littéralement, permet aussi de comprendre à rebours la nature intrinsèquement robotique, donc aliénante, du travail domestique. Bonnie qui verse le café de manière compulsive nʼest peut-être pas dysfonctionnelle : elle montre au contraire ce que lʼobéissance des femmes au programme domestique comporte dʼabsurde et de monstrueux. Comme métaphore, Bonnie-mécanisée fonctionne pleinement et révèle, comme Bergson avait pu le montrer au sujet du rire, que le vivant apparemment «  naturel  » est cousin des logiques machiniques. Signe puissant, la roboniche est toutefois limitée, indépendamment de son inscription narrative plutôt féministe. En effet, le récit nʼoffre aucune porte de sortie à ses personnages, dans la logique du genre de lʼhorreur. Ici, pas même une last girl834 ne résiste à son remplacement par les masculinistes. En cela, le film (certes réalisé par un homme) témoigne dʼune posture anti-technique, ou au moins technophobe en même temps que féministe. Cʼest un écueil que Donna Haraway pointe déjà dans son fameux «  Manifeste Cyborg  » (1991). Elle y affirme :
les féministes ont […] beaucoup à gagner en embrassant explicitement les possibilités inhérentes à la dissolution des différences qui opposent nettement organisme et machine et de toutes celles qui structurent de façon similaire lʼidentité occidentale835 (1991).
En dʼautres termes, la philosophe invite les féministes (notamment socialistes et marxiennes) à abandonner leurs arguments anti-machine pour penser des assemblages hybrides. Les masculinistes de Stepford Wives utilisent leur possession des moyens techniques au service dʼun projet sexiste et utilitariste ; le récit prend acte de cette substitution, en renvoyant dos à dos femme et machine. Le film expose ainsi la nature intrinsèquement machinique du travail domestique, mais ne propose aucune utopie ou tout autre assemblage original corps-machine. Par déduction, le féminisme qui serait opposé à ce masculinisme se situe du côté des femmes «  naturelles  », non machinisées. Cʼest aussi en ce sens que le récit se termine sur une aporie : les personnages nʼont pas dʼissue, mais les femmes «  cyborgiennes  » non plus. Du point de vue du design, la servante robote ici dépeinte est une vision de cauchemar, dont lʼâme a été absorbée par lʼefficace de la tâche. Le design peut-il nous aider à penser des assemblages hybrides qui concilient ce devenir machine du travail domestique avec des subjectivités non aliénées ? Exister dans un continuum dʼappareils électriques ne peut-il pas constituer une stratégie ?
Stepford Wives (1975) imagine des femmes remplacées par leurs doubles robotiques ; son remake, en 2004, postule même lʼexistence dʼune télécommande reliée à la boniche qui permette de lui faire accomplir les tâches domestiques, service sexuel compris. Jʼai évoqué la manière dont ce scénario métaphorise en premier lieu la servitude féminine, plutôt quʼil nʼévoque une véritable potentialité. Mais lʼarrivée sur le marché de majordomes numériques invite à une autre interprétation. En effet, si les femmes nʼont pas littéralement été supprimées en faveur dʼandroïdes, des substituts technologiques sont offerts sur le marché pour prendre en charge ce qui a longtemps été le travail des femmes, voire plus précisément des mères. Dans dʼautres travaux auxquels a collaboré Anthony Masure, jʼai étudié la manière dont les assistants vocaux sont traversés par dʼimportants biais de genre qui font plutôt dʼeux des assistantes vocales (Pandelakis 2018 ; 2021). Comme Moulinex nommait ses robots Charlotte ou Jeannette, les entreprises de la Silicon Valley ont aisément donné des noms féminins à leurs assistants vocaux (Siri, Alexa, Cortana). Par ailleurs, une analyse trop rapide pourrait nous mener à croire que les technologies du numérique «  dématérialisent  » le travail et, dès lors, se passent de corps et donc de genre.
Rien, dans cet a priori, ne se vérifie. Tout dʼabord, il existe bel et bien une matérialité du numérique, que ce soit dans les infrastructures qui rendent nos usages numériques possibles (serveurs, satellites, smartphones) ou dans les usages eux-mêmes, qui impliquent encore nos mains, nos yeux, et donc toute une série de processus physiques incarnés. Si un service, dans une application, ne possède pas au premier regard la tangibilité dʼun marteau qui plante un clou, il nʼen possède pas moins une matérialité propre. Deuxièmement, de nombreux objets, phénomènes ou idées peuvent être genrés indépendamment de toute sexuation et même de toute matérialité palpable. En dʼautres termes, la présumée «  virtualité  » ne résout pas les biais de genre, et de nombreuses études féministes et anti-racistes ont depuis longtemps démontré que ceux-ci étaient accentués par les usages du numérique, en raison des biais de conception logicielle ou encore de la gestion de jeux de données (Wachter-Boettcher 2017 ; Noble 2018). Enfin, les mythologies liées aux technologies du numérique, notamment celles produites par la Silicon Valley, reposent fréquemment sur la valorisation dʼune figure héroïque dans la tradition du génie occidental (Galluzzo 2023, 10). Cette figure est souvent blanche, masculine, valide. En effet, les tropes liés à lʼinnovation fonctionnent sur un récit dʼexceptionnalisme mettant en scène un ou plusieurs jeunes hommes blancs qui auraient tout inventé dans leur garage ou leur cave. Ce mythe, souvent associé à des figures comme Bill Gates, Steve Jobs ou Elon Musk, masque les conditions matérielles effectives, souvent privilégiées, dans lesquelles ces hommes ont construit leurs inventions.
La chercheuse en théorie des media Sarah Sharma sʼempare de cette figure de lʼhomme blanc travaillant depuis chez lui, mais en montre lʼenvers. Plutôt que le récit à succès de la Silicon Valley, elle pointe le cliché de lʼhomme qui travaille «  dans la cave de Maman  »836 utilisé pour discréditer les masculinistes étasuniens (2018). Parallèlement, elle évoque une tendance alors récente dans les médias, consistant à «  suggér[er] que des techbros837 dans la vingtaine gaspillent leurs talents en concevant des technologies et des programmes pour des tâches quʼils aimeraient que leurs mères fassent encore pour eux : conduire, cuisiner, nettoyer, faire la lessive  »838 (Sharma 2018). Elle évoque alors le terme de «  post-mom economy  » qui a émergé pour désigner lʼensemble des applications qui, en revendiquant plutôt lʼingéniosité, lʼinnovation technique et lʼintelligence entrepreneuriale, prétendent se substituer au labeur féminin. Ce faisant, elles éludent les conditions matérielles (tels les rapports de classe, race, genre) qui déterminent lʼattribution habituelle de ces tâches, et promettent de façon fallacieuse de les dissoudre par le téléchargement dʼune application (Sharma 2018). Par effet retour, les applications, en étant pensées comme des servant·es, voient leur potentiel limité. Plutôt que de penser des scénarios alternatifs combinant de manière hybride humain et adjuvants numériques, ces scripts sont condamnés à reproduire des modèles de servitude humaine.
Joanne McNeil évoque ainsi lʼévolution possible du moteur de recherche Google, de plus en plus pensé pour sʼéloigner du modèle de la requête dans un champ textuel (2020, 34). Lʼidée est dʼépouser un modèle prédictif qui sʼemparera de souhaits vagues plutôt que de demandes ciblées. In fine, Google «  espère que lʼon lui [lʼapplication] parlera comme à une servante en cuisine  »839, dit J. McNeil (ibid.). Comme je lʼai évoqué plus tôt (cf. infra., chap II), ce type dʼexternalisation ne fait que confirmer les logiques de servitude. Donner des ordres à une application qui prend en charge le labeur féminin revient à admettre que ledit labeur doit être performé de cette manière, selon la logique descendante de la commande. On en voit justement un aperçu comique dans la série télévisée Silicon Valley : un entrepreneur milliardaire a inventé une application, The Lady (La Dame), qui prend en charge les tâches éducatives -— par exemple, dire à un enfant dʼaller se coucher. Lʼentrepreneur affirme ainsi avoir «  disrupté la masculinité  » (fig. 4.60) : en réalité, ce type dʼinnovations parodiques, peu éloignées de leurs référents existants, intensifient le labeur féminin domestique. Que celui-ci ne leur incombe plus est contingent à lʼexistence dʼune technique dont elles ont tôt ou tard la charge, lorsque lʼapplication cesse de fonctionner ou quʼelle montre ses limites.
Pour saisir cette forme spécifique dʼassignation domestique, les chercheuses et spécialistes des médias Caroline Bassett, Sarah Kember, et Kate OʼRiordan font appel à une figure : Cendrillon. Elle est lʼincarnation dʼun «  nouveau contrat sexuel  » et «  fait partie dʼun environnement transparent, intuitif, affectif, gestuel, sensoriel et haptique  »840 (2019, 5). Pour les trois chercheuses, Microsoft ne propose rien de nouveau par rapport à Monsanto dans les années 1950, si ce nʼest que le futur dʼaujourdʼhui est fait de verre et non de mélamine.

Et si la pantoufle de Cendrillon nʼest pas de verre, lʼimage de ce chausson est mobilisée pour désigner tout ce qui vient apparemment lʼempouvoirer mais aussi lʼenchaîner :
La nouvelle pantoufle de Cendrillon est un plan de travail translucide à commande vocale qui lui demande si elle a besoin dʼaide pour faire ses pâtisseries, ou un miroir de salle de bain à réalité augmentée qui affiche un calendrier de réunions assommant, avant même quʼelle ne se soit brossé les dents (Bassett, Kember & OʼRiordan 2019, 5).841
Si lʼoffre dʼapplications, et plus généralement de nouvelles technologies, relève dʼune post-mom economy, il est probable que ce terme ne sʼapplique que du point de vue des hommes concepteurs et des hommes consommateurs. Pour eux, lʼapplication est source de bénéfices quand elle prend le relais de lʼépouse ou de la mère. Pour les femmes, il faudrait plutôt parler dʼune über-mom economy, tant tout ce qui semble les libérer finit par augmenter les attentes à leur égard et donc par alourdir la charge de ménagère.
La mini-série documentaire Femmes sous algorithmes, produite par la chaîne franco-allemande Arte (2020), incarne dans une forme audiovisuelle la manière dont «  Cendrillon  » est enfermée dans des attentes anciennes par les usages mêmes qui étaient censés la «  libérer  ». Quasiment dénués de voix over, les épisodes montrent comment, en cherchant une réponse à une question simple sur le Web, en particulier sur YouTube, une usagère peut-être exposée à des contenus très injonctifs et souvent conservateurs, quelle que soit leur tonalité progressiste. Dans «  Clean like a Boss  », une requête portant sur le nettoyage des moisissures conduit les réalisatrices sur la piste des contenus épinglés grâce au hashtag #cleantok, et dans lesquels sont dispensés de multiples conseils sur le ménage, voire des vidéos documentant dans les moindres détails des routines dʼentretien. Rapidement, les enquêtrices dévient sur les contenus sponsorisés, puis découvrent les univers #mompreneur et #girlboss où des femmes monétisent leurs recommandations de produits. Lʼépisode sʼachève du côté des tradwives qui revendiquent le déterminisme de la différence sexuelle et recommandent un partage genré du travail, en rappelant quʼune femme doit être soumise à son mari. Comme tous les épisodes, «  Clean Like a Boss  » se conclut par la collusion finale entre le point de départ (nettoyer les taches de moisissure) et le point dʼarrivée (être une épouse au foyer soumise). Ce faisant, la série met en évidence les effets de récursivité propres au Web (Citton 2023, 324) : plus un contenu est consulté, plus le chemin qui mène jusquʼà lui sera aisé. Plus encore, lʼintérêt de la mini-série réside dans les moyens audiovisuels sont mobilisés pour montrer la dimension genrée de la récursivité, et pas seulement pour mettre en évidence une différence entre les contenus proposés aux hommes et aux femmes. En effet, la notion de chaîne de gestes, que jʼai esquissée plus tôt, y prend un sens tout différent. Plutôt que de constituer des actions isolées pouvant être enchaînées, à la manière de ceux prônés par les spécialistes en économie domestique des deux siècles derniers, ce sont ici des gestes, leurs images et les commentaires sur eux qui forment une chaîne de consultation. Une tâche commune -— comme nettoyer sa salle de bains -— pourrait a priori être désincarcérée dʼun programme sexiste dʼassignation du travail domestique aux femmes. Pourtant, les contenus qui prolifèrent sur le Web, même lorsquʼils ne sont pas eux-mêmes injonctifs, existent en continuité thématique (par le jeu des hashtags) avec dʼautres qui le sont davantage.
Dʼautres épisodes nous guident également vers les questionnements propres à cette fin de chapitre. «  Miracle Morning  » explore le succès du livre du même nom, écrit par Hal Elrod, en visitant dʼabord des contenus faisant lʼapologie de ce lever aux aurores (vers 5 heures du matin), censé apporter productivité et bien-être. Rapidement, les témoignages se font plus nuancés, et ce temps précieux trouvé le matin est vite investi par de nouvelles occupations, comme la méditation, le yoga, et les tâches ménagères. Les youtubeuses présentent ainsi leur Google Agenda segmenté en microtâches, à la demi-heure près, dans une exhaustivité que même Paulette Bernège aurait sans doute trouvée exagérée. Dans «  Bullet Journal  », un mouvement similaire est visible. Le BuJo, sorte dʼagenda augmenté lui aussi censé apporter une productivité accrue, devient rapidement un outil de tracking où chaque phénomène corporel fait lʼobjet dʼune consignation. La série documentaire met en évidence au moins trois phénomènes liés à la massification des contenus sur les plateformes de partage de contenus en ligne. Premièrement, la recherche dʼinformations est très étroitement liée à des comportements de consommation : la bascule de YouTube à Amazon est simple et facilitée par des vidéos sponsorisées qui multiplient les placements de produits. Deuxièmement, les méthodes destinées à améliorer son bien-être se superposent à celles qui ciblent la productivité : le bonheur est individualisé et commodifié à lʼenvi dans ces contenus, et constamment montré comme étant à portée dʼachat. Enfin, ces vidéos qui sont créées en majorité par des femmes, et qui sʼadressent le plus souvent à un public féminin, rencontrent tôt ou tard la question du ménage.
Dans des vidéos qui parlent dʼorganisation au travail ou de routine matinale, la tâche ménagère finit par sʼinviter de manière impromptue et la question générale du partage, si elle est peut-être posée par ailleurs, ne lʼest pas frontalement dans les contenus sélectionnés par la mini-série, voire est complètement éludé dans la mesure où lʼon entend des femmes parler de lessives comme sʼil sʼagissait de leur travail. Stepford Wives critique en 1975 lʼappropriation du corps des femmes par les hommes, en utilisant la figure du robot. Cette robotisation nʼest pas seulement métaphorique : elle désigne concrètement les nouvelles subjectivités qui ont été façonnées par lʼélectrification, lʼarrivée de lʼélectroménager dans les domiciles, et par la numérisation des environnements, notamment domestique. Ainsi, la boniche qui fait son café vaille que vaille éclaire nos habitus contemporains : elle désigne la manière dont les chaînes algorithmiques constituent autant de nouveaux programmes, tout en continuant à servir lʼancien. Parmi ces vieilles injonctions, il sʼen trouve une qui nʼa a priori pas sa place en cuisine : être belle. Pourtant, je vais montrer ci-après que le soin de soi, pour les femmes, fait bien partie des tâches dʼentretien qui sont attendues dʼelles.
Depuis le XIXe siècle au moins, lʼespace domestique est indissociable dʼun ensemble de discours prescriptifs. Parfois écrits par des hommes, mais aussi souvent saisis par des femmes comme lʼoccasion de construire une expertise, ces textes explicitent des savoir-faire au logis et en cuisine. Il semble, à lire Catharine Beecher ou Paulette Bernège, que lʼobjet du travail soit le logis, et à travers lui, la famille. Par moment, il semble que lʼépouse ménagère disparaît : fourmi travailleuse, elle nʼest pas la destinataire affichée de son travail, et encore moins un sujet. En réalité, le travail domestique inclut des actes de soins très hybrides comme sʼoccuper des enfants, assurer le travail administratif lié au logis, et même, dans certaines analyses, le service sexuel accordé au mari842. Parmi ces actes, on pourrait ajouter le soin que les femmes au foyer doivent sʼaccorder à elles-mêmes. Si faire le ménage implique souvent de se salir, il émerge au XXe siècle une nouvelle injonction : celle de nettoyer tout en restant impeccable. Dans le documentaire précédemment cité Lʼhistoire oubliée des femmes au foyer, la réalisatrice accompagne les images de femmes en plein labeur dʼune archive radio. Le commentateur843 ouvre ainsi son émission :
Il est 10 heures du matin, lʼheure sacro-sainte du ménage. Premier conseil, Madame : évitez le style faussement ménagère. De grâce ! Pas de papillotes et de tablier taché, et évitez enfin la pire de toutes les affectations : le style starlette, cʼest-à -dire plumeau et fume-cigarette  » (in Dominici 2021).
La mode, pendant les 30 Glorieuses, nʼest pas uniquement associée aux femmes actives et aux stars du cinéma, même si le commentaire relève lʼexistence de ce public, porté ici au rang de modèle. Comme de nombreux discours avant et après lui, ce morceau radiophonique met en relief la ligne de crête très fine sur laquelle se déplacent les femmes quand il sʼagit du soin de soi : pas assez, cʼest être souillon ; trop, cʼest basculer dans la séduction ostentatoire, présentée ici comme ridicule puisque sont associés plumeau et porte-cigarette. En incitant les femmes à prendre soin dʼelles, le texte découpe ces rôles qui jouent le rôle dʼaimant ou de repoussoir pour les femmes et, plus encore, pour les petites filles. Le collectif contre le publisexisme, dans son étude de 2007 au sujet des jouets, pointait lʼexistence de quatre rôles pour elles : «  la mère, la ménagère, la femme séduisante et lʼamoureuse  »844 (26). Le propos de lʼouvrage, essentiel, présente cependant des limites, parce quʼil analyse les scripts des objets sans saisir la part dʼaffordance qui les traverse. Au demeurant, ce découpage des rôles conserve une part de permanence dans nos représentations actuelles.
En surface, ces injonctions peuvent sembler contradictoires : nettoyer tout en étant perchée sur des talons est sans doute assez périlleux. Pourtant, jʼaimerais montrer ici que ces rôles ne sont pas concurrents, mais plutôt complémentaires. Il sʼagit dʼun continuum de rôles, qui se croisent, se contaminent, mais aussi créent des opportunités de détournement ou de hacking. Cʼest ce que laisse deviner lʼextrait ci-dessus : la starlette, avec ses affectations, ne sʼémancipe peut-être pas, mais échappe un temps au rôle de ménagère quʼon a taillé pour elle. Je ne considérerai donc pas, ci-après, que la mode, les produits de beauté, ou la chirurgie esthétique relèvent uniquement dʼune culture de la beauté féminine marquée par le male gaze. Il existe dans ces pratiques des formes dʼexpression et dʼagentivité que leur relation au regard masculin et, plus largement, au capitalisme nʼépuise pas complètement. En outre, cette possibilité dʼêtre belle au XXe siècle, et donc offerte au regard, contredit les règles de modestie et de pudeur des siècles précédents et se déploie dans de nouveaux contextes, comme les plages estivales (Granger 2017, 117). Lʼexposition du corps féminin ne sʼarrête pas là , dans la mesure où elle sʼinsère dans une performance de classe plus générale. Ici encore, le corps de la ménagère est un artefact parmi les autres :
Une grande diversité dʼappareils ménagers étant devenue abordables et les femmes racisées étant de plus en plus rares à travailler dans les ménages de la classe moyenne, les femmes au foyer de lʼaprès-guerre sont devenues elles-mêmes des objets dʼexposition, leur comportement et leur visibilité étant nouvellement remis en question et configurés pour établir et renforcer les notions de féminité, dʼhétéronormativité et de Blancheur845 (Harris 2013, 188).
La performance de genre et de race est soutenue par son contenu relatif à la beauté, selon lʼhistorienne de lʼart et de lʼarchitecture Dianne Harris. La beauté de la boniche est un paradoxe en soi, si on considère quʼil est difficile de conserver une apparence apprêtée tout en nettoyant son environnement et en cuisinant. Mais le «  labeur esthétique  »846 (Elias, Gill & Scharff 2017, 13), qui consiste à se faire belle, sert précisément à faire disparaître le travail domestique comme travail. Dianne Harris mentionne ce faisceau de contradictions :
Les appareils modernes étaient destinés autant à supprimer la stigmatisation des tâches ménagères quʼà réduire le travail lui-même, ce qui explique peut-être pourquoi les femmes ont toujours été représentées en train de faire le ménage avec des appareils tout en étant impeccablement habillées, coiffées et parées de bijoux847 (2013, 195).
Inclure la beauté et sa production dans le labeur domestique permet ainsi de resituer la fonction des objets électroménagers : plutôt que de faire disparaître magiquement un travail, ils sont censés en occulter les signes qui marquent le corps des femmes.
Apparence du corps et apparence du foyer sont ainsi réunies sur un même axe, tendu vers la beauté de lʼobjet cible (corps, maison), au risque pour les femmes de se fixer des objectifs inatteignables. Dans sa célèbre étude du «  complexe mode-beauté  », la chercheuse en philosophie et études de genre Sandra Lee Bartky relie les impératifs de consommation à leur valorisation sur une place de marché par des acteurs économiques divers. À la manière dʼun complexe militaro-industriel, ils fabriquent des «  produits, […] des services et […] de lʼinformation  » qui «  glorifient le corps féminin et provoquent des occasions dʼindulgence narcissique  »848 (2012, 39). La théoricienne met lʼaccent sur le temps consommé par lʼachat de produits, lʼexécution de soins et la charge mentale liée à un soin de soi permanent (quand on pense par exemple à rentrer le ventre en attendant le bus), pour finalement conclure sur lʼabsence de «  temps mort  »849 qui caractérise une telle subjectivité. Dʼautres études ont pu mettre lʼaccent, dans la continuité du travail de S. L. Bartky, sur le caractère intensif du labeur esthétique, décrit comme une combinaison dʼ«  autosurveillance, autodiscipline et auto-culpabilisation  »850 (De Benedictis & Orgad 2017). Toutefois, il ne sʼagit pas de rejeter en bloc les soins esthétiques pour leur supposée superficialité, la surveillance nʼétant pas nécessairement un concept entièrement négatif. Les récentes surveillance studies soulignent même lʼaspect scopophilique, la dimension de désir, et donc le plaisir qui peuvent être associés au fait, pour les femmes, de regarder les corps dʼautres femmes (Elias, Gill & Scharff 2017,14). En dʼautres termes, la beauté de la ménagère sʼinsère de manière complexe dans le champ du labeur domestique, dans la mesure où ce travail du beau constitue une énième corvée, mais permet peut-être aussi dʼesquisser une échappatoire -— tel ce miroir demandé par les femmes juste après une fenêtre, dans le sondage cité par Siegfried Giedion dans son étude (cf. infra.).
Une seconde convergence entre beauté et travail ménager se situe dans la promesse initialement incarnée par lʼélectricité, et par laquelle nous avons débuté ce chapitre. Ainsi, lʼélectrobonne sert dʼaspirateur comme de sèche-cheveux, et les «  secrets de lʼélectricité  », au XXe siècle, sont autant mis au service de la bonne tenue de la maison que de lʼallure de sa principale et emblématique occupante, au moyen de «  fers à friser  », de «  bains vapeur pour le visage  » et de «  vibro-masseurs électriques  »851 (Furlough 1993, 507). Le Salon des arts ménagers, dans ses diverses communications, souligne parfois lʼidée selon laquelle le temps libéré par lʼélectroménager doit être employé par la ménagère pour prendre soin dʼelle. En 1957, le journal des actualités Pathé présente un segment sur le 26ème Salon des arts ménagers, visité par Colette Ricard, Noë lle Adam et Louis de Funès pour la promotion du film Comme un cheveu sur la soupe. Le commentaire en voix over renseigne assez bien sur les discours en vigueur autour du travail domestique des femmes. Tandis que de Funès se livre à quelques pitreries852 en se cachant par exemple dans un réfrigérateur, Noë lle Adam est désignée comme «  fille dʼÈve  » qui «  rêve de sʼentourer de ces mille esclaves électriques sobres, discrets, propres  ». La beauté corporelle féminine est à peine évoquée que, déjà , un lien avec dʼautres valeurs comme lʼhygiène est effectué et traverse les objets, eux-mêmes sommés dʼêtre beaux. Tandis que lʼassignation féminine en cuisine est nommée comme un pouvoir (en vertu de «  lʼirremplaçable autorité de la femme qui règne […] en souveraine maîtresse de maison  »), le contenu vidéo sʼachève sur la cuisine de demain, que nous avons déjà croisée deux fois dans ces pages. Pour le commentateur, lʼart ménager consiste à «  préserver [les mains de femme] des tâches pénibles  ». Aussi, de la vision du futur en cuisine, dit-il quʼelle est «  à ce point parcourue dʼinflux électriques que les mains de femmes nʼauront vraiment plus rien à faire… si ce nʼest bien sà »r leurs éternels raccords de beauté  ». On retrouve ici ce paradoxe du temps libre féminin : il nʼest libéré que pour être mieux mis au service dʼautre chose, et rarement dʼelle-même -— et les impératifs de beauté sont pernicieux, tant ils peuvent donner lʼimpression de relever du soin de soi. Or, ils doivent aussi être considérés comme un travail supplémentaire des ménagères, par lequel elles valorisent leurs foyers et donc leurs époux.
Du point de vue du design, de telles analyses impliquent de tracer un nouveau continuum entre le corps féminin et lʼespace de la cuisine. Les housewives sont liées aux murs des maisons par leurs gestes de labeur, et le sont doublement dès lors que leurs corps font aussi partie dʼun programme esthétique global. Il est dʼailleurs intéressant, à ce titre, que la représentation de soi sur les réseaux sociaux affecte aussi les modes de visibilité des intérieurs. Des formes médiatiques comme le relooking, et sa modalité picturale première, le «  avant/après  », affectent aussi bien les corps que les espaces. Tandis que les corps se remodèlent à la gym et par les régimes, les cuisines subissent le coup de balai du homestaging853 : les deux pratiques sont étroitement liées à une conception néolibérale de lʼindividu, qui doit travailler à lʼamélioration de son image plus encore que de lui-même. Betty Friedan, dans les années 1960, déplore la «  glamourisation  »854 de la condition de housewife (1979[1963], 58), mais une telle analyse donne lʼimpression que lʼesthétique est extérieure au travail domestique : en réalité, elle en maille tous les aspects. La ménagère travaille à lʼesthétique générale des lieux, et donc à la sienne, à partir du moment où elle peut être perçue comme un équipement de la cuisine équipée. Ces objets sont aussi créés en vue dʼassembler un paysage esthétique complet. En 1953, Jacques Viénot participe à la création du Label Beauté France qui doit récompenser des créations industrielles épousant une forme de «  perfection  » (Leymonerie 2016, 78–79). Cet administrateur de galerie et éditeur a marqué lʼhistoire du design en fondant lʼInstitut dʼEsthétique Industrielle, soutenu par ses «  treize lois  » ayant valeur de manifeste (Leymonerie 2016, 66 ; 72). Il est utile, en France, de se souvenir de cette antériorité hybride du design, discipline qui est un temps défendue comme «  esthétique industrielle  ». Cela est dʼautant plus pertinent que cette exigence de Beauté, ce goà »t de la belle courbe et de lʼélégance forment un projet esthétique global pour les objets -— corps féminin compris. Et cette belle courbe renvoie justement à un dessin précis. Parmi les contraintes appliquées à la boniche, jʼai évoqué la Dexedrine, sorte de corset médicamenteux qui en préserve la docilité : elle est aussi le secret de sa «  ligne  » -— terme que lʼon associe volontiers aux courbes dʼun objet comme à celles dʼun corps -— cʼest-à -dire de sa «  silhouette svelte  » (Preciado 2011, 159). Lorsquʼil est question de beauté, dʼallure, la connotation de légèreté est un impératif récurrent dans la culture occidentale. Pour cette raison, il est impossible de mentionner le culte de la beauté féminine sans observer son indéfectible lien avec la minceur, que nous allons examiner à présent.
Jʼai beaucoup parlé de la cuisine en lien avec le ménage, peut-être au point de faire disparaître la fonction première de ce lieu : préparer à manger, et parfois même consommer sur place ce qui a été assemblé. De même, la féminité est souvent liée au fait de se contenir. Émotions, sexualité, parole et même rire sont affectés par une même exigence de continence depuis le XIXe siècle, même si certains comportements ont pu être libérés ou banalisés. Lʼexigence faite aux femmes de rester à leur place sʼest plutôt déplacée quʼelle nʼa disparu : pour de nombreuses commentatrices, lʼinjonction à la minceur féminine855 relève dʼune demande à prendre moins de place et donc à avoir moins de pouvoir. Ainsi, il existe aujourdʼhui dans les pays anglophones un corpus généreux relevant des fat studies qui vise à décortiquer les oppressions spécifiques vécues par les personnes grosses856. La grossophobie, comme toutes les oppressions, doit être comprise dans ses dimensions intersectionnelles, comme nous y invite la chercheuse Audrey Rousseau dans son panorama des fat studies. Elle rappelle en effet que « [l]es biais cognitifs aÌ€ lʼeÌgard de la grosseur (fat/weight bias) -— associ[e]nt cette caracteÌristique physique aÌ€ un indice dʼimmoraliteÌ, de deÌfaillance, voire de laideur  » et quʼelles «  touchent particulieÌ€rement les corps feÌminins  » (2016, 12). Elle fait en cela écho à de nombreuses études antérieures, notamment féministes, qui évoquent déjà les attentes spécifiques formulées à lʼégard des corps féminins sans pour autant nommer directement leur dimension grossophobe. Le scope de cet écrit ne me permet pas dʼévoquer en détail toutes les formes que peuvent prendre les injonctions à la minceur telles quʼelles sont adressées aux femmes : régimes, sport intensif ou ciblé «  perte de poids  », pilules amaigrissantes ou coupe-faim, chirurgie esthétique, vêtements galbants, hexis posturale, etc. Il existe de nombreuses pratiques dédiées à la «  maintenance  » du corps féminin, étant entendu que la jeunesse comme la minceur doivent être préservées. Les discours ne sont évidemment pas en reste, des productions médiatiques (presse féminine, dossiers spéciaux «  maillot de bain  ») aux phrases les plus ordinaires, de celles que lʼon prononce au quotidien pour refuser un plat ou commenter tel repas trop gras, assuré de «  finir sur les hanches  ».
Il existe en effet en Occident une préoccupation collective pour la minceur, et une forme de normativité mince : tout comme les personnes queer sont supposées hétérosexuelles jusquʼà preuve ou annonce du contraire, toute personne mince est censée vouloir conserver cette apparence, et toute personne grosse est censée travailler à trouver ou retrouver cet état. «  Mince  » est lʼétat par défaut de tout corps, relié à dʼautres états considérés comme souhaitables et supérieurs comme blanc·he, valide, cisgenre, etc. Deux valeurs centrales sʼarticulent à la minceur : la beauté et la santé. Souvent, ces deux derniers aspects se recouvrent, et font imaginer une meilleure santé de ces corps perçus comme beaux (Tovar 2023). De nombreuses études sʼattachent à déconstruire le lien entre bonne santé et minceur, pour promouvoir dʼautres approches médicales qui ne pathologisent pas par défaut la grosseur (Lyons 2009, 84). Dans les discours communs, «  grosseur  » est souvent synonyme de laideur, ce qui est significatif quand on sait à quel point la laideur est agitée en épouvantail pour limiter lʼagentivité des femmes. Au travers de lʼHistoire, les féministes ont toujours été caricaturées comme des femmes laides, voire enlaidies par leur féminisme ou, plus largement, par leur activisme politique.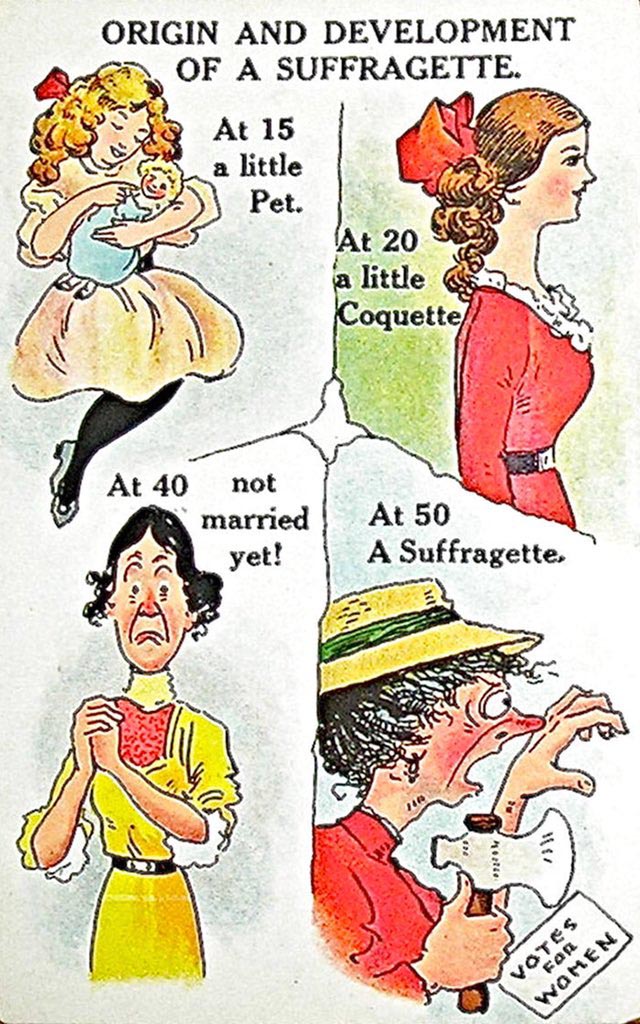 fig. 4.61 : Carte postale humorisitique raillant les suffragettes ; datation estimée, début du XXe siècle. Ce sont ces «  ‹ Républicaines qui portent cocarde [et] sont laides à faire peur ›  » évoquées par Michelle Perrot (2012, 531), ou encore cette vieille femme échevelée, aux doigts griffus et aux yeux exorbités, censée prouver par son apparence, sur une carte postale anglaise du début du XXe siècle, les conséquences désastreuses du suffragisme (fig. 4.61). Plus récemment, on retrouve des propos similaires dans la bouche des masculinistes, notamment sur les réseaux sociaux. Le rejet des corps gros est également traversé par des représentations racistes et classistes (Tovar 2023).
fig. 4.61 : Carte postale humorisitique raillant les suffragettes ; datation estimée, début du XXe siècle. Ce sont ces «  ‹ Républicaines qui portent cocarde [et] sont laides à faire peur ›  » évoquées par Michelle Perrot (2012, 531), ou encore cette vieille femme échevelée, aux doigts griffus et aux yeux exorbités, censée prouver par son apparence, sur une carte postale anglaise du début du XXe siècle, les conséquences désastreuses du suffragisme (fig. 4.61). Plus récemment, on retrouve des propos similaires dans la bouche des masculinistes, notamment sur les réseaux sociaux. Le rejet des corps gros est également traversé par des représentations racistes et classistes (Tovar 2023).
Les femmes se doivent dʼêtre belles, désirables sexuellement, et donc dʼêtre minces : dès lors, la cuisine, lieu supposément nourricier devient paradoxalement une fabrique du manger-moins ou, en tout cas, un espace où lʼon travaille à contrôler la forme de son corps par des choix alimentaires. Jean-Claude Kaufmann analyse à ce sujet les implications pour la subjectivité des épouses :
Le conflit oppose deux perspectives identitaires. Dʼun côté, la mère nourricière ou la scénariste dʼune vie familiale pleine de saveurs ; de lʼautre la femme individu autonome et réflexif maîtrisant son alimentation et soucieuse de son corps (2015[2005], 117).
Et de citer une enquêtée qui, en une phrase, matérialise le paradoxe dʼune surveillance alimentaire en cuisine : «  ça me fait plaisir quʼils en reprennent, même si moi je ne peux pas  » (118). À cet égard, les images de cuisines vides croisées dans le deuxième chapitre prennent un sens complémentaire ici  : les cuisines ne sont pas désertées parce quʼon nʼaurait plus rien à y faire, mais plutôt en raison dʼune tactique dʼévitement qui fait fuire la nourriture, sa préparation, et les plaisirs associés. Les cultures alimentaires occidentales sont intensément traversées par ce couple conceptuel minceur-santé. Les connaissances scientifiques liées aux calories, au métabolisme et aux propriétés des aliments se sont démocratisées et donnent lieu à des comportements justifiés a priori ou a posteriori par une littérature plus ou moins scientifique. Agnès Giard sʼamuse, dans son étude des habitus alimentaires en France, de ce «  fabuleux sottisier  » que constituent les préjugés, les connaissances erronées et autres vieilles croyances au sujet de la nourriture, y compris chez «  des gens cultivés, attentifs à la précision et à lʼexactitude de leurs informations dans dʼautres domaines  » (1994, 237). Travailler en cuisine, cʼest aussi manipuler ces savoirs scientifiques ou pseudoscientifiques, avec des objectifs variés et contradictoires en tête : nourrir, mais aussi faire plaisir, et sʼassurer que tout le monde reste mince. Pour les sociologues Faustine Régnier, Anne Lhuissier & Séverine Gojard, «  les progrès de la scolarisation féminine ont pu contribuer au déclin des aliments réprouvés sur le plan diététique (graisses, sucres, alcool, etc.) et au succès des aliments perçus comme sains (yaourts, fromage blanc, eaux minérales, jus de fruits, etc.)  » (2009, §7). Elles relient également les connaissances diététiques des femmes, plus étayées, à leur niveau scolaire en moyenne plus haut. Il est probable que ces connaissances supérieures ne soient pas uniquement corrélées au niveau scolaire, mais aussi à la responsabilité qui pèse sur les mères, lorsquʼil est question de poids, et pas seulement du leur. En effet, si les mères sont souvent tenues pour responsables des échecs de leurs enfants, force est de constater que la grosseur, lue comme «  obésité  », lorsquʼelle touche les plus petits, est associée à un échec maternel plus que paternel. Les sociologues Luisa Stagi et Sebastiano Benasso parlent ainsi du «  mother blame  » qui frappent les mères des enfants en surpoids (2018, 165), dans un contexte dʼ«  épidémiologisation de lʼobésité  » (177). Il est en effet fréquent dʼentendre parler dʼune épidémie dʼobésité, ce qui produit au moins deux conséquences néfastes : tout dʼabord, la grosseur est vue comme non désirable, pathologique, et comme un phénomène univoque. Ensuite, le portrait de la grosseur en virus participe dʼune forme de panique morale dans la mesure où la menace est jugée endémique et incontrôlable, comme par ailleurs lʼhomosexualité, la transidentité ou les relations interraciales.
Tandis que la responsabilité de la minceur pèse -— paradoxalement -—sur les individus, sommés de faire les bons choix pour leur alimentation indépendamment des conditions matérielles qui sont les leurs, lʼobésité est récemment apparue dans les discours occidentaux comme une menace à la Nation -— par exemple dans la campagne ciblée menée par Michelle Obama, Letʼs Move, visant à réduire lʼobésité infantile aux États-Unis (Stagi & Benasso 2018, 178). En France, la minceur comme enjeu national se matérialise fréquemment dans des discours sur la «  malbouffe  » et les fast foods, accusés dʼêtre des sources de contaminations alimentaires venues des États-Unis, dans la lignée de discours nationalistes plus anciens reliant santé de la Nation et hygiène (Furlough 1993, 507). On retrouve ici cette double culpabilisation des femmes : ce quʼelles produisent en cuisine (le propre, le sain) ne vise pas seulement leur famille, mais leur famille en tant quʼelle est liée, de manière synecdotique, à la Nation (qui se veut Blanche, mince, bourgeoise). Elles en sont dʼautant plus responsables que conjoints et enfants, dans certaines études sociologiques, apparaissent comme les consommateurs privilégiés de cette «  malbouffe  » contre laquelle il faut se protéger. Dans lʼétude de Luisa Stagi et Sebastiano Benasso, par exemple, les enquêtées disent faire les courses seules pour éviter ces achats malvenus (2018, 172). On remarquera quʼà nouveau, lʼépouse se retrouve face à un groupe composé des enfants et du mari, ce dernier apparaissant parfois comme un enfant de plus. Ainsi, «  [l]e bon développement psychophysique des enfants devient donc une unité de mesure de lʼamour maternel  » (169). Mal nourrir ses enfants serait une défaillance morale, voire une trahison du rôle de mère. Une telle connexion interroge, lorsquʼon sait que cʼest en partie grâce aux plats préparés, à cette nourriture dite «  industrielle  » plutôt quʼau partage des tâches, que les femmes ont pu connaître une compression de leur temps de travail domestique (Singly 2007, 76–77).
Un design alimentaire ou un design des arts de la table qui investirait le travail culinaire à partir dʼune problématisation de lʼinjonction à la minceur est encore largement à inventer. La grossophobie est même trop souvent un angle mort des processus de conception en design, comme le révèlent les témoignages de personnes grosses, humiliées lorsquʼelles prennent lʼavion ou se rendent dans un parc dʼattractions (Baker 2018). Le projet U4hk : United For Healthy Kids, mené par la marque Nestlé, implique des créations des Designers 5.5 et de lʼagence Ogilvy & Mather857 (2015) qui ciblent directement lʼobésité infantile au Mexique. fig. 4.62 : Designers 5.5 et de l’agence Ogilvy & Mather : projet «  Healthy Kids  », sponsorisé par Nestlé (2015). Le projet propose une vaisselle amusante pour les enfants (fig. 4.62.a & b) : ici, des assiettes intègrent un petit volcan pour y mettre son jus de viande ou sa sauce, là , un plat voit sa surface décorée dʼun avion (des petites têtes de chou-fleur pouvant alors figurer des nuages). Mais la notion dʼeffort en tant quʼelle est irrémédiablement liée au fait de manger traverse aussi le projet. On voit ainsi des couverts devenir des manches de corde à sauter, ou un presse-agrume être actionné par un bras de fer avec un levier stylisé pour imiter le bras dʼun luchador (fig. 4.62.b).
fig. 4.62 : Designers 5.5 et de l’agence Ogilvy & Mather : projet «  Healthy Kids  », sponsorisé par Nestlé (2015). Le projet propose une vaisselle amusante pour les enfants (fig. 4.62.a & b) : ici, des assiettes intègrent un petit volcan pour y mettre son jus de viande ou sa sauce, là , un plat voit sa surface décorée dʼun avion (des petites têtes de chou-fleur pouvant alors figurer des nuages). Mais la notion dʼeffort en tant quʼelle est irrémédiablement liée au fait de manger traverse aussi le projet. On voit ainsi des couverts devenir des manches de corde à sauter, ou un presse-agrume être actionné par un bras de fer avec un levier stylisé pour imiter le bras dʼun luchador (fig. 4.62.b).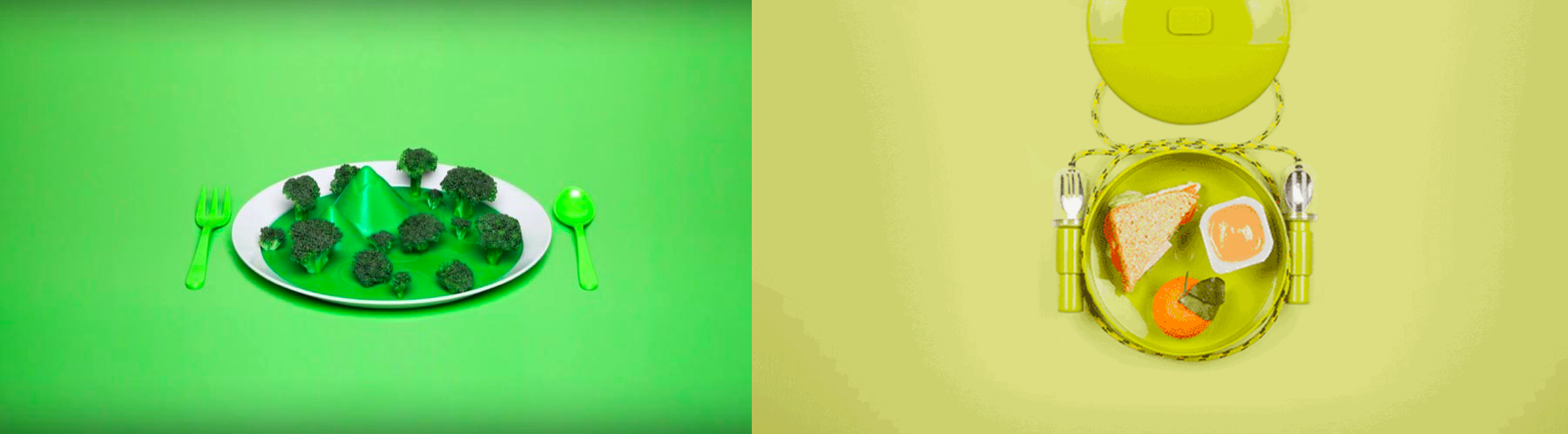
Outre le caractère potentiellement anecdotique de telles propositions, un autre implicite fait retour : manger se mérite, et tout ce qui est consommé doit être dépensé, comme le suggère le nom dʼune campagne similaire bien connue en France, manger-bouger. Parfois, des personnes concernées fondent leur démarche de design sur un engagement ouvertement anti-grossophobie, comme Margareta Zulueta dans son mémoire de master Weighted: Designing Towards Fat Liberation (2022). Dans ses travaux, la designer propose plusieurs micro-projets, plus ou moins finalisés ou spéculatifs : Flex est une ligne aérienne accessible pour les voyageur·ses gros·ses ; Affrmd est une application de rencontre sécurisant lʼexpérience de ses usager·es ; Venus Bebere approche par la céramique les silhouettes des corps gros et propose une alternative à la ligne élancée streamline (fig. 4.63). Un seul projet est véritablement lié à la question alimentaire, ce qui montre en soi un changement de regard sur la grosseur, décorrélée dʼune perte de poids obligatoire et donc du contrôle alimentaire. Enfin, le fat-positive dinner858 est une proposition de scénario dans laquelle des femmes grosses se réunissent en non-mixité pour discuter de leur rapport à la nourriture, et la partager sans peur du jugement des pair·es.

Toutes ces propositions sont très intéressantes, mais celles qui sʼinscrivent en design dʼespace et de produit ne traitent pas de la question alimentaire, davantage saisie par une proposition de design de services. Du point de vue de cette étude, la cuisine reste donc en retrait — et il sʼagit moins dʼune critique adressée au travail très porteur de M. Zulueta, que dʼun constat : la discipline du design dans son ensemble sʼempare encore très peu de ces questions, et les designers gros·ses revendiquant cette position située sont encore trop rares.
Pourtant, il existe de multiples liens entre les tâches domestiques, la vie en cuisine et la question de la minceur. En janvier 2021, la revue Marie-France évoque dans un article les «  tâches ménagères qui brà »lent le plus de calories  »859, et la série Femmes sous algorithmes (2020), entre autres contenus surprenants, montre quelques extraits de vidéos combinant planches et cirage de parquet, ou encore squats et vaisselle (fig. 4.64). Lʼinjonction à «  faire le ménage  » ou la cuisine nʼest pas seulement puissante en vertu de modèles anciens de la parfaite housewife : ils sont aussi proposés sous le nouvel emballage de la femme multi-tâches qui combine douceur domestique et dureté sur le marché du travail, maternité et séduction, plats mijotés et abdominaux. fig. 4.64 : Faire son ménage en faisant du sport, sur une vidéo YouTube montrée dans Femmes sous Algorithmes (2020). Les chaînes de gestes sont idéalement poreuses -— encore sʼagit-il de savoir à quels imaginaires on les associe. Pour terminer ce chapitre qui investit les appareillages techniques du corps, je souhaite à présent retourner aux origines de mon questionnement, qui posait le lien du corps féminin à lʼélectricité avant dʼinvestir celui aux appareils électroménagers. Les petits génies de la vie domestique sont souvent présentés à la fois comme des prouesses techniques issues de la rationalité scientifique, et comme des objets magiques. Si lʼobjet de pointe appareille potentiellement une roboniche pas si libérée, lʼobjet magique devrait logiquement être associé à une fée. Cʼest cette figure, et son envers apparent, la sorcière, qui va à présent faire lʼobjet de mon attention.
fig. 4.64 : Faire son ménage en faisant du sport, sur une vidéo YouTube montrée dans Femmes sous Algorithmes (2020). Les chaînes de gestes sont idéalement poreuses -— encore sʼagit-il de savoir à quels imaginaires on les associe. Pour terminer ce chapitre qui investit les appareillages techniques du corps, je souhaite à présent retourner aux origines de mon questionnement, qui posait le lien du corps féminin à lʼélectricité avant dʼinvestir celui aux appareils électroménagers. Les petits génies de la vie domestique sont souvent présentés à la fois comme des prouesses techniques issues de la rationalité scientifique, et comme des objets magiques. Si lʼobjet de pointe appareille potentiellement une roboniche pas si libérée, lʼobjet magique devrait logiquement être associé à une fée. Cʼest cette figure, et son envers apparent, la sorcière, qui va à présent faire lʼobjet de mon attention.
Cuisiner, laver, brosser, repriser, briquer, balayer, écouter et chérir… Voici quelques-unes des multiples tâches qui ont pu être confiées aux femmes au cours de lʼHistoire, et quʼelles peuvent encore prendre en charge aujourdʼhui, en dépit dʼune apparente répartition plus égalitaire du travail dans les couples hétérosexuels. Ces gestes semblent bien simples, en tout cas, ils paraissent concrets, au plus près de la poussière, des pelures et du désordre. Cʼest peut-être parce quʼils sont si bassement matériels que ces travaux ont été régulièrement, dans lʼhistoire des images, associés à la magie. Il ne faut pas seulement balayer la poussière, il faut quʼelle disparaisse ; les sols ne doivent pas uniquement être propres, ils doivent briller ; quant à la nourriture produite en cuisine, elle possède des vertus multiples -— on pense à Catherine Deneuve, en Peau dʼÂne (1970), préparant dans une «  jatte plate  » un gâteau dʼamour pour son prince charmant. De quoi la magie est-elle le nom ? Désigne-t-elle le caractère merveilleux dʼun logement bien rangé et dʼune cuisine habitée, ou nous renseigne-t-elle plutôt sur la nécessité toujours renouvelée de masquer le travail domestique et sa dure réalité ? Catherine Clarisse, lorsquʼelle étudie les guides de la Baronne Staffe, relève des propos qui semblent plutôt confirmer la seconde option :
Il sera nécessaire de mettre, de temps en temps, un livre, un journal dans les mains de ton mari, en lui disant que tu vas remplir tes devoirs de maîtresse de maison. […] Et sʼil veut te suivre à lʼoffice, à la cuisine, nʼy consens pas. Il vaut mieux quʼil croie que tu nʼas quʼà toucher les choses dʼune baguette de fée, et ne pas lui laisser voir les inévitables dessous un peu mesquins, un peu vulgaires de tout ménage. Nous nous en tirons sans rien perdre de notre grâce, mais ils dépoétisent le foyer à un mari (Clarisse 2019 ; Staffe 1999[1900]).
Un tel écrit nous renseigne sur la dimension complexe du concept de «  magie  » lorsquʼil est appliqué à la cuisine. De «  magie  », le Centre National de Ressources textuelles et lexicales donne la définition suivante : «  art fondé sur une doctrine qui postule la présence dans la nature de forces immanentes et surnaturelles, qui peuvent être utilisées par souci dʼefficacité, pour produire, au moyen de formules rituelles et parfois dʼactions symboliques méthodiquement réglées, des effets qui semblent irrationnels  »[^179]. Cette définition est dense, et offre de nombreux points saillants. On apprend ici que la magie est un art, mais un art mà » par le «  souci dʼefficacité  » -— à en rester là , on pourrait presque lui substituer le terme de «  design  ». Ce sont bien sà »r les effets irrationnels qui décalent tout à fait la définition, et séparent les fées (ou les sorcières, nous y reviendrons) des designers. Par leur nature comme par leur échelle, les effets de la magie la décalent du réel le plus quotidien : est magique ce qui dépasse le fonctionnement ordinaire du monde (et peut-être les personnes plus ordinaires, «  vulgaires  » selon les mots de Staffe, que sont les plus pauvres).
Appliqué au domaine des arts ménagers, cet art de la magie apparaît dans ses dimensions efficaces -— notamment, celle, citée dans les chapitres précédents et illustrée par Ma sorcière bien-aimée, du «  clac des doigts  ». Faire vite, mais encore ? La magie se situe aussi dans lʼocculte ; en cuisine, cette dimension du secret touche au tour de main, aux savoir-faire parfois non écrits qui peuvent se transmettre de mère en fille. Dans la publicité et autres supports audiovisuels, ce sont de multiples codes qui sont déployés pour rendre compte de cet invisible qui se produit et résulte dans un vite-fait et bien-fait : le scintillement, auquel fait référence une harmonie de harpe ; lʼapparition dʼune entité spectrale (comme Monsieur Propre, qui sort de la bouteille de produit ménager comme un génie) ou encore la lueur qui se tient à lʼextrémité dʼune baguette magique. Mais dans ces publicités, le coup de baguette habille en général un jump cut entre lʼétat sale et lʼétat propre et dissimule le travail réalisé.
Une autre ambiguïté marque la figure de la fée au logis, pourtant séduisante. Cette séduction tient dʼailleurs au fait simple du pouvoir de la magie : on parle dʼailleurs de pouvoirs magiques, ce qui suggère pour les femmes capables de les déployer une forme dʼempouvoirement. Pourtant, un tel enthousiasme devrait sà »rement être bien vite tempéré : dans la Sorcière bien-aimée (ou Bewitched, 1964–72 ; fig. 4.65), les pouvoirs de Samantha sont toujours disponibles dans le champ du logis, et jamais au-delà , ce qui a pu inspirer des critiques sévères sur la série. fig. 4.65 : Visuel du générique de Bewitched ou Ma Sorcière bien-aimée (1964–72). En effet, la fée du logis est une figure limitante pour les femmes : elle admet leur «  magie  », et donc leur pouvoir, à la condition quʼil soit mis au service de ses traditionnelles missions de ménage, cuisine et soin de la famille. En ce qui concerne Ma sorcière bien-aimée, comme la figure de la fée du logis en général, il nʼest pas impossible que cette figure soit moins univoque quʼelle nʼy paraisse. Pour Amy Herzog et Joe Rollins, «  [l]es dynamiques de genre dans la série étaient complexes et multiformes, et pourraient être interprétés aussi bien comme sexistes et que comme féministes, souvent au sein dʼun même épisode  »860. Si on peut mettre cette ambivalence sur le compte de lʼépoque à laquelle a été filmée la série, jʼaimerais proposer ici lʼidée que la figure de la fée est profondément ambivalente, et quʼil nʼest pas très productif de lui opposer la figure en apparence plus féministe, sulfureuse et potentiellement punk de la sorcière. Il me semble quʼil est beaucoup plus intéressant de penser une figure de femme magicienne qui allie voire hybride ces deux rôles de fée (plus maternante, douce, bienfaisante) et de sorcière (plus impure, menaçante, voire méchante) pour tâcher enfin dʼen combiner les ressources et les exigences, en dépit des contradictions. La sorcière ou la magicienne peuvent être des figures utiles pour penser des façons dʼêtre féministes et queer en cuisine. Plus quʼune identité, elle peut être une modalité, une «  fonction sorcière  » (Rosenberg 2018, 45) une «  sorciérologie  »861 (Viguier 2023, 3) ou encore inviter au «  désorcèl[ement]  » (association Loops862). Convoquer la sorcière doit donc mʼaider ici à dépasser les dualités, y compris celle qui la relie au couple fée/sorcière. Si je vais les séparer ci-après, cʼest pour mobiliser des corpus reliés à ces termes, et parfois éloignés, plutôt que pour établir une stricte catégorisation. En quoi la fée du logis est-elle moins sage que lʼon ne le croit, et que peut-elle apporter au design des cuisines ? Par ailleurs, quels sont les liens avec la sorcière, et comment cette dernière figure peut-elle être convoquée au sujet des savoir-faire domestiques ?
fig. 4.65 : Visuel du générique de Bewitched ou Ma Sorcière bien-aimée (1964–72). En effet, la fée du logis est une figure limitante pour les femmes : elle admet leur «  magie  », et donc leur pouvoir, à la condition quʼil soit mis au service de ses traditionnelles missions de ménage, cuisine et soin de la famille. En ce qui concerne Ma sorcière bien-aimée, comme la figure de la fée du logis en général, il nʼest pas impossible que cette figure soit moins univoque quʼelle nʼy paraisse. Pour Amy Herzog et Joe Rollins, «  [l]es dynamiques de genre dans la série étaient complexes et multiformes, et pourraient être interprétés aussi bien comme sexistes et que comme féministes, souvent au sein dʼun même épisode  »860. Si on peut mettre cette ambivalence sur le compte de lʼépoque à laquelle a été filmée la série, jʼaimerais proposer ici lʼidée que la figure de la fée est profondément ambivalente, et quʼil nʼest pas très productif de lui opposer la figure en apparence plus féministe, sulfureuse et potentiellement punk de la sorcière. Il me semble quʼil est beaucoup plus intéressant de penser une figure de femme magicienne qui allie voire hybride ces deux rôles de fée (plus maternante, douce, bienfaisante) et de sorcière (plus impure, menaçante, voire méchante) pour tâcher enfin dʼen combiner les ressources et les exigences, en dépit des contradictions. La sorcière ou la magicienne peuvent être des figures utiles pour penser des façons dʼêtre féministes et queer en cuisine. Plus quʼune identité, elle peut être une modalité, une «  fonction sorcière  » (Rosenberg 2018, 45) une «  sorciérologie  »861 (Viguier 2023, 3) ou encore inviter au «  désorcèl[ement]  » (association Loops862). Convoquer la sorcière doit donc mʼaider ici à dépasser les dualités, y compris celle qui la relie au couple fée/sorcière. Si je vais les séparer ci-après, cʼest pour mobiliser des corpus reliés à ces termes, et parfois éloignés, plutôt que pour établir une stricte catégorisation. En quoi la fée du logis est-elle moins sage que lʼon ne le croit, et que peut-elle apporter au design des cuisines ? Par ailleurs, quels sont les liens avec la sorcière, et comment cette dernière figure peut-elle être convoquée au sujet des savoir-faire domestiques ?
La fée est une figure puissante parce quʼelle est un point de contact entre lʼimaginaire du logis moderne et les politiques féministes et queer. Au premier abord, les Radical Faeries863 et autres fées queer peuvent sembler lʼenvers radical de la fée «  mainstream  » dont le pouvoir se limite à faire briller les sols et laver sa vaisselle en un clin dʼœil. Il est intéressant de regarder la fée comme une ficelle (Haraway 2020[2016], 21–30) pouvant relier des univers, plutôt que de la couper en deux pour décréter à quel moment elle est politique, et à quel moment elle ne lʼest pas. On critique souvent, notamment au sujet des jouets, la manière dont fées et princesses sont des figures inoffensives qui, en étant proposées aux petites filles, charrient leur lot dʼinjonctions et de limitations propres au partage de genre. On lit ainsi (par exemple dans le collectif Contre les jouets sexistes) que dʼautres rôles doivent être proposés aux petites filles -— quand bien même ces rôles sont aussi traversés par des injonctions douteuses, comme celle de se réaliser impérativement par une carrière en entreprise, ou de cumuler avec succès ses rôles de «  maman  » et de travailleuse, sans égard pour les difficultés quʼoccasionne cette multiplication des rôles. Ainsi, pour «  queeriser  » la cuisiner, il suffit peut-être de relier sa résidente, la fée du logis, à dʼautres fées queer, radicales et politiques.

Cy Lecerf Maupoix travaille à re-tisser cette généalogie dans Écologies Déviantes (2021, 195–217). Dans un des derniers chapitres de cet ouvrage, sont évoqués une cérémonie dans le pays Basque, inspirée par Starhawk, une rencontre à San Francisco avec Joey Cain, membre des Radical Faeries (fig. 4.66), les écrits dʼEdward Carpenter, la Mattachine Society et les berdache864 autochtones, soit toute une constellation du «  néo-paganisme gay  » (Lecerf Maulpoix 2021, 215). Dans ces imaginaires écopolitiques, le socialisme rencontre des «  fêtes dionysiaques  » (212–13), et la conscience gay, traditionnellement associée aux villes et à lʼessor urbain, permet dʼinvestir un féminin sacré865 transversal, décorrélé de la sexuation des êtres. La sexualité libérée est associée à des formes rituelles, à une relation repensée avec les êtres humains et non-humains, ainsi quʼà des connaissances sorcellaires («  herbes médicinales, […] plantes, […] animaux, […] météorologie et […] astrologie  ») (213). Il y a donc un intérêt à investir la magie en cuisine, non celle promise par les publicités, et qui relèvent davantage dʼune instantanéité illusoire, mais plutôt celles auxquelles invitent des traditions plus ou moins anciennes, où se croisent fées, sorcières, et autres figures magiques. Dans les lignes qui suivent, je parlerai donc de «  sorcière  », tout simplement parce que les sources que jʼemploie préfèrent ce terme, et quʼil est plus volontiers relié à une tradition politique de lʼinvestissement magique. Toutefois, comme je lʼai proposé précédemment, mon but est bien de creuser cette «  dimension sorcière  » au cÅ“ur de la cuisine, y compris chez la fée du logis qui en est peut-être une forme discrète et embryonnaire.
En 2016, je prépare la première version de mon cours, Queer[ed] Design, destinée à des étudiant·es de Licence 3 Design, Prospective, et Sociétés à lʼuniversité Toulouse -— Jean Jaurès. En enquêtant sur les points de contact entre théories queer, pratiques transpédégouines et design, je découvre le travail de Clément Rosenberg (fig. 4.68), alors étudiant à lʼÉcole Nationale de Création Industrielle (ENSCI).
Parmi un foisonnement de lignes de sorcière, jʼai sélectionné pour mon cours celle qui relie savoirs gynécologiques anciens, critique des violences gynécologiques modernes et enjeux de santé sexuelle et reproductive. Ce thème me semblait alors dʼune grande importance, eu égard de lʼâge de mes étudiant·es. fig. 4.67 : Andro-Chair, de Cristine Sundbom, Anne Hertz, Karin Ehrnberger & Emma Börjesson, 2015. Jʼai ainsi pu évoquer le projet Andro-Chair (2015) réalisé par les chercheuses en design Cristine Sundbom, Anne Hertz, Karin Ehrnberger & Emma Börjesson. Cette chaise (fig. 4.65), munie dʼun support pour sʼallonger sur le ventre et dʼétriers, est censée retranscrire pour des hommes lʼexpérience de lʼexamen gynécologique vécu par les femmes. Si la proposition nʼintègre pas du tout les corps des personnes trans, et donc la possibilité que des personnes transmasculines perturbent ce scénario, la proposition nʼen conserve pas moins une grande force. Cette proposition, qui vise à «  révéler les normes et acceptations qui se cachent derrière les expériences négatives des femmes  »868, ne présente pas un registre de formes que lʼon pourrait spontanément qualifier de «  sorcière  », ou même de «  magique  ».
fig. 4.67 : Andro-Chair, de Cristine Sundbom, Anne Hertz, Karin Ehrnberger & Emma Börjesson, 2015. Jʼai ainsi pu évoquer le projet Andro-Chair (2015) réalisé par les chercheuses en design Cristine Sundbom, Anne Hertz, Karin Ehrnberger & Emma Börjesson. Cette chaise (fig. 4.65), munie dʼun support pour sʼallonger sur le ventre et dʼétriers, est censée retranscrire pour des hommes lʼexpérience de lʼexamen gynécologique vécu par les femmes. Si la proposition nʼintègre pas du tout les corps des personnes trans, et donc la possibilité que des personnes transmasculines perturbent ce scénario, la proposition nʼen conserve pas moins une grande force. Cette proposition, qui vise à «  révéler les normes et acceptations qui se cachent derrière les expériences négatives des femmes  »868, ne présente pas un registre de formes que lʼon pourrait spontanément qualifier de «  sorcière  », ou même de «  magique  ».
Son répertoire visuel est plutôt empreint dʼune froideur clinique, légèrement exagéré pour mieux suggérer lʼinconfort à des observateurs masculins. Par son propos, critique des conditions médicales qui déterminent lʼabsence dʼautonomie corporelle des femmes (et personnes sexisées, par extension), ce projet sʼinscrit dans une généalogie sorcière. Il est cousin des emménagogues pris par les femmes pour gérer leur fertilité (Ehrenreich & English 2010[1973], 61–87), des pratiques du collectif Gynepunk qui fabrique ses propres outils gynécologiques, ou encore des travaux de Fanny Maurel, étudiante du master DTCT en 2017–19.

Dans son mémoire Outils sorcellaires : se réapproprier les savoirs sur la gynécologie par un design sorcière869, Fanny Maurel situe sa pratique graphique dans une visée de «  resorcèlement  ». Elle propose ainsi un grimoire gynécologique, alternatif DIY au carnet de santé, tant dans ses moyens (tout le monde peut lʼimprimer chez soi et se lʼapproprier) que dans sa visée (il ne sʼagit pas de faire interface avec le médecin, mais dʼapprendre à connaître son corps, ses cycles, ses maux, etc.) (fig. 4.67). Dans un projet ultérieur, Les Sorcières-Théoriciennes, an encounter between theory and domestic space, F. Maurel utilise un numéro de la revue Sorcières qui porte sur lʼespace domestique pour relier pratiques sorcellaires et soin du logis, et proposer une chronologie qui documente les points de contact entre domus, théories domestiques et théories queer et féministes870. En cela elle investit les générations de «  sorcières, alchimistes et accoucheuses*  »* (Preciado 2008, 135) condamnées pour sorcellerie, rendues coupables de la pratique de la médecine, de la sexualité, et de lesbianisme.
Les travaux de Fanny Maurel, inscrits en design graphique, font écho aux recherches antérieures de Clément Rosenberg, qui dessine dans son propre mémoire une «  fonction sorcière  ». Si le propos de C. Rosenberg est plus éloigné des questions gynécologiques, il est en revanche pleinement inscrit dans les savoir-faire au logis et en cuisine. Dans son projet de diplôme, il propose dʼinvestir le balai, emblématique des sorcières, pour proposer de nouveaux outils et des rites pour les accompagner. Cʼest finalement une prise de soin qui est suggérée, dont la dimension ritualisée est évocatrice de son travail antérieur dans Cosmologie pâtissière (2016). Ce lien me semble aussi présent dans dʼautres réalisations prédatant le travail sur les sorcières, comme les Monstres et merveilles, dans ces sculptures étranges, queer, au sujet desquelles il écrit :
si notre Å“il est dʼores et déjà surpris, cʼest la main qui sʼaperçoit de la supercherie : du ciment mou, des faux airs de porcelaine friable, un touché inattendu  » (Rosenberg, ca. 2017, fig. 4.66).
La pratique est celle du design, la proposition appartiendra sans doute plus volontiers au champ de lʼart, mais toutes deux dessinent quoi quʼil en soit des possibles pour penser le foyer, ses matériaux, ses textures et ses contacts. Les objets qui pourraient naître de cet héritage ne seraient plus uniformément lisses, muets, doux, streamline, automatiques. Ils pourraient eux aussi devenir rugueux, bavards, résistants, avachis, relationnels -— au moins dans leurs formes, si lʼon nʼest pas prêt à imaginer un grille-pain désobéissant. Aussi, comme le queer, la magie agit-elle comme puissance négative : les trous des marges, les absences, la destruction plutôt que lʼapport, le sabotage stratégique, le refus sont ses moyens et sa méthode. Depuis que jʼenseigne, je ne compte plus les projets de design qui proposent de «  réenchanter  » (le quotidien, le monde, la ville, les rapports humains, etc.). Camille Ducellier, notamment dans ses travaux avec le collectif Looops, propose à lʼopposé de «  désorceler la finance  », comme Olivier MarbÅ“uf, lecteur de Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, propose à leur suite de mettre en Å“uvre un «  désenvoà »tement du capitalisme  » (MarbÅ“uf 2012, 66). La pratique sorcière peut dénouer, défaire, plus quʼelle nʼajoute au désordre ambiant. Comme je proposais dans mon propos introductif, à la suite de Maxime Cervulle, de «  chausser des lunettes queer  » (Cervulle 2008, 14), on peut sʼéquiper de «  lunettes sorcières  » pour regarder le monde. Le collectif Looops présente ainsi son projet qui consiste à regarder les «  salles de marchés […] comme des lieux mythiques où sʼopèrent une forme de transe obscure et délirante codée par une gestuelle […] digne dʼun rituel néochamanique  »871. Il ne sʼagit pas nécessairement de verser «  la magie  », comme un contenu prédéterminé, dans les jattes et autres Thermomix de la cuisine, mais plutôt de regarder ce qui, dans cette pièce, fonctionne déjà comme magie, comme soin sorcière. Les cuisines de sorcières sont aussi plus volontiers collectives, quoique pas uniquement collectives, tels ces grands projets que Dolores Hayden a compilés dans les années 1980. Elles se rendent plutôt disponibles à la collaboration : elles sont pensées comme des laboratoires qui peuvent accueillir une magicienne, ou plusieurs. Le cinéma en donne un aperçu, avec The Witches of Eastwick (1987), où des sorcières se retrouvent dans cette pièce de la maison pour fabriquer une poupée vaudou. Si le balai est fréquemment évoqué comme symbole de la sorcière, et sʼil semble se relier idéalement à mon étude dans la mesure où il implique aussi le ménage, cʼest lʼimage du chaudron bouillonnant qui me retient plutôt en cette fin de chapitre. Son bouillonnement, visible, évoque le temps long des choses qui ont besoin pour être bonnes de mijoter. Sa force peut venir du feu, comme de lʼélectricité. À lʼimage du panier souhaité par Ursula Le Guin pour des fictions moins masculines et moins tranchantes (1989), le chaudron contient, accueille, mélange et relie. Il est comme le contre-modèle de la boîte noire électroménagère, sans pour autant basculer dans une binarité ancien/moderne. En effet, je nʼoserais pas ici affirmer que «  cʼest dans les vieux pots que lʼon fait les meilleures soupes  ». La marmite de sorcière peut être cyborg, connectée, DIY, high/low-tech, bricolée, etc. Cʼest justement cette impureté qui en fait lʼantidote idéal aux visions lisses et «  tout-en-un  ».
Quʼest-ce quʼune cuisine queer ? Si on admet que ce concept de queer est un outil épistémologique permettant de faire plier la norme ou de décrire toute entreprise qui caresse cet objectif, il convient de décrire le «  normal  » afin de programmer au mieux son dérèglement. Dans cette pièce de la maison que je me suis attaché à analyser, la femme au foyer apparaît comme une pierre angulaire, au sens fort du terme. Elle nʼest pas seulement une figure symboliquement centrale dans cet espace, mais au fil des images et des représentations, dans la lignée de représentations plus anciennes, elle devient elle-même pilier, mur, partie de cet équipement qui nous fait parler de cuisine équipée. Les binarités, une fois nommées et rendues visibles, comme dans le projet de Karin Ehrnberger, Minna Räsänen et Sara Ilstedt, peuvent être rendues obliques par le jeu de lʼinversion. Par une sorte de travestissement appliqué aux objets, les stéréotypes dominants apparaissent, mais il est alors difficile de faire apparaître de véritables alternatives. Parmi ces binarités, on retrouve le couple dehors/dedans, qui fait facilement imaginer une libération sous forme de fuite. Aussi, les femmes sont-elles plutôt en cuisine que dans la cuisine. Si cet espace doit se queeriser, ne faut-il pas lui arracher sa résidente la plus traditionnelle, a fortiori si ses murs façonnent une prison ?
Pour que les femmes sortent de la cuisine, il faut que leur travail soit pris en charge. Lʼexternalisation sur un personnel salarié, dans un contexte capitaliste, est apparue au chapitre précédent comme une sorte dʼimpasse sociale. Si læ travailleureuse précaire ne peut être destinataire de cette externalisation, peut-être que son avatar, le robot, peut remplir cette fonction. Mais cette promesse de libération par le robot, plutôt quʼune alternative parallèle au majordomat, est ici apparue comme lʼune de ses occurrences. Lʼobjet électroménager est au cÅ“ur de réseaux de production complexes qui impliquent dʼautres travailleur·ses pauvres. Par ailleurs, le petit peuple des cuisines, en même temps quʼil forme une importante part de nos usages contemporains, est au cÅ“ur de multiples «  arnaques  » (Tabet 2005) qui affectent les femmes. La promesse de gain de temps est en réalité associée à une augmentation des exigences vis-à -vis du travail domestique, quand elle ne reste pas inaccessible du fait dʼun manque de moyens pour sʼéquiper -— et sʼéquiper de manière qualitative ! Ainsi, lʼexternalisation sur un objet technique apparaît comme une fragile stratégie, prête à sʼécrouler dès que lʼobjet dysfonctionne ou nʼest pas disponible. De plus, au cours de lʼHistoire, les femmes ont en effet été stratégiquement écartées des domaines des sciences et des techniques. Elles nʼont donc peu ou pas participé à concevoir ces objets dont elles étaient la cible. Par ailleurs, il est courant en Occident de considérer comme technique ce qui est plus visiblement le résultat dʼun processus complexe dʼingénierie, ou ce qui est nouveau, quelle que soit la pertinence de la nouveauté en question. Dans ce contexte, les femmes sont écartées deux fois du champ des technologies : parce que leur «  nature de femme  » réclame que lʼantithèse de la nature, la technique, reste le théâtre de leur incompétence ; et parce que ce qui est déjà technique dans leurs pratiques et leurs savoir-faire ne comptent pas comme tels. Ce travail compte autrement, même au point dʼêtre compté. Aux débuts de lʼinformatique, ce sont bien les femmes qui assurent la puissance de calcul. Les premiers ordinateurs, on lʼoublie souvent, étaient des ordinatrices -— au point quʼil a existé aux débuts de cette discipline une unité de mesure, le kilo-girl, pour compter ce travail spécifiquement féminin (Lechner 2023, 75).
Si ce type de faits historiques, lorsquʼils sont déterrés par des théoriciennes, sont utiles, ils rappellent aussi à quel point les technologies (numériques notamment) sont à double tranchant pour les femmes. Pour la discipline du design, la binarité homme/femme est difficile à investir : nous avons rappelé ci-dessus que son approche tend à imposer lʼinversion comme méthode. Sans rejeter celle-ci tout à fait, puisquʼun design par le travestissement me semble potentiellement fécond, il me semble quʼapprocher la question en traitant de la dimension sexiste dʼautres binarités peut être une stratégie porteuse. Dans le contexte de ce chapitre consacré aux objets électroménagers, lʼopposition high-tech/low-tech apparaît comme un site intéressant de questionnement comme de projet. Il ne sʼagit pas ici de rejeter en bloc les hautes technologies, au motif quʼelles seraient nécessairement aliénantes. Dans de nombreux récits de science-fiction, lʼapproche technocritique a tôt fait de basculer dans un primitivisme non interrogé, qui oppose réseaux sociaux et «  vraie vie  », réel et virtuel, artifice et authenticité, souvent sans réaliser à quel point ce «  retour aux sources  » est un véritable terrain miné pour les personnes minorisées par leur genre, leur classe, leur race ou leur validité.
Il nous faut donc imaginer des chemins de traverse, des zones impures : des techniques qui nʼen sont pas, des savoir-faire primitifs associés aux hautes technologies, des boîtes grises plutôt que noires, qui laissent voir un peu de leurs entrailles, ou font rêver autre chose quʼun logis autonome ou le travail sʼeffectue en un «  clac des doigts  ». Les objets électroménagers existants sont-ils nécessairement imperméables à ce programme ? Rien nʼest moins sà »r, à condition de les inscrire plus clairement dans cette question récurrente de lʼexternalisation. À ce sujet, la chercheuse Sarah Sharma écrit :
On semble nous proposer lʼargument suivant : si les femmes ne veulent pas remplir leurs fonctions au sein du patriarcat, quʼil en soit ainsi, il y a dʼautres technologies qui le feront872 (2018).
Lʼobjet électroménager est toujours, au XXIe siècle, un élément clé des cuisines individuelles en Occident. Mais là où la seconde moitié du XXe siècle lʼa vu connaître une forme dʼhyperspécialisation, jusquʼà le rapprocher dʼun gadget, il semble quʼaujourdʼhui tous ces artefacts sont réunis par une seule catégorie parente, égalisante, à partir du moment où la fonction première de lʼobjet devient, par une inversion intéressante, un port parmi dʼautres dans la maison connectée. Le goà »t du carrossage, qui sʼest imposé sur la base de lʼhéritage streamline, notamment dans lʼère du tout plastique dʼaprès-guerre, facilite cette mutation de lʼobjet en terminal bluetooth, indépendamment de sa fonction première. Là encore, il est difficile dʼêtre critique de cet état de fait sans basculer dans des discours réactionnaires anti-écran. Que faire de cet écran dans une réflexion qui tâche de penser une forme dʼagentivité en cuisine ? Peut-être faut-il en décaler la compréhension. Dans les vidéos que jʼai pu analyser au cours de ce chapitre, lʼécran comme terminal nʼest pas le seul agent dʼune «  modernisation  » de la cuisine. Il existe aussi de nombreux panneaux, paravents, et mêmes surfaces transparentes qui matérialisent une forme de coulisse dans laquelle les actes du labeur domestique prennent une valeur magique car instantanée. Je pense au panneau derrière lequel disparaît une actrice ou au dôme de verre dans lequel le poulet est mystérieusement grillé dans «  Design for Dreaming  », ou encore, au panneau blanc de la cuisine IKEA 2025, derrière lequel les matériaux sont censés être recyclés. Dans la réalité tangible comme dans la fiction, au sujet des domestiques comme des robots, il semble que lʼ«  arbitrage  » soit encore et toujours «  entre ‹ faire › et ‹ faire faire ›  » (Devetter & Rousseau 2011, 79) et que «  faire faire  » relève fréquemment dʼun «  faire derrière  ». La tâche lorsquʼelle ne peut être accomplie (par volonté ou par nécessité), peut toujours être déléguée à un·e autre. Et lorsque lʼimagination échoue à penser un véritable futur de tel ou tel geste en cuisine, le labeur peut toujours renvoyé à la magie.
Alors, que faire ? Faut-il adopter une posture nihiliste, à la manière dʼune Chantal Akerman qui dans Saute ma ville (1968) compose quelques années avant Jeanne Dielman lʼenvers tragicomique de la fatalité ménagère ? Dans ce court-métrage, on voit un personnage sans nom sʼactiver en cuisine à la manière dʼune Stepford Wife dysfonctionnelle, en cassant la vaisselle, en couvrant ses jambes de cirage, et en se tartinant le visage de mayonnaise pour finir par mettre la tête dans la gazinière (geste évocateur du suicide de la poétesse Sylvia Plath) -— le film finissant alors sur un bruit dʼexplosion. Que la répétition soit issue de la folie ou du programme, elle semble placer les femmes dans une impasse : on ne peut pas réinventer la cuisine. Cʼest à cet endroit que le cyborg peut véritablement sʼimposer comme une figure puissante. Par son truchement, la répétition peut être mobilisée autrement, depuis lʼimmense répertoire créatif quʼelle constitue. Plutôt que la danse de demain, performée sur lʼautoroute du futur dans «  Design for Dreaming  », cʼest le «  savoir-sentir  » du chorégraphe Rudolf Laban qui peut constituer une voie, en suivant le commentaire de ses travaux par la danseuse et philosophe Emma Bigé (2023, 31). Elle évoque ainsi, en suivant Isabelle Launay, «  le mixte dʼhabitudes sensorielles et motrices qui se développent au travers dʼune pratique et en particulier de la répétition de certains gestes ou de certaines attitudes  » (ibid.). À cet égard, le retour du même, loin dʼêtre la monotonie aliénante pointée par Betty Friedan ou une forme de mécanisation déshumanisante du vivant, peut constituer une porte dʼentrée pour qui veut queeriser la cuisine.
Constituer la répétition comme méthode rejoint par ses qualités rituelles les savoirs sorcières évoqués en fin de chapitre. À première vue, la sorcière est lʼenvers indiscipliné dʼune fée trop soumise, dont les pouvoirs sont limités à la sphère domestique. Mais regarder la fée de cette manière, cʼest encore considérer que le travail en cuisine a peu de valeur intrinsèque. Par conséquent, je propose un continuum fée-sorcière qui permet de saisir de manière transversale tous les savoir-faire potentiellement empouvoirants en cuisine. Cette posture présente lʼavantage de ne pas abandonner la magie, ses images et ses discours à ceux qui mobilisent son lien à la modernité pour chanter des futurs sauvés par la technologie. Se faire sorcière en même temps que fée, cʼest refuser lʼopposition de la beauté (et du soin de soi qui la matérialise) et de la laideur féminines. Lʼinjonction à offrir une image corporelle plaisante pour le regard masculin (male gaze) est certes un des leviers du sexisme, mais sʼopposer unilatéralement à ce fait ne manque pas de présenter un piège. À refuser ce destin, on pourrait en effet rapidement basculer dans une critique de lʼapparence qui solidifie lʼidée dʼun «  vrai  » ou dʼun «  naturel  » supérieur moralement à lʼartifice. Et si les corps des femmes existent dans la continuité de lʼarchitecture domestique et de son petit peuple de génies domestiques, lʼinverse se vérifie également. Le refus de la beauté corporelle peut aussi affecter le design. En dʼautres termes, un programme queer en cuisine nécessite de marcher sur une ligne de crête, entre le refus de lʼévidence du Beau (forcément lisse, élancé, pourquoi pas aérodynamique) et une défiance affirmée à lʼégard des postures anti-forme, anti-production voire résolument anti-design. Faire la révolution ne revient pas à faire la peau aux esthétiques.
Il est tout aussi important de ne pas fétichiser les figures qui servent de boussole à la pratique de projet ou à lʼaction militante. «  Sorcière  », on lʼa vu, recoupe une multitude de pratiques qui vont des fêtes collectives aux partages de savoirs sur la santé reproductive, de la consommation de produits «  New Age  » à la redécouverte de pratiques de soin ancestrales. Le chercheur en études de genre Hil Malatino, dans son étude des affects trans, aborde avec beaucoup de précautions le revival spirituel qui a traversé les communautés queer ces dernières années (2022, 188–98). Pour lui, lʼassociation de pratiques communautaires trans (par ailleurs éminemment nécessaires) à un substrat culturel New Age court le risque de reproduire des formes de domination blanche à lʼencontre de populations indigènes dont les rituels et pratiques spirituelles sont volontiers appropriés par des personnes en quête de soin, dʼagentivité, ou tout simplement dʼailleurs. Il précise sa crainte en pointant la manière dont la recherche dʼune entité transcendante, dʼune forme déique ou dʼune expérience transformatrice «  est trop souvent fondée sur la reproduction de la similitude, lʼillusion et lʼélimination tacite de la différence  »873. Paradoxalement, cʼest la recherche dʼaltérité, de la part de sujets privilégiés (car Blanc·hes et possédant le capital culturel adéquat) qui mène au gommage des particularités, plus spécifiquement celles des sujets minorisés. Comme toutes les figures que je vais tenter de faire vivre dans mon propos final, la sorcière doit être mobilisée avec prudence et sans doute une forme dʼhumilité. La sorcière est associée à la magie, mais elle nʼest pas magique ; surtout, elle ne nous sauvera pas.
Mon investissement de la dimension punk de la sorcière pourrait également suggérer que je préfére le low-tech au high-tech, le primitif au technique, le cabossé au lisse du carénage. Rien nʼest plus opposé à mon propos. Les bascules par-dessus tête des systèmes de valeur, en plus dʼêtre inefficaces, ne font probablement quʼentériner leur dualité. Par conséquent, parler de pratiques sorcières ou fées nʼest pas une manière de balayer dʼun revers de main lʼhéritage des marques dʼélectroménager ou les événements commerciaux que sont les salons ou les expositions. Au contraire, malgré les contradictions qui les traversent, ces lieux sont de précieux réservoirs à idées ou tout simplement à images dont la critique peut sʼemparer. En effet, une cuisine située dans un espace privé peut être souvent difficile à observer dans ses dimensions les plus fines. Les expositions, dans leur dimension de «  display  » (Brunet & Geel 2023, 274), permettent de visibiliser les programmes des designers et architectes, en même temps quʼelles contribuent à écrire lʼespace domestique et sa destinée. Ces lieux qui mêlent logiques muséales et de supermarché investissent aussi frontalement la question «  du  » futur. Trop souvent pensés au singulier, ces temps à venir, tels quʼils sont rêvés, sont souvent en deçà des capacités prospectives du design. Au Salon des arts ménagers notamment, on imagine volontiers des robots capables de réaliser toutes les tâches, mais on nomme encore cet artefact servante, actant par là une incapacité collective à échapper aux imaginaires du majordomat, en même temps que le marquage au fer rouge des tâches domestiques du sceau de la féminité. Se demander ce que représente la Marie mécanique est à cet égard une entreprise bien vaine : quʼelle soit servante, épouse ou simple robote, son profil géométrique évide surtout ce quʼelle nʼest pas -— cʼest-à -dire, jamais un homme, et jamais un groupe. Les rêves du Salon ne sont pas aussi vintage quʼils le paraissent : les techbros de la Silicon Valley ne projettent guère rien de plus excitant. Il y a bientôt dix ans, Rose Eveleth nommait déjà ce triste fait lorsquʼelle demandait : «  [d]ans une cuisine du futur dotée dʼune technologie incroyable, pourquoi ne pouvons-nous toujours pas imaginer quelque chose de plus intéressant quʼune femme préparant le dîner seule ?  »874 (2015).
Les futurs du passé contiennent des avertissements salutaires. Ils révèlent à quel point des formes nouvelles peuvent aisément prolonger des schémas anciens et les rapports de pouvoir qui sʼy attachent. À la suite de ce constat, une attitude possible consiste à refuser de prédire lʼavenir (Steward 2023, 141–42) pour «  futurer  » (Pandelakis 2024) au présent. Il me semble que cʼest ce type de pas de côté que propose Emma Bigé depuis la discipline de la danse, quand elle parle de «  manifester, non [s]a subjectivité, mais une vie qui nous traverse  » (2023, 187). Faire la part du déjà -là , voilà une activité qui a, elle aussi, été rendue convenue à travers son appropriation par le développement personnel, qui invite volontiers à méditer ou contempler le monde dans une visée individuelle de bien-être875. Il me faut donc faire plus et comme le réclame ma discipline, projeter. Plutôt que de proposer une cuisine et un aménagement spécifique, jʼai choisi dʼutiliser ma pratique graphique pour rendre visible les champs de force qui traversent la cuisine. Je proposerai ci-après une carte visuelle qui redoublera celle, textuelle, que représente la traversée effectuée par cet écrit, à la manière de Giuliana Bruno. Le poster, dont la production va être soutenue par lʼécriture du chapitre conclusif qui suit, vise à rendre visibles les liens dʼinterdépendance qui maillent la cuisine. Il cartographie les réseaux qui alimentent, mais aussi ceux qui privent et qui vampirisent ; il sʼintéresse aux détails, aux objets apparemment discrets mais riches de promesses qui façonnent nos gestes électroménagers.
Je me suis demandé, dans le chapitre précédent, si le logis était lʼautre usine du capitalisme. Le travail de ce quatrième chapitre me permet de retourner la question : et si, plutôt que lʼobjet, lʼusine était la véritable «  boîte noire  » contenant toutes les autres ? Quand lʼobjet est illisible, ou quand son pavé numérique occulte toute autre forme dʼinterface, ne faut-il pas en chercher la cause plus loin ? Lʼopacité de la fabrication, mise en évidence par Vladan Joler & Kate Crawford, ou plus tôt par Douglas Thwaites, fait écho à lʼaspect «  muet  » des surfaces lisses des artefacts. On peut alors repenser les objets dans une optique de lisibilité, comme sʼy emploie aujourdʼhui Aurélien Pons, ou, depuis la pratique du dessin, manifester cette superstructure qui relie le logis à lʼusine, les épouses à leurs murs ou encore la cuisine à ses dépendances (au sens littéral du terme). Dans cet écosystème et dans les visuels qui le donnent à lire, lʼobjet est un site de parentèles, un «  node  » (Chachra 2021) autour duquel sʼarticulent dʼautres lieux et dʼautres corps, pour façonner un «  cyborg collectif  »876 (Chachra 2021 ; Raven 2017).
À présent, le titre de mon travail sʼéclaire peut-être plus précisément. Lisible comme une mini-provocation, il ne sʼintitule pourtant pas Cyborg & Boniche dans lʼidée de créer un contraste maximal entre ces deux termes ; Cyborg & Boniche nʼest pas un oxymore. Plutôt, la collusion des deux termes rappelle lʼintrication de rôles, de savoir-faire et dʼexpériences subjectives qui les relient -— il nʼest pas possible de sʼinventer cyborg sans renouer avec sa boniche intérieure. Réciproquement, la boniche mérite à présent, en 2024, un reclaim fort nécessaire : il est temps que nous, collectivement, prenions la mesure de son immense potentiel technique, poétique et créatif. Modestement, la cartographie écrite et dessinée que je propose ci-après se donne précisément cet objectif. Sorcière, cyborg, boniche vont à présent être mobilisé·es ensemble, en tant que corps au travail et possibilités dʼexpériences reterritorialisées : ces trois mots sont les clés par lesquelles je vais interroger nos espaces, afin dʼaider à en façonner les utiles survivances.
Un placard, un sac Deliveroo, un tablier, un robot ménager. C’est par ces entrées que j’ai tâché d’en découdre avec la cuisine : un lieu évident, quotidien, traversé d’images d’Epinal, telle celle d’une femme appliquée à faire la vaisselle ou à préparer le repas pour ses enfants. Ce n’est pas tant cette image qui m’invite à la réflexion que son rejet, répété et collectif, au profit d’autres histoires dont les buts politiques ne sont pas toujours clairs, et peuvent même être dissimulés. La working girl célébrée dans les années 1980, ou son avatar, la féministe corporate à la Sheryl Sandberg n’incarnent pas un modèle plus souhaitable, en dépit d’une séduction plus apparente. Queer et design se rencontrent souvent sur le mode de l’inversion de genre (chap. IV) : pourtant, ce concept de queer devrait toujours être mobilisé en résistant aux raccourcis, pour conserver ce tressage qui le compose et associe une modalité, un mouvement et une nécessité (chap. I). Il n’est donc pas question de renverser placard, sac, tablier et robot pieds par-dessus tête. Ces objets, mobilisés comme métaphores autant que cas concrets d’étude, restent des clés d’entrée, auxquelles j’ajouterai dans le propos, qui va suivre un cinquième élément-concept-outil. Lequel ? Dans un esprit d’analogie, j’aurais pu faire du pousse-café l’emblème de ce texte ultime. Étant donné la longueur du trajet, ce choix n’aurait pas été complètement hors de propos mais il aurait eu le désavantage d’entériner une conclusion en forme de fin—alors que je ne souhaite ici rien de plus qu’introduire de nouvelles pistes de recherche.
Commencer à nouveau, non pas le même trajet, mais faire aller ces idées, trouvailles et propositions au contact de la pratique de projet, dans une proposition personnelle, et dans de futures adaptations par des étudiant·es (encadré·es par moi, ou non). Pour cette raison, en fait de pousse-café, c’est la table que je mobiliserai pour incarner mon propos. En introduction, j’ai fait de mes quatre objets des piliers soutenant la maison archétypale : mais en fait de tablier, c’est plutôt la surface plus basse de la table qui peut dans nos esprits incarner ces appuis.
Table : surface plane, peut-être irrégulière, en tout cas disponible à l’usage, ouverte pour le travail, le partage, des activités hybrides plus ou moins salissantes. Surface de contemplation, si des images s’y retrouvent et s’y télescopent, devenue alors tableau résistant, par son orientation même, à proposer une fenêtre. Pourtant, une fenêtre est peut-être une ouverture bienvenue pour les femmes ou, si je peux m’autoriser une fois, à dessein, ce singulier que j’ai critiqué, la Femmeâ„¢ (Métais-Chastanier 2018) à qui l’on a imposé une place en cuisine aux allures de fusion avec l’espace environnant. Femme en tablier, assurant les corvées, un travail pour lequel il n’existe pas de prix, de palmes, et si peu de représentations médiatiques valorisantes. Faut-il comprendre que je propose ici de ré-instituer les concours de «  Meilleure ménagère  » et de « Fée du logis  » proposés pendant les années 1936–39 et 1949–70 (Bouillon 2022, 142) au Salon des arts ménagers ? Bien sà »r que non, puisque tout l’enjeu de cet écrit a consisté à cartographier les réseaux et souvent les impasses qui relient logis, femmes et travail domestique. Mobiliser un être-boniche n’est pas un retour aux expériences de femmes que j’ai pu croiser dans ces pages, vissées à leurs éviers ou à la corvée de pluches. Il ne s’agit pas non plus de fantasmer un «  avant  » où l’être au logis aurait été plus agréable : on a vu, en critiquant les travaux de Sharon Hayes (chap. II), à quel point tout ce que ce « retour  » à la domesticité reconduit d’expériences oppressives, entre foyer colonial fondé sur l’exploitation des plus pauvres et des personnes non-blanches, et fantasme d’une unité familiale unique et moralement supérieure, car hétérosexuelle. La cuisine qui se queerise ne *revient pas à  *une quelconque origine : elle queerise le temps en sortant les savoir-faire boniche du programme conservateur qui paradoxalement, en a constitué le socle. En cela, ce faire-cuisine «  vit avec le trouble  » ([Haraway 2020[2016]]{.mark}) : il fait la part de ce qui peut être sauvé du pire (quand bien même le pire a fait son lit) grâce à l’esprit du marronage (chap. II) ou du hacking. Opérer un reclaim sur la boniche est donc une opération au présent. Elle consiste à dire : voilà en quoi, moi, je suis boniche. Voilà ce que je sais faire de boniche, et comment je peux l’apporter ailleurs, le déplacer, le remobiliser.























AHMED, Sara. 2014. « White Men  ». Blog feministkilljoys
-------—. 2016a. « Interview with Judith Butler  ». Sexualities, vol. 19, no. 4, 1er juin, p. 482–492, [en ligne], [https:
-------—. 2016b. « Queer Fragility  ». Blog feministkilljoys
-------—. 2017. Living a Feminist Life. Durham, États-Unis : Duke University Press.
-------—. 2019. What’s the Use?: On the Uses of Use. Durham, États-Unis : Duke University Press.
ALAIMO, Stacy. 2008. « Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature  ». In ALAIMO, Stacy & Susan HEKMAN. Material Feminisms. Bloomington & Indianapolis : Indiana University Press, p. 237–264.
-------—. 2010. Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington & Indianapolis : Indiana University Press.
ANZALDUA, Gloria. 1987. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco : Aunt Lute Books.
BACQUÉ, Marie-Hélène & Carole BIEWENER. 2013. L’empowerment, une pratique émancipatrice. Paris : La Découverte.
BAKER, Jes. 2018. Landwhale: On Turning Insults Into Nicknames, Why Body Image Is Hard, and How Diets Can Kiss My Ass. New York : Seal Press.
BALSAMO, Anne Marie. 1996. Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women. Durham, États-Unis : Duke University Press.
BARAD, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham & Londres : Duke University Press.
BARRETT, MicheÌ€le. 1987. « The Concept of 'Difference’  ». Feminist Review, no. 26 (été), p. 29–41.
BEAUBATIE, Emmanuel. 2021. Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre. Paris : La Découverte.
BEDERMAN, Gail. 1996. Manliness and Civilization: A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880–1917. Chicago : University of Chicago Press.
BERGMAN, Barry. 2007. « Black, white, and shades of green – Exploring issues of race, land, and identity, geographer Carolyn Finney finds a place for herself in academia  ». UCBerkeley News, 28 novembre, [en ligne], [https:
BERSANI, Leo. 1995. Homos. Cambridge : First Harvard University Press.
BERSANI, Leo. 1998[1995]. Homos. Repenser l’identité. Odile Jacob (Traduction de Christian Marouby).
The BIOLOGY AND GENDER STUDY GROUP. 1989. « The Importance of Feminist Critique for Contemporary Cell Biology  ». In TUANA, Nancy (dir.). Feminism and Science. Bloomington : Indiana University Press, p. 172–187.
BONTÉ, Milan. 2022. « Négocier la ville en escales. Les espaces publics au prisme des expériences trans à Paris, Rennes et Londres  ». Thèse de doctorat sous la direction de Nadine Cattan, Paris I, [en ligne], [https:
BOURCIER, Sam. 2002. « Queer Move/ments  ». Mouvements, vol. 20, no. 2, p. 37–43, [en ligne], [https:
-------—. 2017. Homo Inc.Orporated. Le triangle et la licorne qui pète. Paris : Cambourakis. [j’ai – papier – lu]
-------—. 2018. Queer zones redux. La trilogie. Paris : Amsterdam.
BOURCIER, Sam & Elisabeth MERCIER. 2015. « Genres, sexualités et médias : enjeux politiques, identitaires et disciplinaires dans l’université francophone  », Communiquer, no. 14, [en ligne], [https:
BOWLES, Nellie. 2018. «  Thermostats, Locks and Lights: Digital Tools of Domestic Abuse  ». New York Times, 23 juin, [en ligne] [https:
BUTLER, Judith. 2006[1990]. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York : Routledge.
Thanks folks.
On appelle «  féminisme de la première vague  » lʼensemble des actions politiques menées par des femmes pour lʼobtention du droit du vote à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Ce mouvement sʼamorce dès 1848 aux États-Unis, pour un amendement permettant lʼaccès des femmes au suffrage en 1920 -—  ce mouvement politique concerne donc trois générations de femmes, dans un vaste ensemble de pays, bien que les compte-rendus historiques se focalisent plus volontiers sur les États-Unis, lʼAngleterre ou la France. Dès le XVIIIe siècle, le suffrage des femmes est mis en place dans certains conditions en Suède ou encore en Corse, comme en témoigne la chronologie collaborative relative au suffrage féminin disponible sur Wikipédia, [en ligne], https:
Lʼopposition entre ces deux expressions («  lean in  » et «  dig deep  ») est plus claire en anglais. ↩ï¸&
Dans ce schéma, cʼest la «  poussée  » queer militante et universitaire des années 1990 qui constitue le troisième mouvement. ↩ï¸&
Selon lʼINSEE, en 2015, les femmes gagnent en moyenne 18,4% de moins que les hommes (contre 21,5% en 2002) (Berger, Bonnet, Julia & Vuillemin 2017). En 2023, les hommes gagnent encore en moyenne 14,1% de plus que les femmes (lorsquʼiels sont salarié·es du secteur privé), selon le rapport gouvernemental «  Chiffres-clés : vers lʼégalité réelle entre les femmes et les hommes  ». ↩ï¸&
Lʼempowerment se traduit en français par «  empouvoirement  ». Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener identifient trois traditions intellectuelles qui nourrissent la notion. Ici, je parle dʼempowerment comme capacité dʼagir et possibilité à sʼauto-déterminer, en puisant dans les conceptions militantes queer étasuniennes actuelles. ↩ï¸&
Lʼacronyme LGBTQIA+ signifie Lesbiennes Gays Bi.e.s Trans Queer Intersexes Asexuel.le.s. Dans certains cas, le «  A  » est revendiqué comme pouvant également signifier «  Allié·es  », mais cela reste discuté dans les communautés concernées par lʼacronyme, tout comme lʼinclusion des personnes asexuel·les. Dans certains cas, lʼacronyme est écrit LGBTQIA+POC, POC renvoyant à lʼacronyme étasunien «  People of Colour  » ou personnes racisées en français. ↩ï¸&
Au milieu des années 2010, les sorcières et les pratiques de sorcellerie connaissent un regain dʼintérêt, notamment pour leur relation historique avec le féminisme, que ce soit par la pratique vernaculaire du soin (comme lʼévoque Silvia Federici dans ses travaux) ou la mobilisation militante de la figure de la sorcière comme figure de pouvoir (par exemple par le W. I. T. C. H aux États-Unis). Dans ce contexte, sorts, astrologie et tarot sont mobilisés comme des outils de self-care et de refondation de la communauté, comme en témoigne notamment Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha. Je serai amené à évoquer ce retour des sorcières dans les représentations féministes au chapitre IV. ↩ï¸&
Rencontrée en 2018, cette image résonne étrangement avec des faits de violences policières survenus en 2024 : Sonya Massey, une femme noire de 36 ans, a été tué par un policier blanc alors quʼelle faisait la vaisselle dans son domicile proche de Chicago. ↩ï¸&
Le terme «  hater  » (que «  haineux  » traduit mal) vient de lʼanglais et renvoie aux pratiques de dénigrement systématique qui ont lieu sur les réseaux sociaux. On croise parfois le terme «  rageux  » dans les discours militants en France. ↩ï¸&
Selon les statistiques, les femmes noires trans sont victimes de surmortalité aux États-Unis. La Human Rights Campaign (HRC) identifie dans un rapport de 2018 que sur 5 crimes transphobes, 4 victimes sont des femmes trans racisées, [en ligne], https:
«  Standing at the kitchen sink, a transgender woman of color is cleaning her dishes. This is her house and she has made it her cozy sanctuary. These are her dishes, and she cleans them for herself. She is well aware of the hatred outside her window, the flood of bigotry that never ceases to flow through the South. […] She is not escaping. She is surviving and thriving. She will not be swayed out of living her best life, despite all the darkness in the world.  », sur le site du jeu, http:
«  For the masterʼs tools will never dismantle the masterʼs house  » ↩ï¸&
«  When we talk of ‹ white men › we are describing an institution. ‹ White men › is an institution. By saying this, what I am saying? An institution typically refers to a persistent structure or mechanism of social order governing the behaviour of a set of individuals within a given community. So when I am saying that ‹ white men › is an institution I am referring not only to what has already been instituted or built but the mechanisms that ensure the persistence of that structure. […] How then is ‹ white men › built or even a building? Think about it. One practitioner relayed to me how they named buildings in her institution. All dead white men she said. We donʼt need the names to know how spaces come to be organised so they can receive certain bodies. We donʼt need the naming to know how or who buildings can be for  ». ↩ï¸&
Cette question fait volontairement écho aux travaux du designer et enseignant Clément Rosenberg («  Tout le monde dit que je suis sorcière  »), soutenus à lʼENSCI en 2018. ↩ï¸&
Je pense ici au film La noire de… dʼOusmane Sembène, que je commente en détail dans le chapitre III. ↩ï¸&
«  a pattern of regular doings  », ma traduction. ↩ï¸&
«  home […] is often absurd, and often cruel  », ma traduction. ↩ï¸&
«  the lower the culture, the more apparent the ornament  ». ↩ï¸&
Je me permets de noter ici que, malgré lʼimmense qualité des cours de design que jʼai pu recevoir dans ma formation, aucun ne sʼest frontalement emparé de lʼabsence des femmes ou de leur invisibilisation. ↩ï¸&
«  Womenʼs clothing differs outwardly from menʼs in its preference for ornamental and colourful effects, and the long skirt that completely covers the womanʼs legs. These two elements alone show us on their own that women have remained far behind in their development over the last few centuries  ». Ces propos font écho à ceux de John Ruskin pour qui «  [l]ʼintellect [dʼune femme] nʼest pas destiné à lʼinvention ou à la création, mais à lʼordonnancement, à lʼarrangement et à la décision  » ( «  [A womanʼs] intellect is not for invention or creation, but for sweet ordering, arrangement, and decision  »), dans son Sesame and Lillies publié en 1865, comme le rapportent Annmarie Adams et Peta Tancred (2000, 38). ↩ï¸&
Je ne mʼétends pas ici sur cette expression empruntée à Woolf, mais elle sera contextualisée et questionnée en temps voulu. ↩ï¸&
Voir la notice du CNRTL, [en ligne], https:
«  Der Architekt denkt, die Hausfrau lenkt  », traduction en français dʼaprès la version en anglais de Karina Van Herck. ↩ï¸&
«  regulat[ing] of […] details  ». ↩ï¸&
Il sʼagit dʼun document préparatoire au CIAM 9 (Congrès internationaux dʼarchitecture moderne) dʼAix-en-Provence, écrit en 1953, que je cite ici de seconde main. ↩ï¸&
On pourrait aussi ajouter que cette mention suggère un engouement spécifique des femmes pour la consommation, comme si elles y étaient plus sensibles, ou davantage «  victimes  » de la culture capitaliste. ↩ï¸&
La franchise The Hangover est un très bon exemple contemporain du buddy film tel que Thomas Elsaesser lʼa défini, signalant la reprise du «  motif permanent de Huckleberry Finn dans la culture américaine, qui concerne un couple dʼhommes sʼassociant pour échapper à la civilisation et aux femmes  » («  the ever-present Huck Finn motif in American culture, about the male couple ganging up to escape civilisation and women  »), cité par Timothy Shary, Millenial Masculinity, 2013. Dans le même ouvrage, lʼautrice Maria San Filippo apporte un éclairage différent sur un corpus de buddy films, interprétés comme incarnant une forme de queerness. ↩ï¸&
Je cite ici ce texte un peu tardif (2015) dʼAlain Findeli par rapport à la source généralement citée (2010) car cette dernière est le texte dʼune communication qui nʼest aujourdʼhui plus en ligne. De plus, il se trouve que le texte de 2015 donne lʼoccasion à A. Findeli de retracer la généalogie de ce terme du côté des Radicaux italiens («  Branzi, Manzini, peut-être Mendini  ») mais aussi de Heidegger lecteur dʼHölderlin (voir note 6 du texte de 2015). ↩ï¸&
Je développe cette question du peigne afro comme objet de design antiraciste dans mon cours Queer[ed] Design, en mʼappuyant notamment sur les travaux de Juliette Sméralda, Du cheveu frisé au cheveu crêpu (2012). ↩ï¸&
Ce processus de reclaim (réappropriation, ou retournement du stigmate en français) est très fréquent dans lʼhistoire des populations minorisées. Des hommes noirs peuvent par exemple utiliser en anglais le terme de n*gg*r ; plus récemment, les personnes en situation de handicap ont procédé au même geste de déplacement en employant pour leur compte le terme de crip (contraction de «  cripple  », «  estropié  » en français). ↩ï¸&
Muriel Plana parle du MIC, soit le Marché Institutionnalisé de la Création propre aux créations des arts de la scène. Toutefois, lʼobservation sʼentend également sinon plus au sujet du design, dans le sens où sa pratique rend souvent incontournable la collaboration avec des acteurs économiques. ↩ï¸&
Je pourrai également parler dʼhétéropatriarcat, soit de «  la distribution inégale du pouvoir, des ressources, de lʼattention et du travail qui suit la division binaire du genre en masculin et féminin, des sexualités en hétéro et homosexuelle, et des manières dʼhabiter le genre assignées à la naissance en cis et trans  » (Bigé 2023, 164). ↩ï¸&
«  heteronormativity in Singapore (and everywhere else) is clearly about much more than the policing of a heterosexual-homosexual binary. Its logic involves not one norm, but a set of norms. Its practice is animated by ideologies of the sexual in concert with ideologies of race, gender, class and nationality (to name but some). And it results in the ‹ queering › of a diverse array of subjects, including but by no means limited to those who might identify as gay or lesbian (or even bisexual or transgendered)  ». ↩ï¸&
«  That which is cast as foreign to the domestic can and ought to be interrogated as also often queer  ». ↩ï¸&
Avec la légalisation de lʼadoption, de la PMA et de la GPA par des couples gay et lesbiens dans différents pays du monde, cette externalité légale des sujets queer vis-à -vis de la reproduction nʼest plus un fait. Elle nʼa jamais été un fait tout court : les sujets queer, par choix ou obligation, se sont toujours reproduits. Toutefois, lʼaccès à la filiation légale pour les couples gays et lesbiens notamment pose la question de leur participation à la culture futuriste de la reproduction, comme le remarquent Lee Edelman (2004, 17) et Sophie Lewis (2019, 22). Cette dernière observe que cet accès autorise même une forme dʼinjonction, que seul·es les plus privilégié·es peuvent satisfaire. ↩ï¸&
Mathias Quéré montre ainsi comment cette tension entre lʼassimilation à la société civile et la solidification dʼun espace de marge traverse lʼactivisme homosexuel en France dans les années 1970. Le GLH-PQ a ainsi pour slogan «  Le ghetto cʼest foutu, les homos sont dans la rue !  » (2018, 62). Dʼautres groupes minoritaires sont également concernés par cette ligne de questionnement. En 2020, la série The Plot Against America (adaptée du roman éponyme de Philip Roth) dramatise cette question en exposant les conflits qui opposent des juif·ves désireux·ses de sʼintégrer à tout prix dans une société étasunienne pourtant en voie de fascisation, et les autres, qui choisissent de faire front, avec tous les risques que cela comporte. ↩ï¸&
Il va de soi que dans le sillage des expérimentations de vie produites par le confinement lié à la pandémie du COVID, la notion dʼaide mutuelle est très exposée à la récupération par le discours néo-libéral. ↩ï¸&
Si Sam Bourcier sʼinquiète dans Homo Inc. que la «  sperm party  » soit remplacée par la «  stimulation ovarienne à 20 000 euros en Belgique ou en Espagne  » (58), on peut également prolonger cette réflexion, sur la mutation des politiques LGBT dans leur version straight et homonationaliste. Les affaires récentes de lʼarche de Zoé (2007), de la missionnaire Renée Bach (2019) ou encore celle de la Youtubeuse Mikka Stoffer (2020) ayant «  rendu  » son enfant adopté pose la question de lʼadoption massive dʼenfants racisés par des familles blanches, parfois au mépris du droit et du statut réel des enfants. Les groupes décoloniaux critiquant ces entreprises ne manquent pas de rappeler que lʼadoption dʼenfants racisés par des familles occidentales blanches prolonge le rapport colonial entre le maître et ses esclaves, puisque le «  droit  » à lʼenfant peut dans certains cas se lire comme un droit sur des corps non-blancs. ↩ï¸&
«  Throughout its history, portraiture has been used to memorialize family lineage and honor family patriarchs and matriarchs. While heterosexual families have a pronounced and illustrated legacy, gay unions have not been acknowledged in the ledgers of history. Through States of Union, same-sex families will be able to claim their place in history and within the centuries-old legacy of portraiture  », ma traduction, [en ligne], http:
«  ever-changing anatomy of a family  », http:
Un élément de prudence : je nʼen déduis pas que le contexte vietnamien est plus homophobe que le contexte français ou étasunien. Il faut se méfier des discours qui tendent à faire de lʼhomophobie le propre de cultures étrangères, puisquʼil sʼagit dʼune stratégie discursive homonationaliste parfaitement identifiée, aux effets politiques désastreux. ↩ï¸&
«  The Pink Choice is a series of photographs about the love between homosexual couples, focusing on living spaces, the affectionate touches, and more importantly, the synchronized rhythm of lovers sharing life together. Viewers may not feel the personalities of the subjects in the photographs, but hopefully they can feel the warmth of their love and mutual caring  », [en ligne], http:
En 1989, Kimberlé Crenshaw propose le terme dʼintersectionnalité pour penser de manière croisée les oppressions, et la manière dont les sujets peuvent être minorisés de manière multiple, race, genre et classe (entre autres) étant intriqués, plutôt que des identités exclusives et séparables. ↩ï¸&
Ici, quelque chose se perd évidemment dans la traduction, dʼoù mon choix dʼutiliser lʼexpression en version originale. «  Homework  » se traduit en français par «  devoirs à la maison  » et comporte des connotations scolaires ; mais le terme signifie littéralement travail à la maison. ↩ï¸&
«  sweaty concepts  ». ↩ï¸&
«  a sweaty concept is one that comes out of a description of a body that is not at home in the world […] A sweaty concept might come out of a bodily experience that is trying  ». ↩ï¸&
Cette exposition reprend le modèle de la Womanhouse des artistes californiennes Judy Chicago and Miriam Schapiro. Dans cette maison, des femmes féministes se sont rassemblées pour vivre et créer des Å“uvres à lʼéchelle dʼune pièce de la maison. Lʼobjectif de lʼexposition Queer Domesticities est dʼapprocher la perspective blanche et cis-centrée de la maison de 1972, pour apporter un ensemble plus riche de points de vue. Jʼévoquerai cette Å“uvre dans le chapitre III. ↩ï¸&
Je fais référence au monde «  au-delà de lʼarc-en-ciel  » («  over the rainbow  ») chanté par Judy Garland dans Le magicien dʼOz (1939). Le personnage de Dorothy est une icône gay bien connue, auxquel fait écho la phrase «  êtes-vous ami avec Dorothy ?  » qui pouvait servir dʼamorce à la séduction aux États-Unis lorsque lʼhomosexualité était encore pénalisée. ↩ï¸&
Susan Fraiman travaille dans Extreme Domesticity (2017) à «  arracher la domesticité de la piété de droite et de la dérision de gauche  » («  sever domesticity from the usual right-wing pieties and the usual left derision  », 3) en explorant des formes queer de la domesticité en littérature. ↩ï¸&
Voir la citation complète : «  no one set of practices or relations has the monopoly on the so-called radical, or the so-called normative  » («  pas un seul ensemble de pratiques ou de relations nʼa le monopole du soi-disant radical, du soi-disant normatif  »). ↩ï¸&
Le terme passing désigne initialement la capacité, pour une personne trans, à être reconnue dans le genre souhaité lors dʼinteractions sociales plus ou moins ordinaires. Le passing nʼest pas fixe, et dépend grandement des contextes (sociaux, géographiques, culturels). Le terme sʼapplique également à des groupes étendus : ici, un couple identifié par le passé comme «  couple de lesbiennes  », peut, suite à la transition dʼune des deux personnes, devenir lisible comme hétérosexuel, et obtenir certains avantages sociaux jusquʼici inaccessibles. ↩ï¸&
«  itʼs the binary of normative/transgressive thatʼs unsustainable, along with the demand that anyone live a life thatʼs all one thing  » ↩ï¸&
«  [a]dvanced capitalism is a difference engine  » ↩ï¸&
«  the paths of transformation engendered by the difference engine" of advanced capitalism are neither straight nor predictable. They rather compose a zigzagging line of paradoxical options. Thus human bodies caught in the spinning machine of multiple differences at the end of postmodernity become simultaneously disposable commodities to be vampirized and also decisive agents for politi- cal and ethical transformation. How to tell the difference between the two modes of « becoming other » is the task of cultural and political theory and practice  ». ↩ï¸&
«  Design processes and solutions […] define […] what is socially relevant  ». ↩ï¸&
La publication de 1932 est la première à porter ce titre, mais ses fondements étaient déjà parus en 1924 sous le titre Architectural Details ; voir le site de la publication, https:
these «  diagrammatic bodies never actually find their analogue in the flesh  ». ↩ï¸&
«  human engineering  ». ↩ï¸&
«  the destruction of home life  ». ↩ï¸&
a «  cell[…] of biovigilance  ». ↩ï¸&
Je remarque que ces dernières années, lʼexpression «  made in China  » est devenue un emblème de lʼobjet mal conçu, produit en trop grande quantité, au mépris de son impact écologique, et destiné à être jeté sans aucune forme de procès. On lui oppose souvent lʼobjet «  circuit court  », en bois, vertueux, créé par «  des petits créateurs  », indifférents à la manière dont ce motif rejette la faute de la surproduction sur des populations asiatiques, pour valoriser en retour des créateurices blanc·hes moralement supérieurs. Lors de lʼépidémie du COVID, la manière dont les marchés de plein vent chinois ont été décrits comme des lieux sales, voire de perdition sanitaire, y compris par des intellectuels français de renom, reprend dans une certaine mesure ce motif du «  mauvais  » producteur chinois. Sa fonction idéologique doit nous interroger. ↩ï¸&
«  disobedience  »â€¯; le titre de leur article est «  Weʼre Here to Be Bad  ». ↩ï¸&
Je détaille la généalogie de ce projet et ce rôle de la sérendipité dans mon travail dans la synthèse jointe. ↩ï¸&
«  I used to do this! Iʼm a chef!  » ↩ï¸&
Le scrapbooking est une pratique vernaculaire de fabrication dʼobjets éditoriaux dont les formes sont diverses et se rattachent aux loisirs créatifs. Plutôt considéré comme féminin, voire présenté comme une activité «  de mamans  », ce hobby associe collage, découpage, usage dʼautocollants, impression de photos, transfert de décalcomanies, etc. pour réaliser des créations diverses (album photo, carnet de recettes, journal intime ou journal de bord, etc.). ↩ï¸&
Difficile ici de ne pas penser aux mots de Nicolas Sarkozy en 2008, qui, alors ministre de lʼIntérieur en visite à la Courneuve, avait parlé de nettoyer la cité des 4000 au «  kärcher  ». Les implications racistes du discours sur la propreté en Occident seront explorées, lorsque jʼévoquerai lessive et lavage «  plus blanc  » dans le chapitre III. ↩ï¸&
«  […] there is no such thing as a merely given, or simply available, starting point: beginnings have to be made for each project in such a way as to enable what follows from them  ». ↩ï¸&
«  foolish  ». ↩ï¸&
Cʼest en tout cas le consensus dominant. Mon collègue Brice Genre propose une autre lecture historique en offrant une proto-histoire du design qui fait remonter les origines de la discipline aux frémissements du premier capitalisme, soit à lʼépoque des premières enclosures, voire, repère une «  attitude  » de designer dans des périodes plus anciennes. ↩ï¸&
Le projet CinéDesign est né en 2016 de la collaboration entre Anthony Masure, chercheur en design, Mélanie Boissonneau, chercheuse en cinéma et moi-même. Depuis, avec Irène Dunyach, chercheuse en design, ont été développées une journée dʼétude (2016) et deux colloques (2018 et 2022), dont un en partenariat avec Guim Espelt et Daniele Porretta de lʼELISAVA à Barcelone. Une publication a été auto-éditée (2017) et une autre est de réalisation, en co-direction avec Irène Dunyach et Elise Rigot (chercheuse en design). Ce projet est détaillé dans la synthèse jointe. ↩ï¸&
«  it has become clear that the rhetoric of creative work is merely a ruse that allows ʼwork-likeʼ practices to invade our leisure, social and non-economic lives  ». ↩ï¸&
Le master Design Transdisciplinaire, Culture et Territoires est une formation du département Arts Plastiques -— Design de lʼUniversité Toulouse -— Jean Jaurès, dans laquelle interviennent aujourdʼhui Fabienne Denoual, Elise Rigot, Cathy Combarnous, Gaë lle Sandré, Brice Genre, Damien Guizard, Thierry Dubrouil, Sylvain Bouyer, Karen Polesello et moi-même. ↩ï¸&
La traduction est si difficile que je fais ici le choix dʼintégrer lʼexpression anglaise au texte ; la version française est proposée par Claudia Mareis (2023, 46). ↩ï¸&
On se souviendra ici de la célèbre carte de Borges, qui à force dʼexhaustivité et de détail, était devenue plus grande que le territoire lui-même (1982[1946]). ↩ï¸&
«  A queer methodology, in a way, is a scavenger methodology that uses different methods to collect and produce information on subjects ·who have been deliberately or accidentally excluded from traditional studies of human behavior. The queer methodology attempts to combine methods that are often cast as being at odds with each other, and it refuses the academic compulsion toward disciplinary coherence  ». ↩ï¸&
«  we would need , in fact , to think in fractal terms and about gender geometries  ». ↩ï¸&
Jérôme Cabot a produit une telle méta-analyse dans «  La position du slamo-gauchiste  », publié dans lʼouvrage collectif Pour des recherches diaboliques, Théories et création interartistiques en laboratoire (2024). ↩ï¸&
«  Serious cultural work isnʼt supposed to include lists of fragrance-free curly hair products or instructions about how to tour while sick and hurt less, right? But — fuck that  ». ↩ï¸&
«  how much fun are they?  » ↩ï¸&
Dʼautres auteurices font bien sà »r usage de la même approche ; je pense par exemple à la manière dont Françoise Vergès évoque la banane comme clé dʼentrée permettant dʼentrer dans les questions de colonialisme, sexisme et capitalisme sans passer par des généralités ou une pensée trop abstraite (2019, 36). ↩ï¸&
«  passing through the fabric of my body  ». ↩ï¸&
«  dwelling  ». ↩ï¸&
«  gender nomadisms  ». ↩ï¸&
On lit par exemple chez Bruno : «  Alors que jʼessayais de tendre un pont entre le langage de lʼanalyse académique et le discours subjectif, voire même autobiographique, jʼai vu ma recherche être «  attirée  », très littéralement, vers la cartographie émotionnelle de cartes comme celle de Scudéry, qui tire des lignes depuis et pour des trajectoires expérientielles  ». La version originale est plus évocatrice car elle joue sur lʼhomonymie anglaise entre draw (tirer) et draw (dessiner) : «  As I have tried to bridge the language of scholarly analysis with subjective, even autobiographical discourse, I have watched my research being « ʼdrawn, » quite literally,to the emotional cartography of maps like Scudéryʼs, which draw, and draw upon, experiential trajectories  » (2). ↩ï¸&
«  the challenge lies in how to think about processes rather than concepts  ». ↩ï¸&
Dʼautres artistes ont évoqué cette tension entre vie familiale et vie domestique, telle la plasticienne Hessie, à laquelle était dédiée une rétrospective aux Abattoirs en 2018. ↩ï¸&
«  I wrote most of the cyborg manifesto here […] because there could be a rhythm between physical labor and writing and a whole lot of good food […] we invested in a good cooktop and a very good convection oven early on  », ma traduction. ↩ï¸&
«  Consider a kitchen. The kitchen has hot plates cups and spoons cups and spoons to measure parts a blender and spices. A sink. Water. A microwave. Water. Milk and butter in the fridge. Water. Oils. Knives. Water. Water. Tap water. Endless boundless water. Fresh water. Water for washing hands in. Water to bathe a cat in. Water for cleaning dishes. Water for tea. Water for drinking. Water  »â€¯; je traduis «  consider  » par «   considérez  » alors quʼil faudrait sans doute proposer «   prendre lʼexemple de  » comme équivalent. Mais ce verbe considérer me semble important, et résonne avec la portée que lui accorde Marielle Macé dans Sidérer, considérer (2016). ↩ï¸&
«  People with AIDS across the country are turning themselves into human test tubes […] they turn their tenement kitchens into laboratories, mixing up chemicals and passing them out freely to friends and strangers to help prolong lives  ». ↩ï¸&
«  I was itchy, compelled in the same way Iʼd felt, pre-testosterone, when I saw a vision of a man bearded and shirtless, sitting at some future kitchen table, and I knew in my gut that it was my destiny to become him  » ↩ï¸&
«  Every time I lay the table, I am designing something  ». ↩ï¸&
Cʼest dʼailleurs, à mon sens, un point fondamental de toute théorie féministe qui sʼattaque à lʼespace domestique, ne serait-ce quʼen raison dʼune réalisation initiale, ou dʼun sentiment, qui sʼenracine dans lʼexpérience. Dans Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, Silvia Federici se rappelle ainsi sa mère, ses tartes, son pain et ses travaux de couture (2012, 21–22). ↩ï¸&
Ce fait est récurrent dans les langues latines : lʼanglais utilise deux mots (kitchen/cooking), tout comme lʼallemand (Küche/Kochen), tandis que lʼitalien possède un seul mot (cucina), de même que lʼespagnol (cocina). ↩ï¸&
Je pense ici la cabane de lʼabbé Laugier, qui en pleine période baroque, voire rococo, sʼinsurge contre les débordements décoratifs de son temps (avant Adolf Loos au XXe siècle) et plaide en faveur de structures architecturales claires, qui laissent apparaître leurs principes et ne se revêtent pas dʼatours artificiels et sans fonction (fig. 0.41). ↩ï¸&
Un dossier récent de la revue Strelka, «  Quarantinology  », imagine comment cette bascule de lʼespace vers le tout-domestique pourrait amener à la conception de nouveaux espaces et usages. Parmi les utopies-dystopies inventées dans le dossier, le cubicle communalism imagine un monde où les espaces de bureau, désertés, deviendraient le décor dʼune nouvelle vie en communauté (fig. 0.42). ↩ï¸&
On appelle «  momtrepreneur  » des femmes dont la vie de mère, souvent au foyer, mais pas toujours exclusivement, est au centre de lʼactivité économique. Il peut sʼagir dʼun métier exercé en auto-entreprenariat à la maison, ou de la vente dʼarticles fait-main (par exemple sur le site Etsy), ou encore dʼun travail dʼinfluenceuse réalisé sur Instagram en valorisant son style de vie. Ces femmes choisissent souvent cette carrière parce quʼelle permet de combiner les rôles de mère présente dans la vie de ses enfants et dʼentrepreneure. ↩ï¸&
On parle de «  tournant spatial  » (ou «  spatial turn  ») au sujet des Humanités pour désigner une forme de conscience spatiale appliquée aux objets dʼétudes, dans la lignée de Michel Foucault, mais aussi des travaux dʼEdward Soja (1989). Ce retour de lʼespace est aussi dà » à une prise en compte des apports de la géographie et de lʼurbanisme. ↩ï¸&
Et non «  être placardisé  », expression française qui renvoie au fait dʼêtre mis sur la touche, dans le domaine professionnel notamment. ↩ï¸&
On parle dʼouting pour désigner le fait dʼêtre désigné comme lesbienne, gay, trans, etc. sans avoir donné son consentement. Il existe des ressources militantes sur ce sujet puisque «  outer  » une personne est considéré comme une forme de violence (sans parler des agressions multiples auxquelles ce geste peut exposer lʼintéressé·e). ↩ï¸&
Ce récit renverse le motif horrifique (souvent imaginé par les enfants, relayé par la littérature et la culture populaire) du monstre dans le placard ou sous le lit. Lʼidée de garder les personnes LGBT «  au placard  » participe aussi de cette économie qui renvoie le monstre à son lieu naturel, contenu dans lʼobscène (au sens littéral) de la chambre privée. ↩ï¸&
«  mundane-modern  »â€¯; «  medieval-magic  ». ↩ï¸&
«  The wardrobe is the perfect artefact to mediate [both realms] because it is both: it is modern in the sense that every modern house feasibly has one; but as house furnishings go it is also old, like the chest, stool and tester bed  ». ↩ï¸&
Il est intéressant (et sans doute significatif), que la porte-parole la plus célèbre des TERFs (Trans Exclusionary Radical Feminists -— cʼest-à -dire les «  féministes  » auto-proclamées qui refusent dʼinclure les personnes trans dans leurs luttes -—lʼautrice J. K. Rowling, ait écrit un roman fantastique racontant lʼhistoire dʼun sorcier qui sʼignore, forcé à vivre dans le placard sous lʼescalier de ses oncle et tante. Le personnage de Harry Potter nʼest pas gay, mais son expérience de lʼostracisation et de lʼignorance de sa propre identité ont fortement fait écho chez les jeunes LGBTQIA+ qui ont lu le récit. J. K. Rowling, cependant, ne semble pas voir de problème à renvoyer au placard les personnes trans quʼelle dépeint principalement (dans ses propos et dans une fiction, Troubled Blood, publiée sous le pseudonyme de Robert Galbraith) comme une menace. Lʼironie nʼa pas échappé à la youtubeuse Natalie Wynn lorsquʼelle a analysé la controverse autour de J. K Rowling dans lʼépisode «  J. K. Rowling  » sur sa chaîne YouTube Contrapoints (2021) et mis en évidence les contradictions internes entre son Å“uvre et son discours. ↩ï¸&
Ce nʼest pas seulement le résultat dʼune projection de la société hétéronormative sur les personnes gays et lesbiennes. Il y a bien eu un retournement dans les années 60–70, la nécessité du secret faisant place à la nécessité de se dire ; mais celle-ci est aussi une conséquence de lʼactivisme LGBT (et surtout LG) de ces deux décennies. Comme le rappelle Eve Kosofsky Sedgwick : «  lʼexpression ‹ le placard ›, en tant que signifiant publiquement intelligible pour des questions eÌpisteÌmologiques aÌ€ theÌmatique gaie, nʼest aujourdʼhui compreÌhensible quʼen vertu des politiques gaies post-Stonewall orienteÌes vers la sortie du placard  » («  the phrase ‹ the closet › as a publicly intelligible signifier for gay-related epistemological issues is made available, obviously, only by the difference made by the post-Stonewall gay politics oriented around coming out of the closet  », traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française) (1990, 14 ; 2008[1990], 36). ↩ï¸&
«  E.1027 is a house filled with secrets, pockets in walls, sliding passages, and tempting clefts. Grayʼs architecture hides and reveals simultaneously. It is out in the open but still closeted  ». ↩ï¸&
Jʼutilise volontairement ce terme qui signifie à la fois le retournement dʼun paradigme, mais qui évoque aussi, historiquement parlant, la compréhension des hommes gays, par le corps médical et par eux-mêmes, comme «  invertis  » au XIXe siècle. La notion, de Karl Ulrichs à Sigmund Freud, recouvre plusieurs acceptions (Eribon 2012[1999], 124–127), et jʼy reviendrai dans partie E ci-après. ↩ï¸&
«  layers of interiors within its interiors  ». ↩ï¸&
«  to ask how certain categorizations work, what enactments they are performing and what relations they are creating, rather than what they essential mean  », traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française (2008[1990], 47). ↩ï¸&
«  For if I were to argue that genders are performative, that could mean that I thought that one woke in the morning, perused the closet or some more open space for the gender of choice, donned that gender for the day, and then restored the garment to its place at night  ». ↩ï¸&
Maude-Yeuse Thomas définit ainsi rapidement ce dispositif de la fringothèque : elle «  est un lieu permanent sans calendrier ni atelier où sont déposés des vêtements. Le fonds dépend des dons volontaires et un appel est effectué chaque année  » (2013, 126–27). ↩ï¸&
«  mobile closet  ». ↩ï¸&
«  music closet  ». ↩ï¸&
«  Newly ‹ out › lesbians may construct safe home spaces by ‹ hiding in music ›. Beyond the walls of home, safe public spaces are made by using music as a ‹ mobile closet ›  ». ↩ï¸&
«  [t]o insist on the closet limits queer space to a dichotomy of heterosexuality and homosexuality  ». ↩ï¸&
Jʼentends bien ici que ces deux orientations non normatives suggèrent un univers dʼattractions romantiques et sexuelles bien plus larges. En toute rigueur, il faudrait ajouter à cette énumération «  bisexuel·le  » et «  pansexuel·le  », mais ces deux termes ne sont pas symétriques à «  gay  » et «  lesbienne  ». La bisexualité est encore mal reconnue, y compris dans les milieux LGBTQIA+ ; dans une société hétéronormative, elle est souvent associée à une «  phase  » (que lʼon quitterait pour adopter une sexualité reconnaissable, cʼest-à -dire hétéro ou homo), quand elle nʼest pas soupçonnée de ne pas exister. Le régime du vrai que je vais évoquer ci-après participe pleinement à lʼeffacement de la bisexualité et de la pansexualité. Dʼautres conceptions communes de la bisexualité existent aussi, bien sà »r, et rejettent complètement lʼidée dʼune impossible bisexualité au profit de lʼidée dʼune bisexualité universelle et primitive. Didier Eribon commente cette idée et le succès quʼelle a rencontré dans les milieux gays des années 70, et notamment au sein du FHAR (2012 [1999], 442 ; 451), en rupture avec la culture homosexuelle plus clairement revendiquée comme telle par le groupe Arcadie. ↩ï¸&
Foucault dit «  sexualité  » mais aussi, très souvent, «  sexe  ». Ce terme est polysémique, et recouvre le sexe-pratique sexuelle et le sexe-sexuation des corps. À cause des confusions pouvant émerger ici du terme «  sexe  », je tâcherai de dire aussi souvent que possible «  sexualité  » et «  sexuation  » dans un souci de clarté. ↩ï¸&
Foucault lʼaffirme dans ce contexte : «  Le dispositif de sexualité a pour raison dʼêtre non de se reproduire, mais de proliférer, dʼinnover, dʼannexer, dʼinventer, de pénétrer les corps de façon de plus en plus détaillée et de contrôler les populations de manière de plus en plus globale  » (141). ↩ï¸&
Dans la ligne du philosophe Clément Rosset qui parle dʼune «  Mystique de lʼauthenticité et mystique du passé  » au sujet du naturalisme moderne (2011, 296). ↩ï¸&
Ce motif de lʼhumanité amnésique connaît au moins un précédent célèbre dans lʼeschatologie propre à lʼÉglise de Scientologie. Celui-ci est particulièrement séduisant dans la mesure où il suppose une «  vérité  » inaccessible dont lʼindividu a été privé, mensonge qui est la cause unique de son mal-être. Les théories conspirationnistes fonctionnent de manière similaire sur ce principe organisateur de la vérité cachée qui, rendu soudainement accessible, possède un potentiel transformateur pour lʼindividu. ↩ï¸&
Victoire Tuaillon a consacré un épisode de son podcast Le cÅ“ur sur la table à lʼimpact de ces guides, et à leur aspect séduisant ; voir «  Lʼingénieur et lʼinfirmière  » diffusé par Binge Audio le 8 juillet 2021. ↩ï¸&
«  Understanding and Delighting in Your Differences  ». ↩ï¸&
«  a discrete entity packed in the brain  ». ↩ï¸&
«  the study of ‹ sex as a biological variable›  ». ↩ï¸&
«  Our hormones respond to the life we lead, breaking down the false division between internal biology and our external environment. And so, it should be little surprise to learn that it is not just mothersʼ hormones that change during the transition to parenthood, but fathersʼ, too  ». ↩ï¸&
Susan Faludi a utilisé ce terme devenu pérenne pour désigner le «  retour de bâton  » qui a suivi lʼobtention dʼacquis sociaux pour les femmes dans son ouvrage du même nom. Il peut sʼappliquer à tout mouvement réactionnaire succédant au progrès social, quand bien même sa diffusion ne semble pas structurée ([2010]1991). ↩ï¸&
Comme dans le cas de lʼaffiche revendiquant le maintien des stéréotypes, la représentation interroge : le père est représenté en bleu, la mère en rose -— jusquʼici, lʼimage est attendue. Mais la fusion des deux parties du cÅ“ur ainsi coloré, représentant le couple hétérosexuel, figure lʼenfant en violet… produisant ainsi une image là aussi assez trouble quant à la notion de genre. Ailleurs, deux bébés, un bleu, un rose, sont menacés par la théorie du genre (le texte indique : «  Théorie du genre à lʼécole, Stop !  ») représentée par un gigantesque escargot… bleu. Accidentellement, le code qui distingue le genre des bébés genre lʼescargot, dès lors perceptible comme une menace fondamentalement masculine. Il est intéressant que les textes de la Manif pour Tous soient assez clairs, mais que leurs images, fréquemment, créent des doubles sens de lecture. ↩ï¸&
Le concept dʼune cartographie militante, dont lʼusage même serait politique, relève dʼune longue tradition, évoquée entre autres par Shannon Mattern dans son article «  How to Map Nothing  » publié par la revue Places en mars 2021. Dans cet écrit, S. Mattern évoque les travaux dʼAudre Simpson qui parle de «  cartographies du refus  » («  cartographies of refusal  ») pour désigner sa méthode consistant à rendre visibles les rapports de force en place (issus du colonialisme, de la violence dʼÉtat, etc.) et les actions qui résistent à ces violences systémiques. Il me semble quʼil y a quelque chose ici à réactiver pour mon propre travail. ↩ï¸&
Les observations qui suivent concernent surtout les langues comportant des pronoms genrés et a fortiori celles qui genrent les adjectifs accordés (par exemple : le français, lʼitalien, lʼespagnol, etc.). ↩ï¸&
Il est intéressant de noter quʼentre le moment où jʼai commencé le chapitre et le moment où jʼen ai effectué la première relecture, on ne mʼappelait quasiment plus «  Madame  », ou alors, cette interpellation était très vite conscientisée par les interlocuteurices comme une erreur, leur imposant de sʼexcuser immédiatement et profusément. Quels détails ont fait passer la lisibilité de mon corps dʼune incertitude à une reconnaissance ? La question reste en suspens, à lʼheure des ultimes relectures où mon corps semble avoir définitivement basculé dans une forme de stabilité désormais sanctionnée par un «  Monsieur  ». ↩ï¸&
La controverse en question tient aux pratiques cliniques qui découlent de son positionnement. John Money opère ainsi le jeune David Reimer sans son consentement après un accident et une chirurgie correctrice ratée. Puisque son pénis nʼest pas fonctionnel, John Money propose aux parents du jeune Reimer de le socialiser comme fille et procède dans cette logique à des opérations chirurgicales préliminaires (Butler 2006[2001], 184). Lʼexpérience est un échec sur le plan pragmatique, le jeune Reimer retournant à son physique originel plus tard dans sa vie adulte, indépendamment de sa socialisation féminine ; il finit par se suicider en 2004. Le second échec, et le plus important bien sà »r, se situe sur un plan éthique, puisque cet enfant nʼavait manifesté aucun désir de modifier son apparence corporelle, ni même aucune expression identitaire le rapprochant du genre féminin, ce qui signifie que son consentement nʼa pas été respecté et que les expériences de Money relèvent de violences médicales. ↩ï¸&
Ces points seront rendus plus explicites dans la partie B.1 sur le vérisme scientifique. ↩ï¸&
On pensera aussi bien (même si ces violences ne sont en rien équivalentes) à lʼabsence de soin qui empêche la transition (et garde les personnes trans au placard, ou les pousse au suicide), les thérapies de conversion (interdites pour les lesbiennes et homosexuels en France, mais pas pour les personnes trans), les législations actuelles aux États-Unis poussant à criminaliser les parents dʼenfants trans, ou à détransitionner de force les mineur·es trans, et enfin, évidemment, aux camps de concentration ou dʼextermination nazis qui ciblèrent particulièrement les hommes homosexuels (parmi lesquels il est probable que se trouvaient plusieurs personnes présentant une variance de genre, puisque la différence nʼétait alors pas forcément identifiée et nommée). ↩ï¸&
«  experiential gender  ». ↩ï¸&
«  to ‹ refer › naively or directly to such an extra-discursive object will always require the prior delimitation of the extra -discursive. And insofar as the extra-discursive is delimited, it is formed by the very discourse from which it seeks to free itself  ». ↩ï¸&
Cʼest aussi un risque inhérent à la diffusion des idées. Jʼai ainsi pu voir comment, dans des publications militantes, ou des interactions dans ces milieux, le principe féministe selon lequel «  le personnel est politique  » sʼassèche pour ressembler à «  le personnel nʼest que politique  » (ce qui a de nombreuses conséquences funestes, dont le surinvestissement des comportements personnels et le développement dʼune surveillance intra-communautaire qui prétend faire de la politique en poliçant les «  bons  » comportements). ↩ï¸&
«  The debate between constructivism and essentialism thus misses the point of deconstruction altogether, for the point has never been that ‹ everything is discursively constructed ›; that point, when and where it is made, belongs to a kind of discursive monism or linguisticism that refuses the constitutive force of exclusion, erasure, violent foreclosure, abjection and its disruptive return within the very terms of discursive legitimacy  ». ↩ï¸&
«  to lose authoritative biological accounts of sex, which set up productive tensions with gender, seems to be to lose too much  ». ↩ï¸&
La liste est en réalité bien plus longue. Isabelle Dussauge et Anelis Kaiser, dans un article dédié aux lectures féministes des neurosciences évoquent «  Catherine Vidal, Sigrid Schmitz, Rebecca Jordan-Young et Cordelia Fine, Anelis Kaiser, Deboleena Roy, Daphna Joel, Robyn Bluhm, Anne Jaap Jacobson et Heidi Lene Maibom  » (2013, §7). ↩ï¸&
«  biology is much more dynamic than feminists have presumed  ». ↩ï¸&
«  biology is not a synonym for determinism and sociality is not a synonym for transformation  ». ↩ï¸&
«  Gender and race never existed separately and never were about preformed subjects endowed with funny genitals and curious colors. Race and gender are about entwined, barely analytically separable, highly protean, relational categories  ». ↩ï¸&
«  strategic utility  »â€¯; pour être parfaitement clair, Haraway utilise cette dénomination pour parler de «  sexe  » et «  genre  ». Mais il me semble que lʼobservation peut-être étendue, voire même provoquer une compréhension de nos usages des catégories qui soit plus importante, plus centrale dans lʼeffort épistémologique, que la catégorie elle-même. ↩ï¸&
Dans une note, Maya Gonzalez et Jeanne Neton disent vouloir «  préciser [quʼelles] nʼentend[ent] pas par là lʼabolition de toute possibilité de vivre ou de performer certaines formes de subjectivité  » (note 9, 10–11). La précision est appréciable, mais jʼavoue être troublé par lʼidée que la subjectivité se «  performe  ». ↩ï¸&
Je précise que je parle bien de certaines analyses qui, en étant récurrentes, mʼont semblé significatives. Mes étudiant·es produisent aussi des écrits tout à fait intéressants ! ↩ï¸&
Il existe, et cʼest intéressant, le phénomène inverse de reconnaissance dʼune «  esthétique queer  » associée à tout ce qui est excessif, flamboyant, pailleté, etc. Hélène Marquié, au sujet de la danse, observe quʼun tel rapprochement, lorsquʼil est systématisé «  rédui[t] la complexité des constructions corporelles et identitaires à des signes -— au sens sémiotique -—, des stéréotypes, et qui plus est, les fige […] par la réitération, tout en masquant, sous lʼapparence transgressive, la reconduction des éléments normatifs incorporés à lʼidentique  » (2015, 160–70, §15). ↩ï¸&
On pourrait aussi parler avec Erving Goffman de «  gender display  » (1979, 1), traduit par la revue Terrains en «  déploiement du genre  » (2004). ↩ï¸&
Je tiens à préciser quʼelles ne sont pas des impasses au même titre. Je serai toujours plus incisif avec lʼordre sexiste qui solidifie le système binaire sexe-genre quʼavec le mouvement queer féministe qui enjoint à détruire ce système ! Mais dans une perspective épistémologique, les deux positions doivent être regardées et analysées. ↩ï¸&
«  1– Everyone must be in a box. 2) There are only two boxes. 3) No one can change boxes and no one can be in the middle. 4) You can not pick your box  ». ↩ï¸&
J’emprunte cette formulation à Gayle Rubin, qui écrit plus précisément «  sex/gender  » (2012[1975]). ↩ï¸&
Je le précise pour visibiliser le contexte, mais en réalité, un grand nombre de ses observations, concernant la galanterie, les gestes dans le couple hétérosexuel ou la terminologie utilisée pour décrire des faits dans les médias restent dʼactualité. ↩ï¸&
Comme ceci est résumé par cette citation : «  Lʼidée de nature est lʼenregistrement, au fond tout à fait banal, dʼun rapport social de fait  » (Guillaumin, 1978, 27). ↩ï¸&
«  surgical shoehorn  », traduction dʼOristelle Bonis & de Françoise Bouillot pour lʼédition française (2012[2000], 25). ↩ï¸&
On peut penser à dʼautres exemples : la manière dont des jeunes filles cisgenres en aménorrhée sont placées sous traitement hormonal à nulle autre fin que celle dʼavoir leurs règles et de maintenir une apparence de naturalité en est un. La manière dont les femmes cisgenres interrompent la prise de leur pilule pour avoir leurs règles (bien que ceci ne soit pas nécessaire et constitue ce que Paul Preciado appelle des «  techno-règles  » [2014, 161]) en constitue un autre. ↩ï¸&
«  categories presented in a culture as symmetrical binary oppositions […] actually subsist in a more unsettled and dynamic tacit relation according to which, first, term B is not symmetrical with but subordinated to term A; but, second, the ontologically valorized term A actually depends for its meaning on the simultaneous subsumption and exclusion of term B; hence, third·, the question of priority between the supposed central and the supposed marginal category of each dyad is irresolvably unstable, an instability caused by the fact that term B is constituted as at once internal and external to term A  », traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française (2008[1990], 31–32). ↩ï¸&
«  the sister or brother, the best friend, the classmate, the parent, the child, the lover,the ex-: our families, loves, and enmities alike, not to mention the strange relations of our work, play, and activism, prove that even people who share all or most of our own positionings along these crude axes may still be different enough from us, and from each other, to seem like all but different species  », traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française (2008[1990], 43–44). ↩ï¸&
Une telle vision considérera ainsi que «  la Femme  » est toujours désavantagée dans son interaction avec «  lʼHomme  ». Or, historiquement, et encore de nos jours, une femme blanche face à un homme noir pourra exercer une forme de pouvoir dès lors que la différence constitutive première ordonnant leurs rapports sera la race. Cela dépend évidemment du contexte. ↩ï¸&
«  the opiate of the masses  ». ↩ï¸&
«  can decline domestic tasks on the general ground of his sex, while identifying any of his wifeʼs disinclination here as an expression of her particular character  »â€¯; traduction de la revue Terrain (2004). ↩ï¸&
«  a sameness of all women as Woman  ». ↩ï¸&
«  implicit allegories of the relations of men to women  ». ↩ï¸&
«  parent-child complex  ». ↩ï¸&
Jʼavais évoqué ce moment historique dans ma thèse au sujet des masculinités héroïques (Pandelakis, 2013, 432–435). ↩ï¸&
En 2013, je traduisais par «  femmelette  ». ↩ï¸&
MTF signifie male to female (féminin vers masculin) et FTM signifie male to female (masculin vers féminin). ↩ï¸&
«  who is to have control of womenʼs (biologically) distinctive reproductive capability  ». ↩ï¸&
La version originale est plus adéquate : «  [t]o the patriarchy, we all do gender wrong  ». ↩ï¸&
«  the idea that we are just comedy […] «  that weʼre playing dress up in order to make people laugh  ». ↩ï¸&
«   I kind of hate the idea of disclosure, in the sense that it presupposes that there is something to disclose. It reinforces their assumption that there is a secret that is hidden and that I have a responsibility to tell others. And that presupposes that the other person might have some kind of issue or a problem with whatʼs to be disclosed, and that their feelings matter more than mine  ». ↩ï¸&
Ces extraits déclenchent lʼhilarité ou la sidération des hommes trans interviewés dans le documentaire, tel Brian Michael Smith qui observe : «  au lieu dʼavoir une conversation… comme une personne le ferait […] la personne fait genre : ‹ jʼai des seins ! ›  » («  instead of having a conversation… like a person […] itʼs like ‹ Iʼve got tits ›  »). ↩ï¸&
«  Hollywood has taught [us] how to react to trans people  ». ↩ï¸&
Ce film a été très souvent analysé en études filmiques et par la théorie queer ; lʼactrice Laverne Cox rappelle dans Disclosure tout le paratexte médiatique qui a entouré la sortie du film et qui enjoignait, comme pour dʼautres films identifiés comme étant «  à twist final  », à ne pas révéler la fin pour ne pas gâcher le plaisir. On retrouve ici la dialectique entre vérité et mensonge et son activation, sur le plan narratif, par le motif du secret. On notera que ce type de représentation est un véritable piège pour les personnes trans : en les avertissant que la vision de leur corps nu suscitera du dégoà »t et/ou des violences, ces contenus médiatiques peuvent les inciter à ne pas dévoiler leur transidentité… ce qui in fine prolonge lʼassociation des personnes trans avec une forme de dissimulation. The Crying Game (1991) est considéré comme le film qui a proposé ce motif, ensuite repris par dʼautres. Jack Halberstam amène cependant une critique nuancée du film lorsquʼil explique y voir un «  regard transgenre  » ( «  transgender gaze  »â€¯; 2005, 77). Muriel Plana propose également un regard nuancé dans un chapitre de collectif publié en 2014. ↩ï¸&
On appelle tucking la pratique «  qui consiste à faire remonter les deux gonades […] dans la cavité accessible juste sous le pénis  » (selon WikiTrans, [en ligne], https:
La journaliste Samantha Cole décrit quelques-uns de ces dispositifs dans un article pour la revue Vice où elle documente un gender reveal ayant produit un feu de forêt massif en Californie, des feux dʼartifice à Philadelphie (provoquant des brà »lures chez les invité·es) ou encore, en Louisiane, un lancer de pastèque à un alligator qui, en croquant le fruit, révèle un intérieur bleu ou rose. ↩ï¸&
Jʼévoquais en 2014, dans une communication sur la représentation anatomique à lʼécran, comment les lieux où se pratiquaient lʼanatomie à la Renaissance étaient appelés «  théâtres  » et fonctionnaient sur le registre du spectacle, parfois avec lʼaddition de musique. ↩ï¸&
«  The pretense that science is objective, apolitical and value-neutral is profoundly political because it obscures the political role that science and technology play in underwriting the existing distribution of power in society  ». ↩ï¸&
Le terme est identique en anglais. ↩ï¸&
Les chercheureuses appartenant à ce groupe et signant sous cette appellation sont : Athena Beldecos, Sarah Bailey, Scott Gilbert, Karen Hicks Lori Kenschaft, Nancy Niemczyk, Rebecca Rosenberg Stephanie Schaertel, et Andrew Wedel. ↩ï¸&
Nancy Tuana cite Martin Frobenius Ledermuller (1719–1769) pour qui «  le petit animalcule [le spermatozoïde] se développe dans la mère comme la graine dans le champ  » («  the small seminal animalcule develops in the mother just as the seed does in the field  », voir F. J Cole, Early theories of Sexual generation, 1930, 68, cité par Tuana 1989, 167). ↩ï¸&
«  ‹ sperm tales › make a fascinating subgenre of science fiction  ». ↩ï¸&
«  In one image we see the fertilization as a kind of martial gang-rape, the members of the masculine army lying in wait for the passive egg. In another image, the egg is a whore, attracting the soldiers like a magnet, the classical seduction image and rationale for rape […] Yet, once penetrated, the egg becomes the virtuous lady, closing its door to the other suitors. Only then is the egg, because it has fused with a sperm, rescued from dormancy and becomes active  ». ↩ï¸&
On trouve des échos de cet imaginaire dans le matériel électronique également, qui distingue prise mâle/prise femelle, la prise mâle étant généralement pénétrante et la prise femelle pénétrée. ↩ï¸&
On me reprochera peut-être lʼusage de ces qualificatifs pour désigner des humains : il est vrai quʼils peuvent réintroduire lʼidée dʼune sexuation binaire dont découlerait le genre. Je souhaite toutefois éviter tout malentendu qui pourrait surgir de lʼusage des termes «  masculin  » et «  féminin  » dans ce contexte. Je parle bien ici de gamètes, étant admis que les configurations chromosomiques XX et XY qui leur sont typiquement associées ne sont pas les seules et incluent une variance dans la sexuation -— sans parler de lʼidentité de genre. ↩ï¸&
«  produce  » et «  shed  », dans le texte du scientifique Vernon Mountcastle cité par Emily Martin. ↩ï¸&
«  drifts  »â€¯; «  streamlined  ». Je trouve le choix de vocabulaire (de Bruce Alberts et al., dans Molecular Biology of the Cell, 1983, cité par Emily Martin) particulièrement intéressant pour les designers. Le streamline renvoie en effet à un ensemble de choix stylistiques liés à une époque très précise de la conception industrielle, soit les années 1930, après la crise financière de 1929. Cʼest le moment où le design industriel sʼemploie à envelopper ses objets, à en cacher les processus techniques derrière des coques aérodynamiques dont le dessin, sʼil vient de lʼindustrie aéronautique, sʼapplique à des objets du quotidien. Cʼest une esthétique souvent analysée comme réinjectant de la magie dans les objets (en voilant les coulisses de leur fonctionnement), voire connotant un futur meilleur réalisé par la grâce de la technique. Je serai amené à évoquer la question du streamline tout au long de cet écrit. ↩ï¸&
«  strong objectivity  », in Sandra Harding, The «  Racial  » Economy of Science, Bloomington, Indiana University Press, 1993. ↩ï¸&
«  We unmasked the doctrines of objectivity because they threatened our budding sense of collective historical subjectivity and agency and our ʼembodiedʼ accounts of the truth, and we ended-up with one more excuse for not learning any post-Newtonian physics and one more reason to drop the old feminist self-help practices of repairing our own cars. Theyʼre just texts anyway, so let the boys have them back  ». Je souhaite faire observer que le terme «  text  » bénéficie en anglais dʼune forte polysémie : il signifie aussi bien dans le contexte de la phrase «  les textes  » (des contributions écrites) que la nature conceptuelle, référentielle dʼune production linguistique. ↩ï¸&
Elle emploie le terme dʼ«  embodiment  », difficile à restituer complètement à la traduction. ↩ï¸&
Il est entendu que les sciences font aussi usage de techniques pour produire leurs savoirs. Je mʼattarderai moins sur cet aspect, moins central pour mon argumentaire. ↩ï¸&
«  The world neither speaks itself nor disappears in favor of a master decoder  ». ↩ï¸&
«  trans-corporeality  ». ↩ï¸&
Jʼai en effet beaucoup évoqué la manière dont lʼassociation des humains à la Nature et à une nature intrinsèque avait des effets dommageables sur certaines populations qui semblent rompre ce contrat de Nature qui lierait lʼhumain à ses gènes, ses hormones, ses gonades, etc. Mais réifier le concept de Nature pourrait avoir des effets opposés en apparence sur le plan épistémologique, proches sur le plan éthique (cʼest-à -dire que se séparer radicalement de la Nature, du bios, pourrait avoir des effets aussi délétères que le fait de sʼy identifier). Lʼauteur de science-fiction Kim Stanley Robinson évoquait récemment cette tendance à désarticuler lʼhumain et son environnement, pour affirmer : «  La Nature ? Tu es la nature, la nature est toi. Le mot est aussi inutile quʼune frontière, il nʼy a pas dʼhumain en dehors de la Nature, tu nʼas pas de pensées ou de sentiments sans ton corps, et la Terre est ton corps, alors épargne-toi sʼil te plaît cette dichotomie humain/nature, et prends soin de ta santé, cʼest-à -dire, de la santé de ta biosphère  » (« * [N]ature? You are nature, nature is you. Natural is what happens. The word is useless as a divide, there is no Human apart from Nature, you have no thoughts or feelings without your body, and the Earth is your body, so please dispense with that dichotomy of human/nature, and attend to your own health, which is to say your biosphereʼs health*  »). Bien entendu, il ne sʼagit pas pour autant de rebasculer dans un déterminisme biologique. Le propos de Kim Stanley Robinson a trait au mirage de lʼexploration martienne comme solution à lʼeffondrement climatique. On peut sembler loin des questions de sexe et genre, et pourtant, les urgences écologiques ont eu comme effet de bord le retour de discours pro-Nature… avec tout ce qui peut être naturalisé par ce concept (les identités sexuées, certains comportements sexuels, pratiques alimentaires, etc.), dans un paysage idéologique marqué par la question de la continuité de lʼespèce. ↩ï¸&
Jʼemprunte cette idée de la Femme copyrightée à Barbara Métais-Chastanier, chercheuse et dramaturge ainsi quʼà Donna J. Haraway dans Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan _Meets_OncoMouse (1997). Dans cette ouvrage, elle explique que ces glyphes «  marquent la syntaxe des relations naturelles/sociales/techniques figées dans la propriété  » («  mark the syntax of natural / social / technical relationships congealed into property  »â€¯; 7). ↩ï¸&
Et auquel les hommes hétérosexuels se réfèrent ; il sʼagit de «  lʼéternel féminin  », cette figure faussement puissante de la femme envouteuse, enchanteresse, «  tenant  » les hommes sous le joug de sa séduction. La pop culture en fournit de nombreux exemples. Quʼon pense ainsi à Julio Iglesias chantant dans «  Pauvres diables  » (1979) : «  Vous les femmes, vous le charme / Vos sourires nous attirent nous désarment / Vous les anges, adorables / Et nous sommes nous les hommes pauvres diables / Avec des milliers de roses on vous entoure / On vous aime et sans le dire on vous le prouve / On se croit très forts on pense vous connaître / On vous dit toujours, vous répondez peut-être / Vous les femmes, vous mon drame  ». Ou encore dans «  Femmes, je vous aime  » de Julien Clerc (1982) : «  Femmes, je vous aime /Femmes, je vous aime / Je nʼen connais pas de faciles / Je nʼen connais que de fragiles / Et difficiles / Oui, difficiles  ». ↩ï¸&
«  woman: the paradox of a being that once captive and absent in discourse, constantly spoken of but of itself inaudible or inexpressible, displayed as spectacle and unrepresented or unrepresentable, invisible yet constituted a object and the guarantee of vision; a being whose existence and specificity are simultaneously asserted and denied, negated and controlled  ». ↩ï¸&
«  men who have no apparent qualification save that they are not women  ». ↩ï¸&
«  eccentric subject  ». ↩ï¸&
«  feminist consciousness  ». T. De Lauretis sʼappuie particulièrement sur les écrits de Catharine McKinnon pour élaborer son concept. ↩ï¸&
«  the nexus language/subjectivity/consciousness  ». ↩ï¸&
«  reconceptualiz[e] the subject as shifting and multiply organized across variables axes of difference  ». ↩ï¸&
Je traduis imparfaitement, car il me semble que les «  caring courses  » dont elle parle recouvrent les formations Sanitaire et Social qui existent au même moment en France. Jʼai cherché ici lʼéquivalence sociale plus que lʼexactitude linguistique. ↩ï¸&
«  the category ʼwomanʼ […] is always over-layered with other categorizations such as class and race  ». ↩ï¸&
La liste est beaucoup plus longue et il est difficile de la couper sans trahir lʼesprit du texte. Je souhaite noter ici que ce texte possède des vertus pédagogiques notoires. Chaque année, devant mes étudiant·es, je dois expliquer injonctions genrées et scripts de genre. La lecture à haute voix de ce passage me semble plus efficace que bien des élaborations théoriques sur le sujet. Il est à noter que ce texte connaît un jumeau, dédié aux codes sémiotechniques de la masculinité. ↩ï¸&
Même si dans lʼexpérience, les regardeur·ses tendent à écraser sexe et genre lʼun sur lʼautre, comme je lʼai déjà expliqué. Ce que lʼon tient pour un signe du sexe est en général un élément de la performance de genre, ou un caractère sexué grandement requalifié par la culture genrée. ↩ï¸&
«  membership  ». ↩ï¸&
Cette formulation est bien sà »r dépréciative pour les personnes trans, dans la mesure où elle reproduit une hiérarchie dans le genre : les femmes cis seraient «  davantage  » des femmes que les femmes trans, et leur genre serait plus authentique en raison dʼune sexuation de naissance. «  Womyn  » est une orthographe militante de «  woman  » apparue pendant la période du féminisme de seconde vague. Elle est destinée à décentrer lʼhomme («  man  ») de la définition des femmes, en anglais. Rikki Wilchins, activiste, femme trans, raconte dans ses écrits comment elle a participé, avec un groupe de femmes trans et intersexes à fonder Camp Trans, un petit rassemblement en marge du Womynʼs Festival, qui affirmait ironiquement être ouvert aux «  humyn-born humyns  » (Wilchins 1997, 112–113). ↩ï¸&
«  ‹ People who menstruate.› Iʼm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?  ». Cette citation est à la fois dégradante pour les hommes trans et personnes non-binaires qui se voient réassigné·es à la catégorie de «  femmes  », que pour les femmes trans qui en sont exclues en vertu de leur anatomie (réelle ou supposée). Elsa Dorlin évoque ainsi les travaux de Simone de Beauvoir qui critiquent «  lʼinauthenticité  » (2008, 131–153, §9) dont seraient coupables les lesbiennes. Simone de Beauvoir est effectivement ambivalente à ce sujet, comme le montre E. Dorlin. Mais son analyse a le mérite de mettre en relief cet aspect, qui, on le voit, traverse aujourdʼhui les discriminations dont sont victimes les femmes trans, vues comme de «  fausses  » femmes. Dʼailleurs, le gatekeeping des toilettes à lʼendroit des femmes trans est une expérience partagée par les lesbiennes butch (Halberstam 1998, 20–23). ↩ï¸&
«  Savage (that is, nonwhite) men and women were believed to be almost identical, but men and women of the civilized races had evolved proÂnounced sexual differences  ». ↩ï¸&
«  Working-class women were coded as inherently healthy, hardy and robust (whilst, also paradoxically as a source of infection and disease) against the physical frailty of middle-class women  ». Je ne traduis pas ici «  middle class  » par «  classe moyenne  » car il sʼagit dʼun faux-ami ; aux États-Unis, «  middle class  » désigne les classes privilégiées, et non les classes intermédiaires. ↩ï¸&
«  exposed the class-bias and racism of the new womenʼs movement  ». ↩ï¸&
«  a strategic coalition, an umbrella under which we gather in order to make political demands. It might be mobilized in service of those who, given another option, would identify themselves in other ways. In a liberated future, it might not exist at all ↩ï¸&
Le terme «  meuf  » apparaît souvent dans les discours politiques féministes. Il a un peu le même rôle de décalage que lʼappellation «  transpédégouine  » qui tend à repolitiser les luttes des personnes LGBTQIA+ -— en se débarrassant des éventuelles connotations assimilationnistes de lʼacronyme, ainsi que de sa potentielle dépolitisation par le pinkwashing des institutions.  ». ↩ï¸&
Cʼest dʼailleurs le choix quʼa effectué son éditeur, Premier Degré, dans la publication de son ouvrage en 2021. ↩ï¸&
Le titre complet de la pièce est : Up Your Ass, or, From the Cradle to the Boat, or, The Big Suck, or, Up from the Slime. ↩ï¸&
«  femaleness is a universal sex defined by self-negation, against which all politics, even feminist politics, rebels. Put more simply: Everyone is female, and everyone hates it  ». ↩ï¸&
«  any psychic operation in which the self is sacrificed to make room for the desires of another  ». ↩ï¸&
«  an incubator for an alien force  ». ↩ï¸&
«  ontological  »â€¯; «  biological  ». ↩ï¸&
«  while all women are females, not all females are women  ». ↩ï¸&
«  everyone hates it  », en italique dans le texte. ↩ï¸&
«  Gender is not just the misogynistic expectations a female internalizes but also the process of internationalizing itself*, the selfʼs gentle suicide in the name of someone* elseʼs desires, someone elseʼs narcissism  ». ↩ï¸&
«  pussy envy  ». On sera peut-être surpris par le niveau de langue, mais le vocable «  chatte  » a un avantage : il permet de ne pas distinguer la vulve et le vagin (si souvent confondus dans le discours commun), et de les rassembler en un seul appareil, nommé par un seul mot. ↩ï¸&
Je renonce volontairement ici à lʼinclusif : cet être-femelle suggère que lʼhomme devient passive dans le désir, pas seulement passif. ↩ï¸&
Je le traduisais plus tôt (cf. infra., p. **) par «  femmelette  ». Jʼutilise ici cette définition du Dictionnaire bilingue de lʼargot dʼaujourdʼhui (1996). ↩ï¸&
«  This is not just because everyone has an erotic image of themselves as female -— they do -—but the assimilation of any erotic image is, by nature, female  ». ↩ï¸&
«  the feminist assumption that ‹ femininity is artificial ›  »â€¯; «  narcissistic  »â€¯; «  invariably casts nonfeminine women as having ‹ superior knowledge ›  ». ↩ï¸&
«  not just as sex, but as the default sex of the mammalian foetus  ». ↩ï¸&
«  rewind the tape  ». ↩ï¸&
«  testicular estrogen does an excellent job of shaping a female  ». ↩ï¸&
«  Such is the power of the Eve who lurks, forever imprisoned, in even the most full-bearded, bass-voiced, heroically androgenized and macho-minded of males!  ». ↩ï¸&
«  Does he even know what he is saying?  ». ↩ï¸&
«  the embryonic urogenital swellings either remain open to become vaginal labia or fuse to become a scrotum  ». ↩ï¸&
Une telle vision aurait bien des conséquences, notamment sur la manière dont nous concevons la sexualité. Dans la mesure où le sexe (sexuation) est souvent strictement associé aux organes génitaux, et ce, depuis lʼexclamation du médecin à la naissance ou à lʼéchographie («  cʼest une fille !  » ou «  cʼest un garçon !  »), lʼorientation sexuelle est souvent résumée à une préférence pour telle ou telle anatomie. Dans les discours militants queer, on retrouve dʼailleurs des critiques de la «  préférence génitale  ». Julia Serano nous offre une réponse intéressante à cet argument (surtout avancé quand il est question de transidentité) dʼune irréductible différence associée à une préférence individuelle pour un fragment de lʼanatomie : «  Je suis attirée par les gens, pas par des fragments de corps isolés […] Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les parties génitales est quʼelles sont faites de chair, de sang, et de millions de minuscules terminaisons nerveuses en ébullition  » («  I am attracted to people, not to disembodied body parts. […] All that you ever need to know about genitals is that they are made of flesh, blood and millions of tiny, restless nerve endings  », 2016[2007], 279). ↩ï¸&
«  Cʼest OK de vouloir du genre  »â€¯; je laisse la version anglaise dans le texte, sa traduction efficace me semblant difficile. ↩ï¸&
«  The claim that gender is socially constructed has rung hollow for decades not because it isnʼt true, but because it is wildly incomplete. Indeed, it is trivially true that a great number of things are socially constructed, from money to laws to John as of literature. What makes gender gender -— the substance of gender, as it were -—is the fact that it expresses, in every case, the desires of another. Gender has therefore a complimentary relation to sexual orientation: If sexual orientation is basically the social expression of oneʼs own sexuality, then gender is basically a social expression of someone elseʼs sexuality. In the former case, one takes an object; in the latter case, one is an object. From the perspective of gender, then, we are all dumb blondes  ». ↩ï¸&
Muriel Plana nous met en garde dans lʼintroduction de Esthétique queer dans la littérature et des arts contre la fabrication dʼun «  nouveau dogme  » (2015, 17). ↩ï¸&
Le prisme du genre appliqué aux sexualités crée une regrettable partition binaire qui nous pousse à considérer deux homosexualités, ce qui produit, entre autres angles morts, une invisibilisation et une marginalisation de la bisexualité. ↩ï¸&
Sam Kellerman dit en effet ignorer lʼorigine du graphique. La plateforme Tumblr a été déterminante pour la visibilité des personnes trans et les luttes pour leurs droits, au moins jusquʼen 2018, date à laquelle la plateforme a modifié ses conditions dʼutilisation pour bannir les contenus jugés inappropriés. ↩ï¸&
Je remercie Alexia Chandon-Piazza, autrice de la newsletter cailloux*, qui a attiré mon attention sur cet entretien dans son numéro 88. ↩ï¸&
«  package deal  », traduction de Vanina Mozziconacci. ↩ï¸&
«  clear distinctions  ». ↩ï¸&
«  many bodies are gender strange to some degree or another  ». ↩ï¸&
Je précise bien ici que je décris des positions, et je le fais dʼailleurs en forçant un peu le trait, ou en sélectionnant les perceptions les plus exclusives dʼun groupe par lʼautre. ↩ï¸&
«  the continuum model miscalculates the relation between bodily alteration and degree of masculinity  ». ↩ï¸&
Je souhaite mentioner ici lʼexistence du passionnant documentaire Do I Sound Gay? (2014) dans lequel son réalisateur, David Thorpe, entreprend une exégèse de la voix gay, en consultant acteurices, orthophonistes, coachs vocaux, etc. On pense tellement à la représentation comme relevant dʼun régime visuel quʼil est facile dʼoublier la dimension sonore, et ici, vocale, de nos performances corporelles. Les travaux de Carol Gilligan sur la voix des femmes est aussi une piste pour relier agentivité et voix, comprise à la fois comme capacité à se dire et production matérielle de sons. ↩ï¸&
«  the ostensibly least sexual aspects of personal existence  », traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française. ↩ï¸&
Soit Le «  syndrome de la chochotte  » et le développement de lʼhomosexualité, en respectant mes propositions de traductions précédentes. ↩ï¸&
«  effimimania  ». ↩ï¸&
«  conflate feminine gender expression, male homosexuality and MTF transsexuality  ». ↩ï¸&
Il est difficile de résumer en quelques lignes à quoi tient la masculinité des butches. Jack Halberstam en fait un panorama riche et nuancé dans le chapitre «  Lesbian Masculinity: Even Stone Butches Get the Blues  » de son ouvrage Female Masculinity (1998). ↩ï¸&
Jʼeffectue cette précision car il ne faudrait pas que lʼon en déduise que lʼhomosexualité est lʼespace unique de la performance de genre décalée, inattendue ou inversée. ↩ï¸&
Je parle ici des identités caricaturales, mainstream, de «  pédé  » et «  gouine  » qui fonctionnent comme les repoussoirs de lʼhétérosexualité. En réalité, et peut-être en réaction, lʼhomosexualité, la queerness font proliférer les genres ; dʼabord en employant les stigmates comme étendard des luttes (avec le terme «  transpédégouine  », abrégé «  TPG  », aux origines toulousaines), puis en produisant des termes plus adéquats avec les multiples expériences ; en voici quelques-uns : stone butch, lipstick lesbian, tata, tante, sissy, transboi, femboy, softboi, demigirl, demiboy, autant de nuances de genre à leur tour diffractés grâce aux termes ace, grayace, aro… qui désignent lʼattraction sexuelle et le désir amoureux. ↩ï¸&
Je me limite à trois axes (sexe-genre, cis/transidentité et orientation sexuelle) mais il est clair que la race, la classe, la validité (entre autres) contribuent à stratifier encore ce modèle. ↩ï¸&
«  It is a rather amazing fact that, of the very many dimensions along which the genital activity of one person can be differentiated from that of another (dimensions that include preference for certain acts, certain zones or sensations, certain physical types, a certain frequency, certain symbolic investments, certain relations of age or power, a certain species, a certain number of participants, etc. etc. etc.), precisely one, the gender of object choice, emerged from the turn of the century, and has remained, as the dimension denoted by the now ubiquitous category of ‹ sexual orientation ›  » (1990, 8), traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française. ↩ï¸&
«  epistemological privilege of unknowing  » (1990, 5), traduction de Maxime Cervulle pour lʼédition française. ↩ï¸&
Les pansexuel·les définissent généralement leur attirance comme étant indépéndante du genre des personnes désirées. ↩ï¸&
Dans le texte «  Un conte de Noë l  ». ↩ï¸&
Malgré tous mes efforts, je nʼai pu retrouver le tweet original. ↩ï¸&
«  The closet is an impossibly contradictory place, moreover, because when you do come out, itʼs both too soon and too late […] whenever you do come out of the closet, itʼs also already too late , because if you had been honest you would have come out earlier  ». ↩ï¸&
«  Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power  ». Lʼorigine de cette citation a fait lʼobjet dʼune enquête par les contributeurices du site Quote Investigator (2018). ↩ï¸&
La chercheuse Noreen Giffney propose dʼailleurs en 2007 une «  Quare theory  » qui sʼintéresse au queer en contexte irlandais. ↩ï¸&
«  crookedness, state of being bent or hollow  ». ↩ï¸&
«  crooked, awry, bowed, round, circular, hollow  ». ↩ï¸&
«  bow, stoop; incurvation, arch, hollow  ». ↩ï¸&
«  The last thing we should want to do, then, is to devise and distribute a kind of cultural resistance meter, a test to determine how radically transformative , or truly queer, one practice or another really is, so that there can finally be an authoritative knowledge about it and a magisterial discipline of it  ». ↩ï¸&
Jʼen donne un rapide exemple. Agnès Giard écrit : «  Dans la communauté queer, on ne culpabilise pas de porter des talons aiguilles. Ni dʼutiliser des godes en forme de pénis. Tout est jeu de rôle dans ce mouvement décomplexé qui brouille comme à plaisir les catégories, change de genre comme de culotte et prend ses opposants au piège de leurs propres clichés  » (2017). On reconnaît ici une forme de réduction du queer à un jeu libre et amusant autour des codes de genre. Le contexte de la chronique cinématographique courte écrite par la journaliste explique peut-être ce raccourci, mais il nʼen reste pas moins que la définition est réductrice. ↩ï¸&
«  The attempted stabilizing of identity is inherently a disciplinary project […] While conceived as an act of resistance to homophobic oppression, the project of elaborating a gay identity could itself be discredited. For hasnʼt that identity been exclusionary, delineating what is easily recognizable as a white, middle-class, liberal gay identity? […] An intentionally oppositional gay identity, by its very coherence, only repeats the restrictive and immobilizing analyses it set out to resist  » (traduction de Christian Marouby pour lʼédition française chez Odile Jacob). Je remercie la revue Trou Noir dʼavoir attiré mon attention sur ce texte. Jʼai repris leurs coupes qui me semblaient efficaces. ↩ï¸&
«  queerness can never define an identity; it can only ever disturb one  ». Cette citation fait dʼailleurs partie de lʼépigraphe de Fictions Queer de Muriel Plana. Christien Garcia évoque également cette citation (2009). ↩ï¸&
«  The LGBT…acronym fixes individuals into stereotypical groups of gay, lesbian, etcetera; while queer allows for an analysis that is critical and separate from these individuated identities. ↩ï¸&
«  I was also disoriented by the emergence of Queer Studies as an affirmation of ‹ queer identities ›, and that happened in certain places within Europe. People now say, ‹ I am queer › and at the time that queer theory began, I am pretty sure that nearly everyone thought that ‹ queer › should not be an identity, but should name something of the uncapturable or unpredictable trajectory of a sexual life  ». ↩ï¸&
«  I understand that in certain contexts the demand for recognition within institutional and public structures is great, and that one way to achieve that is by establishing an identity. But since a fair amount of queer theory has been directed against the policing of identity, the demand to have one and to show one upon demand, it has been a bit startling to me. But then again, I have to ask myself: why should we not be startled by the directions that a term like ‹ queer › takes? It has travelled far and wide, and who knows what next permutation it will have  ». ↩ï¸&
Ces travaux ont été publiés dans lʼouvrage collectif Angles morts du numérique (dirigé par Yves Citton, Francis Jutand, Marie Lechner, Anthony Masure, Vanessa Nurock & Olivier Lecointe), plus précisément dans la notice «  Real name policies : numérique et effets de vérité  ». La publication collective fait suite au colloque de Cerisy du même nom. ↩ï¸&
Je retiens ici la traduction de «  splitting  » proposée par Benedikte Zitouni dans lʼouvrage collectif Penser avec Donna Haraway (2012). ↩ï¸&
«  One cannot ‹ be › either a cell or a molecule -— or a women, colonized person, laborer, and so on -— if one intends to see and see from these positions critically. ‹ Being › is much more problematic and contingent. ↩ï¸&
«  an identity without an essence  ». ↩ï¸&
«  position  » et «  relationally  ». ↩ï¸&
«  a community grounded in anonymity and held together by an absence of both individuality and leadership  ». ↩ï¸&
«  relational ethic  ». ↩ï¸&
«  represents an absence that is radically negative  ». ↩ï¸&
«  While there may be a reluctance to say what queer ‹ is ›, there are assuredly assumptions circulating about what queer ‹ does ›  ». ↩ï¸&
«  Queer: a word with a history. A word that has been flung like a stone; picked up and hurled at us, a word we can claim for us. Queer: odd, strange, unseemly, disturbed, disturbing. Queer: a feeling, a sick feeling; feeling queer as feeling nausea. When we think of what this word has gathered, we gather around the word. It is a fragile assembly  ». ↩ï¸&
«  dominant strains of queer theory have tended to privilege the avant-garde. At one point in my life as a scholar of queer culture and theory, I thought the point of queer was to be always ahead of actually existing social possibilities. On this model, it seemed that truly queer queers would dissolve forms, disintegrate identities, level taxonomies, scorn the social, and even repudiate politics altogether […] Now I think the point may be to trail behind actually existing social possibilities: to be interested in the tail end of things, willing to be bathed in the fading light of whatever has been declared useless. For while queer antiformalism appeals to me on an intellectual level, I find myself emotionally compelled by the not-quite-queer-enough longing for form that turns us backward to prior moments, forward to embarrassing utopias, sideways to forms of being and belonging that seem, on the face of it, completely banal  ». ↩ï¸&
Il existe des spéculations quant au fait que Jeanne dʼArc ne se soit pas seulement habillée en homme pour des raisons pragmatiques, notamment dans les travaux de Clovis Maillet (Les genres fluides. De Jeanne dʼArc aux saintes trans, 2020). ↩ï¸&
Marsha P. Johnson était une femme trans, noire, étasunienne, qui a participé aux luttes pour la libération des homosexuelles et des personnes trans -— bien que lʼemploi du terme «  trans  » nʼait pas été consacré à lʼépoque. Johnson utilisait davantage le terme «  transvestite  » et il est difficile de savoir, après coup, si elle le faisait par défaut ou si le terme lui convenait. Elle a notamment participé aux émeutes Stonewall qui ont ensuite été commémorés par la Pride ; un documentaire, The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017), lui est consacré et relate son parcours militant jusquʼà son assassinat. ↩ï¸&
Madeleine Pelletier était une femme française anarchiste (1874–1939) et aussi la première femme diplômée de psychiatrie en France. Elle a milité pour lʼavortement et le droit de vote. Elle sʼhabillait en homme sans avoir demandé la permission de travestissement alors nécessaire à la préfecture. ↩ï¸&
Marie-Pierre Pruvot, dite «  Bambi  », est une femme trans française, née en 1935, qui a été meneuse de revue pour plusieurs clubs parisiens. ↩ï¸&
James Barry (ca. 1789–1865) était chirurgien dans lʼarmée britannique. Il a vécu toute sa vie en tant quʼhomme. Son sexe a été «  découvert  » lors de lʼexamen post-moterm de sa dépouille. ↩ï¸&
Kosen Takahashi, illustrateur nippo-américain, écrit à son amant dans une lettre de 1899 quʼil est «  véritablement le plus queer des nippons  » («  the utmost queer nipponese  »). ↩ï¸&
Il existe de nombreux projets militants qui sʼintéressent à cette question. Je souhaite aussi mentionner les travaux des étudiant·es Jonathan Brouillon-Chevalier, Valentine Ambroggi, Alaeddine Maamer (UT2J) et Dylan Fluzin (ENS/Paris Saclay) dont jʼai dirigé les travaux et qui questionnent directement la relation entre queer et archive. ↩ï¸&
«  We have never queer, yet queerness exists for us as an ideality that can be distilled from the past and used to imagine a future  ». ↩ï¸&
Les réactions diverses au sujet de la cérémonie dʼouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 en constituent une énième occurrence. ↩ï¸&
«  Why in the world do we let heteros into queer clubs? Who gives a fuck if they like us because we ‹ really know how to party? ›  » ↩ï¸&
Dans le documentaire Stonewall Uprising (2010), cʼest justement ce mot de «  uprising  », soulèvement, qui est préféré à celui dʼémeutes habituellement associé à Stonewall. ↩ï¸&
«  Being queer is not about a right to privacy; it is about the freedom to be public, to just be who we are  ». ↩ï¸&
«  A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. It is in a constant state of transition. The prohibited and forbidden are its inhahitants. Los atravesados Iive here: the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulato, the half-breed, the half dead; in short, those who cross over, pass over, or go through the confines of the ‹ normal ›  ». ↩ï¸&
I «  made the choice to be queer  »â€¯; a «  path  ». ↩ï¸&
Jʼemprunte ainsi son vocabulaire à Michel Foucault, et le déplace dans un tout autre contexte ; le philosophe écrit que le langage à lʼâge classique «  nʼexiste pas […] [m]ais quʼil fonctionne  » (1966, 93). ↩ï¸&
Littéralement : «  tout va bien à la fête  », sauf que la version originale produit un jeu de mots sur le terme «  fair  » qui signifie «  bon, bien  » mais aussi «  fête  » ou «  foire  ». ↩ï¸&
Je commente également, en général, la manière dont la promotion sociale (marquée par lʼachat de la voiture) est montrée comme étant indissociable de la performance de genre réussie dans le dessin animé. ↩ï¸&
«  ultimate trump card  ». ↩ï¸&
«  agential cuts  ». ↩ï¸&
«  There is no safety in the term ‹ queer ›  ». ↩ï¸&
La non-mixité est un paramètre dʼorganisation de réunions, à lʼorigine plutôt dans des contextes militants. Une non-mixité entre femmes permet par exemple dʼévoquer des sujets qui concernent celles-ci, sans être interrompues par des hommes (violences conjugales, discrimination, sexualité, etc.). Les non-mixités peuvent prendre diverses formes : non-mixité entre personnes racisées, entre femmes racisées, entre personnes trans, etc. Dans certains cas, on parle de non-mixité choisie, par exemple «  sans hommes cis  ». La non-mixité est lʼobjet de nombreux débats et polémiques, les plus conservateurs identifiant cette méthode dʼorganisation comme du «  communautarisme  ». ↩ï¸&
«  The women made small talk in my entryway until Postmates arrived at the door with our dinner on demand  ». ↩ï¸&
On appelle «  plafond de verre  » le phénomène par lequel les femmes ont de moindres évolutions de carrières dans les entreprises, et accèdent encore inégalement aux postes à hautes responsabilités, au sommet de la hiérarchie. Il sʼagit dʼune limite invisible et concrète, puisque les femmes nʼont pas interdiction dʼaccéder à ces postes, mais sʼen trouvent de fait écartées. ↩ï¸&
En mai 2020, lʼAcadémie Française pose quʼil faudrait dire «  la  » COVID, puisque que le «  D  » renvoie à «  disease  », soit «  la maladie  » en français. Néanmoins, il me semble que cet empressement des académiciens à corriger un usage qui ne posait pas problème doit être mis en relation avec leur résistance conservatrice à la féminisation des noms de métiers. Dans un tel contexte, je ne vois aucune urgence à appliquer une règle qui rejoint une vieille habitude consistant à féminiser les noms de fléaux (les ouragans ont pendant longtemps reçu des patronymes uniquement féminins). Je dirai donc «  le COVID  » dans ce texte. ↩ï¸&
«  I use my oven for storage  ». ↩ï¸&
«  Look at all this counter space for take out food  ». ↩ï¸&
«  the problem that has no name  ». ↩ï¸&
«  What kind of a woman was she if she did not feel this mysterious fulfillment waxing the kitchen floor?  » ↩ï¸&
«  Millions of women lived their lives in the image of those pretty pictures of the American suburban housewife, kissing their husbands goodbye in front of the picture window, depositing their stationwagonsful of children at school, and smiling as they ran the new electric waxer over the spotless kitchen floor. They baked their own bread, sewed their own and their childrenʼs clothes, kept their new washing machines and dryers running all day. They changed the sheets on the beds twice a week instead of once, took the rug-hooking class in adult education, and pitied their poor frustrated mothers, who had dreamed of having a career. Their only dream was to be perfect wives and mothers; their highest ambition to have five children and a beautiful house, their only fight to get and keep their husbands  ». ↩ï¸&
Je remercie Fanny Ménassi, étudiante de Licence III Design, Prospective et Sociétés, dʼavoir attiré mon attention sur ces contenus dans ses écrits. ↩ï¸&
Pour la citation complète : «  Will the assembly-line steak triumph […] or will there be a return to spontaneous cooking in the home? As with the fate of rural locker plants, everything depends on the attitude of the consumer  ». ↩ï¸&
Des études récentes offrent un chiffre plutôt constant depuis le début du XXIe siècle de lʼordre de 3 %. Cʼest le cas dʼune étude France Agrimer parue en 2024 : mais il convient de regarder de près leur méthodologie qui exclut «  les salades, les pâtes farcies fraîches, les entrées traiteur […] le traiteur végétal  » ainsi que les «  soupes [et les] sandwiches sous vide  » (2024, 4). ↩ï¸&
Sauf à considérer que les poudres protéinées pour sportif·ves et autres repas de régime constituent des avatars de cette proposition. ↩ï¸&
Issus dʼun groupe religieux protestant (The United Society of Believers in Christʼs Second Appearing), les Shakers se sont constitués en communauté au XVIIIe siècle. Les Shakers prônent lʼautosuffisance et la vie humble, comme le montre leur habitat. «  Honnêteté, utilité et simplicité  » définissent leur rapport au mobilier («  honesty, utility, and simplicity  »â€¯; Vincent 2012). ↩ï¸&
On en trouve les prémices dans les années 1950 chez les architectes Frank Lloyd Wright (dans la Duncan House) et Philip Johnson (dans la Glass House). ↩ï¸&
Les takoyaki sont des beignets de poulpes japonais en forme de sphère, qui requièrent une poêle spécifique pour leur cuisson. ↩ï¸&
«  Why the ‹ Kitchen of the Future › Always Fails Us  ». ↩ï¸&
Eveleth mentionne quʼavant dʼêtre une entreprise dʼagrochimie, Monsanto était spécialisé dans la production de plastiques. ↩ï¸&
Je serai amené à utiliser une seconde fois les apports de cet article, qui sont nombreux, dans la partie consacrée aux robots ménagers et à la place des technologies, notamment numériques, en cuisine ; cf. infra., p. **. ↩ï¸&
«  why can we still not imagine anything more interesting than a woman making dinner alone  »â€¯; la citation apparaît comme une question en introduction du texte original. ↩ï¸&
Elle entend ici les cuisines aux États-Unis ; la typologie de la «  cuisine américaine  » correspond à une nomenclature française. Les états-uniens appellent dʼailleurs de type de cuisine «  french kitchen  » (cuisine française) (Clarisse 2004 161). ↩ï¸&
«  More than ever before, the American kitchen is center stage. With a deluge of television networks, TV shows, magazines, and websites, images of the dream kitchens used by famous chefs, owned by celebrities, and purchased by aspiring homebuyers bombard American viewers  ». ↩ï¸&
Au cinéma et dans les séries télévisées, ainsi quʼà la télévision, un spin-off est un nouveau contenu qui reprend lʼunivers ou une partie de la trame narrative dʼun contenu originel considéré comme le «  canon  ». ↩ï¸&
Ce type de trame narrative appartient à une catégorie plus vaste de contenus que lʼon pourrait identifier comme des récits réformistes, dans lesquels un premier état non souhaité, voire repoussant est transformé par un processus télévisé en état second, accompli et désirable. Cʼest la forme du avant/après qui structure beaucoup dʼémissions de relooking, plutôt destinées à un public féminin. ↩ï¸&
Alice Béja note ainsi : «  dans lʼépreuve de la ‹ fête des voisins ›, on les découvre démunis face à des cuisines non professionnelles, comme sʼils nʼavaient jamais mis les pieds dans la leur  » (2014, 14). ↩ï¸&
Phyllis Nan Sortain «  Primrose  » Pechey, connue sous le nom de Fanny Cradock, était une critique gastronomique anglaise. Elle sʼest produite à la télévision, à la BBC, en tant que chef. Elle reste emblématique de la cuisine dʼaprès-guerre pour les Anglais. ↩ï¸&
La description ici est faite par un homme ; on remarquera que Catherine Langeais y perd son nom de famille, devenant simplement «  Catherine  ». ↩ï¸&
Voir sur la page Wikipédia de «  Top Chef  », [en ligne], https:
«  The ticking clock makes a difference  ». ↩ï¸&
«  motherhood trap  ». ↩ï¸&
«  A complete lack of support for pregnancy and childbirth sends a clear message[…]: This world is not for you  ». ↩ï¸&
«  active employment  », ma traduction. ↩ï¸&
«  because the professional kitchen environment is still comparable to that of a frat house or any sort of brotherhood-inspired society or field  ». ↩ï¸&
Je cite cet article une troisième fois ici, avec prudence toutefois puisquʼil me semble comporter des approximations ; Keith Reader y affirme en effet que la mère Brazier a perdu son fils à la guerre, mais la plupart des articles que jʼai lu sur son compte disent au contraire que Gaston Brazier a repris le restaurant de sa mère en 1968. ↩ï¸&
Les dimensions féminisantes de la pâtisserie impliquent dʼailleurs une adaptation du discours pour les hommes qui souhaitent se réaliser dans ce domaine particulier. Dans le Meilleur Pâtissier, un candidat rugbyman, évoque ainsi son intérêt pour la pâtisserie comme une manière «  dʼexprimer une part de féminité  »â€¯; mais ces connotations féminisantes sont immédiatement tempérées par la réaffirmation de lʼhétérosexualité, lorsque le candidat explique que sa pratique lui permet de «  draguer les gonzesses  » (Toquebiol 2018, 86). Le trouble dans le genre, qui occasionne potentiellement un trouble de lʼorientation sexuelle est immédiatement verrouillé par lʼaffirmation de lʼhétérosexualité. ↩ï¸&
«  [t]his chapter—and really, my entire approach to desserts (and life)—is about demolishing stereotypes and then rebuilding something different and exciting  ». ↩ï¸&
Il y aurait beaucoup à dire sur lʼinvestissement du lit comme lieu de vie, et ses conséquences sur lʼhabitat et le design de celui-ci. On pense bien sà »r aux dispositifs ingénieux de Alexandre le Bienheureux (1968), qui a décidé de ne plus quitter sa couche. Vivre dans son lit évoque également les nécessités de la situation de handicap. Dʼailleurs, P. Preciado repère cette dimension chez H. Hefner (2010, 164). Cependant, elle est aussi revendiquée par des personnes minorisées, en réelle situation de handicap. Lʼautrice et militante Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha parle de lʼobligation de rester au lit en raison dʼune maladie chronique. Plutôt que de désigner cette situation comme relevant de lʼimpuissance, elle pose que son lit est «  son quartier général  » (2018, 182), un lieu dʼoù il est possible de pratiquer une forme dʼagentivité («  my world headquarters  ») . ↩ï¸&
Florencia Fernandez Cardoso le traduit pour sa part par «  cuisine-non-cuisine  » (2018, §12). Elle ne cite pas le travail de P. Preciado dans son analyse. ↩ï¸&
Dans le manoir de Hefner, cʼest toute une esthétique opulente qui est mise en Å“uvre. P. Preciado analyse la manière dont cette demeure organise la disponibilité sexuelle des «  bunnies  » de H. Hefner, tout en multipliant les espaces, séparés par des cloisons mobiles et offrant une variété dʼusages (travailler, se divertir) mais aussi de thèmes (grotte, piscine à lʼambiance de jungle, zoo dʼanimaux sauvages) (Preciado, 2010, 135). Lʼemploi des matériaux luxueux relève dʼune mise en scène de la fortune, mais cʼest aussi toute lʼextravagance thématisée des lieux qui rattache le manoir, plus encore que le penthouse, aux folies anglaises, et autres demeures romantiques puis orientalistes des XVIIIe-XIXe siècle (de Strawberry Hill au château de Neuschwanstein). Par ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont la jungle a été convoquée, recyclée et redéployée dans les intérieurs occidentaux depuis le XIXe siècle. Dans ma thèse, Jʼai ainsi pu analyser la jungle artificielle de la tour Nakatomi dans Die Hard (1988) : fait intéressant, le déclenchement de douches écossaises, et le programme dʼaction alors pris en charge par Bruce Willis permettait à lʼesprit de la guerre du Vietnam de sʼinviter dans ce récit se déroulant aux États-Unis (Pandelakis 2013). Il existe tout un colonialisme de poche qui sʼexprime dans cette appropriation de signifiants «  exotiques  » dans un décor occidental. Tapisseries motif «  jungle  », lampes ananas, peaux de bêtes et palmiers (souvent souffrants dans leurs latitudes dʼadoption) constituent le vocabulaire de base de cet orientalisme encore bien vivant. ↩ï¸&
Là encore, si ce trope peut paraître éculé, on peut penser à certaines de ses formes plus contemporaines. En 2021, le rappeur français Booba en livre un aperçu dans la strophe de sa chanson «  Bonne journée  » : «  Elle mʼa dit shut, jʼfais le ménage, jʼsuis jamais chiante / Ton Uber est déjà dehors, tu tʼes crue dans les années 30  ». Faire le ménage, devenir une housewife soumise nʼest pas un argument valable, et la présence féminisante est prestement écartée (par le dispositif externalisé de la VTC). ↩ï¸&
«  The domestic kitchen becomes a site for old and new ways of doing gender, not in mutually exclusive fashion, but in complex iterations of both  ». ↩ï¸&
«  creative potential  ». ↩ï¸&
Jʼai déjà croisé ce terme de «  dude  » dans mon travail de doctorat, en suivant la piste des figures masculines au cinéma. «  Dude  » se traduit mal par «  mec  » ou «  gars  ». Le terme possède des associations variées, de la figure du cow-boy (comme en témoigne lʼexpression «  dude ranch  ») à celle du dandy apprêté, pour rejoindre ensuite lʼimaginaire du surfeur californien (Pandelakis 2013). ↩ï¸&
«  symbolic inversion  ». ↩ï¸&
«  postmeal activities  ». ↩ï¸&
Je dois ici noter que, dans ma propre expérience, jʼai souvent rencontré des hommes qui avaient particulièrement investi cette tâche du remplissage du lave-vaisselle, ou plus exactement, du rangement final avant la mise en route du dispositif. Je trouve intéressante la manière dont de nombreux hommes se spécialisent dans cette tâche, en lʼinvestissant souvent sur le mode de lʼefficacité scientifique, puisque leur réorganisation vise à maximiser lʼespace utile du lave-vaisselle. ↩ï¸&
«  feminine duty  »â€¯; «  masculine performance  ». ↩ï¸&
«  knowledgeable man  ». ↩ï¸&
«  flamboyant man  ». ↩ï¸&
«  before he ‹ takes over › for his performance  ». ↩ï¸&
«  Dadʼs cooking exists in evident contradistinction to Momʼs on every level: his is festal, hers ferial; his is socially and gastronomically experimental, hers mundane; his is dish-specific and temporally marked, hers diversified and quotidian; his is play, hers is work  ». ↩ï¸&
«  trophy kitchen  ». ↩ï¸&
«  debugging  ». ↩ï¸&
Le youtubeur masculiniste et proche de lʼalt-right Roosh V en est un bon exemple. Dans une vidéo datant de 2016, il proclame son nouvel amour du pain, mais explique bien que cela ne le féminise pas : «  [j]e suis ultra masculin […] Cuisiner et pâtisser sont une chose scientifique  » («  I am ultra masculine […] Cooking and baking are a scientific thing  », ma traduction). La youtubeuse et militante Natalie Wynn ironise sur cette reconversion, mentionnant quʼelle veut bien quʼil se convertisse en boulanger, sʼil laisse les femmes tranquilles. Au mot de «  boulanger  », elle se reprend, remplaçant ironiquement lʼexpression par «  ingénieur en panification  » («  bread engineer  », dans «  Incels  », 2018, Contrapoints, [en ligne]). ↩ï¸&
«  sourdough prophet  ». ↩ï¸&
Dans certains cas, la pratique culinaire masculine est vue comme produisant le genre, mais plus encore le sexe, dans la mesure où la dimension physique de lʼalimentation est vue comme ayant un lien direct avec la masculinité du corps des hommes. Le coach sportif Clark Bartram propose ainsi en ligne une recette de «  Chili pour booster la testostérone  » («  Testosterone-Boosting Chili Recipe  », ma traduction) . Lʼhormone est lue comme produisant directement la masculinité, et une pratique culinaire adaptée est liée à une masculinité biologiquement produite (Hill 2017). ↩ï¸&
Selon le rapport 2020 du NPD Group, [en ligne], https:
Deliveroo est un des acteurs les plus importants sur le marché. Il a été concurrencé par des acteurs disparus depuis (Tok Tok Tok, Take Eat Easy) et de nouveaux concurrents, notamment Uber Eats, un service de lʼentreprise de VTC Uber. Lʼidée que læ chauffeur·se de taxi puisse devenir livreuse
https:
Je remercie les étudiant.e.s de Licence Design, troisième année, promotion 2019–20, qui utilisaient la plateforme et donc la livraison comme «  petit boulot  » leur permettant de payer leurs études. Ce sont leurs retours lors de mes cours magistraux qui mʼont permis de découvrir certains des aspects les plus subtils du fonctionnement de ces applications. ↩ï¸&
Cette observation est motivée par une expérience personnelle. En 2018, dans un restaurant à Toulouse, jʼai assisté à une dispute entre deux livreurs venus chercher la même commande en raison dʼun «  bug  » de lʼapplication. La manière dont ces deux travailleurs précaires se retrouvaient en conflit (finalement résolu, de guerre lasse, entre eux) pour une course à quelques euros, tandis que lʼentreprise, basée fiscalement en Irlande, encaissait les bénéfices véritables de leur travail, mʼa fait forte impression. ↩ï¸&
Dans un article plus récent publié dans la revue Temes de Disseny (2021), jʼévoque la série Years and Years dans laquelle un homme CSP+ devient coursier après avoir été ruiné. Dans cette Angleterre située dans un futur proche, les pédaleur·ses sont appelé·es des «  lifestyle enhancers  » («  amélioreurs de style vie  »). ↩ï¸&
Cette conception de lʼhabitat visant à faire disparaître le domestique possède des échos dans la littérature. Dans À rebours de Joris-Karl Huysmans (1884), le dandy Des Esseintes a fait doubler les pièces de vie de couloirs de service afin de se préserver de la désagréable vue de ses domestiques. Mais cette disparition visuelle nʼest pas assez, car il entend encore les servant·es se mouvoir dans les couloirs, quʼil fait alors tapisser afin dʼéluder encore un peu plus leur présence gênante et nécessaire. ↩ï¸&
«  busy individuals  ». ↩ï¸&
Ce phénomène nʼest bien sà »r pas isolé, et prend place dans un contexte où le travail est très fragmenté. Le contrat «  zéro heure  » en Grande-Bretagne, la flexibilité à lʼemploi amenée par la Loi El-Khomri en France, ou encore le recours accru au temps partiel sont autant de données contextuelles qui peuvent pousser les travailleur·ses à maximiser un emploi du temps déjà très fragmenté, en vue de compléter un revenu souvent insuffisant pour vivre dignement. ↩ï¸&
En 2019, Liz Alderman évoque dans un article publié par le New York Times (republié par le Courrier International) la manière dont des coursier·es Deliveroo ou conducteurices Uber sous-louent leurs comptes à des migrant·es sans-papier qui nʼont pas accès à lʼapplication en raison de leur situation administrative. Cette manière dont les précaires se retrouvent à exploiter plus précaires quʼelleux me semble intrinsèque à la structure même de ces plateformes, qui se désinvestissent du salariat, et donc de la condition des travailleur·es qui fournissent le cÅ“ur du service. ↩ï¸&
Mechanical Turk est un service proposé par Amazon qui permet à des entreprises de rémunérer des micro-tâches à très bas coà »t. Ces tâches (tri dʼimages et de données, complétion de méta-données) sont très répétitives, mais pas encore gérables par des IA, ou alors tout simplement moins coà »teuses à faire réaliser par des humains. Le nom du service fait référence à lʼexpression du «  turc mécanique  » qui désigne un dispositif dʼautomate sachant jouer aux échecs construit par lʼinventeur et auteur Wolfgang von Kempelen au XVIIIe siècle. Ce dispositif apparemment intelligent repose sur une supercherie : un joueur dʼéchecs humains est dissimulé dans le boîtier qui forme le socle de lʼautomate, et cʼest lui qui active les mouvements du pantin. ↩ï¸&
Devenue depuis Just Eat, lʼentreprise se distingue de ses concurrents en employant ses livreur·ses en CDI ; néanmoins, je reste critique à son égard car, malgré de meilleures conditions de travail (sur le plan contractuel sʼentend), lʼentreprise participe tout de même à diffuser lʼimaginaire du «  à la demande  » qui me semble éthiquement dommageable. ↩ï¸&
«  ice cream-stained jammies  ». ↩ï¸&
Il sʼagit en fait dʼune seconde partie de campagne : dans la première partie, le voyageur du temps faisait du sur-place et découvrait quʼil était resté à lʼépoque contemporaine, mais était dʼautant plus choqué, dès lors, dʼy trouver des gens commandant encore à manger -— sommet de ringardise -—par un appel téléphonique. ↩ï¸&
Bien que lʼexpression ne fasse pas expressément référence à la livraison de nourriture, il me semble quʼelle possède un grand intérêt pour les designers, dans la mesure où elle signale un changement de paradigme concernant le temps de loisir. La soirée télévision est une typologie ancienne, mais lʼassociation du «  binge  » (goinfrage) de séries à la nourriture livrée fait lʼobjet de nombreux memes, illustrant le sommet de la détente, voire de lʼabandon, après une semaine difficile. Ce recoupement entre consommation audiovisuelle compulsive et externalisation de la préparation alimentaire est dʼailleurs consacré, dʼune certaine manière, par la manière dont la Ligue 1 de football, en France, est sponsorisée depuis 2020 par Uber Eats. La consommation du match de football est ainsi directement associée à celle de nourriture livrée : le partenariat facilite en tout cas lʼassociation dʼidées, et la rend même évidente. ↩ï¸&
Jérôme Pimot se décrit sur son compte Twitter comme «  Vigie des livreurs de plateformes  » ainsi que «  co-fondateur et porte-parole  » du CLAP 75 (Collectif des Livreurs Autonomes de Plateformes) ; [en ligne], https:
Il est intéressant de noter que la science-fiction dystopique a relativement peu anticipé ce retour des coursier·es. Historiquement, le capitalisme financier sʼest pourtant appuyé sur ces travailleur·ses pour délivrer lʼinformation sur les cotations en bourse (Laumonnier 2013, 39). Ces coursiers qui couraient dans Wall Street pour avertir des changements de cotation ont depuis été remplacé·es par la communication quasi-instantanée des signaux wifi ou radio. La technologie a donc rendu obsolète ce corps, ou plutôt lʼa recyclé dans une autre fonctionnalité. ↩ï¸&
«  most meals currently cooked at home are instead ordered online and delivered from either restaurants or central kitchens  ». ↩ï¸&
Le chercheur Arnaud Widendaele a écrit un chapitre, «   «  Le réfrigérateur : un dispositif de vision  », à paraître dans lʼEncyclopédie des Objects Impossibles, ouvrage collectif dont je coordonne actuellement la publication avec Irène Dunyach et Elise Rigot. ↩ï¸&
Lʼassociation entre consommation de nourriture et de produits audiovisuels tient aussi dʼun trope, celui du glouton rivé devant sa télévision. Il est intéressant que la culture populaire valorise le binge, tout en rejetant dans des représentations grossophobes celles et ceux qui pousseraient la logique dans ses retranchements, sans plus jamais sortir de leur canapé. Le film dʼanimation Wall-E (2018) est célèbre à cet égard : les humains y sont représentés comme des larves hypnotisés par leur écran, et la grosseur de leurs corps est complètement associée à ce laisser-aller. Ceci renforce bien entendu le stéréotype selon lequel les personnes grosses seraient paresseuses et inaptes à lʼactivité physique. ↩ï¸&
«  house of tomorrow  ». ↩ï¸&
On pourrait traduire cette expression par «  maison intelligente  », mais dans la mesure où cette expression anglaise est utilisée comme telle en français, je mʼabstiendrai de la traduire dans les pages qui suivent. ↩ï¸&
«  Products will resemble familiar objects and furniture, with a greater relevance and significance to our home life than the‹ black boxes › of today  ». ↩ï¸&
«  are embodied in objects that are anthropologically meaningful, such as an apron, scales, a glass toaster, etc  ». ↩ï¸&
«  buy-—cook-—eat-—clean  ». ↩ï¸&
Je pense ici aux nombreux «  pitches  » de design, notamment chez les étudiant·es qui proposent de «  réenchanter  » le quotidien, sans quʼon sache très bien à quel moment celui-ci sʼest désenchanté et quelle est dès lors la nécessité de son «  réenchantement  ». ↩ï¸&
«  Recipes contain side links and facts; a cherry tart recipe will tell you the number of cherries on an average tree, and a recipe for Chicken Provençal includes the sights and sounds of a typical French market  ». ↩ï¸&
Voir le compte en ligne du site Internet Live Stats, [en ligne], https:
Je traiterai ainsi dans le chapitre III. D. b de la maison mécanisée, et plus précisément de la vidéo promotionnelle «  A Day Made of Glass  » pensée par lʼentreprise Corning, productrice de verre, fibre de verre et autres matériaux composites. ↩ï¸&
«  to the scale of the kitchen  ». ↩ï¸&
La vidéo était disponible le 17 mars 2021 sur https:
Amazon Fresh est une filiale dʼAmazon dédiée à la livraison de courses alimentaires. Elle propose donc une système de livraison classique par camion, un «  drive  » où les courses sont chargées dans la voiture des client·es et depuis peu, des supermarchés physiques. ↩ï¸&
Cette technologie consiste à détecter la température et à souffler de lʼair froid au besoin ; elle permet dʼassurer que lʼensemble de la boîte réfrigérée est maintenue à une température basse et constante. ↩ï¸&
«  Connected like never before  ». ↩ï¸&
En 2024, le coà »t du modèle dʼentrée de gamme est tombé à 2100€ environ. ↩ï¸&
En français et donc en italique dans le texte original, écrit en anglais. ↩ï¸&
«  collages of moments or snapshots in time pinned to a notice board, Blu-tacked to a wall or decorating fridges, freezers and boilers: fun passport photographs, digital images printed on copier paper, party invitations, ticket stubs, favourite quotes, childrenʼs self-portraits, their handprints, post-cards, fridge-magnet-souvenirs  ». ↩ï¸&
Lʼarrivée sur le marché des réfrigérateurs «  intelligents  » a été préparée de longue date par les fictions populaires au cinéma et à la télévision, notamment dans The Sixth Day (2000) et Total Recall (2012). Plus récemment encore, la série Silicon Valley, dédiée à lʼéconomie des start-ups et ses innovations techniques en Californie, représente un frigo intelligent qui sera tout de même critiqué par ses usagers, avant dʼêtre finalement hacké («  The Patent Troll  », saison 4, épisode 7)—ce qui ouvre une brèche dans lʼidéalisation de ce type dʼinnovations. ↩ï¸&
«  more than a fridge  ». ↩ï¸&
Une réserve peut être formulée quant à ce propos : dans le cas dʼune situation de handicap/mobilité réduite, éventuellement, le fait dʼéconomiser ce geste peut être significatif : mais dans ce cas, bien dʼautres fonctions mériteraient dʼêtre repensées dans le Family Hub (placement des aliments en hauteur, système pour bloquer la porte une fois ouverte, accès pour les personnes en fauteuil, etc.). ↩ï¸&
«  women […] butchered on the kitchen table  ». ↩ï¸&
«  The center of Eveʼs Garden mail-order operations during the first year of the businessʼs existence was the kitchen table in Dell Williamsʼs Midtown Manhattan apartment  ». ↩ï¸&
«  golden handcuffs  ». ↩ï¸&
«  Earth Community  ». ↩ï¸&
«  Radical Homemakers have chosen to stop investing their life energy in any employment that does not honour the four tenets of family, community, social justice and ecological balance  ». ↩ï¸&
«  we begin the process of dismantling the extractive economy and creating in its place a life-serving economy that enables us to meet our needs while thriving in harmony with our earth and spirits  ». ↩ï¸&
«  abandonment of the kitchen  ». ↩ï¸&
«  In the process,the American home was left empty, cared for by a woman whose labors had been de-skilled to the point where her obligation to society was to function as a consumer, buying those services and goods for her family that she and her husband,just two or three generations prior,would have worked together to provide  ». ↩ï¸&
dans lʼordre : «  Renouncing  », «  Reclaiming  », «  Rebuilding  », ma traduction. ↩ï¸&
Lʼingénieure Anne Humbert dédie un petit livre à cette question en 2023 : Tout plaquer : La désertion ne fait pas partie de la solution… mais du problème. Elle y critique les imaginaires du retour aux sources chez des cadres supérieurs qui se piquent dʼécologie, après avoir bénéficié du système en place pendant des années. ↩ï¸&
«  a time when the home was not just a place to sleep at night  ». ↩ï¸&
«  each daily need that we re-learn to provide within our homes and communities, we strengthen our independence from an extractive and parasitic economy  ». ↩ï¸&
«  recreation outside the consumer culture  ». ↩ï¸&
«  husbands and wives  ». ↩ï¸&
«  their economic sustainability will rely very heavily on the success of their marriage  ». ↩ï¸&
«  Not all of the husbands are as adept at housework as the wives, but they still pitch in  ». ↩ï¸&
«  losers  »â€¯; «  burden  »â€¯; «  the ideal of generational independence is a cultural myth reinforced by television  ». ↩ï¸&
«  authentic and raw accounts of motherhood  ». ↩ï¸&
«   the more sanitized and sentimental scripts that prevail in mainstream culture  ». ↩ï¸&
«  time spent with her ‹ little Internet friends ›  ». ↩ï¸&
«  social media expert  ». ↩ï¸&
«  As mothers, however, they continue to lack symbolic power  ». ↩ï¸&
«  fresh noodles have become a new staple for us, because we have a bunch of time and a bunch of flour  ». ↩ï¸&
«  were barely coping with childcare and work during the coronavirus lockdown  ». ↩ï¸&
«  because of the pandemic, my choices have been taken away. I feel like a 1950s housewife  ». ↩ï¸&
Cette formulation fait écho à lʼavantage «  cumulatif  » évoqué par les professeurs de philosophie David Robichaud et Patrick Turmel dans La juste part (2012). Les deux auteurs montrent comment un détail biographique comme le mois de naissance a en réalité des conséquences profondes sur la carrière de joueurs de football américain. ↩ï¸&
«  The men seem to be able to lock themselves away in a study, while the women are working at the kitchen table—and also trying to home-educate  ». ↩ï¸&
La campagne de la NHS nʼest pas la seule communication gouvernementale à avoir provoqué un tollé. En France, une série dʼaffiches prévues pour la Martinique illustre la distanciation sociale en utilisant lʼananas comme unité de mesure. Lʼimage a été critiquée comme une représentation raciste, le recours inutile à ce signifiant pouvant être lu comme condescendant. ↩ï¸&
«  Obligation, it turns out, is the real thief of joy; they wouldnʼt make so many TV commercials featuring women who seem ludicrously happy to be doing laundry if endless compulsory domesticity didnʼt slowly sandpaper away at the soul  ». ↩ï¸&
Lʼhistoire de cette publication est détaillée dans la synthèse des travaux qui accompagne cet inédit. ↩ï¸&
«  We canʼt knit our way to revolution  ». ↩ï¸&
«  classist  »â€¯; «  femmephobic  ». ↩ï¸&
«  femme science  », ma traduction. En anglais, le terme «  femme  » est parfois utilisé pour désigner des femmes très féminines, et dans les milieux militants LGBTQIA+ il est utilisé comme terme parapluie, moins marqué par les féminismes exclusionnaires que le terme «  women  » (parfois écrit «  womyn  » pour désigner des femmes selon une lecture strictement biologique, qui implique que seules les personnes nées avec un vagin sont des femmes). Le terme femme, dans ses usages anglophones, est donc porteur dʼune charge politique spécifique, qui décorèle sexe et genre et offre une compréhension plus large de sujets unis par lʼoppression de genre, rapprochant des personnes sʼidentifiant comme femmes, des personnes assignées femme, des personnes féminines, des personnes «  efféminées  », etc. Cet usage du français rend la traduction difficile et risque, sans adaptation, dʼoccasionner des confusions avec le terme générique de «  femme  ». Aussi, je choisis de traduire «  femme  » par «  fem  », puisque cʼest lʼusage le plus courant que jʼai pu entendre autour de moi. ll me semble, intuitivement, que les deux mots ont des usages proches dans les contextes respectivement anglophones et francophones. ↩ï¸&
«  femme skills, technologies, and intelligence  ». ↩ï¸&
«  All the homemade ways we make it  ». ↩ï¸&
«  urban kitchens  ». ↩ï¸&
«  [u]nderstanding their work as voluntary has assured stronger social bonds, but at the same time has perpetuated womensʼ lack of access to the economy  ». ↩ï¸&
Je pense au Master DIS (Design Innovation Société) de lʼUniversité de Nîmes ; la Licence Design, Prospective et Société de lʼuniversité Toulouse -— Jean Jaurès, dans laquelle jʼinterviens, sʼinscrit aussi dans ce champ et dans cette évolution de la discipline. ↩ï¸&
[en ligne], http:
«  green industrial revolution  ». ↩ï¸&
«  Householders become their own designers, processors and assemblers, and their houses mini offices. We get a glimpse of what this could mean for environmental services through technologies which offer the prospect of each house becoming its own power station (through mini combined heat and power boilers and micro renewables), and each car its own energy store (through electric cars)  ». ↩ï¸&
«  feminist cities  ». ↩ï¸&
«  HUSBAND-POWER  ». ↩ï¸&
«  Should it be in the residential complex (whether a single apartment house or a suburban block), in the neighborhood, in the factory, or in the city or the nation?  » ↩ï¸&
«  national standards versus local control, […] general adult participation versus efficient specialization, […] individual choice versus social responsibility  ». ↩ï¸&
«  the ordinary Utopian would no more think of a special private kitchen for his dinners than he would think of a private flour mill or dairy farm  ». ↩ï¸&
«  Just think of the absurdity of one hundred housekeepers, every Saturday morning, striving to enlighten one hundred girls in the process of making pies for one hundred little ovens!  » ↩ï¸&
«  mass-feeding facilit[y]  ». ↩ï¸&
The feminist «  wants to climb high above the harsh labors of the house, on the shoulders of the women whose hard necessity compels them to be paid servants  ». ↩ï¸&
«  Gone were some affluent women ʼs visions of cooperative kitchens delivering elegant , seven-course dinners and cooperative laundries presenting rows of snowy ruffles on dress shirts, perfectly ironed. A sufficient supply of hot soup and enough coal to last the week were more to the point  ». ↩ï¸&
«  n*gro problem  », jʼajoute cette étoile. ↩ï¸&
«  the final corruption of home economics  ». ↩ï¸&
«  the combination of Capital, and the Division and Organization of Labor  ». ↩ï¸&
«  When a new generation of feminists appeared, most of them the children of those families, they had one powerful demand to make, an end to the sexual division of domestic labor. But the new feminists, who tried to share child care and housework with men, did not understand the history behind the domestic environments they inhabited  ». ↩ï¸&
«  Coming in out of the D.C. winter storm felt like walking into an embrace. The roaring fireplace, the low-beamed wooden room filled with Black and Brown women, a table laden with delicious foods so obviously cooked with love. There was sweet potato pie, rice and red beans, black beans and rice, pigeon peas and rice, beans and pimentos, spaghetti with Swedish meatballs, codfish and ackee, spinach noodles with clam sauce, five-bean salad, fish salad, and other salads of different combinations […] The whole spread reflected a dreamlike fullness of women sharing color and food and warmth in light—Zami come true. It filled me with pleasure that such a space could finally come to pass on an icy Tuesday evening in Washington D.C., and I said so  ». ↩ï¸&
«  kitchen table reflexivity  ». ↩ï¸&
«  The kitchen is not simply a space of labor, where food is prepared and consumed, but rather is a space that creates and reproduces a complex set of relations among individuals  ». ↩ï¸&
«  where societal power structures are magically erased  ». ↩ï¸&
Les années Jim Crow renvoient à la période pendant laquelle furent actives les lois Jim Crow aux États-Unis. Ce nom de Jim Crow renvoie au personnage du même nom, un Noir caricaturé de manière raciste dans les minstrel shows, souvent en utilisant le blackface (fait pour un·e blanc·he de se grimer en personne noire) dans les représentations. Après lʼémancipation de lʼesclavage, et donc une période favorable à lʼobtention de droits, un ensemble de lois particulièrement dures ont marqué un recul dans cette progression, en établissant une politique ségragationniste. La période est en général considérée comme débutant en 1896, date du procès Plessy vs. Ferguson, qui affirme le fameux «  séparé mais égal  » («  separate but equal  »), principe qui aura des conséquences funestes pour les droits des Noir·es aux États-Unis. ↩ï¸&
«  In my grandmotherʼs kitchen, soap was made, butter was churned, animals were skinned, crops were canned. Meat hung from the hooks in the dark pantry and potatoes were stored in baskets. Growing up, this dark place held the fruits of hard work and positive labor. It was the symbol of self-determination and survival  ». ↩ï¸&
«  feel no sense of place  ». Il me faut relever ici que la traduction rend mal compte de la force de ce sens du lieu, en raison de la polysémie des formes au singulier en anglais. Ce sens du lieu doit donc se comprendre en même temps, tout à la fois, comme sens des lieux. ↩ï¸&
«  a sense of crisis, of impending doom  ». ↩ï¸&
a «  sense of being wedded to a place  ». ↩ï¸&
«  black self-recovery  ». ↩ï¸&
«  It was an experience of being made into a stranger, the one who is recognised as out of place, as the one who does not belong, whose proximity is registered as crime or threat  ». ↩ï¸&
«  Do you work there?  » Jʼai connu lʼexistence de ce texte par Ellen Kohl & Priscilla McCutcheon. ↩ï¸&
«  a continuation of living space  ». ↩ï¸&
«  liminal space where they can stretch the limits of desire and the imagination  ». ↩ï¸&
«  the physical and psychological act of African survival  ». ↩ï¸&
«  the rainforest as a kitchen  ». ↩ï¸&
«  heterodoxy  ». ↩ï¸&
«  the capacity to imagine and operate simultaneously within, against, and outside the nation-state  ». ↩ï¸&
«  connection between black self-recovery and ecology  ». ↩ï¸&
«  forensic  ». ↩ï¸&
«  asymmetric pricing  ». ↩ï¸&
«  a tortilla is not a blank slate  ». ↩ï¸&
«  The mainstream cultureʼs view of women posits a choice between either total immersion in the kitchen -— be it the crowded, seemingly warmer one of the working class or immigrant culture or the empty, sex-segregated, shiny white one of the middle class -— or total rejection of the kitchen  ». ↩ï¸&
«  September 10, 1975
There once was a picturetaking dyke who was lovers with a pot-making dyke. They lived with a healing dyke and a not-lovedenough dyke, and a far-seeing, kitchen-cleaning dyke. They taught
each other everything they knew and worked a lot at what to do and why. I became lovers with the picture-taking dyke, the moving slowly dyke, the kiss like flowers woman.
– the music playing dyke  » ↩ï¸&
«  Ménage, ménage, ménage,
Ménage, ménage, ménage,
[…] Ménage, ménage, ménage,
Je suis si fatiguée par lʼaspiro,
Jʼai besoin dʼun homme pour mʼaider au plus tôt
Pas besoin dʼun homme qui me propose du cul
Besoin dʼun homme pour emménager au-dessus
Pas besoin dʼun homme pour me maltraiter
Besoin dʼun homme pour les corvées
Quelquʼun dʼenvoyé par le ciel
Quelquʼun qui mʼaide pour le loyer
Quelquʼun pour partager mes envies et mes rêves
Quelquʼun pour mʼaider à faire la vaisselle  » ↩ï¸&
«  Unstereotype Avenue  »â€¯; «  Violence-Free Alley  »â€¯; «  Equal Pay Street  »â€¯; «  Toxic Masculinity Recycling Plant  »â€¯; «  Inclusion square  »â€¯; «  Climate Action Street  »â€¯; «  Equal Representation Avenue  »â€¯; «  Education Boulevard  »â€¯;  «  Freedom Avenue  ». ↩ï¸&
Il faudrait nuancer ce fait : bricoler, fabriquer un placard ou peindre une pièce de vie constitue déjà une forme de conception. Mais je ne parle pas ici de ces interventions après la construction, mais bien de la conceptualisation, sur plan, de lʼespace à vivre. ↩ï¸&
Si la presse sʼenthousiasme en général vis-à -vis de lʼouvrage, le positionnement de son auteur peut nous questionner. Il affirme ainsi que «  [t]outes les recettes – sauf celles de La Cuisine vagabonde (Fayard, 1999) – ont été créées pour Jacqueline [son épouse, ndla] qui en fut le juge  ». Désignée plus loin dans lʼarticle du Monde qui restitue ces propos comme une «  muse  », Jacqueline nʼest pas co-autrice de ces ouvrages. Si les recettes ont été créées par elle, pourquoi la désigner comme juge, et non comme autrice ? ↩ï¸&
Le titre complet de cet ouvrage est Treatise on Domestic Economy, For the Use of Young Ladies at Home and at School. ↩ï¸&
Le titre complet de cet ouvrage est American Womanʼs Home: Or, Principles Of Domestic Science. ↩ï¸&
Harriet Beecher Stowe est célèbre pour avoir écrit Uncle Tomʼs Cabin (La Case de lʼoncle Tom) en 1852. ↩ï¸&
«  One must not confuse organization of the work process with the use of mechanized tools  ». ↩ï¸&
Je remercie lʼauteur Fosco Lucarelli grâce à qui jʼai découvert cette personnalité dans son article «  The Architecture of Cooking. Illustrations from: Urbain Dubois, La Cuisine Artistique, 1872  » publié en 2018 par la revue SOCKS. Lʼouvrage est disponible sur Gallica. ↩ï¸&
«  hodgepodge of standalone pieces of furniture  ». ↩ï¸&
«  The history of the kitchen as we know it today is largely hound up with the growing concentration of its heat sources  ». ↩ï¸&
George Orwell a décrit cette séparation de classe lorsquʼil raconte son travail dans un hôtel parisien à la fin des années 1920 dans Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) : «  Là , la clientèle trônait dans toute sa splendeur -—nappes immaculées, bouquets de fleurs, miroirs, corniches dorées et angelots peints. Et nous, à quelques mètres de là seulement, baignant dans une crasse repoussante. Car il sʼagissait vraiment dʼune crasse repoussante. […] La pièce était envahie par une écÅ“urante odeur de boustifaille et de sueur. Partout dans les placards, derrière les piles de vaisselle, se trouvait dissimulées des réserves dʼaliments, fruits des misérables larcins des garçons […] Mais les clients ne savaient rien de tout cela. Il y avait, à la porte de la salle à manger, un tapis-brosse et un miroir devant lequel les garçons finissaient de se pommader afin de présenter à la clientèle lʼimage même de la propreté  » (92). Traduction de Michel Pétris pour lʼédition 10/18. ↩ï¸&
Le titre complet du traité est The gentlemanʼs house; or, How to plan English residences, from the parsonage to the palace; with tables of accommodation and cost, and a series of selected plans. ↩ï¸&
«  In its more ordinary sense the comfortableness of a house indicates exemption from all such evils as draughts, smoky chimneys, kitchen smells, damp, vermin, noise, and dust; summer sultriness and winter cold ; dark comers, blind passages and musty rooms  ». ↩ï¸&
Les épidémies de la fin du XXe siècle ont nourri la fabrication de mythes parfois personnifiés. Par exemple typhoid Mary a été le surnom donné à Mary Mallon, une domestique dʼorigine irlandaise qui a été la première porteuse saine de la typhoïde aux États-Unis -—ce qui a entraîné la contamination dʼautres personnes et nourri sa notoriété (Leavitt 1997). ↩ï¸&
Il faut noter que cette association de la cuisine à un espace caché, non seulement souillé mais aussi potentiellement réceptacle de secrets et de tours de main, sʼest maintenue dans le langage jusquʼà notre époque. Il nʼest ainsi pas rare de voir le mot «  cuisine  » utilisé pour désigner un espace de travail habituellement dérobé aux regards. ↩ï¸&
the «  servant problem  ». ↩ï¸&
«  feudal  ». ↩ï¸&
Cet essai a été lu en public devant la Womenʼs Service League. ↩ï¸&
«  phantom  ». ↩ï¸&
«  She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was utterly unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed herself daily. If there was chicken, she took the leg; if there was a draught she sat in it-—in short she was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of others. Above all-—I need not say it---—she was pure. Her purity was supposed to be her chief beauty-—her blushes, her great grace. In those days-—the last of Queen Victoria-—every house had its Angel  » (2008[1931], 393–94), traduction de Catherine Bernard pour lʼédition française. ↩ï¸&
Selon le Harriet Beecher Stowe Center à Hartford, Connecticut, [en ligne], https:
«  The Author of all grace and beauty  ». ↩ï¸&
«  alcoholic drinks, tea, coffee, opium mixtures  ». ↩ï¸&
«  domestic exercise  ». ↩ï¸&
«  […] the mother, who will hire domestics, to take away this and other domestic employments, which would secure to her daughters, health, grace, beauty, and domestic virtues, and the young ladies, who consent to be deprived of these advantages, will probably live to mourn over the languor, discouragement, pain, and sorrow, which will come with ill health, as the almost inevitable result  ». ↩ï¸&
«  ignorant domestics  ». ↩ï¸&
«  an image of the kitchen as the captainʼs cockpit of the domestic ship  ». ↩ï¸&
«  they must be made by patience and training  ». Mise en exergue de lʼautrice. ↩ï¸&
«  self-sacrifice  »â€¯; «  domestic isolation  ». ↩ï¸&
«  vigorous man  »â€¯; «  feebler sex  ». ↩ï¸&
«  frivolous  »â€¯; «  useless  ». ↩ï¸&
«  Surely, it is a pernicious and mistaken idea, that the duties, which tax a womanʼs mind, are petty, trivial, or unworthy of the highest grade of intellect and moral worth. Instead of allowing this feeling, every woman should imbibe, from early youth, the impression, that she is training for the discharge of the most important, the most difficult, and the most sacred and interesting duties that can possibly employ the highest intellect  ». ↩ï¸&
«  A woman can resolve, that, whatever happens, she will not speak, till she can do it in a calm and gentle manner. Perfect silence is a safe resort, when such control cannot be attained, as enables a person to speak calmly; and this determination, persevered in, will eventually be crowned with success  ». Mise en exergue de lʼautrice. ↩ï¸&
«  In mind and manners how discreet!
How artless in her very art;
How candid in discourse, how sweet
The concord of her lips and heart  ». ↩ï¸&
«  If she be made a natural orator, like Miss Dickinson, or an astronomer, like Mrs. Somerville, or a singer, like Grisi, let not the technical rules of womanhood be thrown in the way of her free use of her powers  ». ↩ï¸&
«  […] there has been a great deal of crude, disagreeable talk in these conventions, and too great tendency of the age to make the education of woman anti-domestic  ». ↩ï¸&
Lʼhomme en question est Melvil Dewey, qui nʼest autre que lʼinventeur du système de classification qui porte son nom, et qui sert encore aujourdʼhui de fondement à lʼorganisation des fonds des bibliothèques (Hayes 2010, 74). ↩ï¸&
«  Efficiency and the New Housekeeping  ». ↩ï¸&
«  efficiency  ». ↩ï¸&
«  There is no older saying than « a womanʼs work is never done ». If the principles of efficiency can be successfully carried out in every kind of shop, factory, and business, why couldnÃt they be carried out equally well in the home?  ». ↩ï¸&
«  […] in a factory the workers do just one thing, like sewing shoes, or cutting envelopes, and it is easy to standardize one set of operations. But in a home there are dozens, yes, hundreds, of tasks requiring totally different knowledge and movements. There is ironing, dusting, cooking, sewing, baking, and care of children. No two tasks are alike  ». ↩ï¸&
«  Doctors have clinics, farmers their experiment stations, and chemists their laboratories, and it seemed quite natural that women should have some place especially devoted to the working out of home problems  ». ↩ï¸&
«  Efficiency Kitchen  ». ↩ï¸&
«  moderate income  ». ↩ï¸&
«  the best artificial servant of modern times  ». ↩ï¸&
«  electrical flavor  ». ↩ï¸&
On peut observer que ce motif est récurrent dans lʼadoption de nouvelles technologies associées à la cuisine. Pour ma part, jʼai toujours trouvé que les aliments préparés au micro-ondes ou dans des moules en silicone nʼavaient pas la même texture que ceux cuits au four ou dans un plat en tôle dʼacier. La question du transfert de qualités de la «  flamme  » (ou de son substitut) nʼest peut-être pas aussi absurde que ces observations un peu datées peuvent nous le faire penser. ↩ï¸&
«  long view  ». ↩ï¸&
Les graphes qui illustrent les mouvements possèdent une proximité intéressante avec des productions dʼautres champs, telle la notation du mouvement en danse mise au point par Rudolf Laban dans les années 1920–30. ↩ï¸&
«  more accurately standardize any household tasks  ». ↩ï¸&
«  group  »â€¯; «  direction  ». ↩ï¸&
«  The same idea that is nowadays applied to factory layout -—the moving of the work in one direction, process after process, with as little waste motion as possible -—was applied to the layout of the Efficiency Kitchen  ». ↩ï¸&
«  The Twelve Principles of Efficiency  ». ↩ï¸&
«   1. Ideals.
2. Common Sense.
3. Competent Counsel.
4. Standardized Operations.
5. Standardized Conditions.
6. Standard Practice.
7. Despatching.
8. Scheduling.
9. Reliable Records.
10. Discipline.
11. Fair Deal.
12. Efficiency Reward  ». ↩ï¸&
«  the final corruption of home economics  » . ↩ï¸&
«  [t]he Sentinel Automatic Cook Stove  ». ↩ï¸&
«  Although this was a logical impossibility, since scientific management required the specialization and division of labor, and the essence of private housework was its isolated, unspecialized character, nevertheless both Frederick and Gilbreth created surrealistic sets of procedures whereby the housewife « managed » her own labors « scientifically » serving as executive and worker simultaneously  ». ↩ï¸&
«  clearing house  ». ↩ï¸&
Voir la définition proposée par le Centre National des Ressources Lexicogaphiques, [en ligne], https:
«  Some of the equipment is fairly expensive, but I am testing it to see if the labour saved justifies the expense  ». ↩ï¸&
«  step-savers  »â€¯; «  fuel-savers  »â€¯; «  time-savers  »â€¯; «  labour-savers  ». ↩ï¸&
«  Practical Points in Selling Equipment to Mrs. Consumer  »â€¯; «  Feminine Instincts and Buying Psychology  ». ↩ï¸&
«  spokesman for Mrs. Consumer  ». ↩ï¸&
«  two home economists […] became the key ideologues of the antifeminist, pro-consumption, suburban home  ». ↩ï¸&
Danielle Dreilinger insiste sur la particularité du couple Gilbreth dans son étude de lʼéconomie domestique, et souligne à quel point il est alors inhabituel pour un ingénieur de sʼassocier officiellement à son épouse. En outre, elle écrit que Frank avait «  décrété  » («  decreed  ») que Lillian devait avoir un doctorat afin dʼêtre respectée (2021, 70). ↩ï¸&
«  The form of the movement remains invisible and cannot be investigated  ». ↩ï¸&
On veillera à ne pas confondre ce dispositif avec le cyclographe, invention de lʼarchitecte et mathématicien Peter Nicholson qui permet de tracer des cercles de grande taille, cf. Page Wikipédia du «  Cyclograph  », [ en ligne ], https:
Pour cette raison, je suis surpris de lire chez Alexandra Midal que «  lʼorigine féministe de lʼhistoire du design posée par Giedion nʼa pas survécu à lʼanalyse patriarcale des théoriciens du mouvement Moderne  » (2012, 118). Lorsquʼil parle du Cyclogramme, seul Frank est nommé dans le corps principal du texte, et Lillian nʼapparaît quʼen note de bas de page, comme co-autrice de Motion Study for the Handicapped publié en 1920. La question, au fond, est peut-être de savoir dans quelle mesure on peut déclarer que le propos dʼun·e auteurice est féministe. Giedion ne sʼen réclame pas, et son inclusion des femmes reste minimale. ↩ï¸&
«  more credible and rigorous  ». ↩ï¸&
«  [He is] met at the end of the street, […] finds his white trousers and shoes and négligée shirt […] ready, his bowl of apples and Scientific American by his own big chair  ». ↩ï¸&
«  circular routing  ». ↩ï¸&
«  work curve  ». ↩ï¸&
«  this flexible approach was at odds with commercial manufacturersʼ drive to standardise  ». ↩ï¸&
«  flexible design  ». ↩ï¸&
Edna Yost est une autrice et essayiste spécialiste des sciences qui a notamment écrit lʼouvrage American Women of Science en 1943. ↩ï¸&
«  the one best way  ». ↩ï¸&
«  a smug super woman who tried to Taylorize every work process in the home  ». ↩ï¸&
«  superintendent  ». ↩ï¸&
Il est désigné comme «  brother  », «  frère  », et je le genre donc au masculin. ↩ï¸&
«  train an older boy or girl, or perhaps both, to take over the job when he is away  ». ↩ï¸&
«  An armchair with a book near by and a reading lamp properly adjusted means much more than a chair, a book and a light, each selected independently, perhaps for its color and shape alone and placed with no special relation to one another  ». ↩ï¸&
«  If those who supply the soap, the water, the sinks, the dishes, etc.,which are all factors in dishwashing, could watch the operation just once, or better still, perform it themselves, we would have much better equipment within a short time  ». ↩ï¸&
La question est bien sà »r délicate, puisquʼelle implique des catégories auxquelles ces femmes ne pouvaient sʼidentifier, soit que cela ait été impossible en raison des mÅ“urs de leur époque, soit que ces catégories soient tout bonnement anachroniques. Nommer cette absence me semble tout de même important, et permet de regarder autrement des figures trop vites considérées comme blanches, hétérosexuelles, etc. Le travail de lʼhistorien Clovis Maillet me semble aller dans ce sens. ↩ï¸&
Lʼarchitecte et historienne Marie-Jeanne Dumont nous rappelle quʼelle sʼest arrêtée au seuil du concours de lʼagrégation, auxquelles les femmes nʼavaient alors pas le droit de participer (Dumont 2012, 56). ↩ï¸&
Cette revue émane du Salon des Arts Ménagers et André Jules-Louis Breton en est le directeur de publication (Bouillon & Bula 2022, 18). ↩ï¸&
Les illustrations traduisent la silhouette féminine en vogue depuis les années 20 : une femme grande, élancée, sans courbes, poitrine ou fesses proéminentes, diffusé par les illustrations de Gordon Conway et le travail en design de mode de Coco Chanel dans les années 1920 ou Paul Poiret dès les années 1910 (Radke 2022, 94–110). ↩ï¸&
Où lʼon peut lire le célèbre «  Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !  » (Marx 1895, 36). ↩ï¸&
Je pense aux travaux de master de la docteure en design Manon Ménard (2017), ainsi quʼà la thèse de la docteure en design Karen Polesello (2021). ↩ï¸&
Je reviendrai sur cette question du temps libre. Sujet de nombreux posts de blogs, stories Instagram et autres TikTok, le temps de loisirs des femmes est aussi le sujet de certains livres situés entre essai et développement personnel, tel le Overwhelmed: Work, Love, and Play When No One Has the Time de Brigid Schulte, paru en 2014. ↩ï¸&
Lorsque le projet commence, elle est Margarete Lihotzky ; elle se marie en 1927 (Webster 2021–22, 39). ↩ï¸&
«  the mother of all fitted kitchens  ». ↩ï¸&
Giedion mentionne aussi dʼautres cuisines professionnelles comme ayant inspiré les aménagements privés. Par exemple, il relie la cuisine de Frederick aux cuisines dʼhôtel (Giedion 1948, 612). ↩ï¸&
«  a kitchen in the form of a laboratory, with specific types of work surfaces, drawers and cabinets for specific functions and utensils  ». ↩ï¸&
«  not only help to smooth work processes in the kitchen further, but would also reflect the new efficiency visually  ». ↩ï¸&
Deyan Sudjic parle quant à lui dʼau moins 8000 exemplaires (2014, 262). ↩ï¸&
«  Despite Mayʼs drive for standardization, there was in effect no such thing as the Frankfurt kitchen. Size and layout depended on location and building phase, multiple adaptations and adjustments were introduced, dispositions and colors varied greatly, and display kitchens differed from working equivalents  ». ↩ï¸&
Je ne souhaite pas ici opposer fausseté de lʼimage contre «  vraie  » cuisine. Cela irait à lʼencontre de tout mon propos sur les esthétiques de vérité dans le premier chapitre. Il sʼagit plutôt de sʼaccorder sur la manière dont un projet, ici une cuisine, peut être réduit à une image unique dont lʼattrait visuel participe à réduire la multidimensionnalité, au profit dʼune aura «  mythique  ». Walter Benjamin lʼa bien sà »r théorisé en 1935. ↩ï¸&
«  Bolshevist hodgepodges  ». ↩ï¸&
Plus tard, Margarete Schütte-Lihotzky est tout de même arrêtée par la Gestapo et emprisonnée pendant quatre ans dans un camp de travail. ↩ï¸&
«  kitchen ‹ by women for women ›  ». ↩ï¸&
«  spokesperson  ». ↩ï¸&
Je participe au problème en choisissant dʼévoquer à nouveau Margarete Schütte-Lihotzky, qui me semble tout de même incontournable -—mais pas exactement, on lʼa vu, pour les raisons qui sont habituellement invoquées. Il faudrait parler dʼautres figures du XXe siècle qui ont contribué à établir un pont entre science ménagère et architecture de la cuisine. ↩ï¸&
Une étudiante du cours Queer[ed] Design mʼa mentionné lʼexistance de cette autrice, mais jʼai malheureusement perdu son nom. ↩ï¸&
«  farm woman  ». ↩ï¸&
Cʼest une des lignes du cours Queer[ed] Design que je donne depuis 2016. Jʼai à cÅ“ur de contourner la question «  est-ce que untel ou unetel est féministe ?  » (question trop souvent ressassée par les médias) pour demander «  en quoi sont-iels féministes ?  ». ↩ï¸&
«  It is not necessary for feminists to endorse the Victorian concept of womanʼs sphere, but rather to accept womanʼs sphere as an essential, historical, material base  ». ↩ï¸&
«  straight out of some Foucauldian bio-political farce  ». ↩ï¸&
Depuis que jʼai commencé à enseigner le design dans le supérieur en 2010, cʼest un fait qui ne sʼest jamais démenti. Le ratio femme/homme est de manière écrasante «  en faveur  » des femmes, comme dans le reste des disciplines universitaires par ailleurs. Si des variations existent entres selon les domaines et disciplines, les études chiffrées offrent le tableau suivant : en 2022, 85% des candidates obtiennent le bac, contre 75% des candidats. Pourtant, elles sʼinscrivent moins en filières sélectives et, tandis quʼelles représentent «  59 % des inscrits en licence et 61 % en master, elles ne sont que 49 % en doctorat selon lʼétat de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation en France n°17 (2023). ↩ï¸&
En écrivant ce texte, je fais face aux multiples soulignements des adjectifs que jʼaccorde au féminin quand je parle des architectes femmes. Ce détail constitue un symptôme parmi tant dʼautres de la manière dont nous pensons le sujet «  architecte  » au masculin par défaut. ↩ï¸&
Lʼhistorienne du design Cheryl Buckley, que jʼévoquerai ci-après, remarque au sujet du couple Delaunay que Sonia est louée pour son «  instinct  » de la couleur, tandis quʼon a reconnu à Robert la formation dʼune théorie de la couleur (1986, 5). ↩ï¸&
Ce type dʼanalyse, en individualisant les attitudes sexistes des hommes, peut parfois mener à masquer la dimension systémique de la mise à lʼécart des femmes dans les domaines du savoir et des arts. Cela ne revient nullement à excuser les personnes coupables de comportements délétères ou dʼabus. ↩ï¸&
«  Room at the Top? Sexism and the Star System in Architecture  », traduction de Valéry Didelon et Françoise Fromonot. ↩ï¸&
Lʼarchitecte et autrice Erandi de Silva annote en ce sens le texte accessible sur le site Women Writing Architecture, [en ligne], https:
Learning from Las Vegas ; le livre est co-signé par lʼarchitecte, urbaniste et théoricien Steven Izenour. ↩ï¸&
On parle de «  micro-agressions  » (à la suite du psychiatre étasunien Chester M. Pierce) pour désigner les actes de discrimination discrets qui semblent trop ténus pour rejoindre les catégories habituelles des violences verbales (insultes, plaisanteries vexantes) ou physiques (agression, viol). Dire «  micro  » ne revient pas minimiser ces actions qui possèdent souvent un caractère répétitif et quotidien. Dans les discours médiatiques, les micro-agressions sont souvent désignées comme le «  supplice des 1000 coupures de papier  » («  death by a thousand nicks  ») à la suite du chercheur Alvin Poussaint dans son article «  Itʼs the Little Things  ». ↩ï¸&
Littéralement un «  club pour hommes  ». On parlera de boyʼs club au sens large, pour désigner tout espace qui revêt des formes de non-mixité masculine, quand bien même cela nʼest pas énoncé de manière claire. ↩ï¸&
«  The Feminist Movement and the Rational Household  ». ↩ï¸&
«  pseudo-feudalistic  ». ↩ï¸&
«  less open to such views  ». ↩ï¸&
«  advocates of scientific housekeeping  »â€¯; «  they tried to bring together the various work surfaces and utensils  »â€¯; «  their assembly line behaved no more coherently than the contents of an attic  ». ↩ï¸&
«  male designers who have assumed the persona of genius  ». ↩ï¸&
«  Design history also enjoyed fruitful synergies with cultural studies  ». ↩ï¸&
«  ignoring questions of gender and women in the writing of design history was certainly less academically acceptable  ». ↩ï¸&
Ce retard ou «  trou  » de traduction participe de lʼinvisibilisation, sinon des personnes, au moins des thèses féministes qui pourraient participer à faire connaître leur travail. Des efforts réels, parfois collectifs, ont été menés pour rendre des textes anglophones qui nʼétaient pas disponibles presque dix ans après leur publication, comme le Stone Butch Blues (1993) de Leslie Feinberg traduit et publié quasiment à prix coà »tant par le collectif Hystériques & Associées. Je pense aussi aux écrits de bell hooks, restés longtemps indisponibles en français avant les efforts de traduction et publication de maisons comme Cambourakis ou Divergences. Cela nʼenlève rien, bien au contraire, aux traductions réalisées par des militant·es qui diffusent ces textes sur des tracts ou dans des fanzines. La critique sʼadresse plutôt aux grandes maisons dʼédition françaises qui ont consciencieusement ignoré ces textes pendant de longues années. ↩ï¸&
Katha Pollitt explique dans ce célèbre article comment le récit des Schtroumpfs est emblématique du traitement des femmes en fiction. Dans la bande dessinée de Peyo, tous les Schtroumpfs sont désignés par une caractéristique de leur personnalité (boudeur, ébahi, paresseux) voire par une capacité (acrobate, chantant). La Schtroumphette se distingue par son genre (compris comme son sexe). Cette distinction est si profonde, quʼelle est la seule représentante de la classe des femmes -—comme si cette identité épuisait sa personnalité. On en retrouve de nombreux exemple dans la bande dessinée (anglophone ou francophone) du XXe siècle : La Castafiore, seule femme dans Tintin, Mademoiselle Jeanne dans Gaston Lagaffe, April dans les Tortues Ninja, etc. ↩ï¸&
«  Girls exist only in relation to boys  ». ↩ï¸&
Je remercie la chercheuse Pia Baltazar qui mʼa communiqué cet article. ↩ï¸&
Cʼest dʼailleurs un pari épistémologique que jʼaimerais renouveler dans la suite de mes recherches, qui porteront sur la misogynie gay. ↩ï¸&
Plus jeune que Pettena, le théoricien Matthew Campbell parle de la Volkswagen passant de main en main comme dʼune «  putain[…] bon marché  » (2016[2009], 112) ; le carburateur capricieux est comparé à un cantatrice dʼopéra au «  tempérament capricieux et sensuel  » (107). ↩ï¸&
«  The cover sketch for Poésie sur Alger depicts a unicorn-headed (?), winged female body – supple-hipped and full-breasted – (the city/poem?) caressed gently by a hand (the architectʼs hand?) against the skyline of new Algiers. This type of analogy, which claims mastery over the feminized body of the colonized territory (in this case, claiming that its beauty can be reincarnated through the architectʼs intervention), is not unprecedented in the French discourse on Algeria  ». ↩ï¸&
Jʼai croisé ces propos de Martine Delvaux dans lʼouvrage de lʼautrice de science-fiction et essayiste Ketty Steward, Le futur au pluriel : réparer la science-fiction (2023). Étant moi-même auteur de SF, jʼai eu lʼoccasion de voir à lʼœuvre dans ce milieu les logiques de «  pick-me  ». Ainsi, une autrice et une chercheuse à qui je mʼadressais en table ronde mʼont fait remarquer que, contrairement à ce que jʼaffirmais, les femmes nʼétaient pas opprimées. Face à ma surprise, lʼautrice de SF mʼexpliqua alors quʼelle avait tout fait pour que des femmes soient publiées en SF, mais que celles-ci «  nʼosaient pas  » écrire -—étant donc entendu que leur absence était de leur fait. Lʼautrice ajouta que le milieu de la SF nʼétait pas sexiste, puisquʼelle nʼavait jamais été victime, personnellement, de sexisme. On voit bien ici (et à la décharge de lʼautrice, peut-être) le coà »t social quʼimplique la conscientisation du sexisme : reconnaître que les femmes sont discriminées dans son milieu sous-entendrait peut-être pour cette autrice de remettre en question la reconnaissance qui lui a été accordée, et de réaliser que son exception tient moins à lʼexceptionnalité de son talent quʼaux formes électives de la reconnaissance que le patriarcat agence pour voiler ses logiques. ↩ï¸&
Le terme de camp, en anglais, renvoie à une forme de kitsch spécifique aux sous-cultures LGBTQIA+ : est camp toute esthétique qui déborde, par excès de sensibilité non feinte, par facticité visible (voire ostentatoire) ou par grossièreté revendiquée. Le goà »t du camp est teinté dʼironie, même sʼil est fréquent de lire quʼune Å“uvre ne peut pas être camp à dessein : cʼest justement la sincérité ou lʼabsence de recul sur la production qui signe lʼesthétique camp. ↩ï¸&
«  Here is man for you… a virile force, an entire male… it sings the song of procreant power  » ↩ï¸&
«  modernism is gender specific  ». ↩ï¸&
J. Chicago est surtout connue pour The Dinner Party (1979), une Å“uvre colossale composée dʼune table triangulaire et de 39 plats commémoratifs dédiés à des femmes ayant marqué lʼhistoire. ↩ï¸&
Je le souligne car dans de nombreuses sources, on lit que la maison était «  abandonnée  », ce qui peut laisser imaginer une occupation illégale. En réalité, un loyer spécial a été contracté pour trois mois avant la démolition de la maison (Harper 1985, 766 ; voir aussi lʼinterview de Judy Chicago pour le National Museum of Women in the Arts, [en ligne]). ↩ï¸&
Je remercie le designer et enseignant Clément Rosenberg grâce à qui jʼai connu cette source. ↩ï¸&
«  But I always went to my kitchen duty screaming and kicking and hating it all the way. Even after years of living with women in a truly equal situation, the fear of the kitchen is still with me. It is through my struggling with my sisters that I am beginning to see my way through this dilemma  ». ↩ï¸&
Jʼintroduis ici une forme de prudence : ces documents ne sont pas au centre de mes recherches, et par conséquent, il se peut que des propositions plus clairement identifiables comme propositions dʼarchitecture mʼaient échappé. Dʼune certaine manière, je serais ravi dʼavoir tort à ce sujet. ↩ï¸&
Le titre de ce numéro est «  Making Room -—Women and Architecture  » («  Faire place -—Les femmes et lʼarchitecture  »). ↩ï¸&
Cette idée selon laquelle il existerait des prises de forme spécifiques aux femmes nʼest pas seulement issue dʼune lecture dʼhommes misogynes ; «  lʼécriture au féminin  » a été théorisée par des autrices féministes (Hélène Cixous, Luce Iragaray), même si cette clé dʼanalyse a depuis été critiquée. ↩ï¸&
Je dis «  gays et lesbiennes  » plutôt que «  personnes LGBTQIA+  » car cʼest cette dénomination qui avait alors cours. Cela nʼexclut pas que des personnes queer, fluides sur le plan du genre, trans ou intersexes aient fait partie de ces groupes. Il faut se souvenir quʼà cette époque le terme «  gay  » était encore un terme-parapluie, également utilisé par les lesbiennes. Ce nʼest que plus tard que le mot sera remplacé, ou jugé inadéquat dans la mesure il apparaîtra emblématique de lʼassimilation des hommes gays blancs au détriment des minorités qui ont combattu à leurs côtés. ↩ï¸&
Je dois la découverte de cette personnalité à lʼhistorien de lʼart Tony Côme et à son riche «  Horoscope du confinement  » dans lequel il a partagé un grand nombre de sources en 2020. ↩ï¸&
«  The problem with houses is that they are designed by men […] They put in far too much space and then you have to take care of it  ». ↩ï¸&
«  bare boxes to be filled up with mass-produced commodities  » ↩ï¸&
Cʼest peut-être lié à sa position : Bernège affirme clairement dans lʼarticle ne pas vouloir «  batî[r] des romans à la Jules Verne  » (73), et se distingue donc dʼune approche science-fictionnelle. ↩ï¸&
Il y a là un lien intéressant entre décor et utilité, ou encore design et écologie : Philippe Rahm espère dans The Anthropocene Style (2023) rappeler la fonctionnalité perdue de certains éléments de mobilier vus aujourdʼhui comme décoratifs, tels les tapis qui permettent de conserver la chaleur. ↩ï¸&
«  collaborative survival  ». ↩ï¸&
Je dis «  maternel  » par commodité, mais les personnes lactantes ne sont pas toutes des femmes ou des femmes cisgenres. ↩ï¸&
«  peopleʼs septic tanks, vegetable gardens, kitchen taps and sun-made tea  ». ↩ï¸&
Ce titre fait écho à lʼactrice étasunienne afro-descendante Hattie McDaniel, qui nʼa quasiment joué dans toute sa carrière que des rôles de domestique. Lorsquʼon lʼa interpellée sur ce fait, elle a répondu avec malice quʼelle préférait jouer (au cinéma) la femme de ménage que dʼen être une (Young 1989). ↩ï¸&
«  linguistic chameleon  ». ↩ï¸&
«  This view did not necessarily mean that activities necessary for immediate survival, such as domestic subsistence work, were not seen and acknowledged. However, they were generally regarded as a part of nature, supposedly a natural property of women in the ideology of the bourgeois family, or, on the other hand, as exceptions and relics of pre-capitalist modes of production and living, which would pass from the natural world into the economic sphere through either commodifications (liberals) or socialization (socialists)  ». ↩ï¸&
Le concept est formé par le philosophe Louis Althusser, et proposé dans Sur la reproduction (publié post-mortem, en 1995). ↩ï¸&
«  reproduce the underlying structure of social relations and institutions of society  ». ↩ï¸&
«  passive reproduction  »â€¯; «  active reproduction  ». ↩ï¸&
«  the great variety of tasks […] gets packaged into ‹ jobs ›  ». ↩ï¸&
Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les technologies du numérique ont accéléré cette fragmentation. Le modèle du «  turc mécanique  » repris par le service Amazon Turk en est lʼemblème. Dans ce dispositif, des travailleureuses pauvres des pays du Sud réalisent des actions courtes, souvent répétitives, rémunérées quelques dollars à la tâche plutôt quʼà lʼheure. Jʼai par ailleurs exploré ce que donnerait une généralisation globale de ce modèle dans ma fiction de science-fiction La Séquence Aardtman (2021). Lʼinvention des «  contrats Zéro Heure  » en Grande-Bretagne et la Loi Travail en France (2016) sont également des occurrences de cette mutation, à la fois opérationnelle (par le numérique) et institutionnelle (par la destruction des protections garanties par le Code du Travail). Il faudrait ajouter à ce tableau le travail sur lʼidentité numérique, ce «  travail forcé du XXIe siècle  » (Joler 2023, 196). ↩ï¸&
«  [our economy] assumes that the only activities that reality and value are those in which money changes hands  ». ↩ï¸&
«  Should preparing a meal in your home be considered a part of the economy?  ». ↩ï¸&
Ce nom de plume est partagé par deux femmes géographes, Julie Graham and Katherine Gibson. ↩ï¸&
«  losers in a double sense  ». ↩ï¸&
«  Capitalism also depends on domestic labour  ». ↩ï¸&
«  precondition  », en italique dans le texte. ↩ï¸&
«  Setting tables, clearing them off, keeping lamps or gas-fixtures in order, polish stoves, knives, silverware, tinware, faucets, knobs, etc.; washing and wiping dishes; taking care of food left at meals; sweeping including the grand Friday sweep, the limited daily sweep, and the oft-recurring dust-pan sweep; clean- ing paint; washing looking -glasses, windows, window -curtains; canning and preserving fruit; making sauces and jellies, and catchups and pickles; making and baking bread, cake, pies, puddings; cooking meals and vegetables; keeping in nice order beds, bedding, and bedchambers; arranging furniture, dusting and ʼpicking upʼ; setting forth, at their due times and in due order, the three meals; washing the clothes, ironing, including doing up shirts and other ʼstarched thingsʼ; taking care of the baby, night and day; washing and dressing children, and regulating their behavior, and making or getting made, their clothing, and seeing that the same is in good repair, in good taste, spotless from dirt, and suited both to the weather and the occasion; doing for herself what her own personal needs require; arranging flowers; entertaining company; nursing the sick; ʼletting downʼ and ʼletting outʼ to suit the growing ones; patching, darning, knitting, crocheting, braiding, quilting  » ↩ï¸&
«  would not really alter the oppressive nature of the work itself  ». ↩ï¸&
«  [i]nvisible, repetitive, exhausting, unproductive, uncreative  ». ↩ï¸&
«  A womanʼs work is never done  ». ↩ï¸&
Seul le meurtre (féministe ?) lui permettra de briser la boucle sans fin. ↩ï¸&
«  shadow work  ». ↩ï¸&
Jʼai en mémoire à ce sujet une conversation avec lʼautrice de science-fiction et chercheuse Ketty Steward. Cette dernière a notamment écrit au sujet de la domination du roman dans les espaces de réception critique de la science-fiction, qui implique une dévalorisation concomitante de la nouvelle. Ketty Steward défend cette forme et mʼa expliqué une des raisons qui la poussent à continuer dans cette voie : ses lectrices lui indiquent en effet souvent, lors de rencontres, que la nouvelle est un des formats littéraires qui se combine le mieux avec cette vie chargée et fragmentée qui est celle des femmes aujourdʼhui. Il me semble quʼil y a là une leçon quant à la manière dont lʼinvisibilisation du travail des femmes, plus largement des expériences féminines, est facilitée par la domination de certaines formes -—qui ne paraîtront pas «  masculines  » au premier regard et échapperont peut-être, pour cette raison, à une critique féministe. Pour autant, il ne sʼagit pas de dire que la forme courte doit régner : Muriel Plana revendique par exemple la forme épique dans ses propres écrits. ↩ï¸&
On trouve par exemple ce passage chez Pat Meinardi, membre du groupe Redstockings, dans la revue féministe française Le Torchon Brà »le (n°0) : «  Voici la liste des sales boulots : acheter la bouffe, la charrier aÌ€ la maison, la ranger, faire la cuisine, laver la vaisselle, faire la lessive, ranger quand cʼest plus possible, nettoyer par terre. On peut prolonger la liste, mais les strictes neÌcessiteÌs ça fait deÌjaÌ€ pas mal. Nous avons toutes ces choses-laÌ€ aÌ€ faire, ou bien il faut trouver quelquʼun pour les faire aÌ€ notre place. Plus mon mari consideÌrait ces taÌ‚ches, plus il eÌtait saisi de deÌgouÌ‚t, et ainsi se produisit la meÌtamorphose de lʼhabituellement doux et preÌvenant Dr Jekyll en fourbe M. Hyde, preÌ‚t aÌ€ tout pour eÌviter les horreurs du travail meÌnager. Quand il se voyait acculeÌ dans un coin, environneÌ dʼassiettes sales, de balais, de serpillieÌ€res et dʼexhalaisons de poubelles, Il lui poussait des canines pointues, des ongles griffus et des yeux sauvages. Futile le travail meÌnager, trivial ? Ah ah. Essayez seulement de partager le fardeau  » (1970, 10). ↩ï¸&
«  time confetti  ». ↩ï¸&
«  happiness minutes  ». ↩ï¸&
«  pitch in  ». ↩ï¸&
«  He canʼt learn how to mop a floor  »â€¯; «  Itʼs kind of beyond him, for some reason  ». ↩ï¸&
Je cite cette institution car cʼest là où jʼai visité lʼexposition ; initialement, elle a été proposée en 2022 à la salle dʼexposition des Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine. ↩ï¸&
Il sʼagit de Initiation au repassage, de Pierre Brive, 1954 ; CNC Direction du Patrimoine. ↩ï¸&
Ces informations figuraient sur un cartel de lʼexposition. ↩ï¸&
«  what can count as knowledge  ». ↩ï¸&
Comme souvent, les «  origines  » de ce mouvement varient un peu selon les auteurices. Angela Davis situe quant à elle la naissance de Wages for Housework en Italie, en 1974 (2019[1981], 209). ↩ï¸&
Cela est rappelé par exemple dans une tribune publiée par Le Monde en mars 2022 ; les signataires de cette tribune sont Rana Hamra, directrice exécutive de Humanity Diaspo ONG ; Aicha Rassoul Sene, chargée de plaidoyer et de communication Droits des femmes ; Ramata Kapo, présidente dʼExcision parlons-en ! ; Ernestine Ngo Melha, fondatrice et directrice exécutive de lʼAssociation dʼaide à lʼéducation de lʼenfant handicapé (AAEEH) ; Carine Roland, présidente de Médecins du Monde; Noanne Tenneson, directrice générale dʼAlliance des avocats pour les droits de lʼhomme ; Marie-Claire Kakpotia Moraldo, fondatrice et directrice générale Les Orchidées rouges ; Angela Da Costa, cofondatrice de Enfants Prévention Actions Pédophilie Inceste (Epapi). ↩ï¸&
Lʼexpression est de Mariarosa Dalla Costa. ↩ï¸&
Jʼutilise volontairement cette expression quelque peu rétrograde, puisque les femmes sont toujours moins rémunérées en moyenne que les hommes. Il résulte donc de cet état de fait que leur salaire apparaît comme «  second  ». ↩ï¸&
Cette précaution est nécessaire car pour les femmes racisées et des classes populaires, le «  second salaire  » a probablement toujours été indispensable pour la survie économique de leur famille. ↩ï¸&
«  If it were at all possible simultaneously to liquidate the idea that housework is womenʼs work and to redistribute it equally to men and women alike, would this constitute a satisfactory solution?  » ↩ï¸&
«  In South African Society where racism has led economic exploitation to its most brutal limits, the capitalist economy betrays its structural separation from domestic life in a characteristically violent fashion. The social architects of Apartheid have simply determined that Black labor yields higher profits when domestic life is all but entirely discarded  ». ↩ï¸&
«  proposes a design solution to a social question  ». ↩ï¸&
«  liberation as a housewife  »â€¯; «  liberation of the housewife  ». ↩ï¸&
Le terme de gaslighting est aujourdʼhui utilisé de manière courante pour désigner des situations dʼabus moraux, souvent traversés par des formes de domination (de genre, de race, etc.). Le gaslighting consiste à nier de manière systématique les perceptions dʼune personne pour la manipuler (consciemment ou non). Comme dans le film Gaslight (1944) dont lʼexpression est issue, la personne «   gaslightée  » doute de ses perceptions, voire remet en question sa sanité dʼesprit, ce qui donne davantage de pouvoir aux autres autour dʼelle. ↩ï¸&
À force de décrire les discriminations, on peut oublier de rappeler à qui elles bénéficient : ainsi, critiquer la féminité stéréotypée ne doit jamais faire oublier que celle-ci sert à produire la masculinité ; que le racisme est au service dʼune production de la blancheur, ou encore que les représentations rabaissantes de lʼhomosexualité constituent en négatif lʼhétérosexualité, etc. ↩ï¸&
«  White identity is founded on compelling paradoxes: a vividly corporeal cosmology that most values transcendence of the body; a notion of being at once a sort of race and the human race, an individual and a universal subject; a commitment to heterosexuality that, for whiteness to be affirmed, entails men fighting against sexual desires and women having none; a stress on the display of spirit while maintaining a position of invisibility; in short, a need always to be everything and nothing, literally overwhelmingly present and yet apparently absent, both alive and dead  ». Lʼitalique dans la traduction a été ajouté par mes soins. ↩ï¸&
Les personnages noirs représentés par des personnes blanches épousent souvent des caractéristiques outrées qui font écho à des stéréotypes sur la «  personnalité  » supposée de ce groupe humain : ainsi les figures auront des yeux globuleux, des lèvres épaisses et exagérément rouges (soit des traits animalisants), en même temps que des traits figés dans un éternel sourire (ici, il sʼagit plutôt de cantonner le personnage à la servilité). Souvent, les individus apparaîtront nus ou vêtus dʼun pagne connotant une forme de sauvagerie – ce qui renforce en écho la nécessité dʼune mission civilisatrice. ↩ï¸&
«  Omo adds brightness to whiteness  ». ↩ï¸&
«  the locus of true whiteness  ». ↩ï¸&
«  emotional satisfaction and happiness  ». ↩ï¸&
«  home engineering  ». ↩ï¸&
«  domestic advisor  ». ↩ï¸&
«  not ‹ just material goods but social life itself ›  » ↩ï¸&
«  Knowledge, know-how, language and affect are the fundamental stakes in production today  » ↩ï¸&
Et sans doute lʼinvisibilisation des travailleureuses du clic sollicité·es par lʼéconomie du numérique notamment (Lechner, Citton & Masure 2023, 63). ↩ï¸&
Charlotte Perkins Gilman parlait dʼun degré de travail («  grade of work  » 2013[1903], chap. II). ↩ï¸&
«  one can see spheres of work outside the calculus of the wage as prototyping the conditions of work in a capitalism under the sign of ‹ de-valorization ›一the endless commitment, personal investment and temporal and spatial limitlessness of housework, like that of art production, becomes the template for a capitalism that is increasingly not interested in valorising itself through regular waged labor and institutions of expanded reproduction like the welfare state (which made labor cheaper to employ), but through direct asset stripping through part time and precarious and regulated work and privatization of collective institutions  » ↩ï¸&
Selon ses propos rapportés dans lʼarticle «  How to cook elaborate dishes using everyday office supplies -—like Chinaʼs newest internet star  » publié en 2017 par la revue Quartz (auteurice non mentionné·e), [en ligne], https:
«  in economic centers like New York, educated people in the ‹ creative class › are being presented with workplace products in new shades of hospitality-—spaceships for breastmilk included. Among the suite of products that enable self-care against the exhaustion of overwork, it seems more probable to consume our own better treatment. But if such treatment is only accessible through membership, as amenities, it only compounds the exploitation of those who canʼt afford a better situation, which can only be elective and never deserved  ». ↩ï¸&
we must «  reposition the culture of work that elides, erases, and reduces the body. Where can we incubate a political future that we are told is female?  » ↩ï¸&
«  the bits and pieces of any kitchen  » ↩ï¸&
Ces activités nʼont dʼailleurs existé, concernant le mica, que durant la Seconde Guerre mondiale : en dehors de telles périodes, nous dit Douglas Thwaites, il a toujours été plus économique pour la Grande-Bretagne dʼutiliser du Mica venant dʼInde ou de Chine (Thwaites 2011, 91). ↩ï¸&
Pour certains théoriciens, cette fragmentation du faire est à lʼorigine dʼune forme de «  misère symbolique  » (Stiegler 2004). Matthew Campbell écrit ainsi quʼ«  un (sic) des principales sources de fierté que peut apporter le travail est lʼexécution intégrale dʼune tâche susceptible dʼêtre anticipée intellectuellement dans son ensemble et contemplée comme un tout une fois achevée  » (2016[2009], 179). Je le cite toujours avec prudence parce que, chez lui, la déspécialisation et la perte de savoir-faire sont souvent considérées comme une forme de féminisation. ↩ï¸&
Pour Claire Brunet et Catherine Geel, la boîte noire doit aussi être reliée à lʼhistoire des machines de mort, cʼest-à -dire aux objets de guerre et autres armes qui ne sont pas un ailleurs de la discipline du design (2023, 101–102). ↩ï¸&
Jeremy Rifkin les décrit en ces termes : «  Au sein de la communauté DIY — les bricoleurs du ‹ faire soi-même › —, la sous-culture des Makers a pour particularité de recourir à la technologie informatique  » (2016[2014], 175). Chez le chercheur Grégory Marion, les «  makers  » sont une variante de la figure du «  bricoleur  » (2016, 230). ↩ï¸&
On pourrait aussi penser au fait dʼallumer un interrupteur, craquer une allumette, verser du café dans une machine destinée à préparer cette boisson, ouvrir un emballage de céréales, etc. ↩ï¸&
Le doxing consiste à divulguer des données personnelles sans le consentement de la personne représentée (vidéos intimes, photos dénudées, etc.). ↩ï¸&
Le terme «  cyberespace  » (ou en anglais «  cyberspace  »), popularisé par lʼauteur de science-fiction William Gibson (Desbois 2015, 227), peut sembler un peu daté. Il évoque, chez moi, les espaces continus générés en 3D dans le film Tron (1982) ou encore les traductions par les effets spéciaux du film The Lawnmower Man (1992) ; autrement dit, le mot renvoie davantage aux moyens plastiques de lʼévocation, dans les années 1990, dʼun espace virtuel, quʼau Web qui est finalement advenu et auquel nous avons couramment accès en Occident en 2024. ↩ï¸&
«  the clitoris is a direct line to the matrix  ». ↩ï¸&
«  cyberfeminism was a catalytic moment, a collective memetic mind-virus that mobilised geek girls everywhere and unleashed the blasphemic techno-porno code that made machines pleasurable and wet…as I watch pussy riot declining to be ‹ clean and proper › bodies in a most filthy way, i feel the morphing cyborg feminist lineage stretching through time and space  ». ↩ï¸&
Là où les femmes sont souvent exclues du domaine du design, elles y sont volontiers réintégrées «  par défaut  » lorsquʼil sʼagit de sciences et techniques. Bien entendu, le «  design  » qui leur est ici concédé nʼest pas celui de la discipline de conception, mais celui dʼun domaine réinventé pour limiter ses pratiques à la pure surface, à lʼapparence ou au décor. ↩ï¸&
Je parle bien dʼesprit puisque le détournement des images ne nécessite pas de compétences spécifiques en informatique. ↩ï¸&
Je ne voudrais pas ici suggérer que les formes populaires sont systématiquement plus conservatrices que les productions dʼun art dit «  underground  ». Il se trouve que ces deux exemples relèvent dʼun tel motif, mais je nʼen déduis aucune thèse générale à ce sujet. Le personnage de Lisbeth Salander dans la saga Millenium est un contre-exemple parmi dʼautres. ↩ï¸&
Lʼartiste Mary Maggic a soutenu ses travaux de recherches sous le nom de Mary Tsang mais ne fait plus usage de ce nom dans ses publications récentes. Je læ cite donc principalement sous le nom de Maggic dans le texte, et garde le patronyme «  Tsang  » entre parenthèses à chaque fois que je cite son mémoire. ↩ï¸&
«  what if it was possible to make estrogen in the kitchen?  » ↩ï¸&
«  biotechnical civil disobedience  »â€¯; le concept est emprunté au Critical Art Ensemble (Tsang 2017, 13). ↩ï¸&
«  organism factory producing eggs  ». ↩ï¸&
Je paraphrase ici Donna Haraway qui questionne «  ce qui compte comme savoir  » ( «  what counts as knowledge  » dans son texte sur la pensée située (1988, 580). ↩ï¸&
Dans son fanzine «  DIY COLUMN CHROMATOGRAPHY URINE-HORMONE-EXTRACTION-ACTION  » documentant le projet correspondant, [en ligne], https:
Dans le tome I de À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann. ↩ï¸&
«  ‹ Electric Toast, › ‹ Wizzard Pie, › ‹ Telegraph Cake, › ‹ Electric Cigars, › and music by ‹ Prof. Mephistopheleʼs Electric Orchestra ›  » ↩ï¸&
Ce slogan évoque les Éphésiens 5:8, en français : «  Vous étiez autrefois dans lʼobscurité ; mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière  ». ↩ï¸&
«  sweep with electricity  » ↩ï¸&
Lʼincarnation emblématique de ce gothique-technique-merveilleux est sans doute le Frankenstein; or, The Modern Prometheus de Mary Shelley (1818). ↩ï¸&
«  the foods we seem to fetishise in the present -— the artisanal, the local, the small-batch -—are never the ones we seem to associate with the tantalising prospect of ‹ the future ›  ». ↩ï¸&
On remarquera ici que ces produits ont été commercialisés de manière genrée : les repas liquides de Slim Fast ont plutôt été marketés, par le passé, en direction des femmes, tandis que les poudres protéinées (similaires dans leur composition) sont vues comme des produits permettant dʼapparaître plus musclé·e. Le corps musclé est aujourdʼhui rendu désirable pour toustes, avec, malgré tout, un marquage genré de la silhouette qui incite à cibler des groupes de muscles différents selon que lʼon est une femme ou un homme. ↩ï¸&
«  The mechanization of the kitchen coincides with the mechanizing of nutrition  ». ↩ï¸&
«  As the kitchen grows more strongly mechanized, the stronger grows the demand for processed or ready-made foods  ». ↩ï¸&
«  The time of full mechanization is identical with the time of the tin can  » ↩ï¸&
«  examines the biotechnologies and biodiversity of human food systems  » ↩ï¸&
«  to map food controversies  »â€¯; «  to prototype alternative culinary futures  »â€¯; «  to imagine a more just, biodiverse & beautiful food system  » ↩ï¸&
En France et de manière contemporaine, Yves Citton a travaillé de manière particulièrement intéressante en utilisant le glossaire comme moyen sinon comme méthode. Il a ainsi participé à lʼAbécédaire des Bifurcations, signé par Cora Novirus et publié dans le numéro 80 de la revue Multitudes (2020). La publication collective Angles morts du numérique, Glossaire critique et amoureux, co-dirigé avec Anthony Masure et Marie Lechner, auquel jʼai eu le plaisir de contribuer, est une autre occurrence de cette approche. Historiquement, il existe de nombreux précédents à ce type de démarches, du Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert à lʼAbat-Faim de Guy Debord. Jʼai été inspiré par ce travail dans mes pratiques pédagogiques en master DTCT. Depuis quelques années, je donne très régulièrement aux étudiant·es un dictionnaire critique à réaliser dans le cadre du travail de mémoire. ↩ï¸&
«  Biodiversity of the Kitchen  » ↩ï¸&
Lʼartiste, chercheuse, et enseignante Lucile Olympe Haute travaille ces questions, notamment au sujet de la kombucha. Elle a dirigé un workshop à ce sujet pour la Licence Design de lʼUniversité de Nîmes en 2022, [en ligne], https:
«  Intentional Cuisines  ». ↩ï¸&
«  planned rituals, practices and foodways […] serving as an alternative to the dominant and normative cuisines of the time or local area  ». ↩ï¸&
On appelle backronym un acronyme formé sur la base dʼun mot existant. ↩ï¸&
«  reminder to prioritize taste and place when prototyping desirable food futures, avoiding the unnecessary veneration of technology, profit and linear thinking  ». ↩ï¸&
«  Failed Food Utopias  »â€¯; «  historical plans for perfecting the human food system which did not fulfill their initial promise or were otherwise discontinued  ». ↩ï¸&
«  Cyber Agrarian  »â€¯; «  a speculative agroecosystem that employs emerging digital and bio technologies in the pursuit of a regenerative food system  ». ↩ï¸&
«  We Have Always Been BioHackers  ». ↩ï¸&
On sera peut-être surpris que je parle de la lessive dans un ouvrage sur la cuisine. Peut-être cette tâche apparaîtra-t-elle comme un cas frontière. De nos jours, la machine à laver (pour celleux qui en possèdent une) est en effet située dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bains, le garage ou encore la buanderie. Il me semble toutefois que la dimension domestique de cette tâche la relie aux femmes et à la cuisine. Il nʼexiste pas de guide contemporain de partage des tâches ou de traité plus ancien de lʼéconomie domestique qui nʼinclut pas un propos sur ce travail. Dès lors, il me semble être un passage obligé dans mon étude. ↩ï¸&
«  Put a stove in your office  ». ↩ï¸&
«  grateful for it  ». ↩ï¸&
«  despite the proliferation of gadgets for the home, domestic work has remained qualitatively unaffected by the technological advances brought on by industrial capitalism  ». ↩ï¸&
«  Housework still consumes thousands of hours of the average housewifeʼs year  ». ↩ï¸&
«  within reach of the table, giving the master of the house something to do while he is waiting for his egg  ». ↩ï¸&
Ici, on peut remarquer que lʼhistoire de lʼélectroménager croise celle des écologies de lʼattention : le temps libéré (du travail) est converti en «  temps de cerveau disponible  », selon le mot célèbre de Patrick Le Lay en 2004, alors quʼil était PDG de la chaîne TF1. ↩ï¸&
«  The ‹ sheer look › in product design hid mechanisms that in an earlier era might have provided women with a technical knowledge and an indication of how appliances actually operated. As Thomas Hine suggested, though women in an earlier era might have been viewed as household engineers, in the electric push-button 1950s and 1960s they were assured that the only real knowledge they needed was how to turn on the machines (as well as their husbands)  ». ↩ï¸&
Ce gâteau étasunien, à la texture très légère du fait de lʼajout de blancs dʼœufs battus en neige, se rapproche dʼune génoise ou dʼun biscuit de Savoie. ↩ï¸&
«  The eggbeater, which was invented and marketed during the middle decades of the century, may have eased the burden of this work somewhat; but unfortunately the popularity of the beater was accompanied by the popularity of angel food cakes, in which eggs are the only leavening, and yolks and whites are beaten separately-—thus doubling the work  ». ↩ï¸&
Cʼest en effet un point non négligeable de la tâche : les critères qui déterminent sa réalisation ne sont pas universels. Sylvette Denèfle observe ainsi quʼun homme, à lʼépoque où elle écrit, prend 55 minutes pour une lessive contre 1 h 20 minutes pour une femme. Ceci apporte un éclairage nouveau sur les tâches ménagères et le temps qui leur est consacré. La tâche nʼest pas une matière brute qui se partagerait de manière seulement numérique, car les temps féminin et masculin sont différents. Il ne sʼagit pas dire que les femmes sont plus lentes dans lʼabsolu, mais peut-être quʼelles envisagent cette tâche avec un ensemble dʼexigences qui allongent le temps dʼexécution (Denèfle 1995, 99). ↩ï¸&
Les travaux du chercheur Antonio Sanchez au sujet des lavoirs à Bogotá précieux sur cette question. Je ne cite pas de source précise car jʼai eu accès à une version intermédiaire dʼun article à paraître. ↩ï¸&
«  In 1940, just as the Depression was drawing to a close and the economy was shifting to wartime production, one out of every three Americans was still carrying water in buckets, and two out of three Americans did not enjoy the comforts of central heating  ». ↩ï¸&
Ce travail a été dirigé par Brice Genre (enseignant-chercheur et designer) et Sylvain Bouyer (designer). ↩ï¸&
Une telle ambition possède des précédents historiques : ainsi la société Cadillac proposait en 1950 lʼAtomixeur capable de mixer des aliments, de pulvériser la peinture et de sécher les cheveux (objet exposé dans Plateau volant, motolaveur, purée minute, exposition vue au MUCEM, Marseille, en 2023). ↩ï¸&
«  Tools are not passive instruments, conñned to doing our bidding, but have a life of their own  ». ↩ï¸&
«  they will command us, rather than the other way round  ». ↩ï¸&
Il est à noter que certains pays, sans faire le choix de la collectivisation radicale, ont au moins adopté ce principe pour la machine à laver. Les laveries dʼimmeuble existent ainsi aux États-Unis et en Suisse, entre autres. ↩ï¸&
Cela dépend évidemment des usages. De plus, il ne faut pas pour autant disqualifier ces objets. Jʼai pour ma part possédé pendant des années un objet dont lʼunique fonction est dʼouvrir de manière régulière les Å“ufs à la coque -— ce qui mʼa longtemps valu commentaires hilares et railleries de la part de mes ami·es. Sous la pression, sociale, je me suis débarrassé du gadget, seulement pour réaliser que jʼy étais attaché : de fait, il permet dʼouvrir un Å“uf à la coque à la perfection. ↩ï¸&
«  What is the point of imagining new technologies without new ways of living?  », traduction de Irénée Régnauld. ↩ï¸&
«  popular imaginings of the future have promised difference, but delivered more of the same  ». ↩ï¸&
«  fins on the sides elegantly indicate the place to put your thumb to optimize the mechanics of use, a visual cue for intuitive handling. When you hold the peeler against a carrot, it encourages you to apply just enough pressure to catch a ribbon of skin without cutting too deeply, and without a reckless amount of slip that would send both carrot and peeler flying from your hands. Grip and friction and leverage and force-—all of these considerations have to come together in a quick intersection of concerns  ». ↩ï¸&
On me rétorquera peut-être que la catégorie «  assises  » est moins laborieuse linguistiquement parlant ; cependant, une telle catégorie exclurait de fait tous les objets ou systèmes qui permettent de sʼasseoir mais nʼont pas été prévus à cette fin. Or, le rôle dʼune catégorisation vaste consiste justement à aller chercher des solutions fonctionnelles dans la spontanéité des usages plutôt que dans un répertoire existant identifié. ↩ï¸&
Pour S. E. B, ou Société dʼEmboutissage de Bourgogne. ↩ï¸&
Sur le site de la marque, [en ligne], https:
Le titre du catalogue est évocateur dʼune exposition historique majeure dans lʼhistoire du design, Italy : The New Domestic Landscape, sous la curation dʼEmilio Ambasz au MOMA à New York en 1972. Je remercie Aurélien Pons, étudiant du master DTCT, qui mʼa fait connaître le catalogue de Super Solide. ↩ï¸&
«  critical design  ». ↩ï¸&
«  uses speculative design proposals to challenge narrow assumptions, preconceptions , and givens about the role products play in everyday life  ». ↩ï¸&
«  product language  ». ↩ï¸&
«  This is the steel that loves to work -— This is the wife that loves to cook -—this is the husband that loves the wife that loves to cook -— this is the steel that loves to work for both of them  ». ↩ï¸&
Cette image relie le sujet de cet écrit à celui de ma thèse au sujet des héros et super-héros du cinéma étasunien de divertissement. Jʼai notamment écrit sur les points de contact invisibilisés entre deux identités, notamment celles de Clark Kent et Superman (2013). ↩ï¸&
«  she may have climbed the corporate ladder but sheʼll need an actual ladder to climb the washing machine  ». ↩ï¸&
Le réel rejoint parfois la parodie : au début de la pandémie du COVID, lʼépidémiologue Julia Marcus observe le mouvement qui consiste, chez certains hommes, à refuser le port du masque car il est selon eux un «  signe de faiblesse  » («  a sign of weakness  »). ↩ï¸&
«  man up this holiday season and ask your wife to buy you GE Big Boy House Appliances  » ↩ï¸&
Je condense ici grandement les possibles associés au bricolage. Dans sa thèse, le chercheur Grégory Marion relie le bricolage à de nombreux possibles, et même à un potentiel métaphysique dans la mesure où cet ensemble de pratiques peut connecter ses praticien·nes à une capacité dʼagir, nommée comme «  puissance de faire  » dans ses pages (Marion 2016, 165). ↩ï¸&
Cet aspect nʼéchappe pas à Grégory Marion qui parle dʼun «  état photogénique » des objets bricolés et pour cette raison non aboutis, car figés tôt dans leur forme pour conserver leur image (Marion 2016, 156). ↩ï¸&
Marie-Ève Bouillon et Sandrine Bula datent cette performance du 15 février 1936 mais Ellen Furlough propose 1934. ↩ï¸&
«  The agents for their ‹ liberation › were domestic  ». ↩ï¸&
Toutefois, elles connaîtront une fortune intéressante, en étant achetées par lʼauteur de science-fiction Isaac Asimov (Hong 2021). ↩ï¸&
Dans leur histoire du design, Claire Brunet & Catherine Geel évoquent cette tradition du display (terme quʼelles relient à lʼœuvre de George Nelson) en design, soit la possibilité pour la discipline dʼexister dans les lieux dʼexposition, et pas seulement dans lʼhabitat ou lʼindustrie (2023, 274). ↩ï¸&
Bel Geddes est spécialisé en stage design, cʼest-à -dire en scénographie de théâtre à Broadway, avant de devenir designer industriel. Il est aussi un des pionniers du streamline (Brunet & Geel 2023, 132 ; 283). ↩ï¸&
«  Imagine how wonderful it would be to live in a house like this… just imagine  ». ↩ï¸&
«  ultrasonic waves  ». ↩ï¸&
«  cold zones  ». ↩ï¸&
«  irradiated food  ». ↩ï¸&
Jʼemprunte lʼexpression au personnage du prince de Salina dans Le Guépard de Luchino Visconti (1963). Sʼentretenant avec son garde-chasse, lʼaristocrate commente ainsi lʼavènement de la bourgeoisie dont il est le témoin impuissant, notamment au travers du mariage de sa fille avec un parvenu. Il me semble que cet adage des puissants est justement une forme de sagesse bourgeoise : le même doit se réinventer pour garantir sa permanence. ↩ï¸&
«  the place where tomorrow meets today  ». ↩ï¸&
Contrairement à lʼimaginaire Just Eat rencontré dans le chapitre II, le futur implique ici de quitter ce signifiant de la domesticité décontractée. ↩ï¸&
«  Hey, Lady, your apron is showing!  » ↩ï¸&
«  ʼbetter get her to her kitchen, quick!  » ↩ï¸&
«  Tik, tok, tik, tok, Iʼm having fun around the clock  ». ↩ï¸&
«  Tomorrow… Tomorrow…  » ↩ï¸&
«  Some say the future is strange, but I have a feeling some things wonʼt change  ». ↩ï¸&
La forme orale du texte ne permet pas dʼailleurs de distinguer lʼhomme de lʼHomme. Mais vu la présence de la housewife en cuisine, les producteurs de la vidéo imaginent-ils que sa présence pourrait devenir obsolète ? ↩ï¸&
Dans «  Design for Dreaming  », la danse de lʼactrice avec sa jupe évoque éventuellement les chorégraphies de Loie Fuller. ↩ï¸&
«  tupperization  ». ↩ï¸&
Je pense à deux cuisines murales présentées dans le petit catalogue La cuisine, mode de vie (2006) assemblé par Emmanuel Collet. ↩ï¸&
Jʼemprunte la formulation à un texte présent sur un cartel de lʼexposition Plateau volant, motolaveur, purée minute | Au salon des Arts ménagers (1923–1983) présentée au MUCEM à Marseille en 2023. ↩ï¸&
Lorsquʼelle commente cette vidéo, Rose Eveleth pointe un fait évident pour qui a un jour possédé une table en verre : ce matériau est très salissant et le moindre contact le marque inévitablement dʼune trace de doigt (2015). ↩ï¸&
«  The home of the future will look more like the home of the past than the home of the present  ». ↩ï¸&
«  butlers,cooks, nannies, assistants, colleagues -— and even pets  ». ↩ï¸&
La page «  Global Village Coffeehouse  » publiée sur ce wiki dédié aux esthétiques et aux modes, permet de se rendre compte du type dʼimages auxquelles je fais référence ; [en ligne], https:
Un tel choix chromatique a déjà été proposé dès 1986 par lʼarchitecte hongrois Antti Lovag avec sa cuisinette dépliable. Il est relativement difficile de trouver des images de cette cuisine en ligne. Emmanuel Collet en donne un aperçu dans La cuisine, mode de vie (2006). ↩ï¸&
«  food analyzer  »â€¯; «  health monitor  ». ↩ï¸&
«  group cooking tool  ». ↩ï¸&
«  intelligent apron  ». ↩ï¸&
«  to call help from the family or tell them lunch is ready  ». ↩ï¸&
«  mothers, now working away from home, are no longer always available to fill the traditional role of carer  ». ↩ï¸&
«  ‹ the technically-interested man › implicitly positioned as the target consumer of smart devices  » ↩ï¸&
«  sometimes, if questioned, houses would tell stories of love and violence  » ↩ï¸&
«  a means for harassment, monitoring, revenge and control  ». ↩ï¸&
Selon lʼédition 2022 du rapport de lʼINSEE «  Femmes et hommes, lʼégalité en question  ». ↩ï¸&
Il est dʼailleurs lʼobjet de mobilisations de la part de groupes spécialistes de la question, comme lʼassociation Echap<
«  primal scream  ». ↩ï¸&
En plus de recherches par mot-clefs, jʼai également été mis sur la piste de quelques applications par une note de Juliet Drouar dans Sortir de lʼhétérosexualité (2021, 96). ↩ï¸&
On lit aussi plus loin : «  De la taille de vêtement de junior au numéro de Sécurité Sociale de Pierre, en passant par le numéro de téléphone de la nounou, plus de question à se poser !  »â€¯; il est donc suggéré ici que «  Pierre  » ne se rappelle pas lui-même de son numéro de Sécurité Sociale. ↩ï¸&
«  might actually be doing the very opposite  ». ↩ï¸&
Jʼen évoque une dimension dans le texte, mais jʼai également remarqué que le terme de «  charge mentale  » était de plus en plus utilisé pour désigner des situations qui impliquent tout de même aussi, ou seulement, du travail corporel. ↩ï¸&
Nées en 1945 et 1941, Christiane et Huguette font partie de ce quʼon a appelé la Génération Silencieuse, juste avant le baby boom. ↩ï¸&
Je dis bien «  capable  », et dans la mesure où le corps féminin est généralement compris comme corps XX, porteur dʼun utérus et fécond. Nommer la possibilité de reproduction comme «  puissance  » porte le risque dʼessentialiser un corps féminin qui serait féminin en raison de sa capacité reproductive. Ce nʼest bien sà »r pas mon intention ici ; aussi est-il toujours bon de rappeler que (1) certaines femmes nʼont pas dʼutérus ; (2) que certaines femmes ont un utérus fonctionnel et ne souhaitent pas lʼemployer à des fins reproductives ; (3) que certaines femmes sont stériles ; (4) que certaines personnes ayant un utérus ne sont pas des femmes. ↩ï¸&
«  travels domestic  ». ↩ï¸&
Je ne cite que quelques exemples dʼœuvres dʼart qui dramatisent cette question de lʼenchâssement corporel féminin dans lʼespace domestique. Lʼexposition Women House au Musée de la Monnaie à Paris en 2017 en consigne un nombre important. ↩ï¸&
«  New Kitchen Built to Fit Your Wife  ». ↩ï¸&
«  sheʼs bound to save energy in this kitchen  ». ↩ï¸&
«  as straightforward attempts to keep women at home, literally enclosing them in cabinets and appliances  ». ↩ï¸&
«  white males between the ages of eighteen and twenty-five  ». ↩ï¸&
«  the prosthetic logic in architecture  »â€¯; «  technology becomes part of biology  ». ↩ï¸&
Je remercie Irène Jonas et Djaouida Séhili qui citent ce passage que je ne connaissais pas dans leur article «  Les nouvelles images dʼÉpinal : émancipation ou aliénation féminines ?  » publié dans Nouvelles Questions Féministes en 2008. ↩ï¸&
«  never disputed her husband in anything  »â€¯; «  spent a great deal of time looking out the window at the snow, the rain, and the gradual emergence of the first crocuses  ». ↩ï¸&
«  [h]ousewife primly dressed on the steps of her suburban home as she kissed her husband good-bye, shuttled her children off to school in the station wagon, then returned home to iron her sheets and wax her floor  ». ↩ï¸&
«  itʼs the isolation that hurts  ». ↩ï¸&
«  a housewife can watch children and entertain without leaving her work  ». ↩ï¸&
«  behind closed doors  ». ↩ï¸&
«  picture window  ». ↩ï¸&
«  [u]nfortunately, the windows suffer  ». ↩ï¸&
«  [f]rom a feminist viewpoint, the major achievement of most communitarian experiments was ending the isolation of the housewife  ». ↩ï¸&
«  feel calm  »â€¯; «  jumpy  ». ↩ï¸&
«  now she can cook breakfast again  ». ↩ï¸&
«  chronic fatigue and apathy  ». ↩ï¸&
«  You canʼt set her free. But you can help her feel less anxious  ». ↩ï¸&
«  smoothes interpersonal relationship  ». ↩ï¸&
Voir lʼétymologie de «   robot  » sur la page du CNRTL, [en ligne], https:
«  comically incapable of opening doors, or, alas, folding laundry  ». ↩ï¸&
«  commonplace identity, an appellation appropriate to the professional title of bonne à tout faire  ». ↩ï¸&
«  might equally indicate the new, seemingly socially undifferentiated ‹ everywoman › identity of ‹ ménagère › or ‹ housewife › to which all women, working-class and bourgeois alike, [are] now expected to aspire  ». ↩ï¸&
«  for bourgeois audiences that may have harboured a lingering will and capacity to employ a maid but who might also contemplate supplementing that labour with expensive appliances  ». ↩ï¸&
«  electrify [their] wife  ». ↩ï¸&
Apparemment spécialiste des récits qui investissent des angoisses liées à lʼautonomie féminine, I. Levin est aussi lʼauteur de Rosemaryʼs Baby et de diverses pièces de théâtre. ↩ï¸&
«  there will be somebody with my name, and she will cook and clean like crazy, but she wonʼt take pictures and she wonʼt be me… Sheʼll be like one of those robots in Disneyland  » ↩ï¸&
«  Now why would you do a thing like that?  » ↩ï¸&
Selon la terminologie de Carol J. Clover dans Men, Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film (1992). ↩ï¸&
Traduction de Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould & Nathalie Magnan pour lʼédition chez Exils (2007 [1991] 70). ↩ï¸&
«  Mommyʼs basement  ». ↩ï¸&
Lʼexpression étasunienne «  techbro  » est un mot-valise condensant «  tech  » (pour la technique) et «  bro  » qui signifie «  frère  » de manière familière, complice et suggère un entre-soi masculin consolidé par un amour et une expertise communs des technologies. ↩ï¸&
«  suggest[…] that twenty-something techbros were wasting their talents designing technologies and programs for things they wished their Mommies still did for them: driving, cooking, cleaning, laundering  ». Jʼai traduit la phrase au présent comme cela est possible en français. ↩ï¸&
«  hopes that you will talk to it like a maid in the kitchen  ». ↩ï¸&
«  new sexual contract  »â€¯; «  part of a transparent environment that is intuitive, affective, gestural, sensory and haptic  ». ↩ï¸&
«  Cinderellaʼs new slipper is a speech-enabled translucent kitchen worktop that asks her if sheʼd like help with her baking, or an augmented reality bathroom mirror that displays a punishing schedule of meetings before she has brushed her teeth  ». ↩ï¸&
Cet aspect est sujet à discussion. Chez Christine Delphy «   (lʼ]es deux exploitations [matérielle et sexuelle, ndla] sont conditionneÌes et renforceÌes lʼune par lʼautre  » (2009a[1998], 55) ; chez Paola Tabet, le concept dʼ«  échange économico-sexuel  » permet de comprendre le service sexuel comme ayant une valeur économique même quand il nʼest pas tarifé de manière explicite (comme dans le cas de la prostitution) (2005).  ↩ï¸&
Malgré lʼattention portée aux crédits du documentaire, je nʼai pu retrouver la source exacte de cette archive. ↩ï¸&
Je remercie Anna Pavie, ancienne étudiante du master DTCT, car ses travaux sur la pédagogie queer ont mis en exergue cette source que jʼavais oubliée. ↩ï¸&
«  As an abundance of household appliances became affordable, and as women of color became increasingly rare as workers in middle-class households, postwar housewives were themselves objects of display, their comportment and visibility newly questioned and configured to establish and reinforce notions of femininity, heteronormativity, and whiteness  ». ↩ï¸&
«  aesthetic labour  ». ↩ï¸&
«  Modern appliances were intended as much to remove the stigma from the performance of housework as to reduce the actual work itself, which may be one reason that women were always pictured performing housework with appliances while impeccably dressed, coiffed, and bejeweled  ». ↩ï¸&
«  products , […] services and […] information  »â€¯; «  glorify the female body and to provide opportunities for narcissistic indulgence  ». ↩ï¸&
«  ‹ dead time ›  ». ↩ï¸&
«  self-surveillance, self-disciplining and self-blame  ». ↩ï¸&
«  curling irons  »â€¯; «  electric steam bath for faces  »â€¯; «  electric ‹ vibro-masseurs ›  ». ↩ï¸&
Il est également cité, puisque selon lui la femme est aussi utile «  quʼun mouchoir de papier lorsquʼon souffre dʼun rhume de cerveau -— à cela près quʼon sʼen débarasse pas aussi facilement  ». ↩ï¸&
Popularisée en France par lʼémission Maison à vendre (2007–2021) sur M6, la pratique du homestaging consiste en une réfection de surface dʼun espace donné dans le but de le rendre plus attrayant pour des acheteur·ses éventuel·les. ↩ï¸&
«  glamorizing  ». ↩ï¸&
De nos jours, cette exigence est également adressée aux hommes, mais selon des modalités qui sont souvent différentes, et qui nʼont pas le même poids. Une analyse intersectionnelle serait ici nécessaire, dans la mesure où les hommes ne sont pas tous égaux (comme les femmes, du reste) face à lʼexigence de minceur ; les hommes gays, par exemple, semblent davantage entretenir de préjugés négatifs sur les corps gros que les hommes hétérosexuels (Meneguzzo et. al. 2022). ↩ï¸&
Il est encore délicat dʼutiliser le terme «  gros·se  » en français comme simple descripteur, tant il est connoté négativement. Je choisis ici de lʼemployer, ce qui me semble participer dʼun élan collectif (lancé par les intéressé·es) pour déstigmatiser ce terme. ↩ï¸&
Je remercie ici Mariem Aouni, alumna du master DTCT (2020), pour mʼavoir fait connaître ce projet plus en détail et pour tout le travail réalisé pour son mémoire «  Au creux du ventre. Troubles du Comportement Alimentaire, parcours de soin et outils pour se raconter  » (sous la codirection dʼÉmilie Cazin). Ses travaux ont contribué à me sensibiliser aux questions de grossophobie et aux possibilités dʼapprocher celles-ci par le design, comme elle lʼa dʼailleurs très bien fait avec son projet Buddy, un outil conversationnel destiné à lʼaccompagnement de personnes souffrant de TCA. ↩ï¸&
«  Fat positive  » est un terme fréquemment utilisé par les activistes anti-grossophobie. Il remplace le plus générique et très récupérable «  body positive  ». Adopter une attitude fat positive consiste à déconstruire les connotations négatives du terme «  gros·se  » et à ne pas considérer le fait dʼêtre gros comme intrinsèquement non souhaitable. ↩ï¸&
Je remercie lʼétudiante Lucille Poussou (en Licence Design, Prospective et Société, UT2J) qui a attiré mon attention sur cet article. ↩ï¸&
«  [t]he showʼs gender dynamics were complex and multifaceted, and could be read alternately as both sexist and feminist, often within a single episode  ». ↩ï¸&
Jʼai écrit ces lignes alors même que lʼautrice chez qui jʼai rencontré ce concept venait de nous quitter. Jʼai eu le plaisir, pendant mes neuf premières années dans le laboratoire LLA-CRÉATIS à lʼUniversité de Toulouse -— Jean Jaurès, de côtoyer Emma Viguier, artiste, chercheuse, enseignante et sorcière. Cet espace marginal et un peu secret de la note de bas de page me paraît un lieu tout indiqué pour lui rendre ce modeste hommage. ↩ï¸&
Sur son site, Looops se présente en ces termes : «  Aux frontières de lʼart, du journalisme et des sciences économiques et sociales, Looops crée des projets transdisciplinaires qui prennent tour à tour la forme dʼateliers, de conférences, de créations sonores, dʼexpérimentations théâtrales, de formations, de happening, de récits, dʼenquêtes ou dʼexpériences participatives  », [en ligne], https:
Cy Lecerf Maulpoix les décrit comme «  une mouvance de pédales en quête de sens, de spiritualité, et de communauté dont lʼexistence ne devait se concrétiser quʼen 1979 après un premier rassemblement dans lʼArizona  » (2023, 19). ↩ï¸&
Le terme de «  berdache  », explique Cy Lecerf Maupoix, est un terme plutôt dérogatoire utilisé par les colons espagnols pour désigner les premiers peuples du continent américain. Aujourdʼhui, le terme de two-spirit est largement préféré, mais les Radical Faeries ayant développé leur action dès les années 1950, ce vocabulaire aujourdʼhui obsolète était alors usité. ↩ï¸&
Jʼemploie cette expression connotée à dessein. Elle est souvent mobilisée par des féministes essentialistes qui relient lʼêtre-femme à une anatomie particulière, condensée dans les génitoires. De tels discours fétichisent souvent le féminisme à partir dʼune condition maternelle idéale, reliée à la capacité reproductive, volontiers située comme destin. Il existe un enjeu politique à arracher les spiritualités féminines de ces discours essentialistes et, in fine, identitaires. ↩ï¸&
Depuis, un ouvrage de Mona Chollet a entériné cette mode en proposant une synthèse avec Sorcières, La puissance invaincue des femmes (2018). ↩ï¸&
Cette pratique a depuis été largement critiquée. «  Empruntée  » à des peuples autochtones du continent américain, la cueillette et la combustion de sauge posent des problèmes dʼappropriation culturelle mais aussi de sur-exploitation des plants existants, a fortiori quand la récolte est réalisée sans la technique adéquate (McFarlan Miller 2023). ↩ï¸&
«  unveil the hidden norms and acceptances behind womenʼs negative experiences  » ↩ï¸&
Jʼai eu lʼoccasion de codiriger ce mémoire avec la designer Émilie Cazin. ↩ï¸&
Dont les recherches qui ont préfiguré cet écrit en 2017 : la ligne sorcière est ainsi, en quelque sorte, bouclée. ↩ï¸&
Sur le site du projet, [en ligne], https:
«  If women do not want to fulfill their positions within the patriarchy, the argument seems to go, then so be it-—there are other technologies that will  ». ↩ï¸&
«  [is] all too often predicated on the reproduction of sameness, the illusion and tacit elimination of difference  » ↩ï¸&
«  In a future kitchen full of incredible technology, why can we still not imagine anything more interesting than a woman making dinner alone?  » ↩ï¸&
Celle-ci nʼest pas nécessairement mauvaise, et peut même participer dʼune pratique de soin. Malheureusement, comme cela a souvent été pointé, le capitalisme néolibéral est friand de ce type de soin à lʼéchelle de lʼindividu, dans la mesure où il rend ce dernier responsable de sa santé et de son destin, sans que jamais la dimension systémique des rapports de pouvoir soit mise en cause. ↩ï¸&
«  collective cyborgs  ». ↩ï¸&